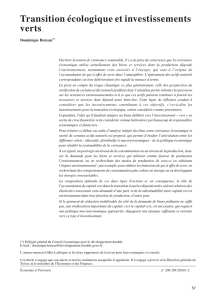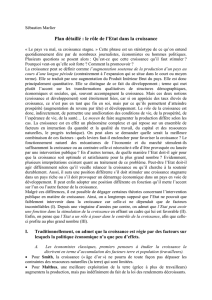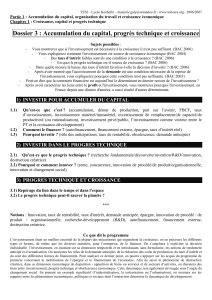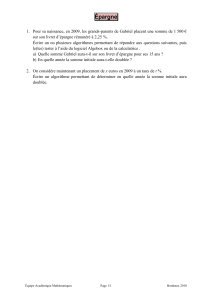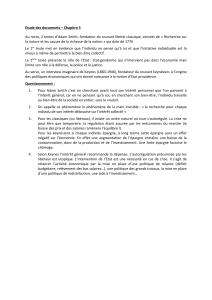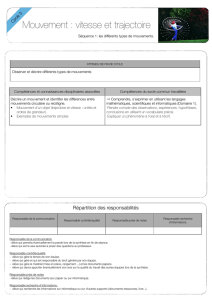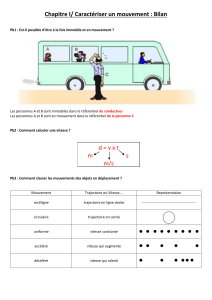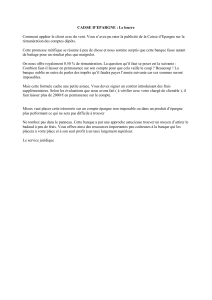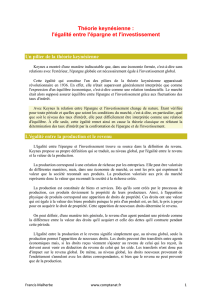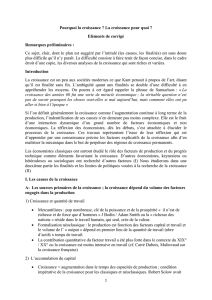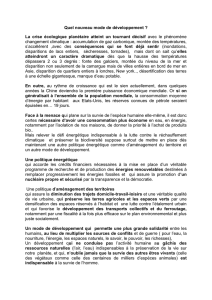Transition écologique et investissements verts Version

1
Transition écologique et investissements verts
Version préliminaire
Dominique Bureau
Résumé
Derrière la notion de croissance soutenable, il y a la prise de conscience que la croissance
économique utilise actuellement des services, notamment ceux fournis par les énergies
émettrices de gaz à effet de serre, dont la production dégrade les actifs naturels, et que leur
épuisement ou leur détérioration très rapide la menace à terme. Pour rétablir sa soutenabilité,
il faut agir sur la demande pour ces services, ou trouver des modes de production plus
économes de ces ressources. La composition optimale de ces deux types d’actions dépend de
la comparaison des élasticités relatives à la demande d’une part, et à la substituabilité entre
capital vert et ressources naturelles, d’autre part.
Si, comme le suggèrent beaucoup d’études sectorielles, le gisement correspondant au premier
type d’action ne suffira pas, une réallocation importante du capital, vers le capital vert, est
nécessaire, qui requiert une politique macroéconomique appropriée, dégageant une épargne
suffisante et orientée vers ce type d’investissement. Certes, leur déploiement sera progressif et
doit se faire « par ordre de mérite ». Mais il demeure une correction immédiate des structures
de production à réaliser, qui doit être intégrée dans les stratégies macroéconomiques.
Si la productivité du capital vert est limitée, son accumulation, nécessaire pour éviter
l’épuisement des actifs naturels, tend à prélever progressivement l’essentiel de l’épargne.
Dans le cas plus favorable, le taux d’épargne rejoint progressivement son niveau habituel.
L’introduction, dans un modèle de croissance de type AK, d’un actif naturel non renouvelable
permet de passer en revue les différentes facettes d’une politique de transition écologique,
notamment par rapport à l’accumulation du capital vert.

2
Introduction
Dans leur rapport au G20, Edenhofer et Stern (2009) mettaient en avant que nous étions
confrontés à une double crise, économique et écologique. Ce diagnostic les conduisait à
recommander que la sortie de crise s’attache à promouvoir une stratégie globale de croissance
de long terme, prenant en compte le risque climatique et, plus généralement, les perspectives
de rareté de certains actifs naturels, en veillant à ce que ceux-ci puissent continuer à fournir
les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être. Concrètement, ils
plaidaient pour que les investissements contribuant à ces objectifs, c’est-à-dire les
investissements pour la transition écologique, soient considérés comme prioritaires.
Cette recommandation apparaît très congruente avec les conclusions de nombreux travaux de
prospective sectorielle s’intéressant, par exemple, à la transition énergétique et la
« décarbonation » du secteur électrique (AIE, 2010) ou, a fortiori, à celles, beaucoup moins
engagées à ce jour -comme le montre la récente « feuille de route » de la Commission
européenne (2011)-, des bâtiments, des villes ou des transports, qui soulignent que ces
transformations nécessitent de nouvelles infrastructures (et en amont de la R et D, de
l’innovation, des démonstrateurs….), et une réallocation forte des investissements, des
équipements utilisant les combustibles fossiles vers des technologies propres. Ces études
estiment souvent qu’une part importante de ces investissements constituent des mesures
« sans regret », qui seraient rentables même en l’absence de prix du carbone significatif. Leur
crainte (cf. Grandjean et al., 2011) est que l’épargne ne soit pas assez orientée vers le
financement de ces investissements « verts », ou ne soit pas à la hauteur de l’ampleur de
l’effort d’investissement considéré comme nécessaire. L’horizon souvent très long des
équipements considérés (réseaux et centrales électriques, infrastructures de transports et
urbaines), et la difficulté à en répartir les risques-notamment pour les technologies et filières
émergentes, constituent par ailleurs des obstacles à leur financement (CEDD, 2011).
Cependant, cette idée qu’il faudrait intégrer un biais délibéré vers l’investissement « vert » en
sortie de crise financière reste considérée comme hétérodoxe par beaucoup de responsables
économiques et financiers, d’autant plus qu’elle leur paraît antinomique avec la maîtrise des
dettes publiques et le besoin, mis en exergue par la crise financière, de renforcer le contrôle
des risques dans la régulation financière. Certes, il est objecté à cela que les investissements à
réaliser concernent autant le secteur privé que le secteur public, et qu’ils visent
fondamentalement à réduire les risques à long terme. Cependant, cet argument est loin de
suffire à résorber le fossé qui demeure entre ces différentes approches ou types de
préoccupations, tous légitimes.
Les controverses qui ont suivi la « Stern Review » (2007) à propos de l’évaluation de la
rentabilité économique et sociale des investissements d’atténuation du risque climatique
constituent une toile de fond pour ces controverses. Cependant ce n’est pas le seul, ni même
peut-être l’élément déterminant, dès lors que l’analyse développée par Edenhofer et Stern (op.
cit.), par exemple, prend justement soin de justifier ses recommandations par le fait que ces

3
investissements sont rentables au sens de l’analyse socio-économique « coûts-bénéfices ».
Plus généralement, le développement de l’évaluation du coût des dommages, ou,
symétriquement, celle de la valeur des services environnementaux, a constitué, ces quinze
dernières années, un champ de recherches et d’études extrêmement fécond, qui permet
aujourd’hui de disposer de références -certes perfectibles et à utiliser en étant conscient de
leurs incertitudes- pour évaluer les politiques ou projets d’investissements, par rapport aux
enjeux d’environnement, de risques, et de long terme qui sous-tendent la notion de
développement durable (Bureau, 2012). La rentabilité économique générale des
investissements verts peut ainsi être documentée, mais si elle pose encore de redoutables
problèmes d’évaluation (Gollier, 2013).
Mais, pour apprécier la place à accorder, aujourd’hui, aux investissements verts dans les
équilibres macroéconomiques, il convient de discuter plus précisément le « timing » de cet
effort, et de justifier plus avant l’importance de la « bosse » qui devrait être financée à court-
terme. A cet égard, les questions plus précises que soulèvent les « macro-économistes »
concernent :
- l’ampleur alléguée des mesures « sans-regret » ou des investissements à réaliser
immédiatement, qu’ils interprètent comme un diagnostic implicite d’une inefficacité
apparente des marchés extrême,
- la rentabilité « immédiate » de ces projets. Certes, il est reconnu qu’il convient
d’intégrer les raisonnements en valeur d’option à la « Arrow-Fisher-Henry »
(Baumstark et Gollier, 2009) ou les contraintes résultant des courbes d’apprentissage,
qui justifient une action précoce et expliquent aussi que les dates optimales de
réalisation des projets « vert » soient peu sensibles à la conjoncture macroéconomique.
Pour autant, celles-ci restent dépendantes des trajectoires de prix, notamment des
ressources naturelles, ou du carbone, si bien que la question de la programmation des
investissements par ordre de mérite, et celle de leurs dates optimales de réalisation
demeurent pertinentes,
- l’affectation des instruments, au regard de la typologie classique de Musgrave, qui
sépare nettement les fonctions de stabilisation et de redistribution, de celles
d’allocation des ressources. Dans cette perspective, il est mis en avant, qu’une fois
établis les prix écologiques nécessaires pour assurer l’internalisation des différentes
raretés des ressources naturelles, la conduite de la politique macroéconomique se
poserait dans les termes « usuels », sous-entendu, sans qu’il y ait lieu de prendre en
compte à ce niveau les considérations allocatives. Toutefois, ceci suppose que les
instruments redistributifs d’accompagnement soient en place, et que les conditions de
financement des investissements verts soient parfaitement efficaces.
Ces questions se situent à un niveau intermédiaire, entre, en amont, l’analyse des contraintes
de soutenabilité, et, en aval, celle des problèmes de financement des investissements verts.
Elles interrogent l’articulation entre les politiques spécifiques de transition écologique
(normes, incitations, orientation du progrès technique) et les autres politiques, ou, dit
autrement, les risques que les imperfections d’autres marchés ou d’autres politiques, fassent
obstacle à la pleine efficacité de celles-ci. Pour cela, il faut en premier lieu identifier ces
interactions potentielles : par exemple, les problèmes de financement seront d’autant plus
aigus que les investissements « verts » seront lourds et « s’ajouteront » aux autres besoins
d’investissement. Comme ce fût le cas au début des années 90 avec les débats sur les besoins

4
d’infrastructures pour la croissance, l’appréciation de ces enjeux est délicate car la prospective
sectorielle raisonne plutôt à partir de modèles technico-économiques, et l’analyse
macroéconomique utilise des fonctions de production très globales. Il est donc nécessaire de
développer des cadres permettant de réaliser le passage entre les deux approches.
Pour cela, il faut distinguer l’évolution des modes de consommation de celle des modes de
production, et enrichir l’analyse des modèles de croissance avec actifs naturels, en explicitant,
au sein du capital productif et de son accumulation, la dynamique des infrastructures ou
équipements qui conditionnent directement la transition écologique, ce que sous-tend le
vocable « investissements verts ». De plus, il faut une description du processus de
remplacement des ressources naturelles par ce capital « vert » qui soit plus réaliste que celle
des modèles « backstop ». Dans ce cas, les deux types d’actifs (capital vert, ici « innovant »,
et ressource épuisable) sont en effet supposés parfaitement substituables, si bien que les
trajectoires optimales consistent en général à utiliser d’abord les actifs naturels, et à
n’introduire le nouveau capital qu’au delà de leur épuisement. Au contraire, les scénarios de
prospective sectorielle évoqués ci-dessus décrivent un processus beaucoup plus progressif,
reflétant implicitement une substituabilité imparfaite entre actifs naturels et capital vert pour
produire les services énergétiques ou environnementaux, obligeant à préserver une quantité
suffisante des premiers pour les générations futures et, aussi, à engager tôt l’accumulation de
capital vert au niveau approprié.
On se propose ici, dans une perspective pédagogique, de détailler l’analyse d’un tel modèle de
croissance, avec le souci de passer ainsi en revue différents aspects, « micro » ou
« macroéconomiques », de la politique économique dans un contexte de transition écologique.
Ceux-ci ne sont pas forcément originaux mais, souvent, sont vus séparément. La première
partie décrit le modèle, et établit une typologie des scénarios (optimaux) possibles de
réallocation du capital entre capital courant et capital « vert ». La seconde partie étudie, dans
l’hypothèse où les économies de ressources ou d’énergie immédiatement mobilisables sont
épuisées rapidement, et ne suffisent pas au regard de la contrainte, de rareté globale, les
impacts de cette dynamique sur l’évolution souhaitable du taux d’épargne.
I. Les réallocations du capital nécessaires à la transition écologique
Le modèle considère le processus d’accumulation du capital le plus simple qui soit. Il
combine un modèle de croissance productive stylisé comme ceux introduits par Ramsey et
Solow, mais potentiellement auto-entretenue (modèle prototype de croissance endogène, dit
« AK », qu’utilisent aussi Guéant et al.(2012) pour étudier le taux d’actualisation à utiliser
pour évaluer les projets visant à préserver la qualité de l’environnement) et, comme c’est
l’usage en économie de l’environnement, la gestion d’une ressource épuisable. Outre la
combinaison de ces deux éléments contrastés eu égard aux possibilités et contraintes mises
sur la croissance, sa spécificité est de considérer que cette ressource constitue « un input »
pour la production de certains services fournis aux ménages (« énergétiques, ou
écologiques »), l’autre « input » nécessaire, et imparfaitement substituable, étant du capital
« vert ». Après avoir présenté le modèle et caractérisé les scénarios de croissance optimale,
on analyse leur conditions générales de réalisation. On montre alors, que selon les
caractéristiques de l’offre et de la demande pour les services utilisant la ressource naturelle,
les réallocations de capital à opérer, entre capital productif et capital vert, peuvent être très
typées.

5
I.1 Le modèle
Au niveau de la consommation des ménages, le modèle distingue deux biens, la
consommation de bien courant (C), et celle des services « énergétiques ou écologiques » (Ĕ)
dont la production combine : des inputs prélevés dans les actifs naturels (F) ; et du capital vert
(V). On suppose que les deux biens de consommation se combinent de manière additive quasi-
linéaire dans la fonction d’utilité, et on note : u(Ĕ) le consentement brut à payer pour ces
services utilisant les ressources naturelles comme facteur de production (u’>0,u’’<0) ; et D(p)
la fonction de demande qui s’en déduit, si p est le prix de ces services (D’(p)<0).
On suppose par ailleurs une fonction d’utilité U croissante, strictement concave, deux fois
continûment dérivable, et telle que l’utilité marginale d’une consommation nulle est infinie.
Le modèle est écrit en temps continu, en notant ρ le taux de préférence pur pour le présent de
la fonction d’utilité intertemporelle (W).
La fonction de production (E(F,V)) des services énergétiques ou écologiques est à rendements
constants, quasi-concave, et y est associée la fonction de coûts unitaires
c(r,q) , r étant le coût d’usage du capital vert, et q le coût relatif de la ressource naturelle par
rapport à celui de l’usage de capital vert. On note f(q) et v(q) les demandes (unitaires) de
facteurs en ressource naturelle et capital vert correspondantes, vérifiant les propriétés
habituelles.
Par ailleurs, on suppose que le capital total productif (K) se décompose entre du capital à tout
faire (K-V), et le capital « vert » (V). Le capital à tout-faire (équipements, bâtiments, mais
aussi capital humain et connaissances) permet de produire à la fois le bien de consommation
courant et le bien d’investissement servant à l’accumulation du capital, avec une rentabilité
marginale constante (a, avec a>ρ, et donc, potentiellement une croissance auto-entretenue).
La production de bien courant vaut donc Y= a(K-V). Pour alléger le formalisme du modèle et
en faciliter la lecture, on considèrera un taux de dépréciation nul
1
. On note K0 le stock de
capital disponible à l’instant initial et S0 le stock de ressource naturelle résiduel à cette date.
La contrainte de non-renouvelabilité de celle-ci pourra s’interpréter, soit comme une
contrainte sur un stock de ressources, par exemple fossiles, mais aussi, alternativement,
comme un plafond strict sur les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de la
caractérisation des trajectoires optimales, il n’y a pas besoin de distinguer entre ces deux
interprétations possibles. En revanche, les conditions institutionnelles de réalisation devront
évidemment préciser selon que la ressource naturelle considérée fait, ou non, l’objet de droits
de propriété établis.
L’essence des exercices auxquels nous voulons nous livrer consiste à imaginer qu’à l’instant
t=0, la société prend conscience que la rareté des ressources naturelles est beaucoup plus forte
que ce qui était antérieurement imaginé ( S0 < S0- ). Pour cela, on s’intéressera donc à la
statique comparative des trajectoires optimales en fonction de S0, dont on note W*(K0,S0)
l’issue en termes de bien-être inter-temporel.
Si, pour identifier l’orientation des réallocations à envisager, on fait l’hypothèse idéale d’un
capital total parfaitement mobile entre ses deux formes ( V ou K-V), disponible en quantité
1
Le paramètre « a » doit donc être vu comme reflétant la productivité marginale nette du capital.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%