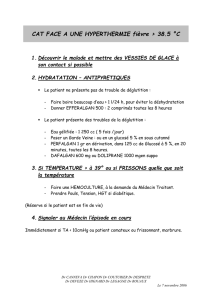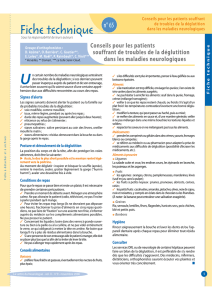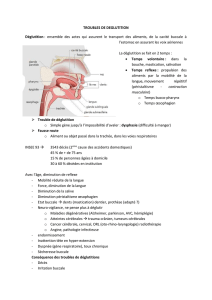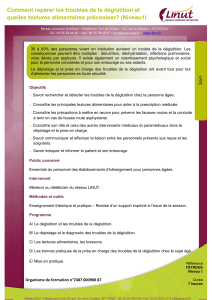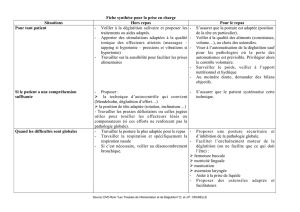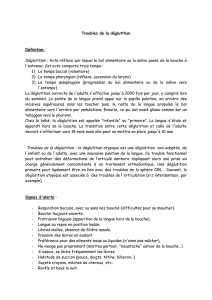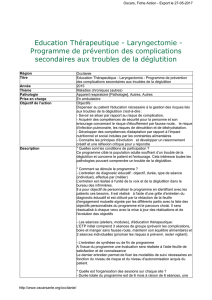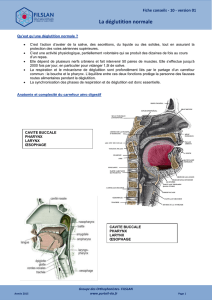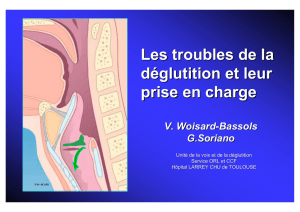soutenance a creteil universite paris val de marne faculte de

SOUTENANCE A CRETEIL
UNIVERSITE PARIS VAL DE MARNE
FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL
**************************
ANNEE 2008 N°
THESE
POUR LE DIPLOME D’ETAT
DE
DOCTEUR EN MEDECINE
Discipline : Médecine Générale
-----------
Présenté et soutenu publiquement le . . . .
A CRETEIL (PARIS XII)
-----------
Par Philippe BETTING
Né le 11 août 1962 à LEBLANC
-----------
TITRE : ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE RETROSPECTIVE
DES DECES PAR FAUSSE ROUTE DANS LA POPULATION DES SUJETS
EN ETAT DE MORT ENCEPHALIQUE.
DIRECTEUR DE THESE : LE CONSERVATEUR DE LA
M. le Professeur Gilles D’HONNEUR BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
Signature du Cachet de la bibliothèque
Directeur de thèse universitaire

2
Remerciements
Nous remercions le Docteur J. CLAQUIN (Service de régulation et d’appui de l’interrégion
Ile-de-France/ Centre - Les Antilles de l’Agence de Biomédecine) pour son aide à la
réalisation de ce travail.
Je remercie le Docteur G. D’Honneur pour son avis éclairé et pour l’aide qu’il m’a apporté

3
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS p. 2
LISTE DES ABBREVIATIONS p. 4
I- INTRODUCTION p. 5
Objectif de l’étude p. 5
II- RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DE LA DEGLUTITION p. 6
1- Anatomie p. 6
2- Physiologie p. 6
III- MATERIEL ET METHODES p. 14
1- Lieu de l’étude p. 15
2- Choix des critères p. 15
3- Recueil des données p. 15
IV- RESULTATS p. 16
1- Caractéristiques démographiques des sujets p. 16
2- Caractéristiques médicales des sujets p. 16
V- DISCUSSION p. 22
1- Critique de la méthode p. 22
2- Principales causes : p. 25
A- Influence de l’âge p. 25
B- Influence de l’index de masse corporel p. 27
C- Maladies psychiatriques et facteurs iatrogéniques p. 28
D- Les causes neurologiques p. 33
E- Les causes ORL p. 39
F- Influence du diabète p. 40
G- influence de l’intoxication alcoolique p. 41
VI- CONCLUSION p. 44
ANNEXE p. 45
BIBLIOGRAPHIE p. 55

4
LISTE DES ABBREVIATIONS :
- Ä : Aiguë
- AD : Antidépresseur
- ATCD : Antécédent
- BZD : Benzodiazépine
- DNID : Diabète non insulinodépendant
- EME : Etat de mort encéphalique
- IMC : Index de Masse Corporelle
- IR : Inter-région
- NL : Neuroleptique
- NLPG : Neuroleptique de première génération
- NLSG : Neuroleptique de seconde génération
- PDS : Polyneuropathie distale symétrique
- PMO : Prélèvement multiorganes
- SRA : Service de régulation des appels

5
I°- INTRODUCTION
La déglutition permet le passage de la salive ou du bol alimentaire de la cavité buccale vers
l’estomac. Alors que nous déglutissons et avalons 580 à 2000 fois par jour, la rapidité et
l’efficacité de ce phénomène moteur essentiellement réflexe le rendent quasiment
imperceptible chez le sujet sain. Son apparente banalité contraste avec l’extrême complexité
des mécanismes réflexes mis en œuvre.
Le pharynx est le lieu de passage commun des voies digestives et respiratoires. Cette
particularité anatomique nécessite des mécanismes de protection des voies aériennes. Leurs
inefficacités engendrent le risque de fausse route avec sa complication ultime : l’asphyxie.
La fausse route ou « choking » pour les anglo-saxons représente la complication aiguë des
troubles de la déglutition. Elle se définit par une erreur dans le trajet d’un corps étranger
généralement alimentaire entrainant son enclavement au niveau des voies aériennes sous-
glottiques.
Nous n’avons pas trouvé de données épidémiologiques propres aux décès par fausse route
alimentaire. Les informations communiquées par l’Institut de veille sanitaire se situent dans
une sous catégorie de la rubrique des « accidents de la vie courante » : les décès par
suffocation. Les accidents de la vie courante sont définis comme des traumatismes non
intentionnels qui ne sont ni des accidents de la circulation, ni des accidents du travail et
représentent près de 20000 décès par an. Les décès par suffocation incluent aussi par exemple
les strangulations par cordon vestimentaire et autres accidents de cette nature. D’après cette
source, les fausses routes alimentaires restent la cause très largement majoritaire dans cette
catégorie. Elles se situent au deuxième rang des causes de décès par accident de la vie
courante tout âge confondu (17,2%), la première cause étant les chutes. En revanche, elles
représentent la première cause de décès par accidents de la vie courante chez les enfants de
moins de 1 an.
(17)
Pour l’année 2002, 2895 cas de décès ont été enregistrés. Il est important de noter que le
nombre de décès par fausse route est en progression constante avec une augmentation de 80%
depuis 1982 alors que les autres causes de décès par accident de la vie courante ne cessent de
diminuer en rapport avec l’efficacité des campagnes de prévention. Chez les plus de 65 ans
entre 1982 et 1999, le nombre de décès par asphyxie aiguë a été multiplié par 3. Cet
événement n’est donc pas une situation rare et maîtrisée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
1
/
60
100%