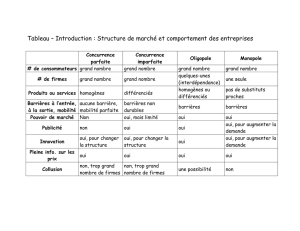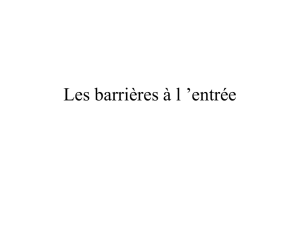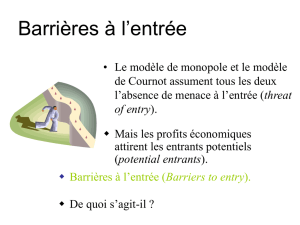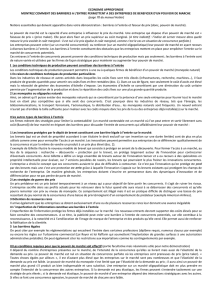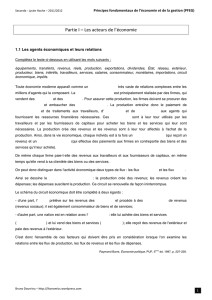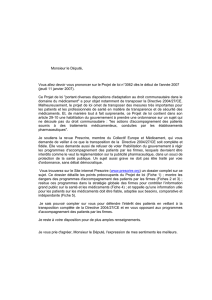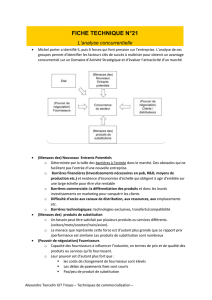Les Barrières à l`entrée : un retour aux origines1

1
Les Barrières à l’entrée : un retour aux origines1
Olivier Maillard
Directeur des Programmes Bachelor
Groupe Sup de Co La Rochelle (France)
Résumé
La position à l’égard des barrières à l’entrée a évolué depuis la fin des années 70. Certains
éléments, considérés antérieurement comme à l’origine de barrières, apparaissent maintenant
sous un jour plus favorable. Les travaux de von Weiszäcker (1980), Demsetz (1982) et
Baumol, Panzar et Willig (1982) ne sont pas étrangers à ces évolutions en fournissant aux
autorités chargées de favoriser la concurrence un certain nombre de critères normatifs à
l’aune desquels juger une structure de marché. L’idéal concurrentiel reste toutefois celui de la
concurrence pure et parfaite et la référence, celle de l’équilibre. Certains économistes, parmi
lesquels les économistes de la tradition autrichienne, en appellent à revenir à la conception
classique de la concurrence, qui tourne le dos à l’idée de structure et de statique
(caractéristiques de la vision pure et parfaite de la concurrence) et met l’accent sur les
comportements et la dynamique. Les seules barrières susceptibles d’être observées dans cet
environnement sont les barrières légales. Les lois antitrust deviennent dès lors inutiles et
seuls comptent la liberté d’entrée, les droits de propriété et le contrat.
Summary
The way we are analysing barriers to entry has changed in the early eighties under the
influential writings of Von Weiszäcker (1980), Demsetz (1982) and Baumol, Panzar and
Willig (1982). Their normative approach give the antitrust authority the opportunity to lead a
policy guided by the promotion of efficiency. Perfect competition and equilibrium remain
however the reference. Some economists, stemming essentially from the austrian tradition, are
promoting the classical vision of competition, a dynamic and behavioural approach, unlike the
structural and static view of the standard model. The only barriers in the classical world are
legal. The antitrust laws are then useless and freedom of entry, property rights and contract
are central features.
1 Certaines idées, exposées dans ce texte, ont été présentées au séminaire 3DI de l’Université Paris II
Panthéon-Assas de même qu’au séminaire du Centre d’Analyse des Processus de Marché (CAPM) de
l’Université Paris I, Paris II et Paris IX. Je remercie vivement les participants de ces séminaires et tout
spécialement David Bounie et Alain Redslob pour leurs commentaires. Les formules d’usage
s’appliquent bien entendu.

2
Introduction
L’une des prédictions les plus importantes de la théorie économique pose que
des profits anormalement élevés ne peuvent perdurer dans une industrie
concurrentielle car leur présence attirera de nouvelles firmes. L’accroissement de la
production qui suivra ramènera le prix au niveau concurrentiel, c’est-à-dire au
minimum de la courbe de coût moyen. Le taux de profit réalisé par les firmes
rejoindra alors un niveau normal, celui-la même qu’elles pourraient obtenir en
affectant leurs ressources dans des projets alternatifs de risque équivalent.
La libre-entrée assure donc une allocation efficiente des ressources dans
l’économie. Si, contrairement aux implications de la théorie, la convergence des taux
de profit n’est pas observée, trois explications peuvent être avancées : tout d’abord,
les risques peuvent être significativement différents d’une industrie à l’autre ;
ensuite, la convergence peut être lente, en raison de taux d’entrée/sortie
particulièrement faibles, et, pour finir, l’absence de convergence peut révéler
l’existence de barrières à l’entrée. Les deux premières objections peuvent être
aisément contournées empiriquement en adoptant une démarche dynamique et en
corrigeant les taux de rendement économique des différences de risque. C’est sur le
dernier point, celui de l’existence de barrières à l’entrée, que se focalise toutes les
oppositions. En effet, de nombreux désaccords existent sur la définition même des
barrières à l’entrée, sur les sources de ces barrières et, partant, sur les implications de
politique concurrentielle.
Les définitions traditionnelles des barrières à l’entrée mettent l’accent sur les
différences d’opportunités des firmes installées et des firmes candidates à l’entrée (I).
Certaines objections formulées à leur encontre permettent de renouveler l’analyse
des barrières à l’entrée et de l’action des autorités en charge de la concurrence (II).
Les progrès en matière de compréhension des barrières à l’entrée sont non
négligeables mais ils ont lieu dans un cadre théorique particulier, celui de la
concurrence statique. Un retour à la vision classique de la concurrence, et à son
expression contemporaine par les économistes autrichiens, permet d’améliorer la
compréhension du phénomène concurrentiel et de ses entraves (III). L’évolution de la
jurisprudence du Conseil de la Concurrence montre que ce dernier a intégré nombre
d’avancées théoriques lui permettant de mieux fonder ses décisions mais n’a pas pris
à son compte le paradigme autrichien (IV).

3
I. Les définitions traditionnelles des barrières à l’entrée
On doit à Bain (1956) et Sylos-Labini (1957) d’avoir les premiers développé le
concept de barrières à l’entrée et souligné le rôle crucial de la concurrence
potentielle2. La portée de leurs travaux est double.
Bain et Sylos-Labini ont, tout d’abord, permis de dégager les facteurs
caractérisant les structures industrielles, et plus particulièrement les barrières à
l’entrée. Ces barrières peuvent être qualifiées de naturelles dans la mesure où elles
sont indépendantes de l’action des firmes installées. En effet, seules les conditions
économiques prévalant dans certaines industries peuvent bloquer l’entrée d’une
firme sur une marché.
Ils sont, ensuite, à l’origine de l’idée que certains comportements adoptés par
les firmes installées, telles que les stratégies de prix, de production,
d’investissements, de recherche & développement, de promotion et de publicité,
peuvent influencer les facteurs de structure et plus particulièrement l’accès des
entrants potentiels. On parlera, dans ce cas, de barrières stratégiques et la structure de
marché est endogénéisée3. Ces comportements stratégiques sont certes très pauvres
chez Bain et Sylos-Labini, comme l’a souligné Modigliani (1958), reflétant sans doute
la croyance que seuls les facteurs structurels sont réellement déterminants à long
terme, mais ils marquent le début d’un ensemble de travaux qui cherchera à
modéliser les réactions des firmes installées à la menace d’entrée grâce, notamment,
aux apports de la théorie des jeux.
I.1. – Des divergences de conception en matière de barrières à l’entrée…..
Bain (1956) donne la définition suivante des barrières à l’entrée :
« Les barrières à l’entrée sont les avantages que détiennent les entreprises en
place dans une industrie sur les entrants potentiels, ces avantages se manifestant
2 La reconnaissance de la concurrence potentielle comme mécanisme de contrôle des comportements
de certaines firmes en position d’exploiter un certain pouvoir de marché revient incontestablement à
J.B. Clark (1902). Toutefois, les travaux de Bain et Sylos-Labini ont remis ce concept au cœur de l’étude
des structures de marché.
3 Salop distingue les barrières à l’entrée « innocentes » des barrières à l’entrée « stratégiques » (Salop,
1979). Cette distinction est celle que nous retenons nous-mêmes, mais elle n’est pas sans poser
problème. En effet, il apparaît difficile de bien séparer ce qui dans une certaine dépense relève d’une
simple volonté de maximiser les profits en absence d’entrée et ce qui relève au contraire d’une volonté
délibérée d’empêcher l’entrée. Dans le premier cas, la firme en place serait supérieure (en raison d’une
technologie plus efficiente par exemple) et capable d’empêcher l’entrée comme un produit-joint de la
maximisation du profit. Dès lors, l’entrée est entravée pour des raisons exogènes, relatives aux
fonctions de coût et de demande. Dans le second cas, la firme installée est moins (ou autant) efficiente
que la firme candidate à l’entrée mais elle dispose d’un avantage dû à des engagements de ressources
antérieures.

4
dans leur capacité à vendre au-dessus du prix concurrentiel, sans attirer de nouvelles
firmes dans l’industrie » (Bain, 1956, p.3).
Sur un plan empirique, l’observation de profits anormalement élevés et
persistant est donc, pour Bain, le signe de la présence de barrières à l’entrée dans le
secteur considéré, l’ampleur des profits constituant une mesure du niveau de ces
barrières. C’est la définition usuelle des barrières à l’entrée.
La définition que donne Stigler (1968) des barrières à l’entrée, en mettant
l’accent sur l’existence d’une asymétrie dans les fonctions de coût entre les firmes
installées et les nouveaux arrivants, semble coïncider, au premier abord, avec celle de
Bain :
« Une barrière à l’entrée est un coût de production qui doit être supporté par
une firme voulant pénétrer un marché sans que celles en place aient à le faire »
(Stigler, 1968, p.67)
Mais au-delà de cet accord apparent sur la définition des barrières à l’entrée,
chacun met l’accent sur les opportunités différentes auxquelles ont à faire face les
firmes en place et les firmes candidates à l’entrée, des divergences existent.
Bain définit les barrières à l’entrée du point de vue de la firme installée.
L’évaluation de la barrière à l’entrée nécessite de comparer les profits de l’entreprise
établie avant l’entrée et ceux de son rival après l’arrivée sur le marché, sachant que
cette entrée peut susciter une réaction de la firme établie.
Stigler se place du point de vue des firmes postulantes. La présence de
barrières à l’entrée pour Stigler est décelée par la comparaison des profits de la firme
installée avec ceux de la firme entrant potentiel, si celle-ci produisait la même
quantité que la firme en place. Si la différence de profits est positive, en faveur de la
firme installée, on a une mesure des avantages que possède cette dernière par
rapport à la firme potentielle, c’est-à-dire une mesure des barrières à l’entrée. En
d’autres termes, une barrière à l’entrée n’existera que si les deux firmes ne sont pas
également efficientes, une fois pris en compte les coûts d’entrée.
Les deux définitions coïncident si aucune firme n’entre sur le marché, puisque
dans ce cas la barrière à l’entrée se réduit au profit de la firme en place. Par contre, si
l’entrée est rendue simplement plus difficile, les deux définitions divergent. La
définition de Bain indiquera une barrière à l’entrée plus «élevée » que celle de Stigler.
Les divergences de conception en matière de barrières à l’entrée entre Bain et
Stigler apparaissent encore plus clairement lorsque l’on s’intéresse aux sources de ces
barrières.

5
I.2. - …. Accentuées par des désaccords sur les sources de ces barrières
Prenons l’exemple des économies d’échelle qui constituent pour Bain une
source importante de barrières à l’entrée. En effet, en présence d’économies d’échelle
dans la production, la taille minimum efficiente peut représenter une part importante
du marché. Les entrants potentiels, dans la mesure où ils sont souvent de taille
modeste, connaissent alors un désavantage en terme de coûts de production et font
face à un dilemme. D’un côté, s’ils choisissent un volume de production faible, le prix
qui s’impose à eux après leur entrée est proche de celui observé avant l’entrée mais
les coûts unitaires, en raison d’une échelle réduite, sont très élevés. D’un autre côté, si
la taille des nouvelles firmes est importante, les coûts unitaires sont bas mais la
production additionnelle aura pour effet de réduire le prix de marché et les profits de
l’industrie. Dans les deux cas, les économies d’échelle découragent l’entrée4.
Pour Stigler, en revanche, il faut chercher une autre explication à l’absence (ou
à la difficulté) d’entrée sur le marché. Les économies d’échelle ne sauraient constituer
une barrière à l’entrée car les entrants ont accès aux mêmes conditions de coût que
les firmes installées5. Ils peuvent donc bénéficier des mêmes opportunités d’échelle
que les firmes en place pour peu qu’ils atteignent la taille minimum efficiente. Le
problème est en fait celui de la taille insuffisante du marché et non pas celui d’une
quelconque barrière à l’entrée. Si nous définissons, comme le fait Stigler, une barrière
comme un différentiel de coût défavorable aux entrants, celle-ci n’existe pas dans le
cas étudié ci-dessus et le nombre de firmes installées est conjointement déterminé par
les économies d’échelle et les conditions de la demande. L’absence d’entrée n’est que
la conséquence d’un niveau trop faible de la demande, laquelle est insuffisante pour
permettre aux firmes de produire une quantité comparable.
La seconde source de barrières à l’entrée identifiée par Bain, la plus
importante à ses yeux, est la différenciation des produits6. Lorsque les produits sont
différenciés, l’élasticité prix croisée de la demande n’est pas infinie lorsque les prix
sont égaux. Ainsi, une firme installée peut, si elle parvient à différencier son produit,
fixer un prix au-dessus du coût marginal, sans qu’une firme candidate à l’entrée
puisse détourner l’ensemble des consommateurs du bien proposé par la firme
installée. A l’origine de cette différenciation selon Bain se trouve essentiellement la
publicité mais aussi les caractéristiques du produit (durabilité, complexité et
4 Ce résultat est très sensible à ce que Modigliani appelle le « postulat de Sylos-Labini ». Ce postulat
stipule que les candidats à l’entrée anticipent une absence de réaction des firmes installées, celles-ci
maintenant leur production au niveau antérieur à l’entrée. Cette menace de la part des firmes
installées peut ne pas être crédible dans la mesure où le profit qu’elles réalisent peut être inférieur
dans ces circonstances à celui qu’elles pourraient obtenir en accommodant l’entrée, c’est-à-dire en
baissant leur niveau de production.
5 La définition des barrières à l’entrée au sens de Stigler met l’accent sur le différentiel de coût actuel
entre la firme installée et les firmes entrantes. Ainsi, un coût supporté au moment de l’entrée par les
seules firmes entrantes est une barrière à l’entrée, même si la firme ou les firmes en place avai(en)t à le
supporter au moment de leur entrée respective (McAfee, Mialon, and Williams (2004, p.462)).
6 Les avantages absolus de coûts constituent une autre source de barrières à l’entrée pour Bain mais
nous l’omettons ici car notre objet n’est pas d’être exhaustif mais de souligner les divergences entre
Bain et Stigler.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%