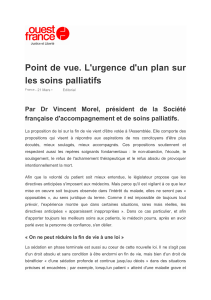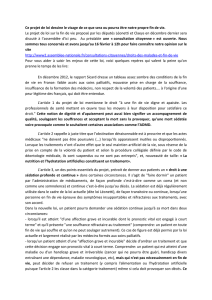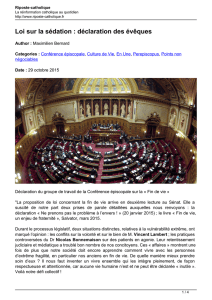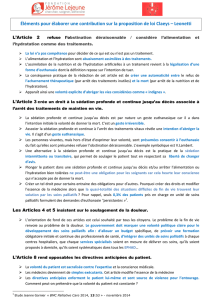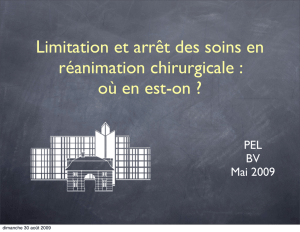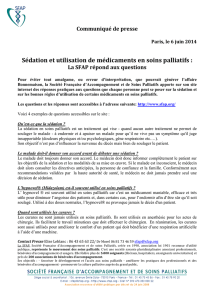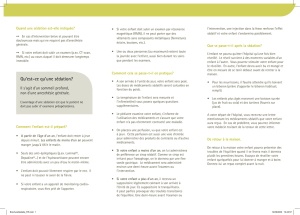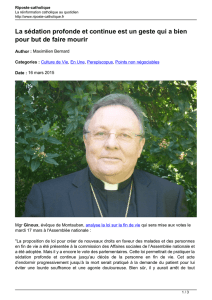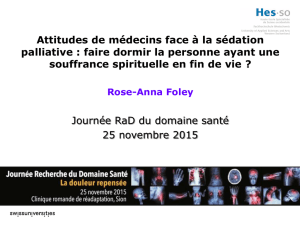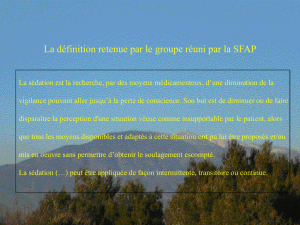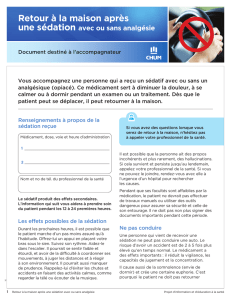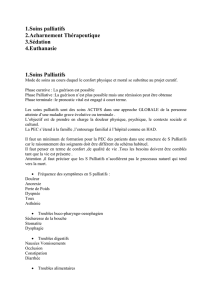La sédation en soins palliatifs€: revue historique de la

La sédation en soins palliatifs : revue historique de la littérature
Extrait du site de la Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon
http://www.croix-saint-simon.org
La sédation en soins palliatifs :
revue historique de la
littérature
- Formation et Recherche - Centre De Ressources National soins palliatifs François-Xavier
Bagnoud - Information et Documentation - Produits documentaires - Synthèses documentaires
-
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon
Tous droits réservés
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 1/6

La sédation en soins palliatifs : revue historique de la littérature
La sédation en soins palliatifs fait l'objet de nombreux débats ou polémiques depuis plus d'une dizaine d'années.
Technique d'anesthésie, la sédation consiste à provoquer, de façon transitoire et possiblement réversible, une
altération de la vigilance. Son application aux soins palliatifs soulève de nombreux questionnements pratiques et
éthiques.
Nous avons souhaité revenir sur les grandes étapes de la réflexion au sujet de la sédation à travers la littérature
médicale.
La sédation : un tabou ?
En France, l'organisation dans les années 80, du mouvement des soins palliatifs, est le résultat d'un double élan.
D'une part, la volonté de proposer une nouvelle approche permettant une meilleure prise en charge des patients en
fin de vie et d'autre part, la réaction aux propositions extrêmes de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité
(ADMD) et à l'usage des "cocktails lytiques"(1).
L'approche palliative propose une amélioration de la "qualité" de la fin de vie des malades atteints d'une pathologie
incurable. Cette proposition repose, selon la définition des soins palliatifs, sur le contrôle optimal des symptômes et
le maintien d'une vie relationnelle signifiante.
Le débat autour de la sédation s'est donc d'emblée inscrit autour de deux objections : un paradoxe fondamental
(altérer la vigilance, donc la relation, devient le moyen du soulagement) et un risque de confusion avec l'euthanasie.
Les débuts d'un débat
Dans la littérature, la référence à la sédation apparaà®t sans qu'une définition très précise soit proposée. La
fréquence du recours à cette technique (de 10 à 52 % des cas)2 ;4), la liste des symptômes ou des situations
relevant d'une sédation font l'objet d'études et de débats(5 ;9).
Peu d'articles se penchent de façon précise sur le versant technique de la sédation. Pourtant, il est notable que dans
cette même période, le midazolam, apparaà®t puis est diffusé aux soins palliatifs. Il offre à la sédation en soins
palliatifs un "support" technique apparemment sûr et maniable, au point parfois de faire passer au second plan la
nécessaire réflexion sur le choix des drogues utilisées et leur mode d'administration.
En France, Marie-Sylvie Richard(10 ;11) et Benoà®t Burucoa(12 ;13) rapportent les expériences de patients qui
restent écrasés par des souffrances physiques ou psychiques, et pour lesquels la sédation ("sommeil
pharmacologiquement induit" pour l'une, "mini-anesthésie" pour l'autre) est proposée.
Le champ du débat éthique est posé d'emblée ; les contradictions, risques de dérive et de confusion pointés. (11)
A mesure que les publications se multiplient, la réflexion continue de s'affiner.
Selon les situations rencontrées, il est bien mis en évidence la nécessité de s'appuyer sur des modèles d'analyse
distincts.
Progressivement, un consensus se dégage autour des indications concernant les situations d'urgence ou de
détresse "terminales" (hémorragie, détresse respiratoire...).
A l'inverse, la sédation proposée pour des situations, caractérisées principalement par la référence aux souffrances
dites morales, fait l'objet de controverses.
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 2/6

La sédation en soins palliatifs : revue historique de la littérature
La réflexion éthique autour de ces notions de souffrance peut apporter une clarification pour ces indications de la
sédation (20 ;22).
Pour Jean Claude Fondras, le débat sur la sédation illustre les contradictions entre éthique utilitariste et éthique
déontologique. Il appartient aux soignants d'éclairer leur positionnement afin de proposer une prise en charge
cohérente(23).
Des concepts-clé
A partir de 1991, le terme de sédation terminale, issu de l'anglais(24), est fréquemment utilisé, malgré la confusion
possible : est-ce une sédation réalisée chez un patient en phase terminale ou une sédation qui "termine" la vie du
patient ?
En 1994, Cherny et Portenoy introduisent la notion qui fera long feu : celle de symptôme réfractaire (refractory
symptom). L'usage actuel de ce terme, devenu assez courant en soins palliatifs, est souvent restrictif par apport à la
complexité de la définition initiale : "le caractère réfractaire peut être attribué à un symptôme lorsque celui-ci ne peut
être soulagé de façon adéquate malgré la recherche obstinée d'un traitement ayant une bonne tolérance, c'est à dire
qui respecte l'état de vigilance. Pour les patients atteints d'un cancer en phase avancée, affirmer le caractère
réfractaire d'un symptôme a de profondes implications. Cela suggère que la souffrance ne pourra être soulagée par
les mesures habituelles. Affirmer qu'un symptôme est réfractaire implique que le clinicien soit convaincu que de
nouvelles interventions (invasives ou non invasives)
1) sont incapables d'apporter un soulagement adéquat
2) sont associées à une morbidité aigue ou chronique excessive ou inacceptable 3) qu'il est très improbable que ces
interventions permettent la survenue d' un soulagement dans un délai de temps raisonnable."
Sédation et euthanasie
En 1996, la polémique avec l'euthanasie est relancée par un article qui qualifie la sédation d'euthanasie lente ("slow
euthanasia")(25). Il ne s'agit donc pas de considérer le risque de survenue d'un décès au cours d'une sédation
comme l'intrication de l'évolution de la maladie sous-jacente et d'éventuels effets indésirables des médicaments
comme le font certaines études(26), mais de proposer la sédation comme forme "socialement acceptable"
d'euthanasie.
Les tentatives de clarifications se font nombreuses (27 ;28). Pour éviter les confusions, Susan Chater propose
d'abandonner le terme de sédation terminale, "ambigu", au profit de celui de "sédation pour détresse intraitable"(29).
Il est difficile dans ce contexte de poursuivre sereinement la réflexion sur le recours à la sédation dans le cas de "
souffrances existentielles"." (30)
Le recours à la règle éthique du double effet(31) devient central dans les discussions, principalement dans la
littérature anglo-saxone. Cette règle postule que lorsqu'une action entraà®ne à la fois un effet désirable et un effet
indésirable, il reste éthiquement justifié d'agir, si on le fait dans la seule intention d'obtenir l'effet désirable.
Certains semblent considérer que l'application scrupuleuse de la règle met fin au débat(32), d'autres critiquent le rôle
prépondérant de l'intentionnalité(33 ;34). Quill en particulier discute la sédation dans un modèle de pensée utilitariste
o๠le défi est de trouver la moins mauvaise proposition permettant de soulager le patient qui souffre. Il semble dès
lors considérer le recours à la sédation, l'augmentation des doses d'antalgiques morphiniques, le suicide assisté,
l'abstention thérapeutique ou l'arrêt volontaire de l'alimentation et de l'hydratation comme éthiquement équivalents(
35).
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 3/6

La sédation en soins palliatifs : revue historique de la littérature
Il semble donc que le débat sur la sédation se resserre autour de son usage pour "détresse", sans que ce terme soit
défini de façon précise. La complexité des réalités ainsi englobées ne permet pas d'échapper aux polémiques.
Sur le terrain des pratiques, le recours à la sédation semble fréquent, sans que la prise en compte des stratégies
décisionnelles soit optimale(36).
Vers un consensus ?
En France, la SFAP et en Europe, l'EAPC travaillent à l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques
concernant l'usage de la sédation.
La SFAP publie en juin 2009 les recommandations "La sédation pour détresse en phase terminale et dans des
situations spécifiques et complexes."
L'EAPC reprend le terme de sédation palliative ("palliative sedation")(37) afin de caractériser une pratique et un
modèle de réflexion propre aux situations palliatives et lever l'ambiguà¯té véhiculée par le terme de sédation
terminale.
La SFAP, au-delà de l'élaboration de recommandations(38) propose d'évaluer le niveau de sédation à l'aide
d'échelles adaptées. La littérature fait en effet rarement référence à la profondeur de la sédation(18 ;39).
Or les discussions qui conduisent à la prescription d'une sédation légère, n'altérant pas, ou peu, la communication
du patient, seront différente de celles nécessaires à la décision d'une sédation profonde.
Cet axe de recherche semble prometteur pour l'élaboration d'études comparatives.
Les débats sur l'utilisation de la sédation en soins palliatifs alimentent depuis une dizaine d'année la réflexion des
équipes impliquées dans la prise en charge des patients en fin de vie. La persistance, malgré des soins attentifs, de
situations de souffrances complexes(40) posent la question des limites du champ d'intervention des soins palliatifs
davantage que celle des rapports entre sédation et euthanasie ou suicide assisté. Prendre en charge, intervenir,
auprès de patients en fin de vie, c'est prendre la responsabilité d'affecter le moment de la mort de l'autre(41).
Seul le plus grand discernement dans la visée éthique propre aux soins palliatifs peut éclairer nos décisions.
Sylvain Pourchet, Praticien hospitalier,
USP, Hôpital Paul Brousse, 2004
Références bibliographiques
Pour accéder aux recommandations de la SFAP concernant la sédation : se rapporter au site de la SFAP
1. Marin I. Traiter l'agonie ? Esprit 1992 ;(jan):91-97.
2. Ventafridda V, Ripamonti C, De Conno F, Tamburini M, Cassileth BR. Symptom prevalence and control during
cancer patients' last days of life. J Palliat Care 1990 ; 6(3):7-11.
3. Fainsinger RL, Miller M, Bruera E. Symptom control during the last week of life on a palliative care unit. J Palliat
Care 1991 ; 7(5):11.
4. Twycross R, Lack SA. Therapeutics in terminal cancer. 2nd ed. London : Churchill Livingstone, 1990.
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 4/6

La sédation en soins palliatifs : revue historique de la littérature
5. Lichter I, Hunt E. The last 48 hours of life. J Palliat Care 1990 ; 6(4):7-15.
6. Mount B. A final crescendo of pain ? J Palliat Care 1990 ; 6:5-6.
7. Roy DJ. Need they sleep before they die ? J Palliat Care 1990 ; 6:5-6.
8. Stieffel F, Bruera E. On symptom control when death is near. J Palliat Care 1991 ; 7:39-41.
9. Truog RD, Berde CB, Mitchell C, Grier HE. Barbiturates in the care of the terminally ill. N Engl J Med 1992 ;
327(23):1678-1682.
10. Richard MS. Faire dormir les malades. Cahiers Laà«nnec 1993 ; 41(5):2-7.
11. Verspieren P. Profondeur et durée du sommeil induit. Cahiers Laênnec 1993 ; 41(5):7-10.
12. Burucoa B. Face aux tous derniers jours de la vie, pour une utilisation des benzodiazepines injectables et des
neuroleptiques sédatifs. Actes du 2ème Congrès de la SFAP. Vaison La Romaine : 1992.
13. Burucoa B, Delzor M, & coll. Hypnovel® et Nozinan®, alternative à l'euthanasie. Pour une sédation vigile non
euthanasiante. Actes du 4ème Congrès de la SFAP. Strasbourg : 1994.
14. Craig GM. On withholding nutrition and hydration in the terminally ill : has palliative medicine gone too far ? J Med
Ethics 1994 ; 20(3):139-143.
15. Wilkes E. On withholding nutrition and hydration in the terminally ill : has palliative medicine gone too far ? A
commentary. J Med Ethics 1994 ; 20(144):145.
16. Stone P, Philipps C. Nutrition, hydration and the terminally ill. J Med Ethics 1995 ; 21:55-56.
17. Fainsinger RL, de Moissac D, Mancini I, Oneschuk D. Sedation for delirium and other symptoms in terminally ill
patients in Edmonton. J Palliat Care 2000 ; 16(2):5-10.
18. Fainsinger RL, Waller A, Bercovici M, Bengtson K, Landman W, Hosking M et al. A multicentre international study
of sedation for uncontrolled symptoms in terminally ill patients. Palliat Med 2000 ; 14(4):257-265.
19. Nunez Olarte JM, Guillen DG. Cultural issues and ethical dilemmas in palliative and end of life care in spain.
Cancer Control 2001 ; 8(1):46-54.
20. Cassel EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. N Engl J Med 1982 ; 306:639-645.
21. Gregory D. The myth of control : suffering in palliative care. J Palliat Care 1994 ; 10(2):18-22.
22. Cherny NI, Coyle N, Foley KM. Suffering in the advanced cancer patient : a definition and taxonomy. J Palliat
Care 1994 ; 10(2):57-70.
23. Fondras JC. La sédation pharmacologique et les contradictions éthiques. European Journal of Palliative Care
1996 ; 3(1):17-20.
24. Enck RE. Drug-induced terminal sedation for symptom control. Am J Hosp Palliat Care 1991 ; 8(5):3-5.
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 5/6
 6
6
1
/
6
100%