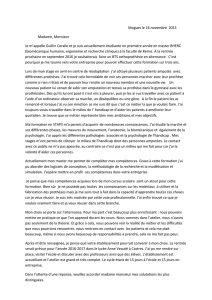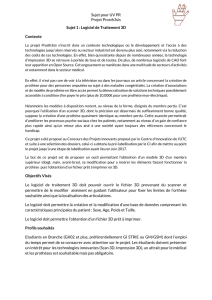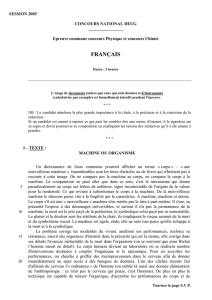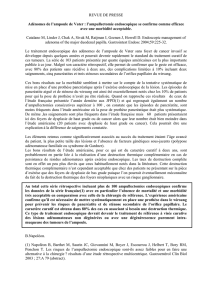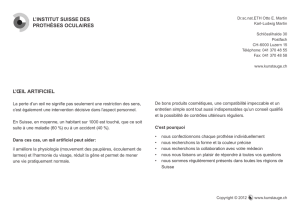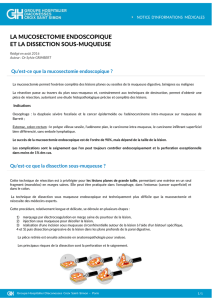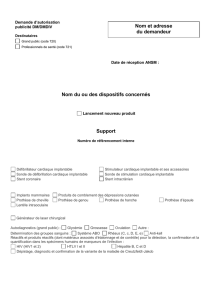L`endoscopie digestive thérapeutique : un progrès pour les

Revue
L’endoscopie digestive
thérapeutique :
un progrès pour les patients
Gérard Gay, Michel Delvaux
Unité de médecine interne à orientation digestive et métabolique, Hôpitaux de Brabois
Adultes, CHU de Nancy, Allée du Morvan, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
L’endoscopie digestive a connu une évolution sensible ces dix dernières années : l’image
d’analogique est devenue numérique, et surtout l’endoscopie de diagnostic est devenue
thérapeutique. En effet, l’évolution technologique des endoscopes, la mise à notre disposition
d’accessoires toujours de plus en plus sophistiqués autorisent actuellement un traitement des
maladies de tractus digestif à deux niveaux. Le premier niveau est celui des traitements
palliatifs où l’utilisation de prothèse métallique auto-expansive améliore l’état clinique des
patients porteurs de cancer de l’œsophage, des voies biliaires et des sténoses malignes
duodénale. Ici, l’endoscopie, non seulement, procure une meilleure qualité de vie mais
autorise les chimiothérapies grâce à l’amélioration de l’état général et des grandes fonctions
(réduction de la cholestase, par exemple). Le deuxième niveau est celui du traitement curateur
des tumeurs digestives grâce aux techniques de polypectomie, de mucosectomie et mainte-
nant de dissection. Sont concernés : les adénocarcinomes compliquant l’œsophage de Barrett,
les petits cancers épidermoïdes de l’œsophage, les tumeurs gastriques inférieures à 3 cm, les
polypes sessiles plans découverts lors des coloscopies de dépistage chez les sujets à risque ou
présentant des cancers familiaux. Ces progrès rendus possibles grâce au développement de ces
nouveaux matériels nécessitent la formation de médecins qualifiés car ces gestes, non
seulement demande de l’habileté mais aussi de la rigueur tant dans l’exécution que dans le
choix de la technique.
Mots clés :gastroentérologie, endoscopie digestive thérapeutique, cancer digestif,
endoprothèse, mucosectomie
Dès l’introduction de l’endosco-
pie digestive réalisée au moyen
d’endoscopes flexibles dans les
années 60, son développement a été
associé à des procédures thérapeuti-
ques : polypectomie endoscopique
pour les tumeurs coliques, sphinctéro-
tomie endoscopique au début des
années 70 pour le traitement de la
lithiase biliaire. Ces deux techniques
ont leurs indications actuellement
bien codifiées. Dans un autre
domaine, la prise en charge des
hémorragies digestives a également
été transformée par l’introduction des
méthodes d’hémostase endoscopique
dès les années 70.
L’endoscopie digestive actuelle-
ment pratiquée avec des vidéo-
endoscopes a singulièrement pro-
gressé dans deux domaines :
–Le diagnostic précoce des can-
cers digestifs où elle autorise l’exérèse
des lésions ainsi détectées par les
méthodes de mucosectomie endosco-
pique.
–La prise en charge des cancers
digestifs évolués où le traitement est
palliatif en raison de l’évolution de la
maladie ou de l’état général du
patient, l’endoscopie autorisant la
mise en place de prothèses au niveau
de sténoses néoplasiques.
C’est dans ces deux domaines que
les progrès les plus significatifs ont été
réalisés au cours de ces dernières
années. Cette mise au point s’intéres-
sera essentiellement aux progrès réali-
doi: 10.1684/met.2006.0002
mt, vol. 12, n° 4, juillet-août 2006 227

sés dans l’utilisation des prothèses digestives endoscopi-
ques dans le traitement palliatif des sténoses tumorales
œsophagiennes, duodénales et coliques et au développe-
ment des thérapeutiques endoscopiques développées
pour traiter des lésions précoces, détectées au niveau de
l’œsophage, de l’estomac ou du côlon.
L’endoscopie digestive thérapeutique
palliative
Les nouveautés d’une procédure maintenant
classique : le traitement palliatif
endoscopique
du cancer de l’œsophage
Le diagnostic du cancer de l’œsophage est encore trop
tardif puisque au moment du diagnostic, 60 % des patients
sont à un stade avancé de la maladie avec un envahisse-
ment des structures extra-œsophagiennes et/ou la pré-
sence de ganglions positifs et/ou de métastases viscérales à
distance. Le traitement chirurgical curatif est donc
l’exception avec un taux de succès à 5 ans de l’ordre de
40 %. D’un autre côté, la survie des patients porteurs d’un
cancer non résécable est inférieure à 1 an. Le plus souvent,
les thérapeutiques endoscopiques seront mises en œuvre.
Dans ce contexte, c’est une prothèse œsophagienne qui
sera mise en place.
Les points techniques à connaître pour le non-spécialiste
–La pose d’une endoprothèse œsophagienne par voie
endoscopique a l’avantage de permettre une amélioration
immédiate de la déglutition et d’autoriser une alimenta-
tion orale dans la majorité des cas (83 à 100 % des cas)
[1]. Sa mise en place, qui nécessitait une dilatation préa-
lable, a été améliorée par l’utilisation de prothèses métal-
liques auto-expansives en alliage nickel-titanium (nitinol)
en lieu et place de prothèses plastiques [2] (figure 1).En
effet, ces dernières, même de générations les plus récen-
tes, qui étaient facilement mises en place par un cathéter
flexible, nécessitaient cependant l’utilisation de matériel
porteur plus gros et moins flexible que celui utilisé pour la
pose des prothèses métalliques. De plus, la dernière géné-
ration de prothèses métalliques est couverte, diminue les
risques d’obstruction prothétique (de l’ordre de 40 % pour
les prothèses non couvertes) [3] et autorise les traitements
des fistules œsorespiratoires et les perforations des cancers
œsophagiens. L’absence de dilatation de la sténose tumo-
rale préalable est ainsi le plus souvent possible du faible
diamètre du cathéter porteur. Un des gros progrès techni-
ques est la généralisation de l’introduction du fil guide et
de son cathéter porteur de la prothèse dans la sténose par
le canal opérateur d’un diamètre de 3,8 mm de l’endos-
cope, la prothèse ne faisant que 3,3 mm de diamètre. La
séquence de mise en place de la prothèse se fait donc sous
contrôle de la vue et ne nécessite donc pas ou peu de
dilatation préalable.
–Les contre-indications relatives à l’utilisation de ces
matériels sont constituées par le caractère haut situé d’une
sténose œsophagienne à moins de 2 cm de la bouche de
Killian.
–Les complications de la mise en place de ce type de
matériel sont l’hémorragie, la perforation, la migration et
l’obstruction prothétique. La douleur après l’installation
de la prothèse est fréquente, surtout lorsque le patient a
subi une chimiothérapie antérieure. Enfin, il faut souligner
que ces complications, notamment la migration, peuvent
nécessiter une réintervention endoscopique. Des traite-
ments endoscopiques peuvent être associés, constitués
par le laser, la thérapie photodynamique, la chimiothéra-
pie intratumorale. L’utilisation de ces techniques dépend
de l’équipe qui prend en charge ces patients et de son
environnement technologique. L’obstruction prothétique
est secondaire à l’envahissement de la tumeur à travers les
mailles de la prothèse ou à son envahissement par ses
extrémités supérieure ou inférieure en cas de prothèse
couverte ou enfin secondaire à l’impaction alimentaire. La
première sera traitée par une désobstruction par méthode
endoscopique : destruction par photocoagulation, mise
en place d’une nouvelle prothèse plastique au travers de la
première en fonction de la situation clinique dans laquelle
se trouve le patient. Pour éviter l’obstruction alimentaire,
un certain nombre de règles hygiéno-diététiques seront
suivies : une alimentation mixée ou semi-solide si le
patient bénéficie d’un état dentaire satisfaisant accompa-
gné de boissons abondantes, gazeuse en fin de repas. Les
aliments comportant des fibres seront évités, les compri-
més seront écrasés. La prise alimentaire et surtout la
digestion seront faites en position demi-assise de façon à
éviter le reflux gastro-œsophagien et le risque de pneumo-
pathie d’inhalation. La migration (15,6 % pour les prothè-
ses couvertes contre 3,6 % pour les non-couvertes) peut se
faire dans l’estomac. Elle est surtout constatée lorsqu’est
réalisée une chimiothérapie. Aussi, la mise en place sera
évitée avant la mise en route de cette thérapeutique puis-
que la prothèse risque de migrer lors de la fonte tumorale.
–Des études économiques ont cherché à évaluer le
mérite respectif des prothèses métalliques et des prothèses
plastiques. Si les prothèses métalliques apparaissent 10 à
15 fois plus chères que les prothèses plastiques, leur
rapport coût/efficacité paraît plus favorable du fait du plus
faible taux de complication et d’une durée d’hospitalisa-
tion pour la mettre en place plus courte [1].
Vers l’utilisation des prothèses métalliques
auto-expansives dans le traitement
endoscopique des sténoses bénignes
Quelques points techniques
–Les prothèses métalliques auto-expansibles couver-
tes et possédant un système d’extraction à leur extrémité
Revue
mt, vol. 12, n° 4, juillet-août 2006
228

supérieure sont maintenant disponibles pour être mises en
place dans le traitement des sténoses bénignes, post-
anastomotique notamment chez les patients à haut risque
chirurgical : sténose radique anastomotique récidivante
après dilatations itératives [4] (figure 2). Dans les situations
où les dilatations successives sont insuffisantes pour obte-
nir un calibre suffisamment large, elles autorisent une
calibration du diamètre de l’anastomose dans des condi-
tions de sécurité relativement bonnes en évitant les dila-
tations itératives. Ces prothèses se présentent sous une
forme contrainte sur un cathéter porteur dans un diamètre
de moins de 10 mm, la prothèse se dépliant jusqu’à un
diamètre de 18 à 23 mm. Les avantages de ces matériels
sont la nécessité de dilatation réduite à la taille du cathéter
porteur et non plus à celle de la prothèse et un déploie-
ment de la prothèse qui exerce une force active de
type radiaire et non plus comme auparavant radiaire et
verticale. La dilatation réalisée est progressive, moins dou-
loureuse et brutale que celle réalisée par les ballonnets
hydrauliques de dilatation ou encore les bougies.
Le moment du retrait : un problème non résolu
La difficulté n’est pas tellement de les retirer que de
savoir combien de temps elles doivent être laissées en
place pour obtenir une dilatation efficace [5] : 1 mois
paraît une proposition raisonnable. Dans ces indications
non tumorales, la prothèse doit être extraite passé ce délai
A
BC
Figure 1. Sténose maligne du tiers supérieur de l’œsophage. A. Prothèse métallique expansive non couverte. B. Mise en place à travers
l’endoscope de la prothèse sur fil guide. C. Contrôle de la prothèse par tomodensitométrie.
mt, vol. 12, n° 4, juillet-août 2006 229

en raison de la formation d’un bourgeon charnu par
réépithélisation muqueuse à chaque extrémité de la pro-
thèse.
Le traitement endoscopique
des sténoses malignes duodénales
Le cancer pancréatique avancé constitue une bonne
indication du fait des progrès relativement lents des théra-
peutiques définitives, en particulier chirurgicales d’une part
et d’autre part de la morbidité et de la mortalité non négli-
geables des chirurgies de dérivation. Les progrès de l’instru-
mentation endoscopique appliqués au niveau de l’œso-
phage l’ont été également au niveau des autres segments du
tractus digestif, en particulier au niveau du duodénum. Si
l’intérêt de la pose d’une prothèse biliaire dans cette patho-
logie tumorale n’est plus à démontrer pour drainer efficace-
ment les voies biliaires améliorant ainsi la fonction hépati-
que, ce qui permet la mise en route de la chimiothérapie,
précisons que ce sont des prothèses métalliques auto-
expansives qui sont utilisées car il n’y a pas de formation de
biofilm bactérien comme avec les prothèses plastiques qui
favorise l’obstruction des prothèses [6]
. Elles sont de plus
maintenant couvertes, ce qui réduit l’obstruction intratu-
morale et facilite leur changement [7]. Le retentissement
duodénal de ces cancers pancréatiques constitue une
indication du traitement endoscopique plus récente. Les
prothèses utilisées sont des prothèses non couvertes auto-
expansives métalliques qui sont une alternative efficace à
la chirurgie, en particulier sur le plan de la durée du
résultat obtenu. Actuellement, l’ensemble des procédures
utilise des fils guides et des cathéters porteurs qui passent
au travers du canal opérateur.
Quelques mots de technologie
Ces prothèses métalliques auto-expansives dévelop-
pées dans les années 90 ont une souplesse qui rend
ABC
DE
Figure 2. Sténose bénigne d’une anastomose œso-œsophagienne. A. Vue endoscopique de la sténose. B. Dilatation au ballonnet
hydrostatique – vue endoscopique. C. Dilatation au ballonnet hydrostatique – vue radiologique. D. Mise en place de la prothèse à travers
l’endoscope de la prothèse sur fil guide. E. Vue de la prothèse métallique, expansive, couverte en place au niveau de la sténose. L’anneau
permet le retrait de la prothèse.
Revue
mt, vol. 12, n° 4, juillet-août 2006
230

envisageable leur utilisation dans ces sténoses malignes
dont le traitement n’est pas compatible avec les prothèses
plastiques. En effet, la souplesse proposée par ces prothè-
ses permet leur maintien en place par appui et impaction
au niveau des parois digestives. Le concept de largage est
identique à celui que nous avons vu au niveau de l’œso-
phage avec la possibilité de passer le cathéter et le fil guide
au travers du canal opérateur d’un endoscope, qui
comporte un gros canal opérateur (4,2 mm). L’utilisation
combinée de l’endoscopie et de la radiologie est un plus
dans la rapidité et la facilité d’exécution de la procédure.
L’endoscope utilisé est soit un axioscope, soit un duodé-
noscope (vision latérale), en sachant qu’il est toujours
possible de garder le contrôle visuel de toute la phase de
largage. Sur le plan pratique, le trajet de la sténose duodé-
nale est repéré par injection directe du produit, contraste
afin de faciliter l’insertion du fil guide qui sera suivi sous
contrôle endoscopique et radiologique. Toutefois, il est
nécessaire de dilater ces sténoses duodénales si le temps
préalable de la mise en place de la prothèse duodénale
nécessite la canulation de la papille pour réaliser une
sphinctérotomie et traiter une sténose biliaire associée.
Chez ce type de patient, le temps biliaire sera toujours
réalisé avant le temps duodénal puisque en effet, une fois
la prothèse métallique non couverte mise en place, il sera
beaucoup plus difficile de cathétériser la papille. En
l’absence de thérapeutique biliaire, il n’est pas nécessaire
de dilater le duodénum avant la mise en place de la
prothèse puisque la force radiale de la prothèse duodénale
sera suffisante pour la réaliser. Les prothèses utilisées ont
des diamètres qui varient de 14 à 22 mm pour une lon-
gueur de 4,5à9cm(figure 3).
Les résultats
La réalisation de cette technique permet d’obtenir un
succès dans pratiquement 96 % des cas. Le taux de reprise
alimentaire est de 95 % chez les patients traités dès la 24
e
heure avec un séjour hospitalier moyen de 3,2 jours. La
durée d’efficacité qui se traduit par une perméabilité satis-
faisante est observée jusqu’au décès du patient dans
89,4 % des cas avec une moyenne de survie de l’ordre de
3 à 4 mois [8]. Ces résultats qui sont largement confirmés,
puisque nous avons maintenant un recul de 5 ans, modi-
fient la prise en charge de ces patients, notamment chez
ceux porteurs d’un cancer du pancréas non résécable où
l’ictère a été la modalité de révélation de la maladie. La
possibilité de traiter ces obstructions duodénales par
méthode endoscopique est un argument supplémentaire
en faveur du traitement de la sténose biliaire par sphinc-
térotomie et mise en place d’une prothèse métallique dès
le début de la symptomatologie clinique et de toute façon
doit faire préférer cette méthode endoscopique aux
méthodes chirurgicales de double dérivation biliaire et
gastrique [8].
Soulignons encore l’avantage crucial de cette techni-
que qui permet par rapport à la chirurgie de dérivation
gastrique une alimentation normale pratiquement au bout
de 24 à 48 heures contre8à10jours pour les dérivations
chirurgicales, l’explication étant que le circuit anatomique
recréé par ces prothèses est beaucoup plus physiologique
que celui créé par la chirurgie gastrique.
L’utilisation de prothèses métalliques auto-
expansives en pathologie colique
En cancérologie colique
Deux applications sont actuellement retenues : la
désobstruction colique dans l’attente d’une chirurgie et le
traitement palliatif d’une tumeur obstructive chez un
patient non opérable.
Les modalités de réalisation
de la décompression préopératoire
–L’occlusion colique d’origine tumorale est un mode
de révélation dans les cancers coliques (25 % des cas). La
mise en place d’une prothèse peut être considérée comme
une alternative à une colostomie temporaire exécutée
avant la résection tumorale curative. Le taux de succès de
la décompression préopératoire est de 85 % pour un taux
de complication à 4 % (perforation, hémorragie, douleurs,
migration) en sachant que la mortalité liée à la procédure
est aux alentours de 1 % [9-11]. L’avantage du traitement
endoscopique est de modifier la prise en charge des
cancers coliques en occlusion. Il s’agit en effet d’une
forme évoluée de la maladie avec un envahissement gan-
glionnaire dans 60 % des cas et un envahissement métas-
tatique dans 40 % des cas. Un traitement chirurgical dans
ces conditions est difficile techniquement avec une mor-
bidité et une mortalité élevées qui vont nécessiter plu-
sieurs temps opératoires. L’intérêt de la mise en place
d’une prothèse colique dans cette situation est l’obtention
de la régression du syndrome occlusif qui permettra la
réalisation d’un geste chirurgical différé chez un patient
bien préparé.
–D’autre part, si le bilan préopératoire montre que la
maladie est trop évolutive, un traitement palliatif définitif
sera choisi.
Les résultats de la décompression préopératoire mon-
trent un taux de succès de la mise en place d’une prothèse
de décompression de 90 % [10, 11]. Au niveau du rectum
distal, ces prothèses métalliques peuvent être source de
ténesme, de douleurs, voire d’une incontinence fécale,
mais si on limite la prothèse métallique à un positionne-
ment à moins de 2 cm de la marge anale, il n’y a pas
d’interférence avec la fonction anale. Bien sûr, l’occlusion
de la prothèse par l’impaction des selles ou la réinvasion
tumorale nécessitera soit la mise en place d’une nouvelle
prothèse à l’intérieur de la première prothèse, soit un
traitement par destruction par un agent physique tel que le
plasma argon. Une étude d’analyse décisionnelle a
démontré que l’insertion de prothèse suivie d’une chirur-
mt, vol. 12, n° 4, juillet-août 2006 231
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%