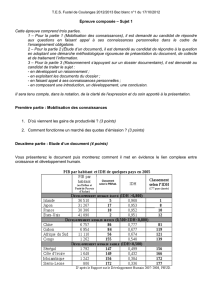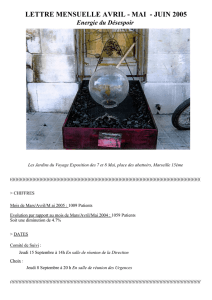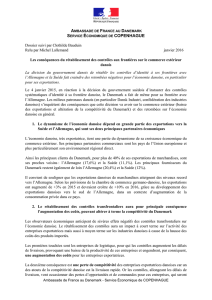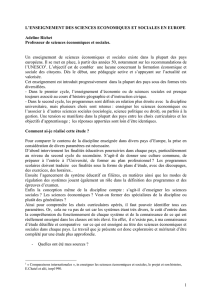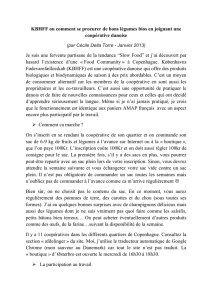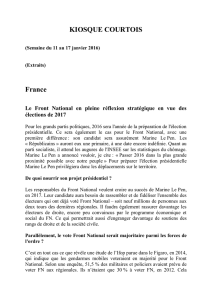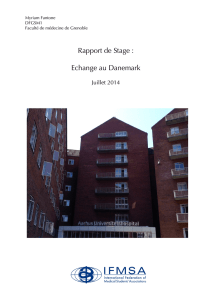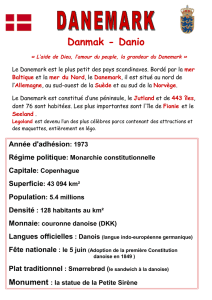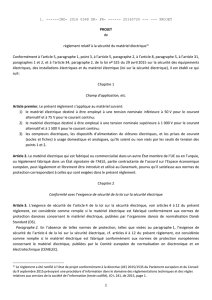mémoire en texte intégral version pdf

UNIVERSITÉ LYON 2
Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Le modèle danois : Une idiosyncrasie
inspiratrice
Michel Anne-Sophie
Quatrième année d’IEP
Séminaire : La construction européenne à la croisée des chemins :
quelles orientations entre approfondissement et élargissement ?
Sous la direction de Laurent GUIHERY
soutenu le 4 septembre 2008
Année universitaire 2007-2008


Table des matières
Introduction . . 4
Chapitre I : l’idiosyncrasie danoise : Fondements et caractéristiques . . 7
I/ Histoire du Danemark, fondement de sa spécificité . . 7
A- D’une grande puissance à un petit Etat . . 7
B- Une histoire politique et sociale fondatrice . . 9
II/ L’idiosyncrasie économique et sociétale . . 13
A- Une économie atypique: Un petit pays ouvert sur l’extérieur . . 13
B- Un tryptique sociétal unique: Liberté, Sécurité, Egalité . . 17
Chapitre II : Le Système social danois ou la réussite d’un Etat-Providence social
democrate? . . 21
I/ L’Etat-Providence social-démocrate . . 21
A- G øs ta Esping Andersen, théoricien de l’Etat-Providence66 . . 21
B- Les fondements de L’Etat-Providence social-démocrate . . 23
II/ Le triangle d’or: Flexibilité-Sécurité-Activation . . 26
A/ Une flexibilité partagée . . 26
B/ Une sécurité assurée . . 30
C/ Une activation développée . . 32
III/ Une évaluation critique du système social danois . . 37
A- Le triangle d’or à l’épreuve de la critique . . 38
B- Le contrat social sous pression ?170 . . 41
Chapitre III : La «flexsécurite» une source d’inspiration en Europe . . 46
I/ Enjeux et limites d’une inspiration de la «flexsécurité» . . 46
A- La «flexsécurité» adaptée aux nouveaux défis de l’Etat Providence? . . 47
B- S’inspirer de la «flexsécurité», un exercice périlleux . . 51
II/ Une approche européenne de la «flexsécurité» . . 54
A- Vers une approche commune de la «flexsécurité» . . 55
B- Raisons et enjeux d’une implication européenne . . 57
Conclusion . . 63
Annexes . . 65
Le triangle d’or . . 65
Les réformes de la politique de l’emploi au Danemark depuis 1994 . . 66
An overview of the Danish system of “flexicurity” . . 67
Les principes communs de «flexsécurité» . . 68
Bibliographie . . 70
Résumé . . 76
Abstract . . 77

Le modèle danois : Une idiosyncrasie inspiratrice
4 MICHEL Anne-Sophie_2008
Introduction
Le matin à Copenhague, il n’est pas rare de voir un député danois en costume, se rendant
au parlement en sifflotant sur son vélo, sa mallette de travail solidement accrochée sur le
porte bagage.
Assurément, la capitale danoise respire «la douceur de vivre». Dans une ville où les
vélos ont remplacé les voitures, où les maisons colorées bordent des rues pavées, où les
parcs et canaux oxygènent le centre-ville, il règne une atmosphère de village. La quiétude
et la sérénité sont les premiers sentiments qu’inspire la vie dans la capitale.
Copenhague est la vitrine de l’Etat danois. Ville la plus cosmopolite du Danemark, elle
cultive son dynamisme tout en préservant un haut niveau de qualité de vie. La capitale
symbolise ainsi la réussite de l’Etat-Providence social-démocrate danois.
Durant l’année universitaire 2006-2007, j’ai effectué mon année de mobilité à
l’université de Sciences Politiques de Copenhague. Cette année passée en immersion
dans la capitale danoise fut l’occasion de découvrir la réalité du modèle danois. Désirant
comprendre les facteurs déterminants qui en font un modèle de référence, j’ai pu également
m’apercevoir de l’existence de certaines tensions.
Ayant pris le recul nécessaire un an après mon retour, écrire ce mémoire est l’occasion
d’achever mon expérience danoise en mettant à profit les connaissances acquises durant
mon année d’immersion.
Le Danemark, petit état d’Europe du Nord, se caractérise par un modèle de société
particulier, fondé sur l’homogénéité et le consensus. Inscrit dans une longue histoire
politique et sociale, ce modèle s’adapte régulièrement aux caractéristiques changeantes
du contexte international. Ainsi grâce à une mutation du modèle dans les années 90 le
Danemark est devenu aujourd’hui un des Etats les plus dynamiques de l’Union Européenne.
La réussite de l’Etat danois a suscité l’admiration de ses voisins européens. Le modèle
de société danois est devenu un modèle de référence. En 2004, dans un rapport destiné à
l’Assemblée Nationale, Pierre Méhaignerie s’interroge: Existe-t-il un «miracle danois»? 1.
Le concept du «miracle danois» traduit la volonté des états européens de trouver
une inspiration qui leur permettrait de retrouver un certain dynamisme économique tout en
développant un haut niveau de cohésion sociale.
Cependant l’image du miracle s’est peu à peu estompée. Les spécificités du Danemark
sont alors apparues comme déterminantes. Le contexte historique, social et culturel de ce
petit Etat nordique aurait ainsi raison de sa vocation à l’exportation.
Au stade actuel de la réflexion (Fin 2007), ce mémoire se propose donc de réfléchir à
la question suivante: les spécificités du modèle danois empêchent-elles de considérer ce
modèle comme une source d’inspiration ?
1 MEHAIGNERIE, Pierre. Rapport d’information sur le marché de l’emploi au Danemark. Assemblée nationale, N°1913.
Novembre 2004. 31 pages

Introduction
MICHEL Anne-Sophie_2008 5
Il s’agit, par cette étude, de sortir d’une opposition stérile entre un optimisme naïf
consistant à penser que l’on peut transposer un modèle et un pessimisme excessif nourri
par une insistance trop forte sur les spécificités systémiques du modèle.
Etudier les caractéristiques du modèle danois pour comprendre ce qui en fait un
ensemble idiosyncratique est le premier objectif.
Le contexte historique, la structure économique ainsi que les caractéristiques sociétales
ont fait émerger un système social spécifique. Reposant sur trois piliers, le système dit de
«flexsécurité» est un exercice d’équilibriste. Il suppose, en effet, de concilier la flexibilité,
la sécurité et l’activation.
Si en anglais le terme de «flexicurity» fait pratiquement l’unanimité, la combinaison
lexicale de la flexibilité et de la sécurité connaît plusieurs variantes en français. On parle
aussi bien de «flexicurité», de «flexsécurité», voir de «flexisécurité».
Le terme retenu dans cette étude est celui de «flexsécurité». C’est, en effet, l’expression
qui est apparue le plus souvent au cours des lectures.
Véritable incarnation d’un Etat-Providence social-démocrate, fondé sur l’universalité et
la redistribution, le Danemark organise son modèle de société autour d’une homogénéité
constamment entretenue grâce aux piliers de la sécurité et de l’activation. La cohésion
sociale est ainsi un facteur clé de ce modèle.
Etudier le modèle danois est donc l’occasion de mener une réflexion sur ce qui fait un
modèle de société. Il semble que si l’établissement de règles et la construction d’institutions
soient des facteurs constitutifs d’une société, le développement d’un lien social apparaît
déterminant. Ce dernier repose sur des valeurs partagées ainsi que sur une vision commune
de l’avenir.
La volonté de vivre ensemble s’exprime à travers la solidarité, pilier d’une société. En
définissant les bases de la solidarité ainsi que les conditions du lien social, l’Etat providence,
revêt une importance déterminante dans les sociétés européennes contemporaines.
En étudiant le modèle danois, il s’agit de découvrir un Etat-Providence social-démocrate
et donc de se pencher sur le concept même d’Etat-Providence théorisé par Gøsta Esping
Andersen. Réussir à trouver un équilibre entre la solidarité et la compétitivité est la vocation
des Etats-Providence existants dans les sociétés européennes contemporaines.
Ayant apparemment trouvé cet équilibre, le modèle danois est devenu un modèle de
référence. Il ne faudrait cependant pas omettre d’évoquer les limites de ce modèle. En
effectuant une évaluation critique de l’activation comme en mettant en lumière les tensions
existantes, il s’agit de nuancer la réussite de l’Etat-Providence danois. En effet, les politiques
actives de l’emploi sont critiquées pour leur manque d’efficacité tandis que la question de
l’immigration met au défi l’homogénéité et le contrat social de base de la société.
Malgré ces tensions, le modèle danois est devenu une source d’inspiration en
Europe. En effet, le «Danemark connaît une situation économique et sociale absolument
exemplaire»2. Par cette phrase, Michel Rocard, préfacier de l’ouvrage de Mogens Lykketoft,
exprime le sentiment de nombreux observateurs européens.
Ce mémoire est donc aussi l’occasion d’ouvrir la réflexion sur le modèle danois en tant
que source d’inspiration en Europe.
A Lisbonne en 2000, les Etats membres de l’Union Européenne se sont fixés des
objectifs ambitieux: «Devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
2 LYKKETOFT, Mogens. Le modèle danois, Editions Esprit ouvert, 2006, 125pages
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
1
/
77
100%