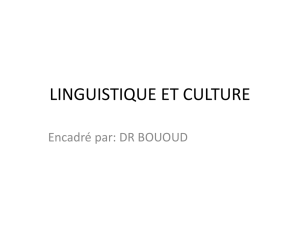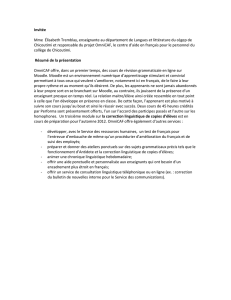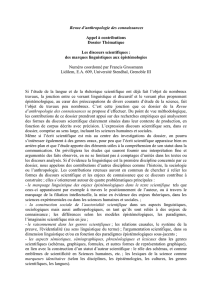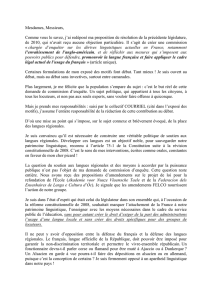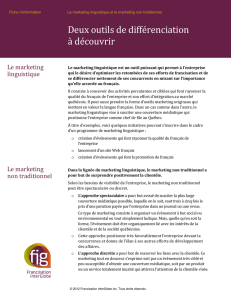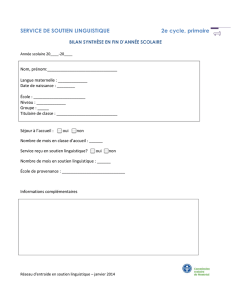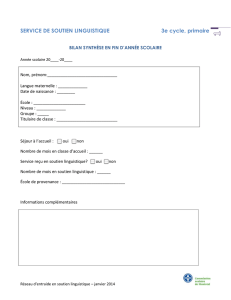Uq rHISTOIRES L`ANTHROPOLOGIE (XVIe

COLLECTION D'ÉPISTÉMOLOGIE
dirigée par Angèle
KREMER-MARIETII
..
PARAlN-VIAL
(J.),
Philosophie des sciences de la nature. Tendances nouvelles, 1983,
320 p.
KREMER-MAIuETIl
(A.), Le Concept de science positive. Ses tenants et ses aboutis-
sants dans les structures anthropologiques du Positivisme, 1983,202
p.
Histoires de l'anthropologie (XVI-XIX' siècles). Colloque
«
La pratique de l'anthro-
pologie aujourd'hui» (Sèvres, 1981) sous la direction B.
Rupp-EISENREICH,
1'»14
"1
Uq
rHISTOIRES
DE
L'ANTHROPOLOGIE
(XVIe-XIXe siècles)
CoUoque
LA PRATIQUE DE L'ANTHROPOLOGIE AUJOURD'HUI
19-21 novembre 1981, Sèvres
PRÉSENTÉ PAR
Britta RUPP-EISENREICH
Publié avec le concours
du Centre National des Lettres
PARIS
KLINCKSIECK
1984

LINGUISTIQUE.ET ANTHROPOLOGIE EN FRANCE
(1600-1900)
par Sylvain Auroux
(C.N.R.S. et Université Paris VII)
1. Développement scientifique et tradition.
On a tendance à définir une discipline scientifique par un
corps de doctrine, produisant des assertions plus ou moins véri-
fiables, et dont la sémantique constitue l'objet de la science.
L'historien des sciences a tout intérêt à utiliser une définition
plus large fondée sur l'idée qu'une discipline scientifique possède
trois composants: l'un théorique (données, concept, problè-
mes), l'autre pratique (intérêts et buts poursuivis), l'autre socio-
logique (institutions, circulation de l'information; formation,
profession et carrière des chercheurs). Il se peut que reproduc-
tion ou production d'une discipline demeurent fermées ou par-
tiellement fermées 1pour tous ses composants ou seulement cer-
tains; nous avons alors affaire à ce que nous nommons une tra-
dition, par définition, plus ou moins indépendante. On n'insis-
tera jamais assez sur le fait essentiel que la science est une insti-
tution, c'est-à-dire quelque chose qui se reproduit seulement par
tradition. Un groupe (ou une génération) de chercheurs travaille
à partir d'éléments qui lui sont transmis et sur la base d'une for-
mation déterminée. Il est tout à fait correct de considérer que le
développement des connaissances n'est pas une simple crois-
sance monotone en fonction du temps et l'historien peut souvent
mettre en lumière des discontinuités plus ou moins intéressantes
(cela dépend du point de vue choisi). Il n'en demeure pas moins
que la science, pareillement au capital, rie s'explique que par
une structure cumulative
2.
Il faut du temps, du personnel, des
concepts, des informations, pour développer les connaissances.
Pas plus qu'on n'explique la naissance du capitalisme industriel

292
par sa structure (mais par la concentration de la main-d'
agricole, la disponibilité du capital marchand et financier, etc.
on n'expliquera le développement de la science par des
res incomparables. Il est tout
à
fait clair, aux yeux d'un
mologue rigoureux, que nous ne disposons pas de modèle
faisant pour expliquer le changement scientifique. Cette
tion impose que nous nous efforcions de considérer avec
tion quelques cas concrets, en accordant le minimum de pl
aux préjugés les plus connus concernant la forme de ce changes
ment.
Ces remarques rapides ont pour but d'introduire à un
blème historique et épistémologique, qu'une conception
ment discontinuiste nous paraît incapable de traiter. Il
('nn,..Arn •••
l
ce qu'on peut appeler
«
anthropologie linguistique
»,
remarques liminaires peuvent permettre de le cerner:
1) Le terme d'anthropologie linguistique est peu utilisé en
France. Nous le trouvons employé par les spécialistes des langues
africaines (M. Houis), ou remplacé par «ethnolinguistiques»
chez les américanistes (B. Pottier). Le mot lui-même évoque le
recherches menées sur les Indiens d'Amérique de Nord par Boas,
Sapir et Whorf. L'expression
«
anthropologicallinguistics
»
est
à \
l'inverse d'un usage assez courant outre-atlantique, où les chaires.l
de linguistique générale sont souvent dépendantes de départe-
ments intitulés
«
Anthropology and Linguistics »3. En France les
chaires de linguistique ou les départements de linguistique sont
plutôt des excroissances des départements de
«
Langue et Litté-
rature », voués initialement
à
l'enseignement d'une langue ou
d'un groupe de langues".
2)
Les définitions de l'anthropologie linguistique sont tout à fait
confuses. En 1961, H. Hoijer (élève de Sapir et héritier de ses
papiers) définissait ainsi sa discipline:
«
Anthropological linguistics may briefly be defined as an are a
of linguistics resarch which is devoted in the main to studies, syn-
chronie and diachronie, of the language of people who have no
writing»
(<<
Anthropological linguistics », Trends in European
and American Linguistics 1930-1960, Ch. Mohrmann
ed.,
pp. 110-127).
Plus loin, il précise que ce type d'étude est celui qui s'occupe
des
«
exotic languages»; qu'il ne diffère en rien de ce que l'on
entend ordinairement par linguistique quant à la méthode, sinon
Linguistique et anthropologie en France (1600-1900)
293
quant aux techniques de recensement des données. Plus loin
encore, il précise les buts essentiels de ce type de recherches:
a) classification des langues (l.c., 112); b) préhistoire (glottochro-
nologie; ibid., 118, sq.) ; c) constitution conceptuelle (problème
d'élaboration des catégories"). On sent bien qu'une telle défini-
tion correspond effectivement à quelque chose, mais le moins
que l'on puisse dire est qu'elle ne brille guère par sa cohérence
conceptuelle. Il est clair que l'étude renvoie à des langues non
indo-européennes; beaucoup effectivement ne disposent pas
d'un système d'écriture, mais historiquement le chinois, et encore
aujourd'hui le malais, qui sont des langues de
«
civilisation », ont
posé ou posent des problèmes de catégorisation. A l'inverse les
«
patois» chez les peuples «civilisés» ont nécessité une
réflexion sur les techniques de recensement et ont été souvent
soumis aux mêmes types de questionnaire que les langues des
peuples sans écriture, cf. Pop, S. - La dialectologie, aperçu his-
torique et méthodes d'enquêtes linguistiques, Louvain, Duculot,
1950. Il est évident que les problèmes de classification ne concer-
nent pas seulement les langues exotiques ou simplement non
indo-européennes. Il paraît étrange d'affirmer la particularité de
l'anthropologie linguistique en même temps que son identité de
méthode avec la linguistique générale. Enfin la spécificité des
méthodes de datation sans recours aux données historiques exter-
nes pose de sérieux problèmes (on sait que le principal contre-
exemple à la loi de Swadesh est donné par les langues romanes,
pour lesquelles nous disposons de datations extrinsèques").
Il est évident que devant ces remarques, à première vue
totalement indépendantes, on pourrait s'en tenir au constat de
l'absence en France de tout ce qui pourrait s'attacher
à
l'anthro-
pologie linguistique, et de l'inconsistance théorique de Hoijer.
On suivrait ainsi les principales histoires de la linguistique qui ne
se sont guère intéressées
à
la question, si ce n'est pour mention-
ner l'existence d'un courant
«
humboldtien
»,
au reste marginal,
en Allemagne au XIXesiècle 7. Nous choisirons une hypothèse de
travail exactement inverse. En mettant
à
jour des matériaux his-
toriographiques négligés", nous montrerons l'existence, du XVIIe
à la fin du XIXesiècle, de travaux français concernant à la fois la
linguistique et l'anthropologie. Par le suivi des thèmes et la
reproduction de l'information, nous montrerons que ce que nous
nommerons «anthropologie linguistique» (certainement par
abus de langage, mais cela n'a pas grande importance pour notre
propos), est avant tout une tradition. C'est à partir de phénomè-

294 Sylvain Auroux
nes qui concernent essentiellement le devenir des traditions, que
s'expliquent à la fois la situation française et le flou de la défini-
tion de Hoijer: l'existence d'une tradition en effet, ne préjuge
en rien d'une cohérence conceptuelle.
2. Le temps des voyageurs et des missionnaires
L'une des faiblesses fondamentales de l'histoire de la lin-
guistique, est que l'on n'a jamais vraiment songé àdépouiller les
récits des voyageurs (P. Martyr qui voyageait avec Colomb, et
Pigafetta qui voyageait avec Magellan sont pour la linguistique
des initiateurs) et les archives des missionnaires. Ce sont pour-
tant les premières sources, tant pour l'étude d'un grand nombre
de langues que pour l'anthropologie. Les récits de voyage
(qu'on prenne par exemple la collection réunie par le président
de Brosses en 1757, sous le titre Histoire des navigations aux
Terres Australes) comportant
à
peu près toujours des remarques
sur les langues et des vocabulaires. Bien entendu, leurs auteurs
ne sont ni des linguistes, ni des anthropologues professionnels,
mais la situation n'est pas du tout la même, pour les deux disci-
plines. Aux XVIe et XVIIe siècles, l'anthropologie n'existait pas ou
du moins ne se distinguait pas des textes que nous étudions.
Voyageurs et missionnaires ont toujours été considérés comme
des sources d'information sur les différents peuples du monde.
Les études sur le langage, par contre existaient (il s'agit sans
doute, avec les mathématiques de l'une des plus anciennes tradi-
tions scientifiques de l'Occident). Mais elles avaient vocation
pédagogique, possédaient une solide tradition théorique, et
étaient limitées par l'étude des langues classiques (latin, grec,
hébreu, arabe) ou celle des langues européennes modernes.
Fondamentalement elles concernaient les langues de l'écriture,
voire de l'Ecriture Sainte (dont l'étude a fortement contribué à
la naissance de la philologie; cf. R. Simon, 1698). Au XVIe
comme au XVIIe siècles, les
«
linguistes» sont des professeurs et/
ou des littérateurs. Le premier ouvrage théorique moderne sur
le langage, la Grammaire Générale de Port-Royal (1600) a été
rédigé sans aucune référence
à
des langues non classiques, avec
des présupposés universalistes et des visées d'abord pédagogi-
ques. Le premier travail important rédigé en français sur une
langue amérindienne, l'œuvre du P.R. Breton (Dictionnaire
295
Linguistique et anthropologie en France (1600-1900)
caraïbe-français, 1665; Dictionnaire français-caraïbe, 1666;
Grammaire caraïbe, 1667) est contemporain de l'œuvre des Mes-
sieurs; bien qu'il s'agisse d'une source souvent citée par les spé-
cialistes, elle ne sera intégrée
à
des travaux plus généraux qu'à la
fin du XVIIIe siècle.
La fermeture du composant sociologique de la tradition que
nous décrivons est assez claire. Celle du composant pratique
l'est également: vocabulaires et grammaires sont des instru-
ments de commerce et de pouvoir (en 1757, De Brosses sera
extrèmement clair dans sa préface), comme de propagande reli-
gieuse. L'information linguistique et anthropologique est une
richesse (en 1665, Breton s'excuse auprès de ses collègues de
divulguer un matériau qui pourra servir
à
d'autres) qui s'accu-
mule dans les missions, et que les autorités romaines, par exem-
ple, thésaurisent aux Archives de la Propagande de la Foi. Reste
à montrer que ce type d'information linguistique concerne bien
l'anthropologie linguistique, et la spécificité de son composant
théorique.
Revenons à l'exemple des Caraïbes. En 1647, le P. Breton
a rédigé un rapport intitulé:
«
Relation de l'Isle de la Guade-
loupe faite par les missionnaires dominicains à leur Général» ; il
est conservé à Rome aux Archives de la Propagande de la Foi,
et on en trouve une version à la Bibliothèque nationale de Paris
(msf. 24974). Le texte est divisé en trois parties; la première est
une description physique de la Guadeloupe; la seconde est une
description de la population indigène, intitulée
«
De l'origine,
mœurs, religion, etc. des Caraïbes
»;
la troisième est une his-
toire de la colonisation. On dispose là d'un cadre canonique",
dont l'ordre et la permanence chez de nombreux auteurs font
fonction de questionnaires dont l'élaboration systématique
débutera dès la fin du XVIIIe siècle. L'information linguistique
est interne à la documentation anthropologique (chez Breton
elle est répartie en deux chapitres: II, 1, De l'origine et humeur
des sauvages;
n,2,
De leur langue); et elle figure à peu près
dans tous les ouvrages de même type, qu'ils aient pour titre His-
toire naturelle et morale, Voyage, Mœurs, Relation, etc. Le lan-
gage est d'emblée relié aux mœurs, c'est une dimension obligée
de l'approche des cultures étrangères. Cela explique sans doute
la relative fermeture théorique de cette tradition. Un régent de

296 Sylvain Auroux
collège, préoccupé de découvrir la nouvelle méthode infaillible
pour l'apprentissage du latin n'ira pas chercher des informations
linguistiques dans l'ouvrage du P. Lafitau intitulé Mœurs des
sauvages amériquains comparés aux mœurs des premiers tems
(1724), lequel comporte pourtant un long et intéressant chapitre
sur la langue
(t.
II, pp. 458-49810).
Deux traits relevés par Hoijer sont immédiatement pré-
sents : les problèmes de classification (ou si l'on veut, de géogra-
phie linguistique), et ceux de l'origine de l'humanité. Pour la
tradition anthropologique le langage est un moyen de recherche
historique (à la demande de ses supérieurs Breton a introduit
des remarques historiques dans son Dictionnaire de 1665), dont
témoigne la longue discussion sur l'origine du peuplement amé-
ricain, commencée avec Grotius (1642), et marquée en France
au siècle suivant, par l'ouvrage de l'interpète du Roi, employé
aux Affaires Etrangères, J.B. Scherer (1777, Recherches histori-
ques et géographiques sur le Nouveau Monde), auquel collabore
Court de Gébelin.
Le composant théorique principal de cette tradition corres-
pond parfaitement à l'un des traits décrits par Hoijer: le pro-
blème des catégories. Qu'on ait affaire à des cultures sans écri-
ture, et donc sans tradition grammaticale paraît alors essentiel:
tout est
à
composer, et les difficultés n'en paraissent que mieux.
Les grammaires latines, puis la grammaire générale, fournissent
un lot de catégories qui s'adaptent mal à des langues non indo-
européennes, d'autant qu'elles ne disposent d'aucun métalanga-
ges morphologique clair. Qu'on parcourt ces travaux, on ren-
contre partout la même litanie et le même type de problème: on
ne
«
trouve
»
pas les catégories françaises et latines dans les lan-
gues étudiées. Breton (1667), par exemple, note que les Caraï-
bes n'ont pas d'article (cela ne l'empêche pas de rédiger un cha-
pitre de sa grammaire sur la question). En 1664, l'auteur d'un
Voyage de la France Equinoxiale en l'Isle de Cayenne, le
P.A. Biet commence ainsi son analyse du galibi :
«
La première
remarque est que de toutes les huits parties d'oraison, avec les-
quelles nous composons un discours, il n'yen a que deux dans
cette langue, à sçavoir le nom, qui sert à nommer les choses, et
le verbe, pour représenter les actions et les passions (... ). Les
noms n'ont que le singulier, soit substantif, quoyqu'il soit propre
297
Linguistique et anthropologie en France (1600-1900)
ou appellatif, non plus que l'adjectif
»
(p. 395). De là l'existence
dans cette tradition de problèmes spécifiques, comme par exem-
ple, le statut du verbe en iroquois, inauguré par le traité du
P. Bruyas, rédigé au Canada en 1666 (Radiees verborum iroquo-
rum neo-eboraci types, ed. 1863). Lafitau reprend la question (1,
oc. cit., p. 486). Sa solution est marquée par la grammaire géné-
rale, seule théorie cohérente dont il dispose:
«
Il faut qu'il
y
ait
un équivalent, qui puisse fournir autant de signes qu'il est néces-
saire, pour suppléer au défaut de ces parties d'oraison, lesquel-
les se trouvant dans une langue, ne se trouverait point dans une
autre, qui serait certainement défectueuse et inutile, si elle
n'avait dans son fonds de quoi remplir la fin et le but de toute
langue» (ibid.).
Proche du problème des catégories, on rencontre celui des
rapports du langage et de la pensée. Il s'agit d'une question que
les missionnaires ont dû affronter concrètement lors de l'élabo-
ration des catéchismes. Un texte du P. Biard, sur le Canada
(Relation de la nouvelle France, 1616, chap. 16, 149 sq.) montre
l'enjeu de la question: les missionnaires ne parviennent pas à
traduire et faire comprendre les termes abstraits les plus essen-
tiels à leur mission auprès des indigènes (vice, vertu, péché,
prière, etc.). Au lieu de relier la compréhension linguistique à la
pratique sociale (attitude qui peut servir aujourd'hui
à
définir
l'orientation théorique de l'anthropologie linguistique), les mis-
sionnaires de l'âge classique ont tendance à adopter une solution
universaliste, qui range les civilisations selon une échelle d'évo-
lution linéaire, et permet d'interpréter l'absence de correspon-
dance par l'existence de «trous» sémantiques aux échelons
inférieurs. La tradition d'anthropologie linguistique n'est pas à
ce point autonome qu'elle ne soit fille de son temps.
3. Des compilateurs aux linguistes: le signe de l'homme
Les compilateurs et les tableaux comparatifs, qui ont pour
source les travaux que l'on vient d'évoquer apparaissent dès le
XVIe siècle (v. par exemple la Cosmographie, d'A. Thevet,
1575). Toutefois c'est au tournant des XVIIIe et XIXesiècles que
ce genre d'ouvrages se généralise rapidement en Europe: on
connaît les travaux de Court de Gébelin (Monde primitif, 9 vol.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%