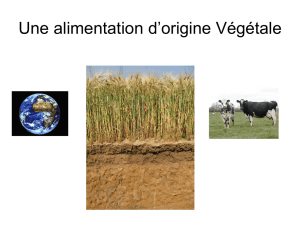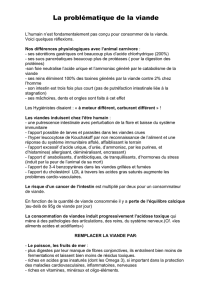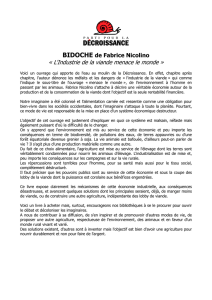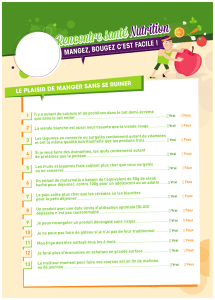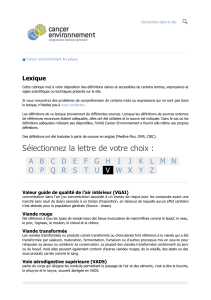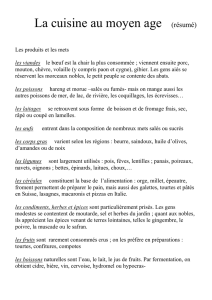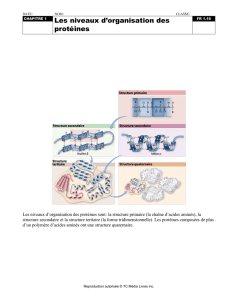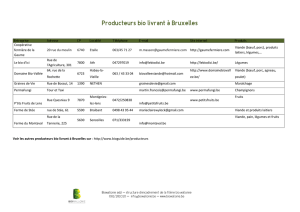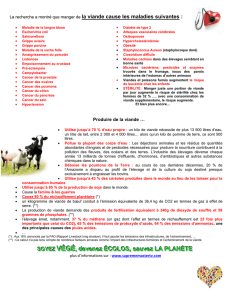L`alimentation des seniors - CIV

DOSSIER
L’alimentation
des seniors
Prévenir la sarcopénie
et la dénutrition


3
DOSSIER
4
8
12
16
18
20
21
24
SOMMAIRE
I. LE SENIOR, UN OMNIVORE PAS COMME LES AUTRES
II. CONSOMMATION DE VIANDE
CHEZ LES SENIORS ET CONTRIBUTION
AUX APPORTS NUTRITIONNELS
III. NUTRITION ET VIEILLISSEMENT :
DES BESOINS SPÉCIFIQUES
IV. PRÉVENIR LA SARCOPÉNIE
V. PRÉVENIR LA DÉNUTRITION
VI. OUTILS D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT
NUTRITIONNEL
VII. BIBLIOGRAPHIE
LE POINT SUR LA VIANDE : EVOLUTION
DES CONSOMMATIONS ET VALEURS
NUTRITIONNELLES
REMERCIEMENTS À :
- PR BRUNO LESOURD, CLAIRE SULMONT-ROSSÉ, PR YVES BOIRIE
POUR LEURS CONTRIBUTIONS À CE NUMÉRO ;
- DR BERNARD CHARDON ET PR STÉPHANE SCHNEIDER POUR LEURS
RELECTURES ATTENTIVES.
Sommaire

4
Derrière le terme de « senior », il est nécessaire
de distinguer deux réalités très différentes :
le jeune senior, la soixantaine, bien en forme
et actif, chez lequel il convient néanmoins
de prévenir certaines pathologies comme
l’ostéoporose ou la sarcopénie ; et le senior
plus âgé (on parle parfois de « quatrième
âge » pour ces personnes généralement âgées
de plus de 75 ans), qui peut être fragilisé.
Quelles sont les spécificités à prendre en
compte quand on s’intéresse à l’alimentation
des seniors ?
Professeur Bruno Lesourd : La première
spécificité me semble être la perte d’appétit.
Une partie des personnes âgées ne mange
plus assez : 2 à 4 % des hommes vers 70 ans,
et 10 à 20 % des femmes par exemple à 75 ans
(De Groot
et al.
, 1999, 2002). Après 80 ans, ces
chiffres s’élèvent à plus de 10 %. Les causes
sont multiples : perte de goût et d’odorat,
difficultés de mastication ou de dentition,
etc. Mais la première cause me semble être
la difficulté pour le senior à réguler son
appétit : si on se rapporte aux travaux de
la Tufts Université de Boston (Roberts
et
al.,
1994), après une période de restriction
alimentaire de l’ordre de 30 % les sujets de
20 ans compensent en mangeant davantage,
tandis que les personnes de 68 ans restent sur
le même niveau d’apports. Même constat dans
l’autre sens : après une période d’abondance,
les jeunes réduisent leurs apports et perdent
le surpoids acquis, tandis que les personnes
âgées continuent à manger davantage. Ainsi,
la régulation n’existe plus passé un certain âge,
avec un corollaire négatif (le danger d’une
anorexie qui s’installe) et positif (en forçant
l’appétit, on peut relancer une alimentation
suffisante). Mais dans tous les cas, la présence
d’intervenants extérieurs incitant à manger
est indispensable,
la personne âgée
ne pouvant plus
compter sur les
signaux que lui
envoie son corps.
Autre spécificité : à l’inverse de croyances
malheureusement encore profondément
enracinées, les besoins nutritionnels des
seniors, notamment en termes de calories
et de protéines, ne sont pas diminués,
malgré une activité physique généralement
moindre. En effet, la baisse physiologique
du rendement énergétique compense des
dépenses inférieures. Pourtant, beaucoup
de paramètres convergent pour entraîner
la personne âgée vers l’attitude contraire,
et donc la sous-alimentation : le corps qui,
par fatigue et diminution de la sensation de
faim, pousse la personne âgée à des dîners
trop légers ; le désœuvrement qui conduit
facilement au grignotage, cassant le rythme
des repas et réduisant l’appétit au dîner ;
les établissements où la standardisation
des plateaux peut amener à supprimer
certains aliments que la personne avait pour
habitude de consommer chez elle (morceau
de fromage ou tranche de saucisson
matinale par exemple) et qui participaient
à la couverture des besoins quotidiens en
I.
LE SENIOR, UN OMNIVORE
PAS COMME LES AUTRES
Vieillissement oblige, le senior doit répondre à des
besoins nutritionnels très spécifiques. regards croisés
de deux spécialistes : le pr bruno lesourd, gériatre
nutritionniste au cHu de clermont-ferrand, et
claire sulmont-rossé, cHercHeur en sciences du goût
et de l’alimentation à l’inra de dijon.
LES BESOINS NUTRITIONNELS
DES SENIORS NE SONT PAS
DIMINUÉS MALGRÉ UNE
ACTIVITÉ PHYSIQUE MOINDRE.

5
DOSSIER
protéines et en calories ; et enfin, la baisse de
l’activité physique, alors que cette dernière
augmenterait les besoins et l’appétit.
Claire Sulmont-Rossé : D’un point de
vue sensoriel, le vieillissement peut
s’accompagner d’une modification de la
capacité à percevoir les caractéristiques
organoleptiques d’un aliment, à savoir son
arôme, sa saveur et sa texture. En effet, l’âge
favorise un déclin des sens de l’olfaction et
de la gustation et une dégradation de l’état
bucco-dentaire (perte de dents, modification
de la salive, apparition de troubles de la
déglutition).
Au-delà de ces modifications physiologiques,
la vie d’une personne âgée est marquée par des
« moments de rupture » (retraite, apparition
d’incapacités physiques ou psychiques,
veuvage, etc.) susceptibles de bouleverser ses
habitudes de vie et en particulier ses habitudes
alimentaires (Cardon, 2009). Cardon et Gojard
(2009) ont, par exemple, montré que la
délégation à un tiers (membre de la famille
ou aide ménagère) d’une partie des activités
alimentaires suite à l’apparition d’incapacités
physiques ou psychiques entraînait une
diminution de la variété alimentaire. Cardon
(2009) a également montré que le veuvage
modifiait les habitudes alimentaires de la
personne restante avec une disparition des
plats « mijotés » et des pâtisserie maison,
porteurs de convivialité et de sociabilité,
et chez les veufs, une augmentation de la
consommation de plats préparés ou surgelés.
Enfin, l’apparition de troubles psychologiques
(dépression, déficience intellectuelle liée à
l’âge) peut également affecter l’appétit et
la prise alimentaire des personnes âgées
(Huffman, 2002).
Les seniors ont-ils des besoins nutritionnels
spécifiques ?
Professeur Bruno Lesourd : Outre leurs
besoins caloriques élevés, les seniors
ont également des besoins spécifiques,
notamment en protéines, calcium et eau.
En ce qui concerne les protéines et le
risque de sarcopénie, on observe, à partir de
cinquante ans environ, une petite diminution
de l’anabolisme protéique, notamment en
raison de l’extraction splanchnique des acides
aminés ingérés : ces derniers, en passant par
la muqueuse intestinale puis le foie avant de
rejoindre la circulation générale, sont utilisés
par les tissus traversés et n’atteignent pas la
périphérie. Or, si l’anabolisme diminue, le
catabolisme demeure tout aussi important :
en résulte une lente diminution de la masse
musculaire, évaluée entre 5 et 15 kg entre
50 et 80 ans (Janssen
et al.,
2000). En outre,
plus souvent malade, le sujet âgé se retrouve
régulièrement dans
une période de besoins
augmentés. C’est la
raison pour laquelle
les sujets âgés, dès
60 ans, doivent
consommer 1 g/kg de poids corporel/ jour de
protéines, contre 0,8 chez un sujet plus jeune
(Afssa, 2007).
Concernant le calcium et le risque
d’ostéoporose, on observe avec l’âge une
perte calcique osseuse de 20 à 30 % autour de
la ménopause et de 1 à 2 % /an chez les deux
sexes après 65 ans. C’est la raison pour laquelle
les recommandations grimpent à 1 200 mg/j
de calcium après 55 ans chez la femme et
65 ans chez l’homme, contre 900 mg/j avant
(Cynober
et al.,
2000 ; Martin, 2001).
Enfin, avec l’âge, l’organisme perd de l’eau.
Le risque de déshydratation augmente
donc, d’autant que le signal d’alerte de la
soif régresse fortement entre 60 et 70 ans.
La personne âgée doit donc apprendre à
boire 1 litre à 1 litre ½ par jour, de manière
volontaire, sans attendre un signal de soif qui
n’arrivera pas ou tard.
LA MASSE MUSCULAIRE
DIMINUE LENTEMENT ENTRE
50 ET 80 ANS, DE 5 À 15 KG.
LE SENIOR EN CHIFFRES
Ü Conséquence directe de l’augmentation de l’espérance de vie,
qui a atteint en 2010, selon l’Insee (chires provisoires) 78,0 ans
pour les hommes (seulement 63,4 ans en 1950) et 84,7 ans pour
les femmes (69,2 en 1950) : la proportion des plus de 60 ans
augmente en France, représentant 22,6 % de la population
au 1er janvier 2010. On prévoit ainsi que près d’un Français sur
trois en 2050 aura plus de 60 ans. La majorité d’entre eux vit à
domicile et est en bonne santé.
Source : Insee, statistiques de l’état civil et estimations de population
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%