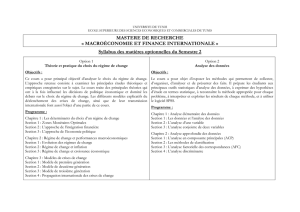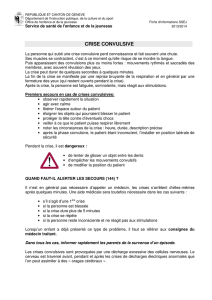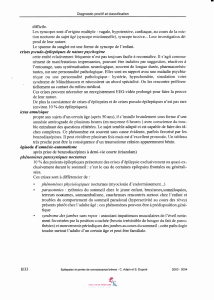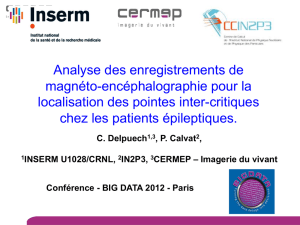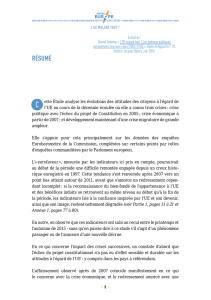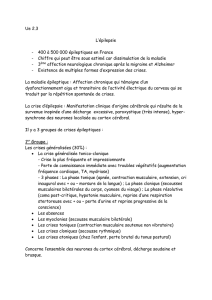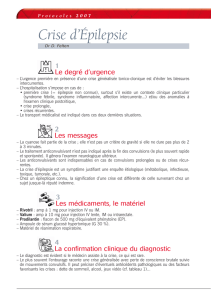Épilepsie

La classication de la Ligue internatio-
nale contre l’épilepsie, datant de 1981,
fait la distinction entre les crises par-
tielles simples et les crises partielles
complexes, en fonction de la présence
ou non d’altérations de la conscience.
Durant les crises, les dysphasies,
les akinésies ou les états d’excita-
tion émotionnelle peuvent à tort être
considérés comme des troubles de la
conscience, raison pour laquelle il est
nécessaire de rechercher la présence
de signes indirects (tab. 1).
Crises partielles complexes
Les crises partielles (focales) com-
plexes (autrefois appelées crises psy-
chomotrices, crises limbiques, etc.)
représentent 40 % des crises d’épi-
lepsie et sont les plus fréquentes.
En fonction de leur origine, les crises
partielles sans (partielles simples)
ou avec altérations de la conscience
(partielles complexes) peuvent dé-
buter par des modications du vécu
et des perceptions ainsi que par des
symptômes psychiques, somato-sen-
soriels, sensoriels (auditifs, visuels,
Une information de la SSN aux médecins généralistes, internistes et pédiatres
Thème principal : Épilepsie
Crises partielles complexes .....................................................................1
Les possibilités thérapeutiques ...............................................................2
Diagnostic différentiel ..............................................................................2
Les assurances .........................................................................................3
Risques liés aux crises épileptiques ........................................................4
Pharmanews .............................................................................................4
Épilepsie
Auteurs de ce numéro :
Dr. Klaus Meyer, Neurorehabilitation, Parkinson-
Zentrum, Epileptologie, Klinik Bethesda Tschugg,
3233 Tschugg BE; Dr. Stephan Rüegg, Abteilung
für klinische Neurophysiologie, Neurologische
Klinik, Universitätsspital Basel, Petersgraben 4
4031 Basel
10.1
Klaus Meyer, Stephan Rüegg
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’épilepsie, qui est la deuxième af-
fection la plus fréquente du système
nerveux central, doit être différen-
ciée d’autres maladies internes,
neurologiques et psychiatriques an
d’éviter toute erreur de diagnostic.
En cas de crises partielles comple-
xes, il est essentiel de tenir compte
de la sémiologie des crises pour
évaluer les risques au quotidien et
choisir le traitement approprié. Par-
ticulièrement dans les épilepsies
pharmaco-résistantes, les aspects
sociaux doivent être pris en compte
à côté des aspects médicaux. A cet
effet, le soutien des institutions et
des assurances peut revêtir une im-
portance toute particulière
Dr Klaus Meyer
Dr Stephan Rüegg
olfactifs, vertigineux), autonomes et
moteurs. Elles peuvent ensuite évo-
luer vers une crise généralisée to-
nico-clonique, encore appelée « grand
mal ». La plupart des crises de grand
mal se manifestant à l’âge adulte ont
un point de départ focal. Lors des
crises temporales, qui sont les plus
fréquentes, le patient est dans un état
de confusion, le plus souvent amné-
sique, mais il n’est pas inconscient.
Il peut être sujet à des automatismes
gestuels simples comme lécher, mâ-
cher bruyamment, avaler, mastiquer
ou encore toucher, pincer et frotter.
Parfois, le patient peut faire des ges-
tes pseudo-ordonnés. L’expression
du visage est gée ou laisse paraître
des sensations d’angoisse, de peur,
de douleur ou de béatitude. Le patient
peut également présenter des symp-
tômes végétatifs associés tels que la
chair de poule, une transpiration ex-
cessive, une hypersalivation ou une
augmentation de la fréquence cardia-
que. Les crises latéro-temporales,
en plus des symptômes mentionnés
ci-dessus qui sont typiques en cas
de point de départ mésio-temporal,
débutent souvent par des manifes-
tations dysphasiques, sensorielles,
auditives, optiques ou vertigineuses.
Par contraste, les crises frontales
débutent et se terminent de façon
brusque et ont généralement une
durée plus courte, inférieure à 30 se-
Société Suisse
de Neurologie (SSN)
Sommaire

210.1
condes. Sur le plan moteur, ces crises
comportent davantage de composan-
tes toniques (stéréotypies posturales
en partie bilatérales), des clonies ainsi
que des mouvements plus étranges et
parfois théâtraux (gigotements répé-
titifs de jambes, bodyrocking, applau-
dissements, position d’escrime). Parmi
les symptômes psychiques gurent la
peur et une hypermotricité affective
(diagnostic différentiel voir tab. 4 sur
www.neurology.ch). Les absences
d’origine fronto-polaire, caractérisées
par une brève perte de conscience et
éventuellement par des symptômes
moteurs discrets, peuvent unique-
ment être différenciées des absences
généralisées classiques (pointes-on-
des à 3/s) au moyen de l’EEG. Certai-
nes crises frontales surviennent prin-
cipalement la nuit. Dans ce cas, des
phénomènes toniques discrets avec
réveils ou symptômes plus complexes
de parasomnie peuvent survenir. Pour
le diagnostic différentiel, un enregis-
trement vidéo-EEG nocturne peut être
indiqué (tab. 3 sur www.neurology.ch).
Dans les crises pariétales ou occipi-
tales, qui sont beaucoup plus rares,
les symptômes somato-sensoriels et
visuels sont prédominants. En raison
de la propagation de l’activité épilep-
tique au cours de la crise, les symptô-
mes localisés typiques peuvent s’en-
tremêler. Pour cette raison, le début
de la crise est très important. Sur le
plan neurologique, il convient de pré-
ciser le syndrome épileptique, ce qui
est essentiel pour le pronostic et le
traitement des crises partielles.
Les possibilités
thérapeutiques
Plus de 20 antiépileptiques sont dis-
ponibles, chacun d’entre eux pouvant
théoriquement conduire à une dégra-
dation des crises. Néanmoins, ce cas
de gure est nettement plus rare en
cas de crises partielles par rapport à
la décompensation des crises épilep-
tiques généralisées avec absences et
myoclonies. Il est impératif de tenir un
calendrier des crises (tab. 1). En effet,
en cas de pharmaco-résistance, la
chirurgie de résection devrait être
envisagée après 2 années de traite-
ment avec au moins deux antiépilep-
tiques. L’efcacité de l’intervention
chirurgicale peut être signicative-
ment supérieure à celle du traitement
médicamenteux, avec une disparition
des crises dans 80 % des cas versus
10 %, en cas d’épilepsie mésio-tem-
porale avec sclérose hippocampique
et symptômes épileptiques corres-
pondants, activité EEG épileptique et
diagnostic neuropsychologique. En
revanche, pour les crises partielles
complexes extra-temporales, le taux
de succès de la chirurgie est inférieur
à 60 %, même en cas de délimitation
préalable des foyers épileptogènes au
moyen de la stéréo-EEG, qui est une
technique diagnostique plus complè-
te et le plus souvent encore invasive.
Les effets cognitifs et antidépres-
seurs positifs de la stimulation du
nerf vague, qui est une intervention
extra-cérébrale, sont contrecarrés
par une disparition des crises unique-
ment dans moins de 10 % des cas et
par une réduction des crises de plus
de 50 % chez seulement env. 30-60 %
des patients. En raison de la stigma-
tisation sociale persistante des pro-
blèmes psychologiques et psychia-
triques, qui ne sont pas si rares, les
facteurs sociaux ont une importance
essentielle, particulièrement chez les
patients souffrant d’épilepsie résis-
tante aux traitements. Il est primor-
dial de savoir si le patient vit seul ou
avec sa famille, s’il est bien intégré, s’il
est exclu socialement ou s’il est déjà
placé dans une institution. De plus, si
le patient présente déjà une invalidité,
s’il est limité dans ses activités et s’il
est confronté à des problèmes et à
des situations conictuelles sur son
lieu de travail ou dans sa vie privée.
Le cas échéant, ces facteurs devraient
être approfondis avec le patient, ses
proches et d’autres spécialistes, voire
être clariés dans une unité d’épilep-
tologie avec des travailleurs sociaux,
des neuropsychologues et éventuelle-
ment des psychiatres.
Diagnostic différentiel
Comme il est rare de pouvoir obser-
ver les crises d’épilepsie en direct, le
diagnostic est généralement un pro-
cessus basé sur des indices, et notam-
ment sur les renseignements anam-
nestiques (par les témoins) ainsi que
sur l’examen clinique neurologique et
les examens instrumentaux supplé-
mentaires. Par ailleurs, il est essentiel
de connaître les diagnostics différen-
tiels et de savoir qu’environ un tiers
des patients référés dans un centre
en raison d’un diagnostic d’épilepsie
souffrent en fait d’une autre maladie.
Sur le plan épileptologique, il est tout
particulièrement indispensable au
cours du processus diagnostique d’ob-
tenir une anamnèse complète et able
(par les témoins) et de pratiquer un
enregistrement vidéo-EEG de longue
durée. Parmi les principaux diagnos-
tics différentiels possibles gurent la
syncope, l’hypoglycémie, les hyperki-
nésies paroxystiques (réactions dys-
toniques aiguës, myoclonies non épi-
leptiques, spasmes hémifaciaux, etc.),
les phénomènes associés au sommeil
(tels que les parasomnies, la cata-
plexie et les myoclonies d’endormis-
sement), les crises de migraine avec
aura, les accidents ischémiques tran-
sitoires, l’amnésie globale transitoire
et les crises dissociatives (« psychogè-
nes ») non épileptiques. Les syncopes
sont des évènements médicaux très
fréquents, caractérisés par une perte
de conscience et une perte du tonus
postural de courte durée. 40 à 65 %
de la population présentent des myo-
clonies ou des contractures toniques
brèves. Cette proportion s’est même
élevée à 90 % chez des volontaires
sains jeunes. En 2002, Sheldon et al.
Important en cas de cri-
ses partielles complexes
Anamnèse par le patient et toujours par
les témoins de la crise
Signes directs d’une crise d’épilepsie :
Symptômes subjectifs •
Manifestations motrices (clonies, •
phénomènes toniques, automatis-
mes de localisation latérale ?)
Signes indirects d’une crise d’épilepsie :
Lacunes dans l’anamnèse •
Pertes d’urine•
Morsures de la langue •
Le patient se retrouve dans des situ-•
ations inhabituelles et inexplicables
Symptômes post-critiques :
Confusion•
Aphasie pure•
Limitations cognitives spéciques•
Parésies•
Calendrier des crises able :
Consignation des facteurs déclen-•
chants et des effets indésirables
Tableau 1

3
10.1
ont publié un score simple basé sur
les indications anamnestiques, capa-
ble de différencier une syncope d’une
crise d’épilepsie avec une sensibilité et
une spécicité élevées (>90 %) (tab. 2).
La Figure 1 présente une comparaison
des autres manifestations cliniques
des deux affections. Les pertes de
conscience liées à une hypoglycémie
se caractérisent également par des si-
gnes prodromiques végétatifs et elles
surviennent exclusivement en cas de
glycémie équivalente à 1 mmol/l. Elles
sont presque uniquement possibles
en cas de diabète de type 1 clairement
connu ou d’erreur de dosage d’insuli-
ne. Pour les phénomènes associés au
sommeil, l’épilepsie doit principale-
ment être distinguée des parasomnies
non associées au sommeil paradoxal,
comme le somnambulisme, l’ivresse
du sommeil, les terreurs nocturnes, le
bruxisme, etc. Il faut notamment faire
la distinction avec les crises d’épilep-
sie frontale nocturne (hypermotricité).
L’échelle Frontal lobe epilepsy and pa-
rasomnia (FLEP) de Derry et al. peut
constituer une aide utile (tab. 3 sur
www.neurology.ch). Les auras des cri-
ses de migraine durent souvent plus
longtemps que les crises d’épilepsie,
elles sont suivies de céphalées unila-
térales typiques et les patients pré-
sentent généralement une anamnèse
de migraine. Les auras ophtalmiques
des patients migraineux sont caracté-
risées par des troubles visuels mono-
culaires, en noir et blanc, sous forme
de lignes (saccadées), alors que les
phénomènes optiques liés à l’épilepsie
sont majoritairement binoculaires (hé-
mianopsie), circulaires, colorés et sou-
vent distordus (métamorphospies).
Les accidents ischémiques transitoi-
res (AIT) sont fréquents chez les per-
sonnes âgées présentant des facteurs
de risque vasculaire et/ou cardiaque.
Tandis que les symptômes positifs
(clonies, paroles, etc.) sont rares dans
les AIT (type « limb shaking »), ils sont
fréquents lors des crises épileptiques.
A l’inverse, des symptômes néga-
tifs (paralysie, perte de la sensibilité,
aphasie, cécité) sont souvent présents
dans les AIT mais ils sont rares en cas
de crises épileptiques. Par contre, des
symptômes négatifs post-critiques
de type paralysie de Todd peuvent
survenir dans les crises épileptiques.
Des difcultés d’élocution se ren-
contrent dans les deux syndromes
(AIT : dysarthrie ; crise épileptique :
« speech arrest »). Les AIT ne sont
presque jamais associés à une perte
de conscience alors que les pertes de
conscience sont fréquentes lors des
crises partielles complexes. L’amné-
sie globale transitoire se distingue de
l’amnésie transitoire épileptique (ATE)
par la durée : le premier type d’am-
nésie devrait durer au moins 1 heure
(durée moyenne de 5-8 heures) tandis
que le deuxième type devrait durer au
max. 1 demi-heure (durée médiane de
90-120 sec.). Par ailleurs, pour poser
le diagnostic d’ATE, une épilepsie doit
déjà être connue. Les crises disso-
ciatives (psychogènes) non épilep-
tiques sont souvent très difciles
à différencier des véritables crises
épileptiques, surtout des crises fron-
tales. Les indications cliniques anam-
nestiques et l’observation exacte de
la crise (par Reuber) sont présentés
dans le tableau 4 (www.neurology.ch).
Pour le diagnostic différentiel, le rôle
primordial de la vidéo-EEG de longue
durée doit être souligné.
Les assurances
Jusqu’à l’âge de 20 ans, l’assurance-in-
validité reconnaît l’épilepsie congéni-
tale comme une inrmité congénitale
(n° 387) et prend en charge l’intégra-
lité des frais de traitement. Il en est de
même lorsque l’épilepsie se manifeste
uniquement au cours de l’enfance et
qu’aucune autre cause postnatale uni-
voque n’est présumée être à l’origine
de l’épilepsie. Le syndrome psycho-
organique (n° 404), le polyhandicap
(n° 390) et les légers troubles mo-
teurs cérébraux (n° 395) sont égale-
ment des inrmités congénitales.
Quant à l’allocation pour impotent,
l’Art. 9 LPGA stipule que les personnes
épileptiques ne sont pas considérées
comme impotentes malgré la surve-
nue de crises périodiques si elles ne
sont pas en permanence dépendantes
de l’aide d’un tiers. Ainsi, l’attribution
de cette allocation dépend des capaci-
tés fonctionnelles entre les crises. De
plus, l’assurance-invalidité prévoit des
prestations d’assistance sous forme
de supplément pour soins intenses
en cas d’épilepsie grave ainsi que des
prestations pour moyens auxiliaires
(comme les casques). Par ailleurs, les
personnes épileptiques souffrant de
confusion et ayant besoin d’assistance
reçoivent un billet d’accompagnement
pour les voyages en train. Pro Inrmis
et Pro Senectute peuvent apporter
leur soutien.
Tableau 2
Score basé sur l’anamnèse pour différencier
une crise épileptique d’une syncope cardiaque /
neuro-cardiogénique (adapté d’après Sheldon et al.)
Question Points (si « oui »)
Morsure de la langue après l’évènement ?
2
Impression de « déjà-vu » ou de « jamais vu » avant l’évènement ? 1
Stress émotionnel avant-coureur en rapport avec l’évènement ? 1
Observation par les témoins d’une rotation de la tête vers un
côté durant l’évènement ? 1
Observation par les témoins d’une absence de réaction suite à
une sollicitation verbale, d’une posture corporelle inhabituelle,
d’extrémités tremblantes, de pertes de mémoire après l’évène-
ment ? (si réponse « oui » uniquement à une des quatre ques-
tions, comptabilisation du point)
1
Observation par les témoins d’un état de confusion après l’évène-
ment ? 1
Vertiges croissants avant l’évènement ? -2
Sueurs avant l’évènement ? -2
Position assise ou debout prolongée immédiatement avant l’évène-
ment ? -2
Somme ≥1: crise d’épilepsie; somme <1: syncope neurocardiogénique/cardiaque

410.1
Pzer AG
Nouvelle indication de Lyrica (pré-
gabaline) : traitement du TAG
Le trouble anxieux généralisé (TAG) em-
poisonne la vie de beaucoup de person-
nes; c’est une maladie chronique et il faut
la prendre au sérieux
1
. Avoir en perma-
nence ce sentiment de peur réduit
considérablement la qualité de la vie et
inue sur le quotidien des malades com-
me sur celui de leurs proches
2-4
. Un trai-
tement du TAG avec LYRICA présente de
nombreux avantages :
• Réduction signicative des symptômes
de TAG par rapport à un placebo
5
• Réduction signicative des troubles du
sommeil des patients souffrant de TAG
6
• Manifestation de l’effet dès la première
semaine de traitement
5
Biogen-Dompé AG
Avonex
Depuis peu, AVONEX est aussi autorisé,
et admis par les caisses maladie, chez
les adolescents à partir de 12 ans. Des
données publiées indiquent que le prol
de sécurité chez l’adolescent entre 12
et 18 ans est similaire à celui observé
chez l’adulte. AVONEX est indiqué pour
le traitement de la sclérose en plaques
évoluant par poussées, pour ralentir la
progression de la maladie et diminuer la
fréquence des poussées. Chez les pa-
tients ayant présenté un seul épisode de
démyélinisation et dont le tomogramme
par RMN est suspect, AVONEX diminue
le risque de poussées.
Information professionnelle: www.neurology.ch
Literature : www.neurology.ch
Risques liés aux crises
épileptiques
Seul environ 1 % des personnes épi-
leptiques ont en 1 an un accident
du travail dû à une crise d’épilepsie,
ayant conduit à un arrêt maladie de
longue durée. Par ailleurs, ces person-
nes n’ont pas plus d’accidents du tra-
vail que la population générale (Bethel
1996). En fonction du degré d’altéra-
tion de la conscience, de motricité
volontaire et le cas échéant, de perte
posturale, il existe cinq catégories de
risques (www.ligaepilepsie.org/FAQs/
misc/1999_S112-123.pdf). Ainsi, il faut
partir du principe que pour la catégorie
de risque D, qui est la plus élevée, les
actions ou mouvements complexes in-
contrôlés, le plus souvent sans rapport
avec la situation, peuvent même don-
ner lieu à de nouvelles situations à
risque, qui peuvent menacer d’autres
employés. Le cas échéant, la sémio-
logie des crises doit être décrite en
détails et il est nécessaire de faire in-
tervenir la SUVA pour une évaluation
et une adaptation du lieu de travail.
Par ailleurs, il convient de remarquer
qu’une crise épileptique survenant
pendant les heures de travail ne
constitue pas un accident du travail.
Un recours de l’assurance-accidents
contre l’employeur ou des collègues
de travail est donc uniquement pos-
sible si ces personnes ont provoqué
l’accident de travail intentionnelle-
ment ou suite à une négligence. Les
activités sportives sont en général à
recommander aux personnes épilep-
tiques en raison de leurs effets posi-
tifs sur les crises. En cas d’épilepsie
active, les sports de vol et de tir ainsi
que la plongée ne sont généralement
pas conseillés. Pour les sports nau-
tiques et les sports de montagne, le
ski dans des zones dangereuses et le
cyclisme sur des routes très fréquen-
tées, la situation individuelle des pa-
tients doit être prise en compte et il
est judicieux de se référer aux direc-
tives suisses relatives au permis de
conduire (www.epi.ch).
L’aptitude au vol des personnes épi-
leptiques dépend du type de crises.
Des attestations doivent stipuler les
interventions spéciques éventuel-
lement requises et les médicaments
emportés. En cas de risque particuli-
èrement élevé, la présence d’un ac-
compagnateur ayant une formation
en soins inrmiers peut être deman-
dée. En cas de voyages dans des pays
où le décalage horaire est important,
la prise d’un somnifère (par ex. benzo-
diazépine) peut être utile. Par ailleurs,
il est recommandé d’augmenter
proportionnellement la dose des
médicaments lorsque la journée de
voyage est prolongée et de la réduire
lorsqu’elle est raccourcie.
Cardiaque Épileptique
< 30 Sek.
Pâleur• Bradycardie / ab-• sence de pouls
Hypotension• Clonies asymét-• riques, bilatérales,
de courte durée
Pas / peu de • confusion
Pas / peu d’am-• nésie
Coloration rougeâtre/• bleuâtre de la peau
Tachycardie• Hypertension• Clonies unilatérales/ • augmentation du
tonus
Morsure latérale de la • langue
Confusion prolongée• Amnésie plus longue• Mydriase•
Sensation de chaleur • croissante
Nausées• Pertes d’urines/selles• Hypersalivation• Sueurs•
Palpitations• Vomissements• Morsure à • l’extrémité de
la langue
Mousser• Nystagmus• Augmenta-• tion du tonus
>10 sec.
Clonies • symétriques,
rythmiques
jusqu'à 5 min. < 30 sec.
Figure 1
Edité en collaboration avec la Société Suisse de
Neurologie. Comité consultatif de rédaction :
Pr Dr C. Bassetti, Pr Dr Ch. Hess, Pr Dr L. Kappos,
Dr P. Myers, Pr Dr A. Schnider, Dr M. Wiederkehr ;
rédaction : S. Jambresic
Edition :
IMK Institut pour la médecine et la communication
SA, Münsterberg 1, 4001 Bâle, [email protected]
Parution : 5 x par an
ISSN 1661-4852 © IMK
Les noms de marque peuvent être protégés par le
droit des marques, même si l’indication correspon-
dante devait faire défaut. Aucune garantie n’est
donnée en ce qui concerne les indications relatives à
la posologie et à l’administration de médicaments.
Avec l’aimable soutien de
Biogen-Dompé AG , Merck Serono (division de Merck
(Suisse) SA), Pzer AG, UCB-Pharma AG.
Les sponsors n’exercent aucune inuence sur le
contenu de la publication. Ils peuvent faire paraître de
brefs communiqués sous la rubrique Pharmanews.
Edition n° 1, vol. 5, janvier 2010
Tous les textes publiés sous la rubrique Pharmanews sont des
afrmations émanant de l’industrie.
1
/
4
100%