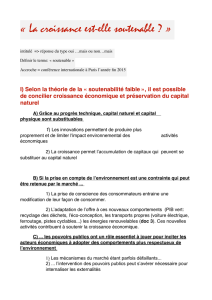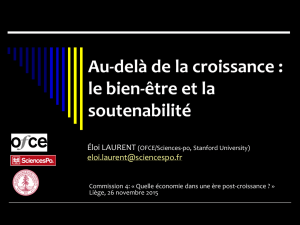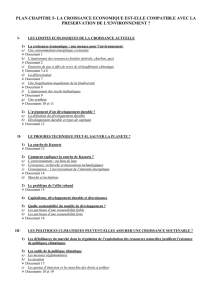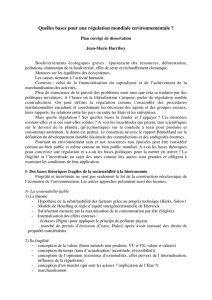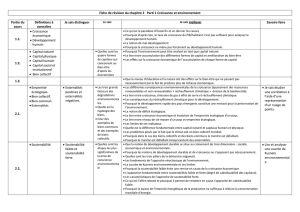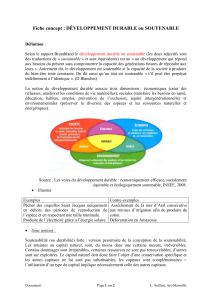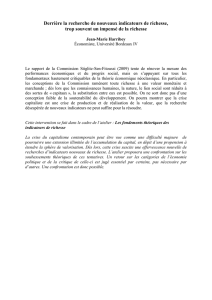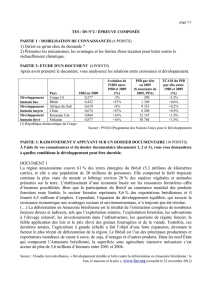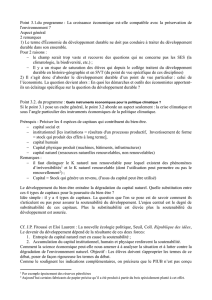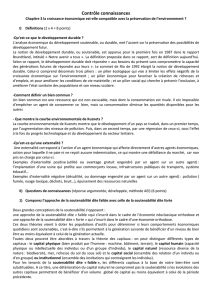Author: Jean-Marie Harribey Title: Passer d`un mode de

Author: Jean-Marie Harribey
Title: Passer d’un mode de développement productiviste à la soutenabilité : La
transition par le non marchand
Institution: MC Université Bordeaux IV
Country: France
Contact: [email protected]
Abstract:
Lorsque le concept de soutenabilité a fait irruption dans la communauté internationale,
tant scientifique que politique, il visait à inclure en son sein deux aspects : la soutenabilité
sociale pour assurer l’équité intra-générationnelle et la soutenabilité écologique pour garantir
l’équité inter-générationnelle. Malheureusement, le ver était dans le fruit, car le rapport
Brundtland, à côté de sa célèbre définition du développement soutenable, s’empressait
d’ajouter qu’une « croissance vigoureuse » – sous-entendu perpétuelle – était nécessaire
[1987, p. XXIII]. On le sait, aucune croissance économique n’est possible indéfiniment. Une
stratégie de soutenabilité véritable doit donc s’efforcer de rendre compatible les deux aspects
de la soutenabilité – l’aspect social et l’aspect écologique – en s’écartant progressivement du
recours à la croissance économique, dont il est avéré qu’elle ne peut ni réduire les inégalités
sociales ni résoudre la crise écologique.
La communication proposée ici vise à explorer une voie propre à amorcer la transition
du mode de développement actuel à la soutenabilité au sein des sociétés marquées d’un bout
à l’autre de la planète par le gaspillage et la dégradation impliqués par l’accumulation
capitaliste, par l’assimilation du bien-être à l’augmentation des quantités de marchandises
consommées quelle que soit leur qualité et par l’impossibilité pour les plus pauvres d’accéder
aux ressources les plus vitales comme la terre, l’eau ou les connaissances.
Puisque la dynamique impulsée par le capitalisme vise à étendre à l’ensemble des
activités humaines le champ de la marchandise, sous toutes les latitudes, quels que soient par
ailleurs les régimes politiques – libéraux ou étatiques, voire dictatoriaux –, qu’elle est en passe
d’atteindre son point ultime avec la mondialisation de l’économie, et que les améliorations
techniques ne compenseront vraisemblablement pas l’effet rebond, nous formulons l’hypothèse
suivante : si les activités non marchandes visant à répondre aux besoins sociaux de type
qualitatif (santé, éducation, culture notamment) ont une empreinte écologique en moyenne
inférieure à celle des activités marchandes à la fois industrielles et de services, il est possible
d’amorcer une transition soutenable par l’augmentation des unes et la diminution des autres.
Ce que nous appelons « démarchandisation » de la société, relative, puis absolue, est
susceptible, en tant que nouvelle dynamique, à la fois de faire progresser la justice sociale, ici
et partout, maintenant et demain, et de diminuer notre empreinte écologique. En effet, si l’on
ne concevait la réduction des inégalités sociales comme ne pouvant passer que par la
croissance des revenus individuels, il est à craindre que l’imaginaire de la consommation
marchande individuelle, favorisé par le mimétisme ambiant, ne l’emporte et que cela exige de
faire croître indéfiniment le « gâteau » sans s’interroger sur son contenu ni sur sa répartition.
Cela signifie que la réduction des inégalités peut passer davantage par l’accès universel aux
services non marchands que par celui de l’extension perpétuelle de la consommation
marchande.
Dans une optique de soutenabilité redéfinie autour de la démarchandisation, deux types
de travaux de recherche théorique et pratique sont à accomplir. Premièrement, au « travailler
plus » nous opposons le « travailler moins » au fur et à mesure que les besoins essentiels sont
satisfaits. Cela va dans le sens d’une certaine démarchandisation de la vie, à travers laquelle
peut être posée la question des finalités du travail et, par suite, celle de l’utilité sociale de la
production.
Deuxièmement, comme la démarchandisation implique de faire progresser les
prélèvements sociaux et écologiques au fur et à mesure de la prise en charge collective des
besoins essentiels de type qualitatif et du financement de la protection des biens communs de
l’humanité (eau, air, climat, etc.) ou de leur production (recherche, connaissances), il convient
d’élaborer une « économie politique » de la soutenabilité. Celle-ci doit être capable de faire
reculer l’idéologie selon laquelle toute activité non destinée au marché est contre-productive et
parasitaire. Au contraire, le travail consacré à produire du « bien » collectif, dans des cadres

spatiaux et institutionnels multiples et complémentaires (du local au global et de l’associatif à
la collectivité territoriale ou à l’Etat) est créateur d’authentiques « valeurs d’usage », sans
qu’elles soient des valeurs marchandes.
Nous insistons sur la nécessité impérieuse de penser la transition pour bifurquer du
productivisme à la soutenabilité. L’échec de la transition marque toutes les tentatives
révolutionnaires de transformation sociale du XXe siècle. Son impensé dans les réflexions
contemporaines hypothèquerait grandement l’avenir. A l’heure actuelle, la transition n’est
pensée dans l’idéologie libérale que comme celle devant nous mener au « capitalisme vert » ;
dans le discours officiel sur le « développement durable », elle est fondée sur l’hypothèse
irréaliste de substitution toujours possible de capital manufacturé au « capital naturel » ; dans
certaines thèses de la décroissance, la question de la transition est évitée au profit du refus
du développement. Pour notre part, en poursuivant notre réflexion [1997], nous essaierons
dans cette communication de donner corps à l’intuition de Nicholas Georgescu-Roegen qui
prenait bien soin de distinguer croissance et développement [1995, p. 104]. L’abandon du
mythe de la croissance infinie n’implique pas le rejet de tout progrès humain et de tout
développement. Au contraire, la possibilité de construire des droits universels à l’éducation, à
la santé, pour ne parler que de ceux-là, reste une voie ouverte pour l’humanité.
Références citées dans ce Abstract
Commission mondiale sur l’environnement et le développement [1987], Rapport
Brundtland, Notre avenir à tous, Montréal, Ed. du Fleuve.
Georgescu-Roegen N. [1979], La décroissance: Entropie-Ecologie-Economie, 2e éd. fr.,
Paris, Sang de la terre, 1995.
Harribey J.M. [1997], L’économie économe, Le développement soutenable par la
réduction du temps de travail, Paris, L’Harmattan.
1
/
2
100%