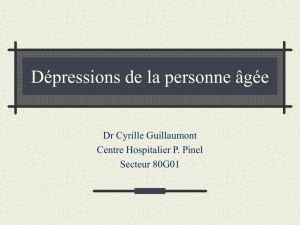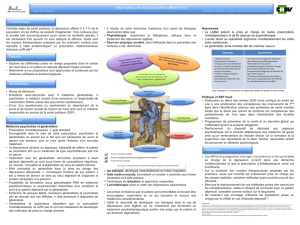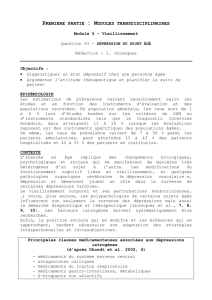Les dépressions sévères : quels concepts ? quels critères ?

© L’Encéphale, Paris, 2009. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2009) Supplément 7, S243–S249
Disponible en lignesur www.sciencedirect.com
journalhomepage: www.elsevier.com/locate/encep
Les dépressions sévères : quels concepts ?
quels critères ?
Severe depression : which concept ? which criteria ?
A. Pélissolo
Service de psychiatrie adulte et CNRS USR 3246, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47 bd de l’Hôpital, 75013 Paris
Résumé La dépression est une affection fréquente et considérée comme grave à l’échelon de la santé
publique, mais les cliniciens rencontrent des formes de sévérité très variable, avec des stratégies
thérapeutiques à adapter en fonction de cette variabilité. Il n’existe cependant pas de critères de
définition consensuels des dépressions sévères, et cette revue vise à présenter et à discuter les différentes
options possibles, qu’elles soient qualitatives ou quantitatives. Pour les classifications internationales, il
existe trois niveaux d’intensité des épisodes dépressifs majeurs (léger, moyen, sévère), définis avant tout
sur le nombre de critères diagnostiques repérés. On dispose par ailleurs de spécifications plutôt
qualitatives de gravité : présence de symptômes psychotiques, nature mélancolique de l’épisode,
présence de signes d’endogénécité. Un ralentissement psychomoteur marqué et le risque suicidaire font
partie des marqueurs cliniques principaux de gravité. Les échelles d’évaluation quantitatives de
l’intensité dépressive permettent par ailleurs de définir des seuils de gravité, par exemple pour des
études thérapeutiques. Ces seuils sont cependant encore mal définis, et varient d’une étude à l’autre.
Des échelles spécifiques d’intensité des dépressions mélancoliques ou du ralentissement dépressif
peuvent également être utilisées pour des travaux cliniques sur ces entités qui peuvent être considérées
comme centrales dans les concepts de dépression sévère. Au total, les critères d’inclusion de la plupart
des études portant sur les dépressions sévères combinent des éléments qualitatifs (jugement du clinicien)
et quantitatifs (score minimal à une échelle).
* Auteur correspondant.
E-mail : [email protected]
L’auteur a signalé des conits d’intérêts avec Lilly, Boehringer Ingelheim, Pierre Fabre, Lundbeck et Servier.
MOTS CLÉS
Classification ;
Dépression sévère ;
Échelles ;
Endogénécité ;
Mélancolie
KEYWORDS
Classification ;
Severe depression ;
Endogenecity ;
Melancholia ; Scales
Abstract Depression is a common disorder considered to be a serious public health problem although
clinicians encounter very different levels of severity and the treatment strategies are tailored according
to this variability. There are however no consensus criteria to define severe depression. This review
presents and discusses the different possible qualitative and quantitative options. In the international
classifications there are three levels of severity of episodes of major depression (mild, moderate,
severe), which are defined above all on the number of diagnostic criteria found. There are other more
qualitative severity factors : the presence of psychotic symptoms, melancholia and the presence of
endogenous signs. Pronounced psychomotor retardation and risk of suicide are amongst the main clinical
severity markers. Quantitative assessment scales for the severity of depression can also define severity
thresholds for use for example in clinical studies. These thresholds are still poorly defined and vary
between studies. Specific severity scales for melancholic depression or depression with psychomotor
retardation can also be used in clinical studies for these factors, which are central to the concept of
severe depression. Overall, the inclusion criteria for most studies combine severe depression with
qualitative (clinicians’ judgement) and quantitative (minimum score on a scale) aspects.

A. PélissoloS244
Introduction
Dans le monde médical, et de plus en plus dans le grand
public, la dépression est aujourd’hui considérée comme
une maladie à part entière. Les soignants et la société
reconnaissent ainsi aux patients concernés un statut de
« vrais » malades, avec notamment le droit à une prise en
charge adaptée. Cette réalité sociologique peut paraître
banale, mais elle n’existe pas encore avec la même évi-
dence pour d’autres troubles psychiatriques, comme cer-
tains troubles addictifs ou certains troubles anxieux.
La dépression est une vraie maladie, mais est-elle une
maladie grave ? Les études épidémiologiques et médico-
économiques placent la dépression parmi les affections les
plus lourdes en termes de santé publique, avec un impact
majeur sur l’espérance et/ou la qualité de vie [25]. Le coût
total de la dépression a été estimé aux États-Unis à au
moins 16 milliards de dollars par an [21]. Ces données,
encore peu connues, justient un effort constant des pou-
voirs publics pour améliorer le dépistage, les prises en
charge, les traitements et la recherche sur les troubles
dépressifs. Mais les chiffres élevés de morbidité, et même
de mortalité, sont des moyennes recueillies sur de grandes
populations, qui ne peuvent pas être transposées de la
même manière au plan individuel. Elles sont le reet des
deux aspects essentiels de l’épidémiologie de la dépres-
sion : une prévalence élevée dans la population générale
(environ 15 % dans la plupart des études), et un retentisse-
ment toujours signicatif mais extrême dans certaines for-
mes graves, du fait du risque suicidaire, de l’incapacité
professionnelle, des conséquences familiales, des compli-
cations psychiatriques et somatiques, etc. [1, 21].
Au plan individuel, les psychiatres doivent faire face à
une très grande variété de présentations et de types de
troubles de l’humeur. Pour les traiter, ils ont à leur disposi-
tion des stratégies éprouvées et efcaces, qui font de la
dépression une maladie curable, même si les difcultés de
l’art ne sont pas négligeables : relation thérapeutique et
compliance souvent délicates à établir, diagnostics parfois
complexes, choix des thérapeutiques toujours individuel et
souvent empirique, récidives fréquentes. Mais les problè-
mes cliniques et thérapeutiques les plus complexes sont
concentrés sur un sous-groupe de patients nettement plus
difciles à soigner que la moyenne. Ce sont ces patients qui
vont nécessiter des suivis rapprochés, des consultations lon-
gues, des prises en charge sur des mois voire des années, le
recours à des stratégies thérapeutiques plus complètes
(associations médicamenteuses, combinaison chimiothéra-
pie-psychothérapie, sismothérapie, etc.), et parfois des
arrêts de travail, des hospitalisations, et des aides matériel-
les et sociales lourdes. Une partie importante de la recher-
che thérapeutique est consacrée à ces formes de dépressions
graves et souvent réfractaires aux traitements usuels.
Or, les repères théoriques et les outils pratiques d’iden-
tication des dépressions graves restent peu consensuels.
Naturellement, deux praticiens peuvent s’entendre pour
dénir l’état de gravité d’un même patient, mais ce juge-
ment est porté sur des bases avant tout subjectives, difci-
les à standardiser et à généraliser. Il s’agit bien sûr d’une
problématique classique en psychiatrie, notamment au
plan du pronostic. Alors que des scores prédictifs assez pré-
cis et opérationnels ont pu être dénis dans de nombreuses
spécialités, comme par exemple les facteurs de risque
coronariens, de déséquilibre d’un diabète ou d’avancement
d’un cancer, il n’existe quasiment pas d’indices de ce type
pour les pathologies psychiatriques.
Le tableau 1 résume les différents éléments pouvant
être pris en compte dans la dénition et/ou la caractérisa-
tion des dépressions graves ou, plus largement, des dépres-
sions que l’on pourrait qualier de « difciles ». On y voit
Tableau 1 Modalités de dénitions des dépressions sévères ou difciles
Éléments pris en compte Caractérisation de formes sévères ou difciles
Éléments cliniques actuels – Intensité des symptômes dépressifs (nombre de symptômes, échelles d’intensité…)
– Présence et/ou intensité de syndromes spéciques (mélancolie, endogénécité,
symptômes psychotiques, etc.)
– Intensité du risque suicidaire
– Intensité des troubles associés (anxiété, addiction, etc.)
– Refus de soins ou coopération insufsante
– Nécessité d’une hospitalisation
Éléments cliniques longitudinaux – Chronicité
– Résistance aux traitements
– Récurrence élevée
– Bipolarité
– Troubles de la personnalité
– Autres comorbidités psychiatriques
Autres facteurs – Stress psycho-sociaux intenses et durables
– Comorbidités somatiques
– Ages extrêmes (enfance et grand âge)
– Intolérance ou contre-indications aux traitements

Les dépressions sévères : quels concepts ? quels critères ? S245
clairement l’hétérogénéité de ces concepts. La plupart de
ces critères sont discutables et difciles à généraliser. Pour
exemple, le fait qu’une étude porte uniquement sur des
patients hospitalisés pourrait paraître un bon moyen, sim-
ple et pertinent, de garantir un recrutement de patients en
moyenne plus sévères. On sait cependant que ce critère est
soumis à de nombreux facteurs de variation, car les déci-
sions d’hospitalisation sont très différentes selon les pays,
les cultures, les régions, les organisations sanitaires et les
facteurs socio-économiques [15].
Les articles à suivre de cette revue porteront sur les
divers éclairages de la gravité des états dépressifs, de la cli-
nique à la thérapeutique, en passant par l’environnement et
la génétique. Dans cet article introductif, nous résumerons et
discuterons les repères objectifs disponibles pour caractéri-
ser la gravité d’un état dépressif, sur la base des classica-
tions internationales et des échelles d’évaluation. La majorité
des travaux développés sur le sujet l’ont été dans une pers-
pective de recherche thérapeutique : comment dénir un
état dépressif sévère pour étudier l’effet d’un traitement
spécique (médicament ou sismothérapie par exemple) ?
Dans la littérature internationale, le terme anglais severe est
alors le plus souvent utilisé, alors que les équivalents de
« grave » (serious) le sont nettement moins [15, 17].
La sévérité dans les classications
Pour le DSM IV-TR, l’épisode dépressif majeur (EDM) consti-
tue l’unité de base des troubles dépressifs [2]. Malgré l’em-
ploi de l’adjectif « majeur » comme traduction de major, le
diagnostic d’EDM correspond à un état dépressif caracté-
risé, sans préjuger de la sévérité de celui-ci. La présence de
cinq symptômes dépressifs sur une période de deux semai-
nes suft à qualier une dépression d’EDM, à condition que
ces symptômes « induisent une souffrance cliniquement
signicative ou une altération du fonctionnement social,
professionnel ou dans d’autres domaines importants » (cri-
tère C). Cette dénition laisse théoriquement place au
jugement clinique et subjectif du praticien pour xer le
seuil d’une souffrance « signicative » mais, dans la prati-
que, il est rare que des patients rapportent cinq symptômes
dépressifs simultanés sans n’en ressentir aucune gêne.
Une fois le diagnostic d’EDM vérié, plusieurs éléments
complémentaires permettent de rendre compte de sa sévé-
rité, de manière dimensionnelle surtout, même si certains
aspects qualitatifs peuvent être pris en compte [2]. La
spécication de sévérité comporte quatre niveaux : – léger,
– moyen, – sévère sans caractéristiques psychotiques, – sévère
avec caractéristiques psychotiques (Tableau 2). Elle repose
sur le nombre de symptômes présents, sur le degré de reten-
tissement fonctionnel, et sur la présence de symptômes psy-
chotiques pour le dernier niveau. Par ailleurs, il est possible
d’indiquer qu’un épisode dépressif est en rémission (partielle
ou complète), si les symptômes étaient présents dans le passé
mais ne sont plus sufsamment nombreux pour répondre aux
critères diagnostiques d’un EDM.
Dans le DSM IV-TR, d’autres spécications d’un EDM
peuvent reéter sa sévérité [2]. Il est possible tout d’abord
de spécier EDM « chronique », si les symptômes sont pré-
sents continuellement depuis au moins deux ans. Par
ailleurs, les caractéristiques catatoniques et mélancoliques
peuvent être appliquées, et marquent habituellement un
degré supplémentaire de sévérité, même si les dénitions
données ne correspondent pas exactement aux représenta-
tions de la clinique psychiatrique classique de la mélanco-
lie (Tableau 3). Les caractéristiques catatoniques peuvent
avoir comme conséquences une malnutrition, un épuise-
ment, une hyperthermie ou des automutilations, ce qui
représente à l’évidence des marqueurs de gravité clinique.
De même, le DSM IV-TR indique que les caractéristiques
mélancoliques sont moins fréquentes chez les patients non
hospitalisés et dans les EDM légers, et plus fréquentes
lorsqu’il existe des caractéristiques psychotiques et diver-
ses anomalies biologiques (non suppression du test à la
dexaméthasone, hypercorticisme, etc.). Il est également
mentionné que les caractéristiques mélancoliques répon-
dent le plus souvent aux traitements antidépresseurs ou
aux sismothérapies, et sont peu associées à des troubles de
la personnalité prémorbide, à des facteurs déclenchants
nets et à une réponse placebo.
Dans la CIM-10, la description de l’épisode dépressif est
très proche de celle de l’EDM du DSM IV-TR, et il existe
également trois niveaux de sévérité (léger, moyen, sévère)
selon le nombre et l’intensité des symptômes [18]. La dé-
Tableau 2 Niveaux de sévérité d’un épisode dépressif majeur dans le DSM IV-TR (APA, 2003)
Niveaux de sévérité Description
Léger – Au plus cinq ou six symptômes dépressifs
– Incapacité légère, ou capacité fonctionnelle normale mais au prix
d’efforts importants et inhabituels
Moyen Sévérité intermédiaire entre « légère » et « sévère »
Sévère sans caractéristiques psychotiques – Presque tous les symptômes correspondant aux critères de l’EDM
– Incapacité nette, observable (par exemple impossibilité de
travailler ou de prendre soin des enfants)
Sévère avec caractéristiques psychotiques – Présence d’idées délirantes ou d’hallucinations, congruentes ou non
à l’humeur

A. PélissoloS246
nition de l’épisode dépressif sévère sans symptômes psy-
chotiques insiste sur des symptômes marqués et pénibles
de perte de l’estime de soi et les idées d’auto-dévalorisa-
tion ou de culpabilité. Il est mentionné que les idées et les
gestes suicidaires sont fréquents, et que plusieurs symptô-
mes somatiques sont souvent présents.
L’originalité de cette classication est de dégager un
ensemble de symptômes dits somatiques, reétant une
composante plus biologique de la dépression : anhédonie,
réveil matinal précoce, aggravation matinale de la dépres-
sion, ralentissement psychomoteur important, agitation,
perte de poids et diminution de la libido.
L’épisode dépressif sévère avec symptômes psychoti-
ques doit comporter en plus des hallucinations, des idées
délirantes (congruentes ou non à l’humeur), un ralentisse-
ment psychomoteur ou une stupeur telle que les activités
sociales habituelles sont impossibles. Les risques vitaux liés
au suicide, à une déshydratation ou à une dénutrition sont
soulignés.
Dans l’ensemble, la dénition d’un noyau symptomati-
que mélancolique (ou somatique) semble permettre de
réduire l’hétérogénéité du concept d’épisode dépressif
majeur, avec la caractérisation de dépressions plus sévères
que la moyenne et partageant peut-être certains facteurs
étiopathogéniques et pronostiques. Certains auteurs, comme
Taylor et Fink [24], militent d’ailleurs pour la réintroduction
d’une catégorie spécique (mélancolie) dans les classica-
tions psychiatriques à venir. Cependant, les données empiri-
ques ne sont pas aujourd’hui sufsantes pour conrmer
toutes ces hypothèses, et les critères actuels de caractéris-
tiques mélancoliques peuvent être présents chez des patients
souffrant de dépressions d’intensité très différentes [15].
La sévérité d’après les échelles
dimensionnelles
Parmi les nombreuses échelles d’évaluation de la dépres-
sion, on peut considérer comme des références la MADRS
(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), la HDRS
(Hamilton Depression Rating Scale), et la BDI (Beck
Depression Inventory). Par principe, ces instruments mesu-
rent la dépression de manière dimensionnelle, avec comme
principal objectif une bonne sensibilité au changement
pour mesurer une amélioration symptomatique après trai-
tement. Leur construction repose sur l’hypothèse d’une
continuité linéaire de la sévérité, en tout cas dans la gamme
d’intensité habituelle des états dépressifs rencontrés en
clinique. Il ne s’agit pas de dénir des sous-types de dépres-
sion de manière qualitative, et jamais de poser directe-
ment un diagnostic.
La gamme des cotations de ces échelles est sufsam-
ment large pour rester discriminante même dans les niveaux
élevés de sévérité, et la plupart des échelles incluent des
items pouvant décrire des symptômes de dépression sévère.
Par exemple pour la MADRS, les cotations 6 des items de
difcultés de concentration (« Incapable de lire ou de
converser sans difculté »), de lassitude (« Grande lassi-
tude, incapable de faire quoi que ce soit sans aide »), ou
encore de pensées pessimistes (« Idées délirantes de ruine,
de remords ou péché inexpiable ; auto-accusations absur-
des ou inébranlables ») permettent de coter de manière
spécique les éléments d’un syndrome mélancolique.
Cependant, les échelles de dépression les plus couram-
ment utilisées, notamment la HDRS, présentent des quali-
tés psychométriques contestées, surtout en termes de
Tableau 3 Spécications des caractéristiques catatoniques et mélancoliques d’un épisode dépressif majeur dans le
DSM IV-TR (APA, 2003)
Spécications Description
EDM avec caractéristiques
catatoniques Au moins deux des éléments suivants :
– immobilité motrice se traduisant par une catalepsie ou un état de stupeur
– activité motrice excessive
– négativisme extrême ou mutisme
– mouvements involontaires bizarres se manifestant par l’adoption de postures,
de mouvements stéréotypés, d’un maniérisme ou d’une mimique grimaçante
prononcée
– écholalie ou échopraxie
EDM avec caractéristiques
mélancoliques Au moins un des éléments suivants :
– perte de plaisir pour toutes ou presque toutes les activités
– absence de réactivité aux stimuli habituellement agréables
Et au moins trois des éléments suivants :
– qualité particulière de l’humeur dépressive (ressentie comme qualitativement
différente du sentiment éprouvé après la mort d’un être cher)
– dépression régulièrement plus marquée le matin
– réveil matinal précoce
– agitation ou ralentissement psychomoteur marqué
– anorexie ou perte de poids signicative
– culpabilité excessive ou inappropriée

Les dépressions sévères : quels concepts ? quels critères ? S247
structure factorielle [3]. Pour palier à ce décit, des
auteurs comme Bech et Rafaelsen ont développé d’autres
outils, notamment une échelle de mélancolie susceptible
d’évaluer de manière plus spécique la dimension dépres-
sive [4]. Les travaux de validation de cette échelle restent
pourtant insufsants pour conrmer son intérêt par rapport
aux outils classiques.
Des scores-seuils sont proposés comme critères d’inclu-
sion dans les études, pour un syndrome dépressif classique
ou pour une dépression sévère (Tableau 4), mais ils sont en
général peu étayés de manière empirique, et laissent donc
une grande marge de choix aux utilisateurs [15, 17].
Tableau 4 Scores seuils des principales échelles
de dépression (Montgomery & Lecrubier, 1999 ;
Nemeroff, 2007)
Échelles Notes extrêmes Dépressions
légères Dépressions
sévères
MADRS 0 à 60 > 20 > 30 ou 34
HDRS-17 0 à 54 > 17 > 25 à 30
BDI-13 0 à 39 > 7 > 16
BRMS 0 à 44 > 5 > 15
En dehors de ces échelles mesurant la sévérité d’un
état dépressif de manière générale, quelques outils per-
mettent de cibler l’évaluation sur une dimension particu-
lière, reétant des symptômes que l’on peut considérer
comme de plus forte gravité. C’est le cas de l’échelle de
ralentissement dépressif (ERD) de Widlöcher, qui mesure
spéciquement les symptômes du ralentissement psycho-
moteur [26], considéré comme une dimension essentielle
des états dépressifs sévères et comme une cible privilégiée
des traitements antidépresseurs.
Il faut citer également les échelles de Newcastle, déve-
loppées dans l’idée de pouvoir poser des diagnostics étiolo-
giques des états dépressifs (endogènes versus réactionnels),
et d’aboutir à un score prédictif de réponse aux sismothé-
rapies [16]. Malgré quelques résultats empiriques satisfai-
sants, la validité de ce modèle et des outils proposés a été
souvent contestée, beaucoup d’études n’ayant pas conrmé
les hypothèses des auteurs.
Enn, une échelle a été mise au point pour poser un
diagnostic de mélancolie, chez des patients présentant un
EDM, et en évaluer l’intensité : l’échelle CORE de Parker
[19]. Les dimensions évaluées par cette échelle d’hétéro-
évaluation sont l’agitation, le ralentissement et la non-
interactivité. La construction de l’échelle CORE a été basée
sur l’hypothèse que ces signes sont plus spéciques du sous-
type mélancolique de dépression que les symptômes d’en-
dogénicité des classications ou de l’échelle de Newcastle.
Cette échelle de mélancolie a été validée par ses corréla-
tions avec des variables biologiques, thérapeutiques, envi-
ronnementales et psychologiques. Constituée de 18 items
cotés de 0 à 3, son score total varie donc entre 0 et 54, et
un score supérieur ou égal à 5 permet de poser un diagnos-
tic de mélancolie, notamment pour l’inclusion dans des
travaux de recherche. Une comparaison des échelles de
Widlöcher et de Parker est présentée dans le tableau V.
Les outils pré-cités ne sont que des propositions de
représentations de la notion de gravité, parfois très diffé-
rentes les unes des autres. Le caractère spectaculaire d’un
état mélancolique, au plus fort du ralentissement et de la
catatonie, n’a en fait pas de valeur pronostique absolue.
L’évolution peut en effet être très péjorative, notamment
en cas de passage l’acte suicidaire, mais elle peut aussi
être très favorable puisque ces états sont réputés répondre
particulièrement bien aux traitements biologiques.
A contrario, un état dépressif peu intense, sans caractéris-
tique mélancolique, dans un contexte de personnalité
pathologique par exemple, peut être insensible à toute
thérapeutique, se chroniciser et aboutir à un suicide. Les
travaux nosographiques et psychométriques réalisés jusqu’à
présent se heurtent à ces contradictions et à cette polysé-
mie des notions de gravité et de sévérité.
En marge de ces mesures symptomatiques, d’autres éva-
luations dimensionnelles peuvent rendre compte indirecte-
ment de la sévérité d’un trouble, comme les mesures de
retentissement général (Échelle Globale de Fonctionnement
du DSM IV-TR), d’adaptation sociale (échelle de Weissman)
et aussi de qualité de vie. Une étude récente a en effet
conrmé l’existence d’une corrélation forte entre sévérité
de l’état dépressif et altération de la qualité de vie, l’im-
pact des autres facteurs comme le soutien social et la sensa-
tion de stigmatisation s’avérant moins important [6].
Application des critères de sévérité
dans les études
Une rapide mise en perspective des critères de sévérité envi-
sagés ci-dessus montre qu’aucun de ceux-là ne semble suf-
sant et en tout cas valide dans l’absolu. Le choix de la
dénition doit donc se faire en fonction des objectifs xés,
de manière pragmatique, par exemple pour mesurer un
changement sous traitement (score élevé à une échelle d’in-
tensité), ou pour constituer un groupe homogène de malades
en vue d’une étude physiopathologique (critères de dépres-
sion avec symptômes psychotiques, ou avec mélancolie).
La littérature scientique récente illustre assez claire-
ment cette proposition, avec un choix très varié de critères
de dénition de la sévérité, et même souvent deux critères
complémentaires associés, l’un plutôt catégoriel, l’autre
plutôt dimensionnel. Ainsi, en examinant la méthodologie
des articles parus au cours des cinq dernières années com-
portant les termes severe depression dans le titre, on
trouve par exemple comme critères d’inclusion :
1. patients hospitalisés et scores supérieurs à 23 à
l’échelle BDI-21 (étude d’imagerie cérébrale du traitement
émotionnel) [10] ;
2. patients hospitalisés et sous-type mélancolique du
DSM IV (étude sur la mémoire procédurale) [22] ;
3. patients hospitalisés et scores supérieurs à 28 à
l’échelle BDI-21 (étude de stimulation magnétique trans-
crânienne) [7] ;
 6
6
 7
7
1
/
7
100%