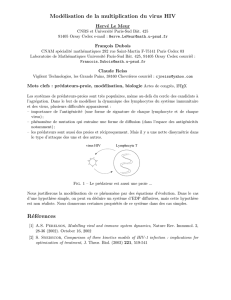Logique - Lancelot PECQUET

Lancelot Pecquet
Logique
(A∧B)`(A∧B)
(A∧B)`Bre∧·
ax (A∧B)`A∧B
(A∧B)`Are·∧
ax
(A∧B)`(B∧A)ri∧
Universit´e Paris XII, Licence d’Informatique
Version du 11 aoˆut 2003

La version originale de ce document est librement consultable en version ´electronique (.ps.gz)
sur http://www-rocq.inria.fr/~pecquet/pro/teach/teach.html. Celle-ci peut ´egalement ˆetre
librement copi´ee et imprim´ee. Tout commentaire constructif (de l’erreur typographique `a la grosse

Table des mati`eres
1 Introduction 7
1.1 Premiers ´el´ements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.1 Objectifs de ce document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.2 Qu’est-ce que la logique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Histoire de la Logique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 La Logique ailleurs qu’en Occident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2 L’antiquit´e gr`ecque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3 La scolastique m´edi´evale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4 L’´epoque moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.5 Contemporains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 Rappels 29
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1.1 Distinction entre langage et m´etalangage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1.2 Structuration du m´etalangage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2 Th´eorie na¨ıve des ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.1 Ensembles, relations, fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.2 Relations d’ordre et d’´equivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.3 Ensembles d´efinis par induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.4 Infini, cardinaux, ordinaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.5 Axiome du choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 Structures alg´ebriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4 Langages .......................................... 35
2.4.1 D´efinitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4.2 Probl`emes de d´ecision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.3 R`egles de r´e´ecriture et grammaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4.4 Syntaxe inductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4.5 S´emantique inductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.5 Fonctions bool´eennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.6 Logique des ordinateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6.1 Instructions conditionnelles des langages de programmation . . . . . . . . . . 40
2.6.2 Circuits bool´eens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3

TABLE DES MATI `
ERES TABLE DES MATI `
ERES
3 Logique propositionnelle 41
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Langages des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2.1 Syntaxe du langage de Kleene .......................... 41
3.2.2 S´emantique bool´eenne du langage de Kleene .................. 42
3.2.3 Sous-langages ´equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.4 Formes normales conjonctives et disjonctives . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2.5 Expressivit´e bool´eenne du langage des propositions . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3 Arbres de Beth ...................................... 45
3.4 Preuves ........................................... 46
3.4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.4.2 D´eduction naturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5 Compl´etude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.6 Compacit´e.......................................... 49
3.6.1 D´efinitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.6.2 Th´eor`eme de compacit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4 Logique du premier ordre 51
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2 Syntaxe ........................................... 51
4.2.1 Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2.2 Sous-formules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2.3 Variables libres, li´ees, α-´equivalence, renommage . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.4 Substitutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.5 Preuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2.6 Validit´e des preuves apr`es substitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.3 S´emantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.3.1 Interpr´etations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.3.2 Morphismes d’interpr´etations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.4 Formes normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.4.1 Mise sous forme pr´enexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.5 Th´eories........................................... 60
4.5.1 D´efinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.5.2 Propri´et´es syntaxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6 Th´eor`eme de compl´etude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6.2 Th´eor`eme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6.3 Corollaires : les th´eor`emes de L¨
owenheim et Skolem ............. 61
4.6.4 Corollaire : le th´eor`eme de compacit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.6.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5 Exemples de th´eories 63
5.1 Th´eorie de l’´egalit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 Th´eorie des groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.3 Th´eories arithm´etiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3.1 Axiomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4Lancelot Pecquet, Universit´e Paris XII
Licences d’Informatique et de Math´ematiques / Logique
Version du 11 aoˆut 2003

TABLE DES MATI `
ERES TABLE DES MATI `
ERES
5.3.2 Propri´et´es arithm´etiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.4 Th´eorie ZF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.4.2 Th´eorie de Zermelo-Fraenkel ......................... 66
5.4.3 L’Axiome du choix et l’Hypoth`ese du continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.5 Th´eor`emes d’incompl´etude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.5.2 Th´eor`eme d’ind´ecidabilit´e de G¨
odel de l’arithm´etique ´el´ementaire . . . . . . 70
5.5.3 Premier Th´eor`eme d’incompl´etude de G¨
odel .................. 70
5.5.4 Second Th´eor`eme d’incompl´etude de G¨
odel .................. 71
5.5.5 Suites de Goodstein ............................... 71
6 Effectivit´e 73
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.2 Test de satisfaisabilit´e de Herbrand ........................... 73
6.2.1 Skolemisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.2.2 Unification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.2.3 Algorithme de r´esolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.2.4 Test de satisfaisabilit´e de Herbrand ...................... 79
7 Conclusion 81
7.1 Logiques d’ordre sup´erieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2 Logiques non-classiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2.1 Logiques modales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2.2 Logiques intuitionnistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2.3 Logiques multivalentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.3 Pourfinir .......................................... 82
Lancelot Pecquet, Universit´e Paris XII
Licences d’Informatique et de Math´ematiques / Logique
Version du 11 aoˆut 2003
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
1
/
83
100%