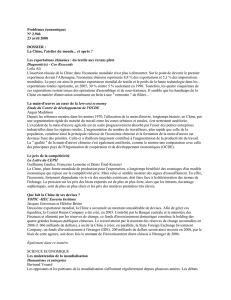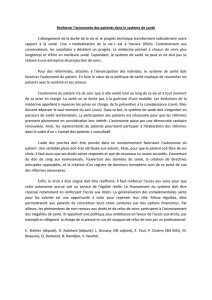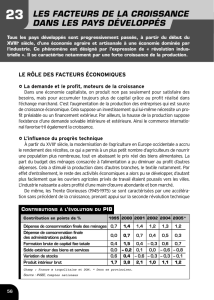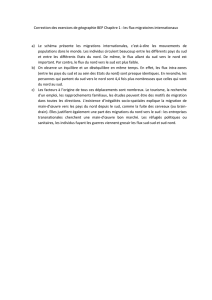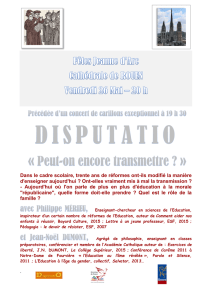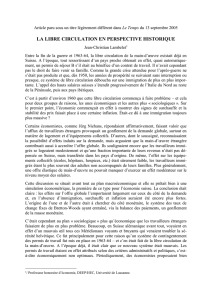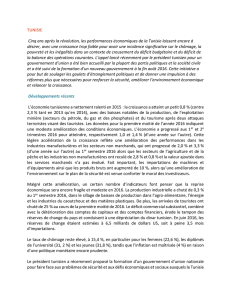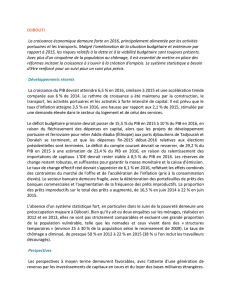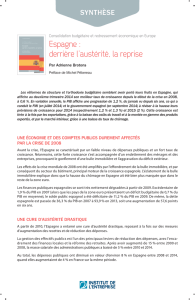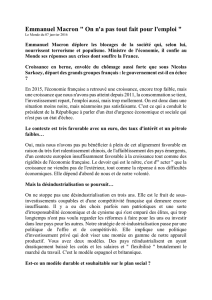Le processus de croissance à long terme de la Chine et ses

5REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005
Le processus de croissance à long
terme de la Chine et ses retombées
sur le Canada
Michael Francis, François Painchaud et Sylvie Morin, département des Relations
internationales
• Au cours des 25 dernières années, la progression
remarquable du produit intérieur brut (PIB)dela
Chine et l’intégration de ce pays à l’économie
mondiale ont eu des répercussions énormes et
ont alimenté de vives discussions au sein de la
communauté internationale.
• Une analyse des déterminants de la croissance en
Chine donne à penser que la hausse rapide de
l’activité dans ce pays se poursuivra et, par
conséquent, le poids de ce pays sur la scène
économique mondiale devrait s’accroître. Dans
un avenir prévisible, quatre grandes sources de
productivité stimuleront l’essor de la Chine : la
poursuite du déplacement de la main-d’œuvre du
secteur agricole à celui de la fabrication, des gains
d’efficience dans l’affectation du capital, les
réformes institutionnelles et les nouvelles règles
du commerce.
• L’intégration de la Chine à l’économie
internationale pose des défis aux décideurs,
dans ce pays comme ailleurs, et implique des
transformations structurelles. Néanmoins, pour
le Canada et le reste du monde, les avantages nets
devraient se révéler substantiels. Certes, la
concurrence à laquelle font face certains produits
canadiens à forte intensité de main-d’œuvre
est susceptible de s’accentuer, mais le Canada
devrait profiter de la demande grandissante de
la Chine à l’égard des produits de base et des
produits et services caractérisés par un coefficient
élevé de compétence.
e poids croissant de la Chine comme puissance
économique a attiré l’attention de la commu-
nauté internationale ces dernières années et
attisé les débats. Ceux-ci ont porté en
particulier sur le régime de change de la Chine, les
énormes réserves de change qui s’y accumulent, la
probabilité que l’économie chinoise connaisse un
atterrissage brutal et les conséquences qu’aurait un
ralentissement notable de l’expansion dans ce pays.
Les discussions font ressortir l’ampleur des retombées
qu’a déjà l’intégration de la Chine sur l’économie
d’autres pays, dont le Canada. On peut s’attendre
à ce que les échanges de vues se multiplient au fur et
à mesure que se précipitera l’accession de plus de
1,3 milliard de personnes (environ 20 % de la population
du globe) à l’économie mondiale et que ce phénomène
continuera de se répercuter sur le commerce inter-
national, les flux de capitaux et l’emploi, en Chine et
ailleurs dans le monde.
L’évolution de la Chine sur les plans économique,
social et politique présente un intérêt particulier pour
le Canada. Dans un contexte de mondialisation
économique, la Chine constitue un nouveau marché
prometteur pour les entreprises canadiennes de certains
secteurs et un formidable concurrent pour celles d’autres
secteurs. Les Canadiens peuvent s’attendre à ce que
les prix relatifs se ressentent de la poursuite de la
mondialisation des échanges commerciaux. Par
exemple, une croissance soutenue en Chine devrait
continuer à faire pression à la hausse sur les prix des
produits de base exportés comparativement à ceux
des produits manufacturés importés. De même, elle
pourrait faire monter le coût du capital au pays par
rapport à celui de la main-d’œuvre. Ainsi, que ce soit
L

6REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005
directement ou indirectement, l’économie canadienne
sera touchée1. Naturellement, les décideurs canadiens
suivent de près la suite des événements dans ce pays
d’Asie centrale.
L’émergence de la Chine ne constitue pourtant pas un
phénomène récent. Au cours des 25 dernières années,
par suite des nombreuses réformes amorcées à la fin
des années 1970, la Chine, qui était un pays à économie
planifiée, est graduellement devenue une « économie
de marché socialiste », capable de générer une croissance
économique robuste et durable. Reconnaissant les
limites d’une planification centralisée, les autorités
chinoises ont exploité de plus en plus les incitatifs
découlant de la logique de marché pour stimuler la
réaffectation des ressources entre les secteurs et les
régions.
Entre 1979 et 2003, l’économie
chinoise s’est accrue d’environ 9 %
en moyenne par année, soit trois
points de pourcentage de plus
annuellement qu’avant la période des
réformes.
Cette stratégie a donné des résultats remarquables.
Entre 1979 et 2003, l’économie chinoise s’est accrue
d’environ 9 % en moyenne par année, soit trois points
de pourcentage de plus annuellement qu’avant la
période des réformes. Parallèlement, durant cette
période, le Canada a affiché un taux de croissance
annuel moyen de quelque 2,9 %2. Des études empiriques
1. Cette influence se fera sentir non seulement par le truchement des
échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays, mais aussi par celui
des variations des prix des marchandises dont le Canada fait le commerce
avec d’autres pays, comme les États-Unis. Ce principe s’applique à toutes les
économies faisant du commerce extérieur. C’est pourquoi on peut s’attendre
de plus en plus à ce que les banques centrales surveillent étroitement les
chocs venant de Chine (par exemple, l’incidence sur les prix des produits de
base) qui sont susceptibles d’influencer leur économie nationale, plus particu-
lièrement les prix. Toutefois, dans l’ensemble, l’établissement de cibles en
matière d’inflation dans un régime de changes flexibles s’est avéré apte à
maintenir les taux d’inflation près des niveaux souhaités, malgré d’amples
fluctuations des prix relatifs.
2. Il convient de souligner le scepticisme considérable et très répandu que
suscitent les statistiques officielles publiées par la Chine relativement à son
PIB. Ainsi, Young (2000) fait valoir que le recours à des indices implicites des
prix du PIB plus appropriés réduit la croissance annuelle du secteur chinois de
la fabrication, pour la période allant de 1978 à 1998, à 6,1 %, alors qu’elle est
officiellement estimée à 7,8 %.
ont montré que, dans une large mesure, l’accélération
de la croissance économique en Chine reflète une
meilleure répartition des ressources au sein de l’écono-
mie, elle-même attribuable aux réformes. En 1980, la
Chine se classait neuvième dans le monde pour ce qui
est du produit intérieur brut (PIB), selon une mesure
utilisant des taux de change définis en fonction de la
parité des pouvoirs d’achat3. Aujourd’hui, elle occupe
le deuxième rang, derrière les États-Unis. Le bond de
l’activité économique s’est traduit pour le peuple
chinois par d’énormes avantages sociaux et écono-
miques, tirant environ 400 millions de personnes hors
de la pauvreté.
Malgré ces améliorations marquées du niveau de
l’activité économique réelle, la Chine demeure un
pays à faible revenu par habitant. En 2002, par exemple,
le revenu réel par personne s’établissait dans ce pays à
4 534 $ É.-U., soit 15 % de ce qu’il était au Canada4.
Suivant certaines hypothèses, les niveaux de revenu
par habitant des pays pauvres finissent théoriquement
par rattraper ceux des pays riches, ce qui signifie que
la croissance de l’activité en Chine devrait demeurer
plus rapide qu’au Canada. Cependant, pour que la
convergence se poursuive au rythme actuel, des
réformes additionnelles seront nécessaires.
Le présent article a pour objet d’analyser les moteurs
de la croissance de l’économie chinoise et les réper-
cussions que celle-ci aura sur le Canada. Les études
sur le sujet donnent à penser que les facteurs alimentant
cette expansion se maintiendront probablement pendant
un certain temps encore et que de nouvelles réformes
viendront soutenir le mouvement. Notamment, il
ressort des données empiriques examinées ici que les
incitatifs créés par le jeu des forces du marché ont
engendré une meilleure répartition des ressources
(notamment une migration de la main-d’œuvre du
secteur agricole à celui de la fabrication), ce qui a
donné lieu à des gains substantiels de la productivité
et de la croissance. À mesure que la poursuite de la
libéralisation des échanges commerciaux favorisera
d’autres réformes et réaffectations des ressources,
l’incidence du processus se fera de plus en plus sentir
à l’étranger. Le Canada pourrait devoir affronter une
concurrence accrue dans les secteurs à forte intensité
3. Les taux de change définis en fonction de la parité des pouvoirs d’achat
autorisent les comparaisons entre pays. En vertu de ces taux de change, une
unité d’une devise donnée (habituellement le dollar américain) permet
d’acheter sensiblement le même lot de marchandises dans tous les pays.
4. Ces chiffres sont calculés suivant les taux de change définis en fonction de
la parité des pouvoirs d’achat, en utilisant l’an 2000 comme année de base
(FMI, 2004).

7REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005
de main-d’œuvre, laquelle exercera une pression à la
baisse sur les salaires des ouvriers non qualifiés. En
revanche, la croissance de la Chine stimulera vraisem-
blablement la demande de produits de base et de
biens à coefficient élevé de compétence, pour lesquels
le Canada possède un avantage comparatif. De plus,
les consommateurs canadiens tireront avantage des
bas prix des biens et services importés de Chine.
Le processus de croissance
Un cadre de mesure de la croissance
La théorie néoclassique de la croissance offre une
méthode empirique5 permettant de déterminer les
principaux facteurs auxquels la Chine doit sa croissance
passée et d’évaluer son potentiel futur. Dans ce cadre,
la croissance peut être décomposée en trois éléments :
la main-d’œuvre, le capital et le progrès technique
(c’est-à-dire les modifications de l’efficience grâce
auxquelles le capital et la main-d’œuvre s’allient pour
produire un résultat). En partant de la fonction de
production néoclassique et en adoptant la notation et
les hypothèses habituelles, on peut aisément exprimer
la croissance de la production au moyen de la formule
suivante :
où les variables y,ket lreprésentent respectivement le
PIB, le capital et la main-d’œuvre. Ainsi, y correspond
au rythme d’expansion de l’économie, et les paramètres
αK et αL, aux parts respectives du PIB attribuables au
capital et à la main-d’œuvre. Les deux premiers
termes de droite expriment donc les composantes de
la progression du PIB imputables à l’augmentation du
capital et de la main-d’œuvre. Quant à r, il s’agit d’un
terme résiduel; il représente l’augmentation pro-
portionnelle de la progression qui aurait été constatée
si aucun des facteurs de production n’avait été
modifié, par exemple par l’adoption d’une nouvelle
technologie ou une meilleure affectation des ressources
en capital ou en main-d’œuvre entre les secteurs. C’est
ce qu’on appelle la croissance de la productivité totale
des facteurs (PTF). Alors que les études empiriques
permettent d’évaluer directement la contribution du
capital et de la main-d’œuvre à l’expansion, pour
mesurer la croissance de la PTF, il faut soustraire des
estimations de l’expansion du PIB les composantes qui
résultent de l’accumulation de facteurs.
5. La méthode de comptabilité de la croissance et l’analyse présentées ici se
fondent sur la contribution majeure de Solow (1956) et de Swan (1956) à la
théorie de la croissance.
yαKkαLlr++=
Plusieurs auteurs ont tenté de calculer la contribution
individuelle du capital, de la main-d’œuvre et de la
PTF à l’expansion de l’économie chinoise au cours des
trois dernières décennies (Tableau 1). Les résultats
qu’ils obtiennent donnent à penser que l’accumulation
du capital s’est taillé la part du lion à cet égard, aussi
bien avant que pendant les réformes, tandis que la
contribution de la main-d’œuvre a été modeste en
raison de la faiblesse du rendement marginal de cette
dernière. Cette constatation est fréquente au sein des
économies dotées d’une main-d’œuvre excédentaire.
Les calculs visant à évaluer la contribution de la PTF
aux gains de production en Chine donnent lieu à une
gamme de résultats relativement variés, en raison de
l’écart entre les différentes estimations de la part du
PIB attribuable à la main-d’œuvre. Quand l’estimation
de cette part est faible, celle du capital s’accroît, de
sorte que la contribution à la croissance de l’appro-
fondissement du capital s’en trouve amplifiée. Par
conséquent, une estimation réduite de la part du PIB
revenant à la main-d’œuvre donne lieu à une estimation
plus modeste de la croissance de la PTF. La plupart des
méthodes produisent, toutefois, des conclusions
similaires en ce qui concerne l’importance relative de
la contribution de chaque composante à la hausse de
la production avant et pendant les réformes. Il se
dégage de la littérature un consensus selon lequel
l’accumulation du capital et la progression de la main-
d’œuvre expliquent la presque totalité de l’expansion
de la Chine avant les réformes, la contribution de
la croissance de la PTF étant limitée ou négative
(Chow, 1993; Hu et Khan, 1996). En revanche, les études
montrent que les hausses de la croissance globale de la
PTF ont joué un rôle favorable et déterminant pendant
la période des réformes. Les estimations de l’apport
Taux de croissance (par année)
Production 5,8 9,3 9,4
Contribution à la croissance (en %)a
Capital physique 3,8 4,2 3,5
Main-d’œuvre 1,0 1,2 0,7
Capital humain 0,8
Productivité totale des facteurs 1,0 3,9 4,3
Tableau 1
Estimations des sources de croissance en Chine
Hu et Khan Banque mondiale
(1996) (1997)
1953- 1979- 1978-1995
1978 1994
a. Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas à la
somme des éléments.

8REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005
de cette croissance à l’augmentation de la production
varient grandement, se situant entre 2 et 5 points de
pourcentage par année, contre des estimations allant
de 3 à 6 points de pourcentage pour l’accumulation du
capital, et de 0,5 à 1,5 point pour la progression de la
main-d’œuvre. Par conséquent, puisque la hausse
annuelle du PIB s’établissait en moyenne à 6 % avant
les réformes économiques pour s’élever à 9 % pendant
celles-ci, il y a lieu de penser que la croissance de la
PTF est en majeure partie responsable de l’accéléra-
tion de l’avance de la production entre la période
précédant les réformes et celle de leur application.
Selon la plupart des études, le déplacement de la
main-d’œuvre hors du secteur agricole imputable aux
réformes a été déterminant dans l’accélération de
la croissance de la PTF (comme en témoignent les
conclusions de Heytens et Zebregs [2003], illustrées
au Tableau 2). Pour comprendre le rôle des réformes
dans ce processus, il convient de les examiner de
manière plus détaillée.
Les réformes
Les réformes économiques et institutionnelles qu’a
connues la Chine ont été réalisées en deux étapes
successives. Au cours de la première étape (1979-1993),
le principal objectif consistait à donner libre cours aux
effets bénéfiques des forces du marché en renforçant
les mesures incitatives à l’intention des agents
économiques tout en protégeant les intérêts acquis.
Les autorités chinoises y sont parvenues en décen-
tralisant progressivement le processus encadrant les
décisions d’ordre économique. Dans une tentative de
réduire les répercussions sociales des réformes, elles
ont mis à l’essai certaines d’entre elles à l’échelon
régional, pour étendre ensuite seulement celles qui
avaient été couronnées de succès. On peut donc
Productivité totale des
facteurs, donta: -0,53 2,78 2,11 2,81 2,30
Réforme structurelle 0,38 0,94 0,76 0,83 0,39
Déplacement de la
main-d’œuvre hors
du secteur primaire 2,34 2,01 1,52 2,15 2,08
Tendance exogène -3,25 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17
Tableau 2
Estimations des sources de croissance de la PTF
en Chine
Heytens et Zebregs (2003)
1971- 1979- 1985- 1990- 1995-
1978 1994 1989 1994 1998
a. Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas à la somme
des éléments.
qualifier de progressif et d’expérimental le processus
de réformes appliqué par la Chine.
La seconde étape (à compter de 1994) a été caractérisée
par l’instauration de mesures visant à accroître
l’efficacité des forces du marché. Ainsi, le régime de
faveur dont bénéficiaient certaines entreprises a été
atténué afin d’uniformiser les règles du jeu; le cadre
comptable des administrations publiques a été modifié
pour en augmenter la transparence; une autorité
monétaire centrale a été créée; les réformes des
entreprises d’État se sont poursuivies; les rudiments
d’un système de protection sociale ont été établis;
la question des droits de propriété a été examinée et,
récemment, un organisme indépendant de régle-
mentation des banques a été mis sur pied (Qian, 1999).
Les réformes dans le secteur agricole et le
marché du travail
Avant le processus de réformes, le secteur agricole
chinois était de type collectif, les autorités centrales
fixant les quotas de production et les prix. Ce système,
comme on pouvait s’y attendre, manquait passablement
d’efficacité. Par exemple, les travailleurs étaient
rémunérés en fonction de la production moyenne de
la collectivité, et non selon leur rendement marginal.
En outre, rien ne les incitait véritablement à migrer
vers d’autres secteurs où leur productivité marginale
aurait été meilleure. Reconnaissant les limites de cette
stratégie, les autorités ont créé, en 1979, le système de
responsabilité des ménages. Les fermiers pouvaient
désormais louer des terres à la collectivité en contre-
partie d’un quota de production fixe (dans les faits, un
impôt forfaitaire). Toute tranche de production
excédant le quota pouvait être vendue sur le marché,
de sorte que le système de rémunération reposait
dorénavant sur la productivité marginale. Cette
structure duale des prix initiait les travailleurs chinois
aux incitatifs associés au libre jeu des forces du marché.
La migration des fermiers au
rendement relativement faible vers
d’autres types d’emplois a été décisive
pour la croissance de la PTF.
D’une certaine manière, on peut également assimiler
l’institution du système de responsabilité des ménages à
une importante réforme du marché de l’emploi, du

9REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005
fait que ce système imposait une nouvelle appré-
ciation de la valeur du travail. Les travailleurs très
productifs voyaient la production et le revenu de leur
ferme augmenter, tandis que les moins productifs
étaient encouragés à chercher un emploi dans d’autres
secteurs. Les nouvelles mesures ont donc rehaussé la
productivitédela main-d’œuvredansle secteuragricole.
De surcroît, le redéploiement des travailleurs
relativement peu productifs dans des secteurs où
ils pouvaient obtenir de meilleurs résultats devait
entraîner un relèvement du niveau de productivité
global de l’économie, ou PTF. En théorie, cet enchaîne-
ment est censé engendrer un nivellement de la
productivité marginale de la main-d’œuvre dans tous
les secteurs. D’après Chow (1993), celle-ci se chiffrait
au début des réformes à 63 yuan dans le secteur
agricole, contre 1 027 yuan dans le secteur industriel.
On peut déduire de ces données qu’il y avait place
pour une redistribution considérable de la main-
d’œuvre au sein de l’économie chinoise. De fait,
Brooks et Ran (2003), parmi d’autres, constatent, après
la mise en œuvre des réformes, un déclin marqué de
l’emploi dans le secteur agricole, qui est passé de 70 %
à 50 % de l’emploi total selon des chiffres récents.
Heytens et Zebregs (2003) concluent que la migration
des fermiers au rendement relativement faible vers
d’autres types d’emplois a été décisive pour la croissance
de la PTF (Tableau 2). Woo (1998) et Young (2000)
soulignent aussi l’importance de la réaffectation de la
main-d’œuvre. Enfin, Brooks et Ran (2003) concluent
que le redéploiement est loin d’être terminé, étant
donné que le secteur agricole compte encore environ
150 millions de travailleurs excédentaires (soit environ
20 % du nombre total d’emplois).
Le secteur non agricole et non financier
Le secteur industriel de l’économie chinoise constituait
la destination naturelle des travailleurs abandonnant
l’agriculture. Afin de promouvoir une meilleure
répartition de la main-d’œuvre et du capital, les
autorités ont opéré trois réformes clés axées sur le
marché et destinées à influencer le secteur non
agricole. Premièrement, les entreprises d’État, dont le
coefficient de capital est généralement élevé, se sont
vu octroyer une plus grande autonomie sur plusieurs
plans : production, approvisionnement, marketing,
bénéfices non répartis, expérimentation de nouveaux
produits et investissements en capital (Chow, 2002).
En vertu d’un nouveau régime de responsabilité
contractuelle, les entreprises ont été autorisées
à rémunérer les travailleurs en fonction de leur
rendement. De plus, la structure duale des prix a
été étendue aux biens industriels. Enfin, tout en
conservant la propriété et la maîtrise des principales
industries, le gouvernement central a restreint ses
interventions sur l’économie en convertissant les
entreprises d’État déficitaires en sociétés par actions.
Parce que leur lien avec les ministères qui en étaient
responsables était affaibli, ces entreprises se sont vu
limiter l’accès aux recettes du gouvernement. On
pense généralement que ce resserrement des restrictions
budgétaires exercé à l’endroit des entreprises d’État,
de pair avec la décentralisation du processus décisionnel
en matière d’économie, a entraîné une meilleure
répartition interne des ressources; du coup, la
productivité marginale imputable au capital et à
la main-d’œuvre et la croissance de la PTF se sont
accrues6.
Deuxièmement, les autorités ont réussi à promouvoir
la croissance du secteur non public. Résultat, malgré
les réformes fondamentales dont les entreprises d’État
avaient fait l’objet, le secteur non public, dominé par
les entreprises de villes et de villages, a été le principal
moteur de la tenue exceptionnelle de l’économie
chinoise. Les entreprises de villes et de villages, bien
qu’appartenant techniquement à l’État, sont géné-
ralement associées au secteur non public, car la
capacité des gouvernements locaux et régionaux de
financer les pertes de ces entités est limitée. Elles
fonctionnent donc plutôt comme des entreprises
privées à but lucratif. En particulier, compte tenu des
restrictions budgétaires qui leur sont imposées, leur
demande de main-d’œuvre et de capital se fonde sur
leur productivité marginale. Ainsi, le transfert de
ressources au secteur non public (où le rendement est
vraisemblablement plus élevé) a donné lieu à une
meilleure répartition des ressources au sein de
l’économie dans son ensemble et a favorisé la
croissance de la PTF.
Troisièmement, la réduction des barrières à l’inves-
tissement direct étranger et l’établissement de zones
économiques ouvertes jouissant d’un régime plus
libéral en matière d’investissement et de commerce,
ainsi que d’incitatifs fiscaux spéciaux, ont créé un
débouché pour les produits manufacturés à forte
intensité de main-d’œuvre. En plus d’avoir contribué
aux forces qui attiraient la main-d’œuvre hors du
secteur agricole, ces politiques ont eu une influence
6. Tant que la productivité marginale de la main-d’œuvre et celle du capital
augmentent proportionnellement, les parts qui leur reviennent demeureront
stables, et la hausse de productivité découlant de cette réforme setraduira par
une accélélration de la croissance de la PTF. Chow et Li (1999) constatent que
les réformes n’ont pas modifié la part revenant à chaque facteur en Chine. Ils
appuient ainsi l’argument selon lequel le régime de responsabilité contrac-
tuelle a contribué à l’amélioration de la croissance de la PTF.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%