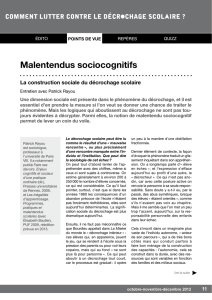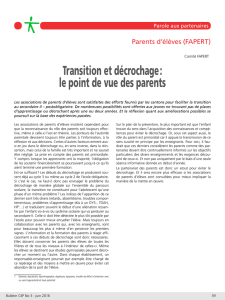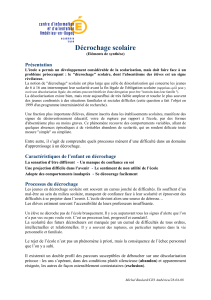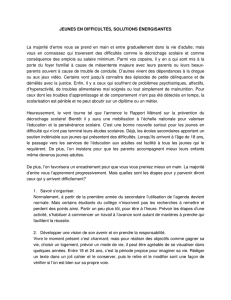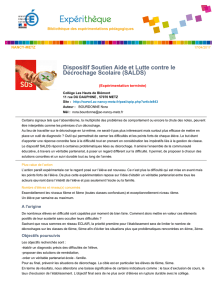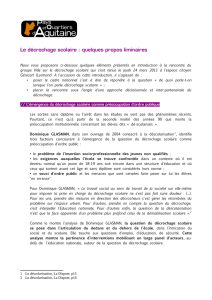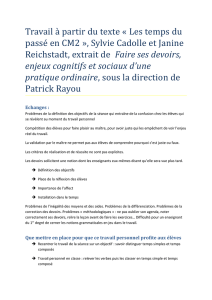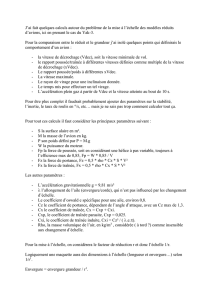Malentendus sociocognitifs, La construction sociale du décrochage

!
Malentendus* sociocognitifs,* La* construction* sociale* du* décrochage* scolaire,*
Entretien* avec* Patrick* Rayou,* Bulletin* de* la* ligue* de* l’enseignement,*
décembre*2012*p.11D13*
"#$! %&'$#(&)#! ()*&+,$! $(-! ./0($#-$! %+#(! ,$! .10#)'2#$! %3! %0*/)*1+4$5! $-! &,! $(-! $(($#-&$,! %6$#!
./$#%/$!,+!'$(3/$!(&!,6)#!7$3-!($!%)##$/!3#$!*1+#*$!%$!-/+&-$/!,$!.10#)'2#$8!9+&(!,$(!,)4&:3$(!:3&!
+;)3-&(($#-! +3! %0*/)*1+4$! #$! ()#-! .+(! -)3<)3/(! 07&%$#-$(! =! %0*/>.-$/8! ?+/'&! $,,$(5! ,+! #)-&)#! %$!
'+,$#-$#%3!()*&)*)4#&-&@!.$/'$-!%$!,$7$/!3#!*)&#!%3!7)&,$8!
?+-/&*A!B+>)3!$(-!()*&),)43$5!./)@$(($3/!=!,63#&7$/(&-0!%$!?+/&(!CDDD8!D,!+!#)-+''$#-!.3;,&0!Faire&ses&
devoirs.&Enjeux&&cognitifs&et&sociaux&&d’une&pratique&ordinaire!E%&/8F5!?/$(($(!3#&7$/(&-+&/$(!%$!B$##$(5!
GHHI5! $-! Les& Inégalités& & d’apprentissage.& Programmes,& & pratiques& et& malentendus& & scolaires!E+7$*!
J,&(+;$-1!K+3-&$/F5!?"L!GHHI5!/00%&-&)#!./073$!$#!GHMN8!
!"# $%&'(&)*+"# ,&(-*.'"# /"01# 21'"# -0# &(33"# -"# '%,0-1*1# $405"# 63*07*.,"# '"5&(51'"89# (0# /-0,#
/'%&.,%3"51#$405"#'"5&(51'"#3*5:0%"#"51'"#-4.5$.7.$0#"1#-4.5,1.101.(5;#<0"#/"01#$.'"#-*#,(&.(-(+."#
$"#&"1#%&)"&=!!
O#! .$3-! -)3-! %6+;)/%! -$#-$/! %$! ,6+../01$#%$/! +7$*! %$(! *1&@@/$(5! 'P'$! (&! *$3QR*&! ()#-! (3<$-(! =!
*)#-/)7$/($8!O#!$(-&'$!40#0/+,$'$#-!=!$#7&/)#!GHH!=!GSH!HHH!,$!#)';/$!%60,27$(!*)#*$/#0(5!*$!:3&!
$(-!*)#(&%0/+;,$8!T$!:36&,!@+3-!.)&#-$/5!(3/-)3-5!*6$(-!:3$!(&!%+#(!,$(!+##0$(!MIUH!,$(!*)#(0:3$#*$(!
%63#! +;+#%)#! ./0*)*$! %$! ,60*),$! #60-+&$#-! .+(! @)/*0'$#-! /0%1&;&-)&/$(5! $,,$(! ()#-! +3<)3/%613&!
%0-$/'&#+#-$(8!V+!(&4#&@&*+-&)#!()*&+,$!%3!%0*/)*1+4$!$(-!.,3(!%/+'+-&:3$!+3<)3/%613&8!W#(3&-$5!&,!#$!
@+3-!.+(!'0*)##+X-/$!*$!:3$!K)3/%&$3!+..$,+&-!%+#(!La&Misère&du&monde!,$!Y%0*/)*1+4$!&#-0/&$3/Z[!
*$(!0,27$(!:3&5!$#!+..+/$#*$5!<)3$#-!,$!<$35!:3&!($!/$#%$#-!=!,60*),$!()3(!,+!./$((&)#!%$(!.+/$#-(!)3!
.)3/!7)&/!,$3/(!*).+&#(5!'+&(!:3&!+3!@)#%!Y#$!()#-!.,3(!,=!.)3/!.$/()##$Z8!T$!:3&!.$3-!+;)3-&/!=!3#!
%0*/)*1+4$!-)3-!*)3/-5!*+/!,$!./)*$((3(!$(-!4/+%3$,[!&,!).2/$!3#!.$3!=!,+!'+#&2/$!%63#$!%&(-&,,+-&)#!
@/+*-&)##0$8!\$/#&$/! 0,0'$#-!%$!*)#-$Q-$5! ,+! @+])#!%607):3$/!,$! .10#)'2#$!-/+%3&-!3#! 4,&(($'$#-!
&#:3&0-+#-!%+#(!()#!+../01$#(&)#8!O#!+!,)#4-$'.(!.+/,0!%6Y0,27$!$#!0*1$*Z5!$-!,6$Q./$((&)#!(6$@@+*$!
+3<)3/%613&!+3!./)@&-!%63#$!+3-/$5!,$!Y%0*/)*1$3/Z8!T$!:3&!#6$(-!.+(!+#)%!*+/!+7$*!*$--$!.)(-3/$!
+*-&7$!)#!/$#7)&$!,+!.$/()##$!=!(+!($3,$!/$(.)#(+;&,&-08!^+#(!%)3-$!>!+R-R&,!$35!.+/!,$!.+((05!%$(!+;3(!
(>'0-/&:3$(5!,)/(:3$!%$(!0,27$(!Y0-+&$#-!)/&$#-0(Z5!*)''$!(6&,(!#6+7+&$#-!.+(!7)&Q!+3!*1+.&-/$8!!
9+&(!&,!'$!($';,$!:3$!,6)#!'$-!3#!.$3!-/).!,6+**$#-5!+3<)3/%613&5!(3/!,+!/$(.)#(+;&,&-0!.$/()##$,,$!
%$(! $#@+#-(! %+#(! ,$3/! 0*1$*8T$,+! (6&#(*/&-! %+#(! 3#! &'+4&#+&/$! .,3(! 7+(-$! %$! ,6&#%&7&%3! +3-)#)'$5!
Y+*-$3/!%$!()#!.+/*)3/(Z5!:3&!+!%$!-/2(!;)#(!*_-0(!'+&(!:3&!*)#%3&-!.+/@)&(!=!@+&/$!;)#!'0#+4$!%$!,+!
*)#(-/3*-&)#!%$(!*+.+*&-0([!,6+3-)#)'&$5!*$,+!($!*)#(-/3&-!%+#(!,+!%3/0$5!+7$*!%$(!/$(()3/*$(!:3&!()#-!
7+/&+;,$(!$#!@)#*-&)#!%$(!@+'&,,$(!$-!%$(!'&,&$3Q!()*&+3Q8!
>'%&.,%3"519#05"#-"&10'"#/*'#&*1%+('.",#,(&.*-",#/"'3"1?"--"#$4%&-*.'"'#-"#/)%5(3@5"=#
O3&5! <3(:36=! 3#! *$/-+&#! .)&#-! $-! *$,+! '0/&-$! :3$,:3$(! ./0*&(&)#(8! \+#(! ,6$#($';,$5! ,$(! *+-04)/&$(!
*,+((&:3$(!%$!,+!()*&),)4&$!/$(-$#-!+(($`!).0/+#-$(!.)3/!%0*/&/$!,$!.10#)'2#$8!O#!(+&-!:36&,!*)#*$/#$!
%+7+#-+4$! ,$(! 4+/])#(! :3$! ,$(! @&,,$(5! .+/! $Q$'.,$5! $-! :3$! (+#(! (3/./&($! ,$(! '&,&$3Q! .).3,+&/$(! ()#-!
.,3(!-)3*10(!:3$!,$(!*,+(($(!')>$##$(!$-!(3.0/&$3/$(8!9+&(!&,!#$!@+3-!.+(!'0*)##+X-/$!,6$Q&(-$#*$!%$!

! M! !
!
.10#)'2#$(!%$!%0*/)*1+4$!+3!($&#!%$(!'&,&$3Q!./&7&,04&0(5!)3!(&'.,$'$#-!%$!@+'&,,$(!:36)#!<34$/+&-!
+!./&)/&!*)'.+-&;,$(!+7$*!,60*),$8!^+#(!+,,$/!*1$/*1$/!-/2(!,)!3#$!'+,+%&$5!(&!$,,$!./)7):3$!3#!/$-+/%!
(*),+&/$5!.$3-!%0(-+;&,&($/!%3/+;,$'$#-!3#!$#@+#-!$-!.$($/!(3/!()#!.+/*)3/(!@3-3/8!T6$(-!%6+&,,$3/(!3#!
.10#)'2#$! ./)./$! =! ,+! L/+#*$5! 3#! .+>(! )a! ,$! /$-+/%! (*),+&/$! $(-5! .,3(! :36+&,,$3/(5! ./0%&*-&@! %$! ,+!
/03((&-$!3,-0/&$3/$8!
9+&(!,$!%0*/)*1+4$!%+#(!,$(!T^?!b!)3!bb!($!<)3$!+3((&!%+#(!%6+3-/$(!*)#-$Q-$([!(0.+/+-&)#!%&@@&*&,$!
$#-/$! ,$(! .+/$#-(5! .+/$#-(! (3/$(-&(! %+#(! ,$3/! 7&$! ./)@$((&)##$,,$! :3&! #$! ()#-! .+(! (3@@&(+''$#-!
./0($#-(5!)3!$#*)/$!./$((&)#!=!,+!/03((&-$!:3&!7+!@&#&/!.+/!%0*)3/+4$/!*$/-+&#(!<$3#$(8!c!*$-!04+/%5!,$!
%0*/)*1+4$! #6$(-! .+(! (+#(! 07):3$/! ,$(! .10#)'2#$(! %$! %0*,+(($'$#-! ()*&+,5! %)#-! ,$(! ()*&),)43$(!
%0;+--$#-!%$.3&(!3#$!%&`+&#$!%6+##0$(8!
d6);($/7$/+&(!*$.$#%+#-!:3$5!*1$`!,$(!$#@+#-(!&((3(!%$!'&,&$3Q!.,3(!)3!')&#(!./&7&,04&0(5!,$(!@&,$-(!%$!
(0*3/&-0! *),,$*-&@(! E/$,+-&)#(! %$(! .+/$#-(5! &#(*/&.-&)#! %+#(! ,$! ./&705! *)+*1! $-*8F! /03((&(($#-! =!
/+'$#$/!;$+3*)3.!%$!<$3#$(!%+#(!%$(!.+/*)3/(!.,3(!*,+((&:3$(8!T6$(-!')&#(!,$!*+(!%+#(!,$(!'&,&$3Q!
.).3,+&/$(8! W-! &,! ($! -/)37$! :3$! *$3QR*&! ()#-! .,3(! @/0:3$''$#-! -)3*10(! .+/! 3#$! +3-/$! ,)4&:3$5! :3&!
-)3*1$! %&/$*-$'$#-! +3Q! +../$#-&((+4$(5! $-! :3$! #)3(! +7)#(! +..$,05! +7$*! %6+3-/$(! *),,243$(5! ,$(!
'+,$#-$#%3(!()*&)*)4#&-&@(8!
!
>(07"A?7(0,#/'%&.,"'=#
O3&5! *+/! ,+! @)/'3,$! .$3-! ./P-$/! =! '+,$#-$#%38! O#! ,$! (+&-5! ,6+*-$! %6+../$#%/$! $(-! &#(0.+/+;,$! %63#!
*)#-$Q-$8!V$(!0,27$(!()#-!()*&+,&(0(!%+#(!3#!*$/-+&#!->.$!%6+--$#-$(5!$-!&,!.$3-!>!+7)&/!3#$!*)#@3(&)#!
$#-/$! ,$(! ,)4&:3$(! ()*&+,$(! $-! ,$(! ,)4&:3$(! %6+../$#-&((+4$8! d$! '6$Q.,&:3$8! T$(! %$/#&2/$(! ()#-!
'+/:30$(! .+/! %$(! (+3-(! *)4#&-&@(! &'.)/-+#-(5! .+/! $Q$'.,$! =! ,6$#-/0$! $#! (&Q&2'$8! O/! ;$+3*)3.!
%60,27$(!#$!7)&$#-!.+(!*$(!,)4&:3$(!*)4#&-&7$(5!'+&(!,$(!,)4&:3$(!()*&+,$(8!W-!(&!,+!*)#@3(&)#!#6$(-!.+(!
%)''+4$+;,$!$#!./&'+&/$5!)a!$,,$(!*)e#*&%$#-!$#*)/$!;$+3*)3.5!$,,$!$(-!.,3(!*)f-$3($!+3!*),,24$5!)a!
*$! :3&! $(-! $#! <$3! #6$(-! .+(! %6P-/$! .),&! +7$*! ,$! ./)@$(($3/! )3! %6+7)&/! @+&-! ($(! %$7)&/(5! '+&(! %6+7)&/!
7/+&'$#-! *)'./&(! ,+! ,$])#8! V$(! Y*)#-/+-(! %&%+*-&:3$(Z5! +&#(&! :3$! ,$(! #)''$#-! ,$(! *1$/*1$3/(! $#!
(*&$#*$(! %$! ,60%3*+-&)#5! *1+#4$#-! %63#! #&7$+3! =! ,6+3-/$5! $-! ,$(! 0,27$(! #$! /$.2/$#-! .+(! *$(!
*1+#4$'$#-(8! V+! *)#(0:3$#*$! #$! ($! @+&-! .+(! +--$#%/$[! ,$3/(! /0(3,-+-(! (6$#! /$(($#-$#-5! $-! *$,+! ,$3/!
+..+/+X-! *)''$! 3#$! &#<3(-&*$5! 7)&/$! *)''$! %3! @+7)/&-&('$5! $-! *$/-+&#(! 0,27$(! #)&/(! )3! %6)/&4&#$!
'+41/0;&#$! &'+4&#$#-! 'P'$! %3! /+*&('$8! \+#(! *$(! *)#%&-&)#(5! ,$! %0*)3/+4$'$#-! ($! %)3;,$! %63#!
/$<$-8!V$! ./);,2'$5!*6$(-!:3$! ,$(!@+'&,,$(! #6)#-!.+(!-)3<)3/(! ,$(! ')>$#(! %$!,$(!+&%$/!=!.+(($/! %63#!
Y*)#-/+-!%&%+*-&:3$!=!,6+3-/$Z8!T6$(-!*$!:3$!')#-/$!-/2(!;&$#!,60-3%$!/0*$#-$!%$!^07$/&#$!g+A.)!(3/!
,$(!%$7)&/(!%+#(!,$(!'&,&$3Q!.).3,+&/$(!ELes&devoirs&à&la&maison5!?"L5!GHMGF8!V$!./)@$(($3/!%$'+#%$!
+3Q!0,27$(!%$!,&/$!$-!,$(!'2/$(!%$!@+'&,,$5!:3&!)#-!=!*h3/!,+!/03((&-$!%$!,$3/(!4+'&#(5!,$3/!%$'+#%$#-!
%$!,&/$!=!1+3-$!7)&Q8!O/! )#! (+&-! :3$!,$(!'0*+#&('$(!&#-$,,$*-3$,(!'&(!$#!<$3! .+/! 3#$! ,$*-3/$!=!7)&Q!
1+3-$!$-!3#$!,$*-3/$!(&,$#*&$3($!#$!()#-!.+(!%3!-)3-!,$(!'P'$(8!9+&(!,6$#($&4#+#-!:3&!+!./$(*/&-!,+!
,$*-3/$!#$!(+&-!.+(!*$!:3&!($!<)3$!%63#$!@+'&,,$!=!,6+3-/$8!i3!-)-+,5!,60*),$!.+/-&*&.$!(+#(!,$!(+7)&/!=!,+!
./)%3*-&)#!%6+,&-0(!$-!%6+,&-0(!:3&!()#-!+3<)3/%613&!.,3(!%3/$(!$-!.,3(!%0@&#&-&7$(!:36$,,$(!#$!
,60-+&$#-!&,!>!+!3#$!)3!%$3Q 40#0/+-&)#(8!T6$(-!.)3/:3)&5!&,!$(-!$(($#-&$,!%$!/$7$#&/!(3/!*$(!:3$(-&)#(!
$-!%6$#!#)3//&/!,+!@)/'+-&)#!%$(!$#($&4#+#-(8 !
1
/
2
100%