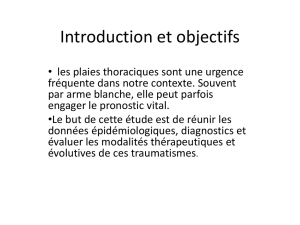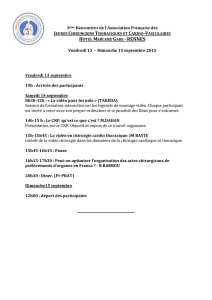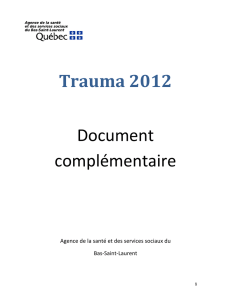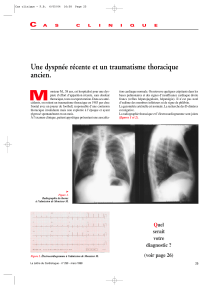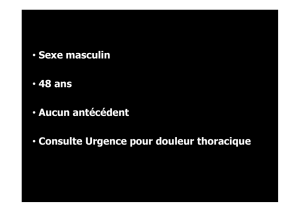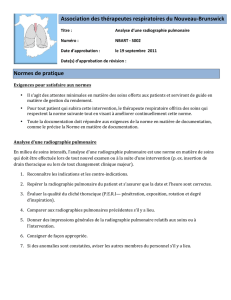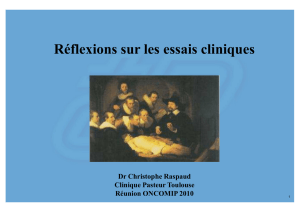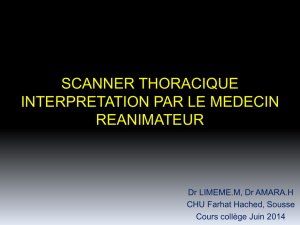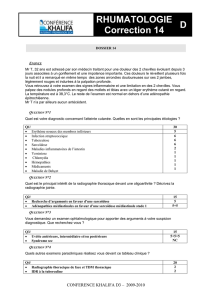gestion du traumatisme thoracique

GESTION DU TRAUMATISME THORACIQUE
Julie Alingrin, Jimmy François, Marc Leone
Service d’anesthésie et de réanimation, Hôpital Nord, Assistance Publique
– Hôpitaux de Marseille, Aix Marseille Université, Marseille, France
E-mail: [email protected]
INTRODUCTION
Les lésions thoraciques sont responsables d’environ 20% des décès liés aux
traumatismes. En Europe, elles sont principalement causées par un accident de
la route ou une chute. Les lésions pénétrantes représentent moins de 10% de
traumatisme thoracique. En réanimation, ces lésions co-existent avec un trauma-
tisme crânien (58%), une lésion abdominale (41%) et les fractures des os longs
(51%) [1]. Parmi les patients avec un traumatisme thoracique, 50à100% ont une
contusion pulmonaire, 30-70% ont un pneumothorax, 20-50% ont un hémothorax
et 15-50% ont des fractures de côtes[1]. Le pronostic des patients dépend des
sites lésionnels, le crâne et le thorax étant associés à une surmortalité[2].
1. PHYSIOPATHOLOGIE
En Europe, les lésions thoraciques sont liées à divers mécanismes. Une
décélération rapide est la cause principale dans la plupart des accidents de la
route. L’aorte peut être assimilée à une colonne lourde de sang avec l’inertie qui se
balance comme le battant d’une cloche. Cela produit des forces de cisaillement. Une
étude cadavérique montre que la décélération enregistrée dans l’isthme de l’aorte
est toujours supérieure à celle enregistrée au niveau du coeur[3]. Cela explique la
rupture de l’aorte thoracique dans les accidents à haute vitesse. Le concassage
est la seconde cause de lésion. Il est responsable de fractures des côtes, volet
costal et lésions viscérales. Le blast est la troisième cause. L’onde de choc peut
causer un traumatisme occulte oculaire, auditif, pulmonaire, cardiovasculaire,
musculo-squelettique et des systèmes neurologiques. Les oreilles doivent être
examinées au moyen d’otoscopie directe pour examiner la membrane du tympan
et la chaîne des osselets.
Les fractures des côtes constituent une partie importante de traumatisme
thoracique. L’incidence exacte est inconnue. Dans une cohorte de patients atteints
de traumatisme thoracique admis en réanimation, des fractures de côtes unilatérales
ont été trouvées dans 60% des cas. Le nombre de côtes fracturées dépend du
mécanisme. L’énergie nécessaire pour induire une fracture de côte est inversement
proportionnelle à l’âge de la victime. La fracture de la première côte est rare. Cette

MAPAR 2015
168
fracture est un marqueur de gravité[4]. Une anomalie artérielle est trouvée chez
14% des patients ayant cette fracture[5]. Les fractures de la dernière côte sont
associées à des lésions abdominales.
Un volet costal se produit quand un segment de la paroi thoracique se détache
du reste de la paroi. Cela nécessite de multiples fractures des côtes adjacentes à plu-
sieurs endroits et la séparation d’un segment provoquant un mouvement paradoxal.
Ceci augmente le travail respiratoire et les douleurs. Le volet costal est accompagné
par une contusion pulmonaire et éventuellement un hémopneumothorax.
Les fractures sternales sont observées chez les victimes d’accidents de la
route subissant un choc dans le volant. Les coussins gonables sont actuellement
protecteurs de ce type de lésion. Les autres causes sont les chutes ou les coups
directs. Des fractures des côtes, contusions myocardiques et pulmonaires sont
associées dans 30% des cas[6].
Dans une série post-mortem, l’incidence des ruptures diaphragmatiques était
de 3,7% [7]. Ces lésions sont facilement manquées en l’absence d’indications de
chirurgie immédiate, générant des complications tardives [8]. Cependant, l’utilisation
de la tomodensitométrie (TDM) spiralée améliore les performances de diagnostic.
L’hémidiaphragme droit est rompu dans 15-20% des cas, le gauche dans 70-80%.
Cliniquement, les patients peuvent être asymptomatiques. Ils éprouvent
souvent dyspnée, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales et des
vomissements. La diminution des bruits respiratoires est le premier constat. Des
bruits intestinaux dans le thorax sont pathognomoniques des hernies intestinales. En
réanimation, une rupture du diaphragme est potentiellement une cause d’échec du
sevrage du ventilateur. La radiographie du thorax initiale est douteuse dans 20-34%
des cas [9]. La radiographie du thorax est répétée pour augmenter la sensibilité.
Une échographie thoraco-abdominale apporte des informations précieuses. La
TDM est utilisée secondairement. L’imagerie par résonance magnétique sagittale
et coronale peut être utile pour certains patients.
L’hémothorax est une collection de sang dans l’espace entre la paroi thoracique
et le poumon, dite cavité pleurale. Il est présent dans 50 % des cas [1]. Il est
secondaire à des fractures de côtes, des fractures vertébrales ou une lacération du
poumon. Les signes classiques de tachycardie, hypotension artérielle, pâleur, sueurs
et de la faim d’air sont difciles à interpréter en réanimation. Le tableau clinique peut
se résumer à un choc hypovolémique. Le diagnostic est suspecté selon le contexte
d’un traumatisme et l’examen clinique. La radiographie thoracique, l’échographie
thoracique et la tomodensitométrie conrment le diagnostic. Les radiographies
thoraciques identient un volume de sang au-dessus de 200 à 300ml. La sensibilité
et la spécicité de tomodensitométrie sont 100%.
Le pneumothorax est une collection d’air dans la cavité pleurale, survenant
chez environ 70% des patients atteints d’un traumatisme thoracique[1]. L’étiologie
la plus fréquente est une fracture de côte qui déchire la plèvre pariétale. Le tensio-
pneumothorax est une affection menaçant le pronostic vital qui résulte de l’aggrava-
tion d’un pneumothorax simple, associée à la formation d’une soupape à une voie
au niveau du point de rupture dans le poumon. L’air est piégé dans la cavité pleurale,
mettant la pression sur le poumon. Cela conduit à une compression du cœur et une
chute du débit cardiaque. En raison de la pression intra-thoracique augmentée, le
retour veineux vers le cœur est altéré. Plusieurs signes suggèrent le diagnostic. La
radiographie thoracique et l’échographie thoracique le conrment[10].

Traumatologie 169
A la suite de dommages aux capillaires, le sang et d’autres uides s’accumulent
dans les tissus pulmonaires. Ceci est l’étiologie du dysfonctionnement pulmonaire
après une contusion pulmonaire. Cette dernière modie les échanges de gaz.
L’ampleur des volumes de contusion permet d’identier les patients à risque élevé
de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)[11]. Une contusion pulmonaire
unilatérale conduit rapidement à une défaillance généralisée de l’ensemble du
poumon[12]. L’histoire de traumatisme suggère le diagnostic. L’augmentation du
gradient d’oxygène alvéolaire-artériel, des râles humides à l’auscultation et une
hémoptysie sont souvent associés. La contusion pulmonaire peut être absente sur
la radiographie du thorax initial. En revanche, la TDM la révèle systématiquement.
L’aspect est à différencier de celui d’un collapsus pulmonaire.
Pendant longtemps, la contusion pulmonaire a été considérée comme une
lésion relativement bénigne[13]. A court terme, la pneumonie est la complication
la plus fréquente[11]. Son incidence varie de 25% à 33%[1,11,12]. L’incidence
du SDRA chez les patients ayant une contusion pulmonaire varie de 4,5 % à
14 % [1, 11]. A long terme, les survivants de traumatismes multiples avec un
traumatisme thoracique ont une limitation fonctionnelle, comme en témoignent
70% des patients avec des tests de la fonction pulmonaire altérée. Le ratio de la
pression artérielle en oxygène à la fraction inspirée en oxygène inférieur à 200 à
l’admission détermine les patients à haut risque de complications pulmonaires[1].
Bien que la rupture traumatique de l’aorte thoracique survienne dans seulement
1% des accidents de la route, elle représente 20% de tous les décès. Son incidence
est deux fois plus élevée dans les impacts latéraux que dans les frontaux. Le risque
augmente avec l’âge. Les multiples fractures des côtes, bilatérales dans 68% des
cas, sont les lésions les plus fréquentes associées à une rupture traumatique de
l’aorte thoracique[14].
La rupture traumatique de l’aorte thoracique est habituellement provoquée
par un impact direct sur le sternum. Toutefois, cette lésion est suspectée chaque
fois qu’il y a un transfert d’énergie importante. Les causes les plus fréquentes de
blessures sont les chutes de plus de 3 mètres et des accidents survenant à des
vitesses supérieures à 50km.h-1.
L’examen clinique reste négatif dans environ 50% des cas. Les symptômes
de la rupture traumatique de l’aorte thoracique comprennent une douleur thora-
cique, dyspnée, douleurs au dos, dysphagie et la toux. En réanimation, les signes
peuvent être une hypotension inexpliquée ou une hypertension au niveau des
membres supérieurs uniquement[15]. Les autres signes incluent l’hémothorax,
une paraplégie et une tamponnade cardiaque. La radiographie thoracique est la
première étape dans la détection de rupture de l’aorte thoracique. Les anomalies
médiastinales sont la pierre angulaire pour évoquer une rupture traumatique de
l’aorte thoracique. L’angiographie a été la modalité d’imagerie standard pour le
diagnostic. L’aortographie est considérée comme spécique de 98% avec une
sensibilité de 100 %. L’échocardiographie transœsophagienne, moins invasive que
l’angiographie, peut être effectuée au lit du patient. La sensibilité et la spécicité
sont excellentes. Ces procédures sont actuellement remplacées par la TDM avec
l’utilisation de contraste qui a 100% de sensibilité et une spécicité de 99,8% pour
le diagnostic de rupture traumatique de l’aorte thoracique[16].

MAPAR 2015
170
L’expression clinique de la lésion cardiaque reste rare. La contusion du myo-
carde est la plus courante, de préférence localisée au niveau du ventricule droit.
Son expression clinique imite une tamponnade cardiaque. Les signes cliniques
de tamponnade comprennent une cyanose de l’extrémité céphalique avec une
dilatation des veines jugulaires, augmentant à l’inspiration. Le pouls paradoxal
correspond à une chute de la pression artérielle de 10 à 20 mmHg à la n de l’ins-
piration. L’électrocardiogramme montre les changements d’ondes non spéciques
ST et T. L’échocardiographie est la pierre angulaire de la démarche diagnostique.
Les lésions trachéo-bronchiques sont principalement liées à un traumatisme
pénétrant. Elles nécessitent un examen attentif. Plus de 80 % des lésions sont
situées à moins de 2,5cm de la carène. Leur incidence est faible. L’analyse de
1178 autopsies de patients traumatisés montre 33 (2,8 %) blessures trachéo-
bronchique, associées à 81% à la mortalité pré-hospitalière [17]. Les signes et
symptômes les plus courants sont la dyspnée, tachypnée, emphysème sous-cutané,
le pneumothorax et pneumomédiastin. En réanimation, un tensio-pneumothorax
générant une fuite d’air continue malgré un drainage adéquat suggère le diagnostic.
La radiographie thoracique est anormale dans 90% des cas, montrant une com-
binaison de signes, y compris l’emphysème, pneumomédiastin, un pneumothorax
ou un épanchement pleural[17]. La TDM détecte plus de 90% des lésions tra-
chéales, mais ne peut pas remplacer la bronchoscopie[17]. L’extubation pendant
la procédure permet d’observer l’ensemble de la région.
L’incidence des lésions œsophagiennes varie de 1,2% pour un traumatisme
fermé à 10% pour les traumatismes pénétrants. Le site de la lésion peut être
cervicale (56%), thoracique (30%), ou abdominale (17%)[18]. Les symptômes
cliniques sont exceptionnels chez les patients de réanimation. La douleur et la
dysphagie peuvent survenir chez le patient conscient. La èvre et l’emphysème
sous-cutané sont les seuls signes rapportés chez les patients non coopérants. La
radiographie du thorax est normale dans 30% des cas[19]. La TDM montre un
emphysème médiastinal et des stules[19].
2. STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE
L’examen clinique est essentiel. Palpation, auscultation et détection des pouls
périphériques sont systématiques dès l’admission du patient. Cependant, l’évalua-
tion clinique a des limites. Pour détecter un épanchement pleural, l’auscultation a
une sensibilité de 58%, une spécicité de 98% et une valeur prédictive positive
de 98%[20].
La radiographie thoracique est systématique. L’utilisation de l’échographie au
chevet du patient a été un réel progrès dans la gestion des patients victimes de
traumatismes. L’échographie de type FAST couplée à l’exploration des cavités pleu-
rales et du cœur est un outil indispensable pour la détection précoce de la collecte
uide[11]. La TDM reste l’examen de choix après stabilisation des patients[21].
3. LES GRANDES LIGNES DE LA PRISE EN CHARGE POUR L’ANESTHÉ-
SISTE RÉANIMATEUR
3.1. FOURNIR DE L’OXYGÈNE
La prise en charge initiale des patients atteints d’un traumatisme thoracique
inclut une bonne stabilisation du rachis jusqu’à exclusion du diagnostic. De l’oxygène

Traumatologie 171
exogène est nécessaire pour obtenir une pression en oxygène alvéolaire à 80 mmHg,
L’étape ultérieure est d’exclure un épanchement pleural. La ventilation mécanique,
en utilisant la méthode invasive ou non invasive, est utilisée si la ventilation spon-
tanée ne peut pas assurer une oxygénation adéquate. La ventilation non invasive
reste discutée chez ces patients. Les recommandations françaises préconisent,
en l’absence de contre-indication, après réalisation d’une tomodensitométrie et
drainage d’un pneumothorax si indiqué, un essai de ventilation non invasive avec
aide inspiratoire et pression expiratoire positive [22]. En l’absence d’amélioration à
une heure, l’intubation trachéale en séquence rapide est indiquée.
Les critères d’intubation trachéale après traumatisme thoracique sont présentés
au tableau I. Au cours de la ventilation mécanique, une stratégie de protection
limitant les niveaux de pression de plateau (moins de 30cmH2O) et le volume courant
(6-8ml/kg) est recommandée [22]. En ce qui concerne l’utilisation de la pression
expiratoire positive (PEEP), son niveau est probablement réglé différemment dans
les phases précoces et tardives de la gestion. Dans la première phase, l’utilisation
de haut niveau de PEEP est à éviter car elle aggrave potentiellement la situation
hémodynamique[23]. Dans une période plus tardive, la ventilation de base suit les
lignes directrices pour la gestion d’un SDRA. Dans le cas d’hypoxémie réfractaire,
le décubitus ventral et les techniques de circulation extra-corporelle sont discutés
au cas par cas selon la balance bénéce/risque.
Tableau I
Critères d’intubation trachéale
Score de l’échelle du coma de Glasgow coma < 9
Echec ou contre-indication de la ventilation non invasive
Fréquence respiratoire > 25 cycles par minute
Acidose (pH < 7.1)
3.2. ANALGÉSIE
L’analgésie est la base de la prise en charge des patients atteints de trau-
matisme thoracique. Le traitement est individualisé selon une échelle de douleur
qui est utilisée systématiquement. Les experts français recommandent l’échelle
numérique ou une échelle verbale simple. L’administration de morphinomimétiques
est fréquente. Toutefois, en raison des effets indésirables des opioïdes systémiques,
d’autres moyens ont été étudiés. L’approche multimodale est recommandée. Elle
englobe un large éventail de procédures et de médicaments, y compris l’analgésie
régionale, l’utilisation judicieuse de médicaments morphinomimétiques de courte
demi-vie, les agents anti-inammatoires non stéroïdiens, l’acétaminophène, la
kétamine ou anxiolytiques[24]. L’analgésie péridurale thoracique est probablement
l’intervention la plus efcace pour la gestion de la douleur[25,26]. Cependant, en
raison des critères restrictifs d’utilisation, elle est utilisée chez moins de 10 % des
patients ayant un traumatisme du thorax. Les experts français préconisent en cas
de lésion unilatérale l’utilisation d’un bloc paravertébral[22].
3.3. LE DRAINAGE THORACIQUE
Insérer un drain thoracique est une intervention chirurgicale. Cette procédure
peut être associée à des complications. Avant d’effectuer la procédure, tous
les opérateurs sont formés adéquatement. Insérer un drain thoracique est une
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%