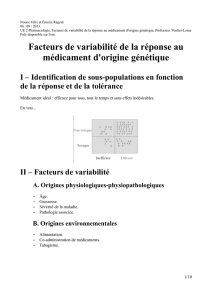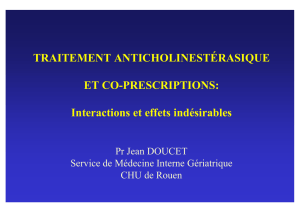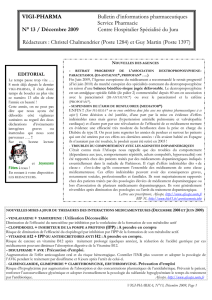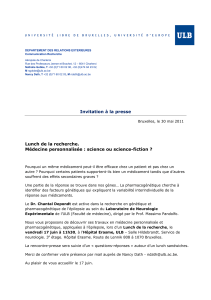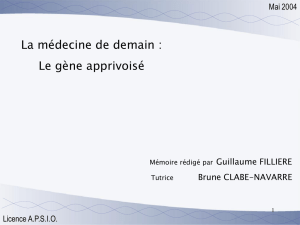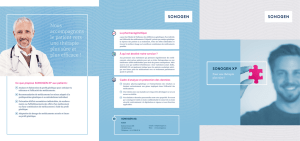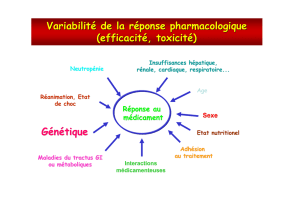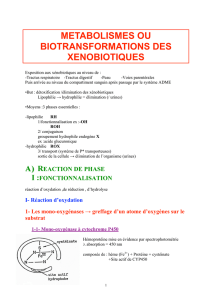Plateforme biopuces à ADN Roche/ Affymetrix en routine

INNOVATION
18
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
Plateforme biopuces
à ADN Roche/ Affymetrix
en routine
Apport de l’AmpliChip CYP 450,
première biopuce marquée CE IVD,
dans l’ajustement des traitements
Installée depuis
près de 9 mois
au laboratoire central
de chimie clinique
des HUG, service du
Pr Denis Hochstrasser,
la plateforme AmpliChip
réalise en routine
et dans le cadre
d’études cliniques,
le test AmpliChip CYP450.
Ce test de génotypage
permet de prédire la
susceptibilité individuelle
au traitement de patients
souffrants de certaines
affections.
Aujourd’hui utilisées en pharmacogéné-
tique, les applications potentielles des bio-
puces sont multiples et la technologie mise
en œuvre s’appliquera dans de nombreux
domaines. En janvier 2006, une réunion a
été organisée aux HUG, entre des spécia-
listes de pharmacogénétique ou de méde-
cine de laboratoire, français (Pr Beaune,
Dr Loriot, Dr Méary) et suisses (Pr Dayer,
Pr Hochstrasser, Dr Rossier). À l’occa-
sion de cette visite, 10 000 BIO a sou-
haité interroger le Dr Michel Rossier
sur son expérience pionnière et le
Pr Philippe Beaune chez qui la première
plateforme française AmpliChip CYP P450 a
été installée en mars.
De gauche à droite :
Dr Michaëla Rebsamen,
Dr Michel Rossier, Mme Adeline Diemand,
Pr Hochstrasser et M. A. Chiappe
AMPLICHIPS AMPLICHIPS
Reportage aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG)

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
INNOVATION
19
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
Pouvez-vous nous décrire l’organi-
sation de votre laboratoire ?
« Le Laboratoire Central de Chimie Clinique
(LCCC) des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG) dépend du département
de pathologie clinique dirigé par le Pr Denis
Hochstrasser. Ce laboratoire est accrédité
depuis un peu plus de 5 ans, accréditation
qui vient d’être confirmée en 2005.
L’activité du service de Chimie Clinique
nécessite des techniques très variées,
allant des gros automates de routine
pour les analyses en urgence, capables
de rendre des résultats avec un temps
médian inférieur à 35 minutes, jusqu’à
des méthodes beaucoup plus manuel-
les (chromatographie, électrophorèse,
biologie moléculaire, examens micros-
copiques). De nombreuses analyses
spécialisées sont également mises au
point au sein du service, par exemple en
toxicologie (spectrométrie de masse) ou
dans le domaine de la protéomique. Le
LCCC (qui comprend une centaine de
collaborateurs) est organisé en plusieurs
sections :
• Une section Urgence qui fonctionne
24 h/24 h autour de gros automates à
haut débit.
• Une section Routine & Qualité pour des
examens plus spécialisés (métabolites,
activités enzymatiques, marqueurs par-
ticuliers) exécutés en série, notamment
par électrophorèse ou par chromatogra-
phie. Le responsable de cette section a
aussi en charge la gestion de la qualité
pour l’ensemble du service de chimie
clinique.
• Une section d'analyses courantes,
située sur un autre site des HUG (hôpi-
taux de gériatrie et de psychiatrie).
• Une section Examens Biologiques :
analyses d'urines, de lavages broncho-
alvéolaires et autres liquides biologiques,
y compris par microscopie (analyse des
sédiments). Certains paramètres endo-
criniens non pratiqués au laboratoire
d’urgences y sont également analysés
par immuno-dosage.
• Une section Toxicologie et suivi théra-
peutique, assurant le dépistage de toxi-
ques ou le dosage des médicaments.
• Une section R&D, spécialisée dans
les approches protéomiques et la décou-
verte de nouveaux bio-marqueurs et enfin,
sous ma responsabilité (Le Dr Rossier est
privat-docent, équivalent d’un MCU-PH
dans le système français – NDRL), une
section un peu hybride, avec des intérêts
aussi bien dans le domaine de l'endo-
crinologie (hormones stéroïdes) que de la
pharmacogénétique. Nous sommes éga-
lement en charge de la surveillance des
analyses de proximité (effectuées au lit du
patient) pour toute l'institution. Une partie
des activités de ma section concerne
donc la mise en place des technologies
de biologie moléculaire appliquées à la
chimie clinique. Les disciplines ciblées
sont la pharmacologie et l’oncologie, ceci
en rapport avec les nombreux dosages de
marqueurs tumoraux ou de médicaments
déjà réalisés dans les autres sections du
service, et nous avons maintenant un recul
d'environ 6 ans dans ce domaine. »
En quelques chiffres, quelle est
l’activité des HUG ?
L’activité des HUG est répartie sur plu-
sieurs sites avec un total de 2 200 lits.
Le site principal où nous nous trouvons
représente plus de 1 000 lits et comprend
les soins aigus, y compris pédiatrie et
maternité. Le laboratoire couvre l’ensem-
ble des analyses de ce site et les analyses
spécialisées des autres sites. L’activité
des différents laboratoires est d’environ
3 millions d’analyses/an, la majorité étant
effectuée en chimie clinique. »
Quelle est la place de la pharma-
cologie et de la pharmacogéné-
tique dans ce contexte ?
« Les prestations de la section Toxicologie
dans le domaine du suivi thérapeutique a
depuis longtemps créé une forte interac-
tion entre le laboratoire et le service de
pharmacologie clinique du Pr. P. Dayer.
À la demande des cliniciens, les pharma-
cologues sont régulièrement consultés
en cas d’inefficacité de traitement, ou, à
l’inverse, d’effets indésirables qui peuvent
être très graves pour le patient et très
coûteux pour la société.
Dans ce contexte, l’idée d’introduire au
laboratoire la pharmacogénétique est
venue tout naturellement pour compléter
nos techniques de toxicologie analytique.
Nous avons bien entendu développé en
parallèle des méthodes conventionnelles
de phénotypage (analyse de la cinétique
d'apparition des métabolites du médica-
ment ou d'une substance analogue ayant
Le laboratoire équipé de la plateforme biopuces à ADN Roche/Affymetrix
nous est présentée par A. Chiappe
AMPLICHIPS AMPLICHIPS

INNOVATION
20
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
la même pharmacocinétique).
Naturellement, nous nous sommes inté-
ressés très tôt aux différents cytochro-
mes P450 (CYP450) très impliqués dans
le métabolisme de très nombreux médi-
caments. Ainsi, à partir de trousses com-
merciales de PCR en temps réel sur Light
Cycler (FRET) ou en Taqman, nous avons
introduit des techniques pour le géno-
typage des principaux polymorphismes
des CYP 2D6, 2C9, 2C19, entre autres.
Ces analyses sont effectuées à partir de
quelques millilitres de sang complet du
patient (en fait ses cellules sanguines),
le matériel biologique de loin le plus cou-
ramment utilisé en chimie clinique. »
Comment choisissez-vous les nou-
veaux tests de pharmacogénétique
à développer ?
« Le processus de développement de
nouvelles techniques est un peu différent
en pharmacogénétique comparativement
aux autres secteurs de la biologie clini-
que. Généralement, c’est le laboratoire
qui met en place de nouveaux dosages
et qui les propose aux services clini-
ques. Jusqu'à présent, dans le cas de
la pharmacogénétique, ce sont plutôt
les pharmacologues qui nous ont solli-
cité pour développer de nouveaux tests
répondant à un besoin précis en fonction
de l’évolution des traitements dans tel
Cas clinique
Intoxication à la codéine lié au polymorphisme
du cytochrome P450 2D6
Nous avons récemment rapporté(1) le cas d'un patient de 62 ans hospitalisé après plusieurs
jours de fatigue, dyspnée, fièvre et toux persistante. Il a subi trois mois plus tôt une chimio-
thérapie pour une leucémie chronique et il prend quotidiennement de l'acide valproïque
(1 500 mg/jour) depuis plusieurs années suite à une crise épileptique généralisée.
À son arrivée, le patient est parfaitement conscient et orienté, bien que clairement hypoxé-
mique (pO2 = 7.5 kPa (56 mmHg)). L'investigation clinique et radiologique suggère alors
une pneumonie bilatérale et un lavage broncho-alvéolaire révèle la présence de levures. Un
traitement adéquat est alors initié (ceftriaxone, clarithromycine et voriconazole) et 25 mg de
codéine sont administrés 3 fois par jour pour apaiser sa toux persistante.
Au 4e jour d'hospitalisation, alors que sa dernière prise de codéine remonte à 12 heures,
l'état du patient se détériore, celui-ci perd conscience et devient rapidement comateux. Il
est alors transféré aux soins intensifs où il est ventilé artificiellement (sa pO2 est toujours
à 7.5 kPa). L'examen neurologique révèle un coma à 6 sur l'échelle de Glasgow. Aucune
amélioration de l'état neurologique n'est observée après 90 min de ventilation (malgré
une pO2 remontée à 9.1 kPa (68 mmHg)). L'administration intraveineuse de naloxone
(2 fois 0.4 mg), un antagoniste des récepteurs aux opioïdes, résulte alors en une amélio-
ration drastique de l'état du patient qui peut alors être maintenu conscient et qui retrouve
une fonction respiratoire normale.
(1) Gasche Y. et al. 2004, N Engl J Med, 351:2827
EXPLICATION PHARMACOLOGIQUE ET PHYSIOPATHOLOGIQUE
La codéine est un "pro-médicament" qui doit être activé en morphine par le CYP 2D6 pour exercer son effet antitussif. L'analyse
génétique, réalisée après cet épisode, a révélé la présence de copies supplémentaires du gène codant pour le CYP 2D6 chez ce
patient, lui conférant ainsi un phénotype de "métaboliseur ultra-rapide" (comme chez environ 2-8 % de la population caucasienne).
Ce résultat a été corroboré par les dosages plasmatiques (effectués pendant l'épisode du coma) de la codéine et de la morphine,
cette dernière étant mesurée à 20 fois la concentration attendue. Le phénotype de métaboliseur ultra-rapide pour le CYP 2D6 a
également été confirmé en mesurant la cinétique du métabolisme du dextrometorphane chez ce patient.
La cause du coma a donc pu être clairement attribuée à une intoxication aux opioïdes (morphine et dérivés), due à une transforma-
tion trop rapide de la codéine. Cette surdose de morphine, due principalement à un polymorphisme du gène CYP 2D6, a encore été
exacerbée chez ce patient par le fait qu'une voie secondaire du métabolisme de la codéine, le CYP 3A4, qui inactive normalement
une partie de la codéine en norcodéine, était clairement inhibée par les autres médicaments administrés simultanément (ceci a
été confirmé par un phénotypage du CYP 3A4), et par une insuffisance rénale aiguë qui a également contribué à maintenir des
concentrations plasmatiques d'opioïdes élevées.
Ce cas démontre l'intérêt clinique à déterminer à la fois le génotype et le phénotype de certaines voies métaboliques pouvant
intervenir dans les effets indésirables de certains médicaments et d'ajuster au mieux de la situation et de façon individualisée le
dosage de ces médicaments.
AMPLICHIPS AMPLICHIPS

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
INNOVATION
21
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
ou tel secteur thérapeutique, en par-
ticulier celui de la douleur pour lequel
nous avons une expertise mondialement
reconnue à Genève. Cette interaction est
extrêmement motivante et nous entrete-
nons des liens privilégiés avec le service
de Pharmacologie Clinique (Pr. P. Dayer
et Dr J. Desmeules).
La première phase d’introduction d'une
nouvelle analyse est en règle générale
initiée au travers d’études cliniques, dont
certaines viennent d’être récemment
publiées.
Outre les objectifs spécifiques des étu-
des, bien définis en amont par l’inves-
tigateur, il s’agit aussi pour nous de
valider la pertinence clinique d’un test,
c'est-à-dire de bien définir dans quelle
situation il présentera vraiment une aide
pour la prise en charge et/ou le suivi thé-
rapeutique (choix de la molécule et de la
posologie initiale). Ainsi que mesurer et
démontrer l’impact médico-économique
favorable de l’introduction de la pharma-
cogénétique en routine. »
Comment concevez-vous la
place de la technique AmpliChip
CYP450 dans votre laboratoire ?
« Nous avions déjà des techniques (com-
merciales ou développées au laboratoire)
pour rechercher les génotypes (allèles)
les plus fréquents des CYP450 2D6
et 2C19. Notre expérience acquise en
9 mois avec l'AmpliChip nous permet
maintenant d’évaluer comparativement
les performances des différents tests.
Globalement, il existe une très bonne
corrélation analytique entre nos techni-
ques "classiques" et l'AmpliChip, mais la
biopuce permet en un seul test de com-
biner l’étude des allèles 2D6 et 2C19.
Surtout, un des avantages majeurs per-
mis par le format biopuce est la capacité
d’explorer en même temps un nombre
beaucoup plus important d’allèles (pour
le CYP 2D6, du moins), en particulier
des allèles fréquemment rencontrés chez
les patients d’ethnies non caucasiennes
que nous ne pouvons pas rechercher de
façon systématique simplement en multi-
pliant le nombre de tests.
Pour une ville internationale et cosmo-
polite comme Genève, et face à l’accé-
lération des échanges inter-culturels et
des migrations de population, pouvoir
rechercher des polymorphismes a priori
rares, mais néanmoins répandus dans
d'autres ethnies, répond presque à une
exigence éthique.
Enfin, un autre intérêt de la biopuce est
de pouvoir définir, en cas d'allèle multi-
dupliqué détecté simultanément avec un
allèle déficient, l'identité de l'allèle impli-
qué afin de mieux prédire le phénotype
résultant (seule la duplication d'un allèle
normal donnera un phénotype de méta-
boliseur ultrarapide). Cette distinction ne
peut pas être faite avec une méthode de
génotypage classique. »
Quels développements
espérez-vous sur AmpliChips ?
« Ils sont nombreux. En effet, les poten-
tialités de cette technologie sont énor-
mes. Actuellement, nous déterminons
les polymorphismes de deux gènes, mais
nous pourrions tout aussi bien analy-
ser plusieurs milliers de gènes simulta-
nément sur le même genre de
puce. La limitation n'est plus
d'ordre technologique, mais
la question consiste mainte-
nant à déterminer quels sont
les gènes pertinents dont l'ana-
lyse permettra d'améliorer la prise
en charge du patient. Par exem-
ple, aujourd’hui le test AmpliChip
CYP450 donne des informations sur la
pharmacocinétique des médicaments à
voie métabolique hépatique CYP 2D6 et
2C19-dépendants, mais nous espérons
pouvoir un jour rechercher des polymor-
phismes dans les gènes-clés intervenant
également dans la pharmacodynamie
des médicaments.
En outre, les développements en cours
dans le domaine de l'oncologie sont
aussi immenses, et notre laboratoire, qui
travaille également sur les phénomènes
de régulation épigénétique par hypermé-
thylation, attend beaucoup de la techno-
logie des puces à ADN.
Nous ne doutons pas que ce type de
plateforme s’ouvrira à un grand nombre
d’applications. »
Vos plateformes de biologie molé-
culaire, qu’il s’agisse du Light
Cycler ou de l’AmpliChip, sont-
elles exclusivement utilisées par le
service de Chimie clinique. Quelle
est votre philosophie en terme de
mise en commun de moyen ?
« Vous avez raison de m’interroger sur
ce point. En effet, la politique du service
est très en faveur de l’ouverture de ces
plateformes à d’autres services, pour
d’autres applications. C’est déjà le cas
pour la PCR en temps réel (Light Cycler)
utilisée par d’autres services, par exem-
ple pour le génotypage en routine des
Apolipoprotéines E ou dans des domai-
nes plus expérimentaux comme la trans-
plantation d'îlots pancréatiques (étude
du relargage des cellules Bêta dans la
circulation sanguine après transplanta-
tion, par analyse des ARN messagers
circulants de l’insuline).
Si ce n’est pas encore le cas pour la
plateforme AmpliChip, les dévelop-
pements de nouveaux tests nous
imposeront forcément d’aller dans
cette voie d’une communauté de
moyens. Cette mise en commun
de plate-formes techniques est
d'ailleurs un des points centraux du
projet de regroupement des laboratoires
actuellement en cours aux HUG. »
Cette plateforme est à la pointe en
matière d'innovation biologique.
Cette image novatrice est-elle
importante pour votre laboratoire ?
« Oui. On est toujours sensible à l’ima-
ge de son laboratoire ! Physiologiste
et endocrinologue de formation initiale
AMPLICHIPS AMPLICHIPS

INNOVATION
22
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006
Question à…
Pr Philippe Beaune, responsable
du pôle Biologie Hôpital Européen
G. Pompidou (HEGP), Paris
En tant que spécialiste du cytochro-
me P450, quel est pour vous l'intérêt
d’intégrer la plateforme DNA Roche/
Affymetrix dans votre laboratoire ?
« Nous travaillons depuis longtemps dans
le domaine de la pharmacogénétique et
nous constatons aujourd’hui que son inté-
rêt commence à s’imposer dans les esprits.
Cependant, il est encore difficile de développer
cette discipline en routine dans un laboratoire
de chimie clinique. Certaines applications sont
bien définies mais des études de validation
doivent encore être faites. Sous l’égide de
l’INSERM, nous mettons en place plusieurs
réseaux de pharmacogénétique pour définir
les études et méthodologies qui permettraient
de valider le concept de pharmacogénétique
en pratique clinique de routine.
D’autre part, nous pensons que les biopuces
sont promises à un grand développement et
il nous semble qu’introduire cette technologie
dans notre laboratoire, sur un sujet que nous
connaissons bien nous permettra d’en avoir la
meilleure approche possible. Dans beaucoup
de domaines thérapeutiques, les cliniciens
ne sont pas demandeurs, mais dans le cadre
d’essais cliniques nous aurons la possibi-
lité par une technique simple de donner des
réponses pertinentes, permettant d’élargir le
champ de la pharmacogénétique actuelle.
Donc, pour résumer, 3 intérêts majeurs :
• donner de la puissance à nos études de
validation et réaliser nos travaux de recherche
dans de très bonnes conditions,
• introduire cette technologie que nous pen-
sons d’avenir à de multiples développements
possibles en biologie ; en mesurer toutes les
possibilités et la praticabilité,
• développer la pharmacogénétique à
l’hôpital. »
Quelles sont pour vous les limites
de la pharmacogénétique ?
« Elles sont dictées par l’évolution de la
recherche pharmaceutique. Les R&D des
laboratoires connaissent de mieux en mieux,
et de plus en plus tôt, les enzymes impliquées
dans le métabolisme des nouvelles molécules
en développement. Dans la mesure du possi-
ble, tout est fait pour de modifier une molécule
pour la rendre moins dépendante d’un cyto-
chrome. Mais cela n’est pas toujours possible,
car l’activité de ces molécules est souvent liée
à leur structure tri-dimensionnelle et donc à
leur métabolisme cytochrome-dépendant.
De plus toutes les enzymes impliquées dans
le métabolisme des médicaments présentent
de nombreux polymorphismes génétiques.
Au total, il y aura donc toujours des compro-
mis pour le design de ces molécules entre
performance et confort (métabolisme hépati-
que, effets secondaires, pharmacodynamie…).
Dans ce contexte, l’exclusion totale de l’inte-
raction du 2D6 et 2C19 dans le métabolisme
des médicaments me semble peu probable. »
Votre service travaille beaucoup sur
les psychotropes, qu’envisagez-vous
dans ce cadre ?
« Vous faites référence au "Réseau
Pharmacogénétique des Psychotropes"
coordonné par le Pr Marion Leboyer (service
de psychiatrie, Créteil). En effet, les psycho-
tropes sont une bonne cible d’application
dans ce domaine, et l’idée du réseau est
de valider la démarche de pharmacogéné-
tique. Pour cela nous étudierons comment
mieux utiliser ces médicaments ; adaptation
de la dose ou de la molécule en fonction des
données de la pharmacogénétique. Dans ce
cadre, nous envisageons bien sur que soient
développées d’autres enzymes du métabo-
lisme aussi impliquées dans d’autres classes
thérapeutiques. Je pense qu’une très vaste
connaissance théorique sur le sujet et que
le "défrichage" sont d’ores et déjà acquis.
Maintenant il nous faut modéliser et valider
l’utilisation de ces tests en routine. »
Pour d’autres applications ?
« Bien entendu. Ce n’est pas une pensée
révolutionnaire, nous souhaitons que se déve-
loppent sur le standard Roche Affymetrix
d’autres applications et nous avons des idées
déjà bien avancées sur les classes thérapeu-
tiques : par exemple, les anti-cancéreux, les
immunosuppresseurs, et les anticoagulants.
Je pense effectivement qu’une plateforme
unique permettant de développer différentes
applications semble préférable à une multipli-
cation de systèmes pour chaque application.
Il doit y avoir une logique similaire aux autres
domaines de la biologie (immuno-analyse,
biologie moléculaire…).
Par ailleurs chaque biopuce devra, dans ce
cadre, évoluer aux rythmes des connais-
sances cliniques. À l’issue de cette visite
très intéressante au service de biochimie du
Pr Hochstrasser, et aux conversations fruc-
tueuses avec le Dr Michel Rossier et Mr A.
Chiappe, j’accueille avec grand plaisir l’idée
d’évaluer dans mon laboratoire la biopuce
Roche P450. »
NB : La plateforme a été installée au laboratoire
du Pr Baune en mars 2006. Son fonctionnement
est sous la responsabilité du Dr Marianne Loriot,
pharmacogénéticienne.
AMPLICHIPS AMPLICHIPS
 6
6
1
/
6
100%