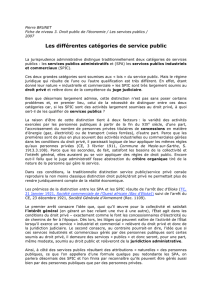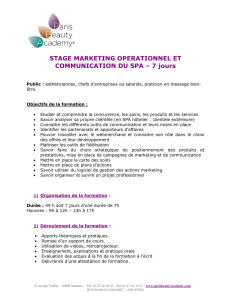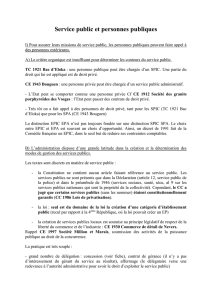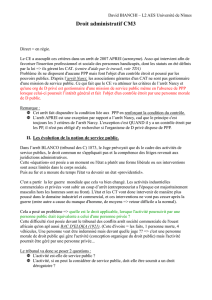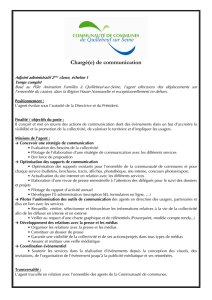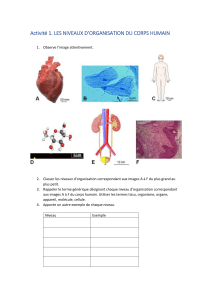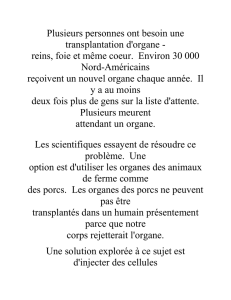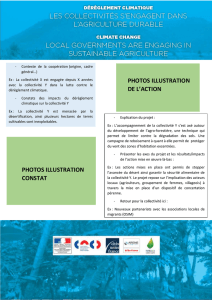cm7

CM 7 : La mission de service publique (SP)
L’action de l’administration a pour raison d’être de satisfaire les besoins du public. Le droit français lui a confié
les 2 missions fondamentales de veiller au maintien de la paix sociale et d’assurer le bonne marche des services
publiques.
I. Définition du service publique
Définition matérielle : toute activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général et qui en tant que telle
doit être assurée ou contrôlée par l’administration car la satisfaction continue de ce besoin ne peut être
garantit que par l’administration.
Définition organique : ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l’état ou autre
collectivité publique en vue de l’exécution de ses tâches.
A) L’intérêt général
Les exigences de l’intérêt général sont appréciées par l’autorité compétente pour décider la création du
service. Il englobe des éléments divers : c’est d’abord l’intérêt de la collectivité nationale et de l’Etat souverain
qu’il incarne. Les particuliers n’en bénéficient donc qu’indirectement en tant que citoyen et ses services leur
imposent des contraintes. C’est les services régaliens (police…) c’est également à l’inverse la satisfaction
directe de besoins individuels apportés par l’Etat. Les responsables de l’Etat estiment que les activités privées
ne suffissent pas à répondre à ces besoins et fournissent alors des prestations aux particuliers (Transport).
B) L’organe exerçant le service public
A l’origine, la définition du SP se caractérisait par sa prééminence organique. La qualification de service
publique dépendait essentiellement de la nature juridique de l’organe qui gère l’activité. Cet organe devait être
une personne publique (Etat, collectivité territoriale…). Les personnes privées ne pouvaient pas gérer de SP.
Cette interdiction est apparue inadaptée à l’évolution de société dont le besoin de SP a considérablement
augmenté. Les personnes publiques sont devenues incapables d’y répondre seule. L’Etat a donc confié la
gestion de certaines activités d’intérêt général à des personnes privées. La question était alors de savoir si ces
personnes privées étaient investient de véritable mission de SP ou non. Le conseil d’Etat a retenu qu’une action
d’intérêt général exercée par une personne privée était une mission de service publique si cette activité était
contrôlée par une personne publique et si la personne privée bénéficiée d’au moins une prérogative de
puissance publique. Ex : Gestion d’un centre de loisir.
Cette dernière condition a été abandonné dans 90’s. La présence renforcée du contrôle de la mission par une
personne publique permet d’effacer l’exigence de la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique.
Définition contemporaine du service public : forme de l’action administrative dans laquelle une personne
publique prend en charge ou délègue sous son contrôle la satisfaction d’un besoin d’intérêt général.
Les SP sont classés en 2 catégories :
- Service public administratif (SPA). Ils relèvent du droit et du juge administratif.
- Service public industriel et commerciaux (SPIC) : ils relèvent du droit privé et du juge judiciaire.
Pour les distinguer, la jurisprudence a recourt à 3 indices :
- Son objet : si l’activité est comparable à celle d’une entreprise privée il s’agit d’un SPIC (Transport)
- Son mode de financement : si les ressources proviennent des usagers et non de subventions ou de
recettes fiscales, il s’agit d’un SPIC.

- Son mode de fonctionnement : si les conditions de gestion du service publique sont dérogatoires
aux règles du droit privé : il s’agit d’un SPA.
II. Le régime juridique du service public
A) Création et suppression
Les SP peuvent être créé et supprimée par un organe central ou par une collectivité territoriale. Depuis 1958, la
création et suppression revient au gouvernement et non plus au parlement. L’Etat ne peut pas créer des
services publics dans n’importe quelles conditions. Leur création ne doit pas apporter des restrictions
arbitraires ou abusives à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie. S’agissant des
collectivités locales, la loi les oblige à créer certains SP (Etat civil, entretien des voies communales…). En dehors
de ces obligations légales, les collectivités locales sont livres de créer les SP de leurs choix à condition de rester
dans leurs domaines de compétences. La suppression d’un SP doit être prise par l’autorité qui en avait décidé la
création. Par ailleurs, certains SP obligatoires ne peuvent pas être supprimés.
B) Organisation
Tous les SP doivent respecter certaines règles appelées lois de Rolland. Ils doivent assurer :
- Continuité.
- L’adaptation.
- L’égalité des usagers.
1. Continuité des services publics.
Ce principe impose l’obligation d’assurer le fonctionnement régulier des SP sans autres interruptions que celles
prévues par les textes. La satisfaction de l’intérêt général ne peut être discontinu sauf pour certains SP
(urgences des hôpitaux). La continuité ne suppose pas une permanence mais les interruptions abusives sont
jugées illégales. Elles ne sont légales qu’en cas de force majeur. Le droit de grève n’est plus aujourd’hui
considéré comme radicalement incompatible avec le principe de continuité. Néanmoins, un service minimum
peut être institué en imposant des négociations préalables et des plans de priorité.
2. L’adaptation des services publics.
Aussi appelé principe de mutabilité, ce principe impose l’obligation de modifier les règles d’organisation et de
fonctionnement des SP pour tenir compte de l’évolution des besoins des usagers.
3. L’égalité devant les services publics.
Il impose l’obligation de traiter de façon identique les usagers du SP lorsque ceux-ci sont dans des situations
identiques. Des différences de traitements sont autorisées lorsqu’elles se justifient par des différences de
situations appréciables. Ce principe implique le respect de la neutralité politique et religieuse des SP. Il permet
aux usagers d’obtenir l’annulation des actes discriminatoires.
RMQ : le principe de gratuité des SP n’est pas un principe à valeur constitutionnelle ou même une obligation
légale. Par conséquent, ce n’est pas une loi du SP. Les SPA sont souvent gratuits (Police) mais les SPIC ne sont
pratiquement jamais gratuit.
III. Les modes de gestion des SP
A) La régie
Définition : c’est le mode de gestion selon lequel le service publique est exploité directement par la personne
publique dont il relève. Dans ce cas, l’administration gère elle-même le service avec son personnel et ses biens.
Les administrations traditionnelles qui assument l’essentiel des tâches publiques sont organisées selon ce

mode de gestion. En principe, les services en régie sont des SPA. Les règles du droit administratif s’appliquent
donc à eux : leurs agents sont des fonctionnaires. Leur responsabilité est engagée selon le droit administratif.
B) La concession de SP
Définition : C’est le mode de gestion d’un SP dans lequel la personne publique (concédant) charge par contrat
une autre personne (concessionnaire) de faire fonctionner à ces risques et périls un SP en lui permettant de se
rémunérer sur les usagers.
Le contrat de concession comporte donc une convention consacrant l’accord des parties et un cahier des
charges établit par l’administration indiquant les règles d’organisation et le fonctionnement du service. Le
concessionnaire qui a la qualité de commerçant est assujetti à des obligations et à des droits.
Obligations :
- Faire fonctionner le service lui-même.
- Obéir aux ordres de l’administration.
- Respecter les principes de fonctionnement du SP. (continuité, adaptation, égalité).
Droits :
- Bénéficie du monopole d’exploitation.
- Bénéficie des moyens matériels et juridiques que le concédant met à sa disposition pour faire
fonctionner le SP.
- Droit à des avantages financiers. Ex : Redevance des usagers, subventions.
C) La délégation de SP
Définition : contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un SP dont elle a la responsabilité à un
délégataire publique ou privé dont la rémunération est liée aux résultats de l’exploitation du service.
Elle ne constitue pas un nouveau mode de gestion des SP mais rassemble des sous catégories préexistantes
telles que les concessions, contrats de gérances et autres contrats voisins.
Les contrats de délégation de SP sont soumis à certaines règles juridiques spécifiques. Ex : concernant la
passation de ces contrats, la loi pose le principe général d’une procédure de publicité permettant la
présentation de plusieurs offres concurrentes. Les procédures de contrôle sur la publicité sont renforcées.
1
/
3
100%