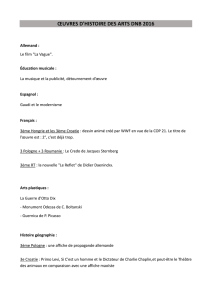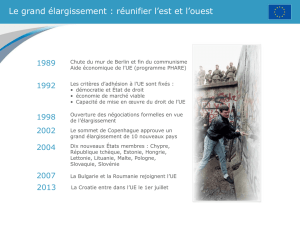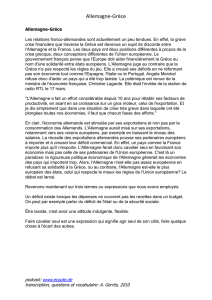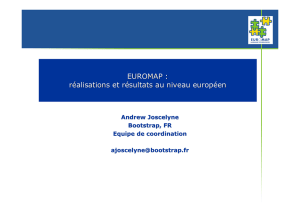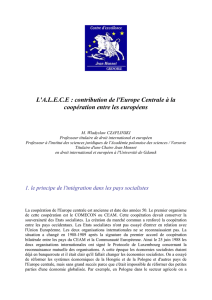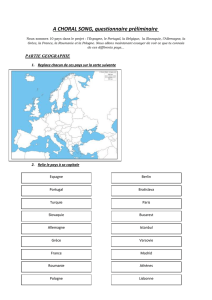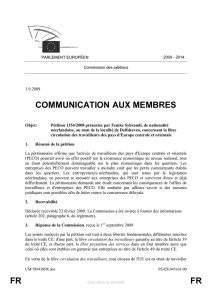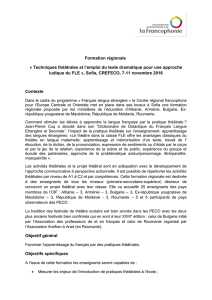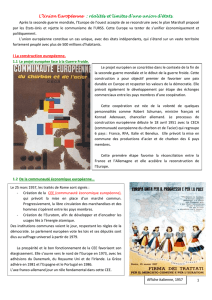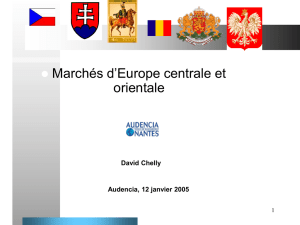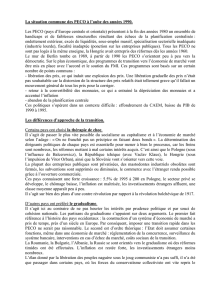L`élargissement : une réponse européenne au nouvel ordre

L'élargissement : une réponse européenne au nouvel ordre
économique mondial
Claude Martin
Même si l'élargissement de l'Europe est un véritable défi pour les quinze pays déjà membres,
l'UE n'a cessé de soutenir les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale en leur
offrant une perspective d'adhésion. Ce processus auquel se sont joints trois pays
méditerranéens (Chypre, Malte et la Turquie s'insère dans un contexte économique de
libéralisme et de mondialisation des échanges où les frontières et les règles du commerce
international évoluent constamment. De ce point de vue, l'élargissement peut être interprété
comme une réponse européenne au nouvel ordre économique mondial. Pour la grande Europe
de demain, les enjeux du développement sont liés aux potentiels d'échanges et à la
libéralisation des capitaux dans les pays candidats. Des problèmes économiques persistent. Ils
concernent, principalement, l'énergie, la reconversion de secteurs industriels, l'agriculture et le
marché du travail. Enfin, la démocratisation et les effets de décentralisation introduisent des
risques d'affaiblissement des Etats, avec l'apparition de nouveaux acteurs économiques, voire,
d'organisations illégales ou à la limite de la loi. Dans ces différents contextes, il paraît difficile
de formuler un scénario de l'après élargissement. S'agissant du développement des pays
candidats les plus avancés, on peut tirer quelques enseignements sur leurs perspectives, en
comparant leur situation avec celle de pays tels que la Grèce et le Portugal avant leur
adhésion. Plus globalement les problèmes concernent le devenir de la grande Europe et les
risques d'une périphérisation des économies d'Europe centrale. Parmi les hypothèses
formulées, la plus probable nous paraît être celle d'une Europe à plusieurs centres, Europe
dans laquelle les régions développeront leur propre logique de prospérité.

1. Mondialisation et recomposition de l’Europe. Deux histoires
parallèles
.1. Le nouveau contexte mondial
a mondialisation est un phénomène relativement récent, facilité par la révolution de
l'informatique (Internet) la chute du mur de Berlin et la libéralisation des mouvements de
capitaux dans l'Union Européenne . La mondialisation ne se limite pas à l'ouverture des
frontières ou à l'Investissement direct étranger. Elle se traduit par un rapprochement
économique, politique et écologique des sociétés, porté par des technologies (connexion des
entreprises et des marchés, télévision par satellite, Internet…). L'impact mondial de la crise
financière qui a commencé en juillet 1997 dans le Sud-Est asiatique illustre bien l'étendue et
la rapidité de ces interconnexions entre différents réseaux. La mondialisation correspond aussi
au basculement d'une bonne partie de la planète dans l'économie de marché et au triomphe du
libéralisme.
Historiquement, la libéralisation des échanges est un processus engagé par le GATT (General
Agreement on Tarifs and Trade) et souscrit par 23 pays occidentaux en 1947. Son programme
consistait à réduire les tarifs douaniers, limiter les barrières protectrices et éliminer les
discriminations en matière de commerce international. L'objectif était d'engager un processus
continu de libéralisation du commerce, favorable au développement de l'investissement, à la
création d'emplois et à l'expansion des échanges . Depuis 1947, diverses négociations vont
aboutir, en 1994, à la création de l'Organisation Mondiale du Commerce. L'OMC est une
organisation inter-gouvernementale à part entière. Signée à Marrakech par 125 Etats, sa
mission est d'élargir le champ de la libéralisation et d'arbitrer les conflits commerciaux.
Quatre ans plus tard, en 1999 à Seattle, l'OMC, avec 135 Etats membres, est devenue le cadre
réglementaire de la mondialisation de l'économie. Les pays signataires se sont engagés à
libéraliser l'agriculture et les services et à prendre quelques règles dans les domaines de
l'environnement, du social et de la santé. De même le projet de l'AMI (Accord Multilatéral sur
l'Investissement ) négocié dans le cadre de l'OCDE permettrait la non discrimination des
investisseurs étrangers en créant ainsi des droits mondiaux pour les entreprises .
2. L'émergence de l'Europe économique
Tandis que le monde se globalise, le dynamisme européen prend la forme d'un arc industriel
dont la pointe nord-ouest se trouve au niveau de Manchester, le centre en Rhénanie et
l'extrémité sud-est au cœur de l'Italie du Nord. La concentration urbaine et la densité du trafic
commercial font de cette épine dorsale de l'Europe, une des zones les plus actives au monde.
C'est autour de cette banane bleue ainsi perçue par les cosmonautes et photographiée par les
satellites, que se dessine l'Europe économique construite à partir de 1950.
L'association, en 1951, de six pays au sein de la Communauté Européenne du Charbon et de
l'Acier (CECA) , est le véritable point de départ du processus. En 1957, le Traité de Rome
réunit l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas au sein de
la Communauté Economique Européenne (CEE). Dès lors, l'Union Européenne ne cesse de
s'élargir du Nord au Sud avec l'adhésion successive, du Danemark, de l'Irlande et du Royaume

Uni en 1972,
de la Grèce en 1981, de l'Espagne et du Portugal en 1986, de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède en 1995. Les critères d'adhésion, fixés en 1993 à Copenhague, se définissent ainsi :
- être un pays européen (appartenance géographique, politique et culturelle)
- garantir la démocratie
- être compétitif sur les marchés de l'Union
- s'aligner sur la législation communautaire (acquis)
- souscrire aux objectifs politique, économique et monétaire de l'UE
En décembre 2002 à Copenhague, une fois de plus, les Présidents, Chanceliers et Premiers
Ministres de l'Union engagent un cinquième élargissement et décident d'intégrer dix nouveaux
membres parmi lesquels huit sont des Etats du Centre et du Nord de l'Europe et deux
appartiennent au Bassin Méditerranéen . L'adhésion de deux Etats balkaniques est reportée à
2007. La Turquie est reconnue comme treizième candidat. Le dynamisme politique du
continent européen est un fait remarquable. Une nouvelle géographie se dessine avec un
potentiel accru d'un million de kilomètres carrés en surface, une population de 370 millions
d'habitants et une économie de l'ordre de 9 milliards d'euros, capable de rivaliser avec celle
des Etats-Unis.
2. L'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale
Les 12 et 13 décembre derniers, le Conseil européen de Copenhague a permis de clore les
négociations avec dix pays (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Rép. tchèque, Slovaquie,
Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte), pour une adhésion définitive au 1er mai 2004.
Copenhague entérine également la clôture de l'ensemble des chapitres de négociation.
L'élargissement de l'Europe aux pays d'Europe centrale et orientale, quel que soit le délai et au
delà des inquiétudes qui se manifestent de part et d'autre, est l'occasion de prendre la mesure
des nouveaux potentiels dont dispose ou disposera l'Europe Unie en termes commerciaux et
financiers.
2.1. Les échanges commerciaux
Après l'effondrement du début des années 90, le commerce intérieur de l'Europe centrale a
connu une reprise grâce à la conjugaison du libre-échange et des stratégies des firmes
multinationales. Si l'on considère les 12 pays candidats en Europe centrale (incluant les pays
baltes et balkaniques) on observe que la presque totalité de leurs échanges sont réalisés avec
leur proximité immédiate, c'est-à-dire avec le reste de l'Europe. Toutefois, l'orientation et
l'importance des échanges varient selon la zone géographique et les secteurs d'activité.
Sur le plan géographique, on distingue trois groupes de pays :
- Les Pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) mais aussi une partie de la Pologne orientés
vers l'Europe du Nord et le Royaume Uni,
- Les Pays d'Europe centrale (Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie et Pologne
occidentale), orientés vers la zone Allemagne.
- les Pays Balkaniques (Bulgarie, Roumanie) plus orientés vers l'Italie, la Grèce et l'ex-
Yougoslavie et moins dépendants de l'Allemagne
Leurs résultats économiques varient selon les secteurs d'activité et leur localisation

géographique.
Ainsi, dans l'automobile, cinq pays candidats (Rép. Tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie et
Slovénie), réalisent 75 % des échanges du secteur avec l'UE 15.
Ces résultats s'expliquent en partie par la proximité des grands marchés européens, l'existence
d'une main d'œuvre spécialisée, combinée à des technologies modernes (importées), des
politiques fiscales et de formation et par un effort dans la préparation des sites de
délocalisation .
Si l'on cherche à comparer les pays membres de l'UE exportateurs vers les pays candidats
d'Europe centrale et des Balkans, il faut tenir compte de leurs performances intra-
communautaires et extra-communautaires. …).
Pour savoir si un pays est performant il faut rapporter le montant de ses exportations à
destination des pays candidats à ses exportations intra-communautaires. Ces performances
doivent être corrigées de la distance géographique (absence de frontière commune, liens
historiques ou culturels. La différence par rapport à l'équilibre permet d'apprécier la marge de
progression des exportations d'un pays de l'UE dans la zone PECO (Tableau 1).
Tableau 1. Taux de couverture des exportations potentielles par les exportations observées de
l'UE à destination des PECO (données 1997)
PECO Pologne Hongrie Slovaquie etTchéquie Bulgarie Roumanie
UE 15 51% 46% 97% 44% 41% 53%
France 60% 64% 74% 53% 35% 61%
Allemagne 45% 36% 137% 39% 43% 55%
Autriche 101% 65% 145% 94% 85% 90%
Italie 80% 88% 84% 67% 42% 102%
Sources : Elargissement. Série Stratégie. RES 06 - 23 avril 2001
Les performances commerciales de la France, inférieures au potentiel, dépassent la moyenne
des performances de ses partenaires. L'Autriche et l'Italie font mieux que la France.
Tableau 2. Taux de couverture des exportations potentielles par les exportations observées des
PECO à destination de l'UE en 1997
PECO* Pologne Hongrie Slovaquie etTchéquie Bulgarie Roumanie
UE 15 37% 28% 79% 32% 42% 47%
France 32% 29% 52% 23% 32% 43%
Allemagne 63% 27% 127% 32% 40% 53%
Autriche 35% 37% 101% 70% 39% 52%
Italie 28% 37% 59% 41% 61% 97%
Sources : Elargissement. Série Stratégie. RES 06 - 23 avril 2001
En sens inverse la marge de progression des exportations des PECO vers l'Union européenne
reste importante. Il est probable que les importations de l'Union en provenance des pays
candidats se renforceront plus rapidement que les exportations de l'Union vers ces pays
(Tableau 2).

Parmi les pays candidats, la Hongrie occupe une place particulière avec près de 80 % de ses
exportations à destination de l'Union.
La moindre performance d'autres pays candidats peut s'expliquer par leur mauvaise adaptation
à la demande européenne, par l'absence de maîtrise des techniques et des réseaux de vente.
2.2. Les mouvements de capitaux
Les possibilités financières des pays candidats sont liées aux mouvements de capitaux.
Dans l'Union Européenne, ceux-ci sont libéralisés pour toutes les formes d'investissements :
directs, immobiliers et de portefeuille. Dans les PECO, le processus de libéralisation des
mouvements de capitaux a déjà commencé et le désir d'adhésion accélère le processus.
La libéralisation produit des effets positifs lorsque l'économie nationale est stable et que les
politiques économiques sont crédibles. Dans toute l'Europe de l'Est, les systèmes bancaires
ont connu une profonde restructuration. Aujourd'hui ils sont presque complètement privatisés.
En 2002-2003, il faut s'attendre à l'achèvement des privatisations des grandes banques dans
six pays candidats (Pologne, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Roumanie et Bulgarie).
Les participations étrangères prévues fin 2002 dans les systèmes bancaires de ces pays sont de
l'ordre de 75 % en Pologne, 90 % en Lituanie, 83 % en Slovaquie, 41 % en Slovénie, 57 % en
Roumanie et 79 % en Bulgarie.
Certains pays bénéficient de financements pour renforcer leurs capacités administratives, leurs
infrastructures et leurs équipements (PHARE, ISPA et SAPARD) dont les principaux
bénéficiaires sont la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie.
Partout se sont ouverts des marchés financiers mais les transactions sont encore peu
diversifiées.
L'Investissement Direct Etranger (IDE) est perçu par les gouvernements de ces pays comme
un moyen indispensable pour accélérer le processus d'ajustement des entreprises et faciliter la
réintégration des économies dans l'économie mondiale. Au niveau économique,
l'investissement direct étranger a un rôle non négligeable sur l'investissement global y compris
sur la balance des paiements. En 2000, les IDE à destination des PECO se sont élevés à près
de 21 milliards de dollars. Cumulés depuis 1990, ils atteignent près de 100 milliards de dollars
pour l'ensemble de la zone, dont 80 % environ en provenance de l'Union. La répartition de
l'IDE n'est pas uniforme : la Pologne, la République Tchèque et la Hongrie en détiennent plus
de 70 %.
Les principaux investisseurs européens dans la zone ont été l'Allemagne (25 %), les Pays-Bas
(16%) et l'Autriche (14 %). La majeure partie de ces investissements porte sur quelques
projets industriels importants (automobile, télécommunication, hydrocarbure..) dans un
nombre réduit de pays, retenus en fonction de facteurs d'attraction.
Les implantations étrangères sont favorisées dans les secteurs prioritaires (industrie, grande
distribution, banques) et dans certaines régions. Ces investissements se répartissent entre les
PECO essentiellement selon l'avancement de leurs réformes à l'exception de la Pologne qui
tout en possédant le plus grand marché, en attire moins.
Les firmes multinationales de la zone Japon Asie -Pacifique investissent également dans les
PECO Pour les FMN, les changements survenus dans les PECO ont créé un nouvel espace
pour redéployer leurs activités. Elles disposent d'un pouvoir de négociation avec ces
gouvernements d'autant plus fort qu'elles peuvent choisir le lieu de leur délocalisation. Leur
mondialisation commerciale et financière s'appuie avant tout sur la mondialisation de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%