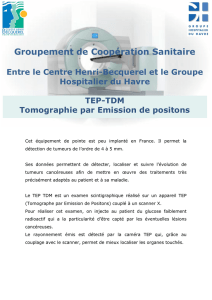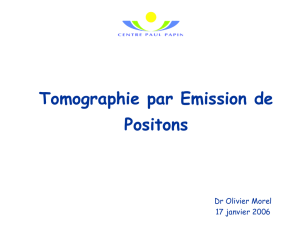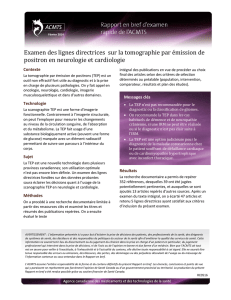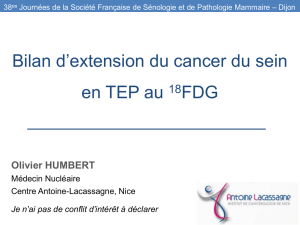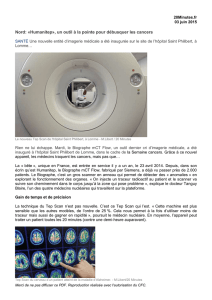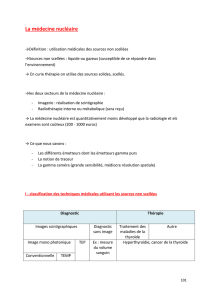Tomographie par émission de positons. pathologie ostéoarticulaire

Tomographie par émission de positons. pathologie ostéoarticulaire
L'imagerie occupe une place essentielle en rhumatologie. Si l'imagerie conventionnelle permet
désormais une visualisation anatomique précise des lésions, il lui reste très difficile de discriminer
les lésions évolutives « actives » des lésions séquellaires. Le couplage d'une information
anatomique et d'une information métabolique fonctionnelle est désormais possible grâce à
l'imagerie par émission de positons (TEP) , récemment mise à disposition des cliniciens. Outre les
indications oncologiques pour lesquelles elle est essentiellement utilisée, la TEP au 18F-FDG
pourrait avoir un intérêt tout particulier dans l'exploration des pathologies infectieuses et
inflammatoires, notamment dans les vascularites. Malgré des premières publications
prometteuses, les données disponibles ne permettent pas de définir précisément le rapport
coût/efficacité de cette exploration cartographique dans ces affections.
1. Les aspects techniques de la TEP
1.1. Métabolisme cellulaire du 18fluorodéoxyglucose (18F-FDG)
1.2. Propriétés physiques et détection du 18fluor (18F)
1.3. Méthodes de quantification
1.4. Modalités pratiques de l'examen
2. L'utilisation de la TEP au 18F-FDG en rhumatologie
2.1. TEP et maladies malignes
2.1.1. Lymphomes
2.1.2. Myélomes et plasmocytomes (Fig. 5)
2.1.3. Sarcomes osseux
2.2. TEP et maladies inflammatoires
2.2.1. Vascularites
2.2.1.1. Maladie de Horton (MH) et pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR)
2.2.1.2. La maladie de Takayasu (MT)
2.2.1.3. Les autres vascularites
2.2.2. Rhumatismes inflammatoires
2.3. TEP et maladies infectieuses
2.3.1. Infections de prothèses
2.3.2. Infections rachidiennes
2.4. TEP et indications diverses
2.4.1. Fractures vertébrales
2.4.2. Sarcoïdose

2.4.3. Fièvres au long cours (Fig. 7)
2.4.4. Autres indications
3. Conclusion
L'imagerie occupe une place essentielle dans le diagnostic et la prise en charge de la plupart des
affections rencontrées en rhumatologie. Malgré les progrès considérables récemment acquis, les
renseignements fournis par l'imagerie conventionnelle « anatomique » demeurent parfois
insuffisants. Si l'apport de l'imagerie fonctionnelle ou « métabolique » par tomographie par
émission de positons ( TEP) après injection de 18fluorodéoxyglucose (18F-FDG) n'est plus à
démontrer en cancérologie, d'autres indications émergent actuellement, notamment depuis
l'avènement des caméras de nouvelle génération associant, aux détecteurs dédiés, un scanner X
permettant une localisation tridimensionnelle précise des lésions « actives » au sens métabolique.
Toutefois, la place de cette imagerie mérite d'être précisée en étudiant de plus grandes séries de
patients.
1. Les aspects techniques de la TEP
1.1. Métabolisme cellulaire du 18fluorodéoxyglucose (18F-FDG)
En pratique courante, le traceur le plus utilisé pour la TEP est le 18F-FDG. À l'instar de son
analogue le 2-déoxyglucose, le 18F-FDG franchit la membrane cellulaire par diffusion facilitée à
l'aide d'un transporteur. Il est ensuite phosphorylé en 18F-FDG-6-phosphate (18F-FDG-6-P) par
l'hexokinase. Cependant, contrairement au glucose-6-phosphate, le 18F-FDG-6-P ne peut pas
servir de substrat à la glucose-6-phosphate isomérase et ne peut donc pas être impliqué dans les
étapes suivantes de la glycolyse ou de la néoglycogénèse.
L'accumulation du 18F-FDG-6-P dans la cellule est ainsi un reflet de la captation de glucose et de
l'activation du métabolisme glucidique.
1.2. Propriétés physiques et détection du 18fluor (18F)
Le 18F, utilisé pour marquer le déoxyglucose, est un noyau instable, émettant des électrons
chargés positivement, les positons, qui perdent leur énergie cinétique sur une très faible distance,
de l'ordre du millimètre. En fin de parcours, chaque positon se combine à un électron chargé
négativement. Cette rencontre aboutit à leur disparition, avec génération de deux photons
d'énergie bien définie (511 keV) et émis de façon synchrone dans des directions opposées. Du fait
de sa courte demi-vie (110 min), le 18F nécessite une source d'approvisionnement proche du
centre de l'examen.
La détection des émetteurs de positons nécessite des caméras dédiées (caméras TEP),
constituées de détecteurs répartis en anneau autour du patient. L'enregistrement quasi-simultané,
par deux détecteurs diamétralement opposés, de deux photons de 511 keV permet de connaître la
droite sur laquelle a eu lieu l'émission photonique, et donc de localiser les molécules de 18F-FDG.
Une reconstruction informatique permet de visualiser la distribution tridimensionnelle du traceur, et
l'image obtenue est par nature tomographique. Actuellement, les caméras modernes associent au
détecteur spécialisé une tomodensitométrie (TDM). Outre la correction d'atténuation, liée à la
perte de signal des organes les plus profonds, qu'offre la TDM, ce couplage permet une fusion des
images fonctionnelles et des images anatomiques, et une meilleure localisation des anomalies. La
résolution de la TDM couplée est fonction du choix de l'opérateur, et peut être millimétrique.
1.3. Méthodes de quantification

L'interprétation des images fournies par la TEP au 18F-FDG est le plus souvent qualitative, même
si une semi-quantification est possible, permettant un suivi évolutif.
1.4. Modalités pratiques de l'examen
Les patients doivent être explorés à jeun depuis 6 à 12 heures et ne doivent pas être perfusés en
glucose, du fait de la compétition entre le glucose et le 18F-FDG au niveau des transporteurs
membranaires. Cette précaution minimise notamment la captation myocardique physiologique du
traceur. Après injection du traceur, le patient demeure allongé dans une pièce répondant aux
normes de radioprotection, au calme, de préférence dans la pénombre et sans parler, afin de
diminuer les fixations musculaires indésirables. L'acquisition des images débute environ une heure
après l'injection, et dure moins d'une heure. La grossesse est une contre-indication formelle à
l'examen. Un diabète déséquilibré peut rendre plus difficile la détectabilité des lésions, en
minimisant la fixation du 18F-FDG.
2. L'utilisation de la TEP au 18F-FDG en rhumatologie
L'augmentation de la consommation de glucose par les cellules est la traduction d'une
augmentation du métabolisme cellulaire mais n'est pas obligatoirement synonyme de malignité.
Une fixation du 18F-FDG, même intense, peut en effet correspondre à une réaction tissulaire
inflammatoire ou granulomateuse, ou s'observer au cours d'une infection. Des études
autoradiographiques de lésions tumorales ont montré qu'un quart environ du 18F-FDG accumulé
était concentré dans les cellules inflammatoires péritumorales. Le principe même de la fixation du
18F-FDG laisse ainsi apparaître un champ d'applications important en rhumatologie.
2.1. TEP et maladies malignes
La TEP–18F-FDG, examen corps entier, semble avoir un intérêt particulier dans les lymphomes
malins, les sarcomes osseux et le myélome.
2.1.1. Lymphomes
La place de la TEP-18F-FDG dans la prise en charge des lymphomes malins, hodgkiniens ou non
hodgkiniens est maintenant bien définie. Le diagnostic repose exclusivement sur l'analyse d'un
prélèvement biopsique, ganglionnaire dans la majorité des cas, parfois osseux dans les rares
lymphomes osseux primitifs ou en cas de localisation osseuse associée. Bien que la majorité des
lymphomes fixent le 18F-FDG (à l'exception de quelques sous-types de lymphomes de bas grade
sources de faux négatifs), la TEP ne peut qu'exceptionnellement aider au diagnostic, en orientant
le siège de la biopsie.
En revanche, la TEP a une place de choix dans le bilan initial d'extension du lymphome. Plusieurs
études ont mis en évidence une meilleure sensibilité de cette technique, par rapport à la TDM,
dans cette indication (respectivement 79–99 % et 65–90 %). L'avantage de la TEP est surtout lié à
une meilleure détectabilité des localisations extraganglionnaires spléniques et médullaires,
présentes dans environ 15 % des cas de maladie d'Hodgkin (MDH) et dans 25 à 40 % des cas de
lymphomes malins non hodgkiniens (LNH). La TDM ne détecte les lésions médullaires que lorsque
l'atteinte osseuse est évoluée et l'IRM, bien que très sensible, ne permet actuellement l'exploration
du corps entier qu'avec difficulté.
Les conclusions d'une récente méta-analyse (13 études et 587 patients) [3] évaluant les
performances de la TEP -18F-FDG pour le dépistage d'un envahissement médullaire
lymphomateux en prenant pour référence la biopsie médullaire sont les suivantes :

● la sensibilité et la spécificité de la TEP -18F-FDG sont respectivement de 54 et de 92 %, avec
une meilleure sensibilité dans le groupe des MDH ;
● dans les LNH, la sensibilité dépend du type histologique, bien supérieure dans les formes les
plus agressives (76 contre 30 %).
Pour ces auteurs, l'intérêt de la TEP -18F-FDG est surtout de guider la biopsie médullaire sur un
site fixant le 18F-FDG lorsque les précédentes biopsies n'ont pas été contributives.
La TEP pratiquée lors du bilan initial de la maladie sert d'examen de référence dans l'évaluation
de la réponse thérapeutique.
La persistance d'une captation du traceur après les premières cures de chimiothérapie est de
mauvais pronostic et pourrait conduire à modifier le protocole thérapeutique. Cependant, la
période optimale de réalisation de la TEP reste à déterminer : une chimiothérapie en cours peut
faussement faire disparaître la fixation du 18F-FDG ; les facteurs de croissance doivent être
arrêtés environ cinq jours avant l'examen afin d'éviter les faux positifs liés à la régénération
hématopoïétique qu'ils induisent. D'éventuelles complications infectieuses induites par la
chimiothérapie peuvent également être une source de faux positifs.
À la fin du traitement, deux tiers des MDH et 50 % des LNH ont une masse résiduelle, mais
l'imagerie « conventionnelle » ne peut aisément faire la différence entre masse résiduelle active et
fibrose. Les performances de la TEP sont excellentes dans cette situation, avec, selon les
auteurs, une sensibilité de 71 à 100 %, une spécificité de 69 à 100 %, et une valeur prédictive
négative proche de 80 à 100 %.
2.1.2. Myélomes et plasmocytomes
Le traitement des gammapathies monoclonales malignes est fonction de la classification de la
maladie, telle que l'ont proposée Durie et Salmon. Dans cette classification, la présence ou non
d'une localisation osseuse joue un rôle essentiel. Si l'atteinte osseuse est évaluée dans cette
classification par les radiographies standard, la plupart des équipes y adjoignent une IRM
rachidienne, plus sensible dans le dépistage de l'infiltration médullaire, des lésions
infraradiologiques et dans la détection des lésions de l'arc postérieur.
La TEP pourrait avoir un intérêt tout particulier pour l'évaluation thérapeutique, notamment dans
les formes non sécrétantes, et permettrait de différencier tissu plasmocytaire et « cicatrice » après
traitement, à condition de réaliser cet examen au moins deux mois après la fin du traitement.
Cependant, ces premiers résultats méritent d'être confirmés sur de plus grands effectifs.
2.1.3. Sarcomes osseux
Bien que la plupart des auteurs aient montré une corrélation entre le degré de captation du traceur
et le grade histologique ou l'agressivité de la tumeur, la TEP -18F-FDG ne permet pas de
différencier de façon formelle tumeur bénigne et tumeur maligne de bas grade, voire de haut
grade. La biopsie demeure donc indispensable. En revanche, la TEP peut guider le geste vers
les zones tumorales les plus hypermétaboliques en cas d'hétérogénéité de fixation.
L'extension tumorale locale est au mieux étudiée par l'IRM. L'incidence des métastases
pulmonaires est évaluée à 80 % et leur résection, lorsqu'elle est possible, améliore le pronostic.
Elles sont souvent occultes lors du bilan initial et méconnues par la TDM en raison de leur petite
taille. Dans cette indication, la TEP ne semble pas supérieure au scanner. Cependant, la TEP,

examen corps entier, permet de dépister des lésions (osseuses ou des parties molles) jusqu'alors
méconnues.
La fréquence des métastases osseuses, habituellement détectées par la scintigraphie osseuse
aux bisphosphonates marqués au 99mTc, est estimée entre 10 et 20 % des cas.
Les différences de localisations des faux négatifs (au niveau de la voûte crânienne pour la TEP) et
des faux positifs selon l'imagerie utilisée, soulignent l'intérêt d'associer les deux modalités
d'imagerie.
La réponse à la chimiothérapie préopératoire néoadjuvante est un facteur pronostique essentiel,
un taux de nécrose tumorale supérieur à 90 % étant considéré comme une bonne réponse au
traitement. Plusieurs auteurs ont montré une corrélation entre la diminution du taux de captation
du 18F-FDG sous chimiothérapie et le degré de nécrose tumorale.
2.2. TEP et maladies inflammatoires
2.2.1. Vascularites
Les limites de la résolution spatiale des appareils de première génération restreignaient l'utilisation
de la TEP à l'étude des vascularites des artères de gros calibre et la plupart des travaux publiés
portaient sur la maladie d'Horton et la maladie de Takayasu. Les nouvelles machines comprenant
une TDM « multibarettes » couplée à un détecteur lui-même mieux résolu, permettent désormais
le rattachement de foyers hypermétaboliques à des petites structures vasculaires.
2.2.1.1. Maladie de Horton (MH) et pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR)
Dans sa forme classique de MH, la plus fréquente, intéressant les branches de la carotide externe,
notamment l'artère temporale superficielle, le diagnostic ne pose guère de difficulté et la TEP-18F-
FDG n'a pas d'intérêt diagnostique. En revanche, la TEP pourrait avoir une place dans le
dépistage des atteintes des vaisseaux de gros calibre dont la fréquence est estimée à 10–15 %
des cas. Des atteintes des artères sous-clavières et axillaires ont ainsi été diagnostiquées par la
TEP au 18F-FDG.
l'imagerie métabolique au 18F-FDG pourrait permettre un dépistage plus précoce de l'atteinte
artérielle (avant l'apparition d'un épaississement de la paroi ou d'une prise de contraste en TDM
ou IRM), dépistage essentiel notamment dans les atteintes aortiques dont on connaît la gravité
potentielle liée à la constitution d'un anévrisme. Par ailleurs, la TEP dans le suivi des patients
traités par corticothérapie montre une diminution de la fixation du 18F-FDG en quelques semaines
ou mois. La TEP pourrait être plus spécifique que les examens morphologiques (TDM et
IRM/ARM) qui ne peuvent discriminer aisément entre lésions évolutives et séquellaires, même si
certaines diminutions rapides du degré de fixation du traceur chez des patients dont la maladie
n'est pas encore contrôlée peuvent être expliquées par des modifications métaboliques induites
par la corticothérapie (telle qu'une diminution de l'expression membranaire des récepteurs GLUT-1
et GLUT-2.
L'utilisation de la TEP dans la MH pose en théorie le problème de la spécificité des images
vasculaires chez des patients souvent âgés. En effet, s'il n'existe pas de captation physiologique
du 18F-FDG par les parois artérielles saines, les plaques athéromateuses peuvent, en revanche,
capter le 18F-FDG. Dans la maladie athéromateuse, la fixation est habituellement discrète,
réalisant rarement une atteinte segmentaire homogène d'un seul tenant, et ne posant en pratique
que peu de problèmes diagnostiques, surtout avec l'apport de la TDM couplée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%