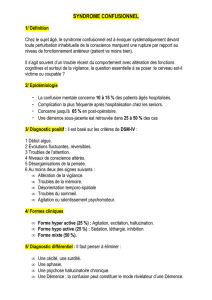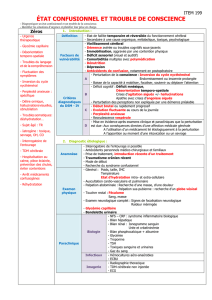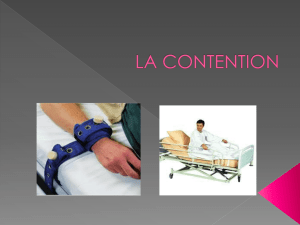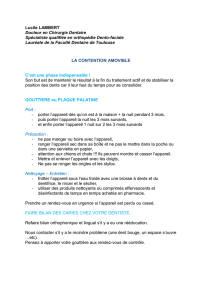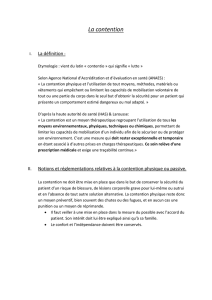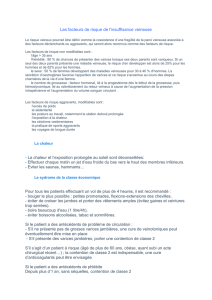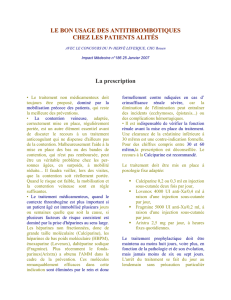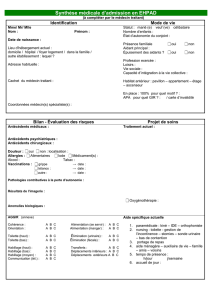universite de nantes - Service Central d`Authentification Université

1
UNIVERSITE DE NANTES
________
FACULTE DE MEDECINE
________
ANNEE 2008 N°6
THESE
pour le
DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE
QUALIFICATION EN MEDECINE GENERALE
par
Sophie BONNETIER PICHIERRI
Née le 1er Octobre 1978 à Le Mans
________
Présentée et soutenue publiquement le
Mercredi 5 Mars 2008
________
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DU SYNDROME
CONFUSIONNEL DU SUJET ÂGÉ HOSPITALISÉ :
UNE ÉVALUATION DES PRATIQUES PLURI PROFESSIONNELLES
EN COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE.
________
Président du Jury : Monsieur le Professeur Gilles BERRUT
Directeur de thèse : Monsieur le Docteur Pascal CHEVALET
INTRODUCTION
Le syndrome confusionnel survient de façon très fréquente chez les personnes
âgées hospitalisées.
La gravité du syndrome confusionnel du sujet âgé est liée à un risque accru de
complications médicales (chutes, complications de décubitus, déshydratation …) et

de complications sociales. La mortalité des patients, immédiate et à un an,
présentant un syndrome confusionnel est importante. Le pronostic fonctionnel peut
être réservé et, à long terme, le risque d’institutionnalisation et de troubles cognitifs
durables est majeur.
Il pose un problème de santé publique : augmentation du coût financier de
l’hospitalisation, de la durée de séjour, des besoins de surveillance, du coût des
aides à domicile ou de la vie en institution. Le syndrome confusionnel peut exister à
l’admission ou apparaître durant l’hospitalisation. On peut donc dans ce dernier cas
le considérer comme un marqueur de la qualité des soins.1,2
De nombreuses études ont été menées pour élaborer des méthodes de dépistage et
de prévention du syndrome confusionnel de la personne âgée, des outils
diagnostiques et des conseils pour sa prise en charge. Néanmoins, la définition
même du syndrome confusionnel reste controversée et les difficultés de sa prise en
charge chez le patient âgé sont multiples.
Les difficultés diagnostiques s’expliquent par le caractère sémiologique souvent
subjectif, par la fluctuation des troubles, par l’existence de différentes formes
cliniques parfois trompeuses. Le « piège » est plus grand encore chez des
personnes aux antécédents de démence ou de troubles psychiatriques. Le syndrome
confusionnel chez la personne âgée hospitalisée peut être méconnu.
Les difficultés thérapeutiques sont nombreuses. La prise en charge du syndrome
confusionnel est problématique et pose à tous les professionnels exerçant en
gériatrie des questions d’ordre éthique : l’utilisation des contentions physique et/ou
chimique, l’information à donner au patient, et l’implication de la famille dans le soin.
Ces problèmes peuvent générer une inquiétude pour les soignants.
La prise en charge des complications médicales est primordiale mais prend-on assez
en compte la souffrance psychologique du patient et de sa famille ?
Au regard de toutes ces problématiques, la prévention apparaît essentielle. Il est
ainsi important pour les équipes médicales et soignantes de savoir « repérer » les
sujets à risque de confusion.
L’enjeu est donc d’améliorer la prise en charge du syndrome confusionnel durant
l’hospitalisation dans le but de diminuer la survenue de complications et la durée des
troubles et ainsi la morbimortalité chez les patients âgés.
Peut-on élaborer, à travers la lecture d’articles, des recommandations simples,
applicables à un exercice professionnel dans un court séjour gériatrique ? Et peut-on
après étude des pratiques, aboutir à des actions d’amélioration ?
I. LE SYNDROME CONFUSIONNEL DU SUJET AGE
A.Définition
Le syndrome confusionnel (SC), « delirium » en anglais, se manifeste par une
perturbation cognitive globale, d’apparition brutale avec installation des signes sur
quelques heures ou quelques jours au maximum. Les signes sont fluctuants dans le
temps et en intensité. Il s’agit d’une faillite temporaire et potentiellement réversible du

fonctionnement cérébral.3 Cet état est transitoire mais peut durer de quelques jours à
plusieurs semaines.
Les facteurs étiologiques sont en général multiples (causes métaboliques,
organiques, toxiques, psychologiques) et peuvent parfois ne pas être retrouvés.
Les patients âgés sont particulièrement à risque. Le vieillissement cérébral, les
troubles sensoriels, la faiblesse organique expliquent cette fragilité. Le SC est un des
marqueurs cliniques d’un état de fragilité (« frail elderly »), comme la chute ou
l’incontinence.4
B.Historique
La confusion est déjà observée dans la Grèce Antique par Hippocrate (460-366 av.
J.-C.). 5
Il décrit des états d’agitation, d’excitation et d’insomnie sous le terme de « phrenitis »
ou encore des états de « lethargus » caractérisés par une somnolence, une inertie,
un émoussement des sens6, et ceci en accompagnement des fièvres ou d’autres
maladies graves, sans que l’on fasse le lien de cause à effet.
Il semblerait même que quelques années avant Hippocrate, Caelius Aurelianus
aurait utilisé la notion de « phrenitis »7.
C’est Celsus (25 av. J.-C.-50 apr. J.-C.) qui utilise le terme de « delirium » -du verbe
delirarer : s’écarter du sillon- pour décrire un trouble mental survenant dans les états
fébriles8.
Le terme de « confusion mentale » apparaît en France en 1851 avec Delasiauve9.
Pinel avait décrit en 1809 l’« idiotisme » après une émotion intense, et Esquirol avait
avancé le concept de « démence aiguë» en 1814.
Philippe Chaslin écrit en 1895 - dans « la confusion mentale primitive » :
« Les règles diagnostiques sont impossibles à établir d’une façon générale, car la
confusion mentale est plus que toute autre affection susceptible de revêtir une
apparence extrêmement variée. » 6
Il abandonne en 1915 cette définition au profit du « syndrome confusionnel ». Il
affirme ainsi une étiologie organique du trouble.
Régis et l’Ecole bordelaise avaient décrit en 1901 un état de torpeur avec une
désorientation. Plus tard ils insistent sur la recherche de la cause qui pour eux est
essentiellement de nature toxi-infectieuse.
Le terme de syndrome confusionnel sera préféré à celui de confusion pour mettre en
avant l’existence d’une affection somatique sous-jacente. 5
C.Physiopathologie
La physiopathologie du Syndrome Confusionnel du sujet Agé (SCA) est mal connue.
Elle est probablement multifactorielle.
1.Particularités du sujet âgé

Les modifications neuropsychologiques survenant avec l’âge expliquent une moindre
résistance aux facteurs de stress10. Le SC touche par conséquent particulièrement
les sujets âgés.
Le vieillissement cérébral est un phénomène complexe et difficile à étudier. En effet,
plusieurs mécanismes entrent en jeu et il est difficile de corréler la clinique ou les
capacités intellectuelles avec les données anatomiques, histologiques,
neurochimiques et vasculaires3.
Il se traduit par des modifications macroscopiques (diminution du poids cérébral,
atrophie corticale), des modifications histologiques (perte cellulaire, apparition de
plaques séniles, augmentation de la charge cellulaire en lipofuchsine), des
modifications neurochimiques (diminution du système dopaminergique, diminution
des enzymes du système cholinergique, diminution du système GABAergique).
Les modifications vasculaires sont controversées : la circulation cérébrale est
longtemps conservée, la diminution du débit sanguin cérébral serait donc la
conséquence et non la cause du vieillissement cérébral3.
De plus, les contextes culturel, psychoaffectif et sensoriel influencent le vieillissement
cérébral3.
2.De multiples hypothèses
Plusieurs hypothèses de physiopathologie sont émises.
Des déséquilibres dans la neurotransmission des voies cholinergique et
dopaminergique sont le plus souvent mis en cause1.
Inouye et al1 envisagent aussi le rôle des cytokines de l’inflammation par altération
de la neurotransmission et augmentation de la perméabilité de la barrière
encéphalique. Le stress chronique, par augmentation des cytokines et par
hypercortisolisme chronique constituerait également un facteur important.
Les enregistrements EEG ne sont pas spécifiques du SC. Il existe un ralentissement
global avec apparition d’ondes alpha et theta. L’EEG est similaire quelque soit la
forme clinique (en dehors des SC dus à un syndrome de sevrage en alcool ou en
benzodiazépines où il peut être normal). 8, 11
D.Diagnostic
1.Critères diagnostiques du DSM-IV
Il a longtemps été difficile pour les cliniciens de s’entendre sur une définition des
critères diagnostiques de ce que l’on appelait encore la « confusion ».
Actuellement, plusieurs études se basent sur la définition du « delirium » par
l’American Psychiatric Association dans le DSM-IV en 1995 12,13 :

A. Perturbation de la conscience (c'est-à-dire baisse d'une prise de conscience claire
de l'environnement) avec diminution de la capacité à mobiliser, focaliser, soutenir ou
déplacer l'attention, et avec une désorganisation de la pensée relevée par des
propos incohérents.
B. Modification du fonctionnement cognitif (tel qu'un déficit de la mémoire, une
désorientation temporo-spatiale, une perturbation du langage avec recherche de
mots et fuite des idées, une altération du cycle veille/sommeil, une augmentation ou
une diminution de l’activité) ou bien une perturbation des perceptions (illusions,
hallucinations) qui ne s’expliquent pas mieux par une démence préexistante,
stabilisée ou en évolution.
C. La perturbation s'installe en un temps court (habituellement quelques heures ou
quelques jours) et tend à avoir une évolution fluctuante tout au long de la journée.
D. Mise en évidence, d'après l'histoire de la maladie, l'examen physique ou les
examens complémentaires d'une perturbation due aux conséquences physiologiques
directes d'une affection médicale générale, d’une exposition à un toxique ou d’un
syndrome de sevrage.
Des troubles de l’humeur 11 sont aussi décrits avec une perplexité, une anxiété3, des
phases d’irritabilité, d’angoisse, de peur, des éléments de discours paranoïaques, et
des phases d’apathie, de troubles dépressifs1.
Le diagnostic est donc essentiellement clinique. Néanmoins tous ces critères sont
soumis à l’interprétation de l’examinateur. Les difficultés sémiologiques sont donc
bien réelles.
On retrouve dans les travaux anglo-saxons des outils diagnostiques réalisables au lit
du malade et reproductibles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
1
/
121
100%