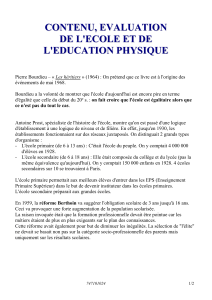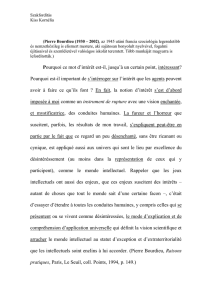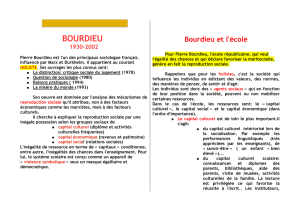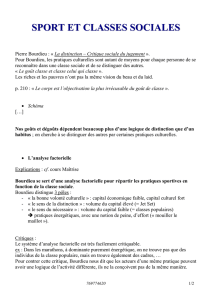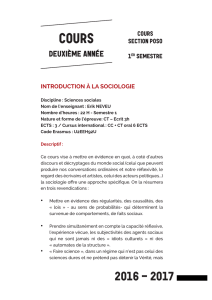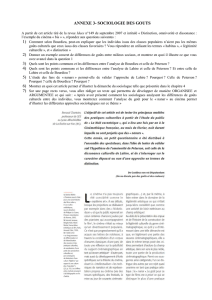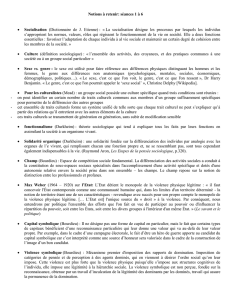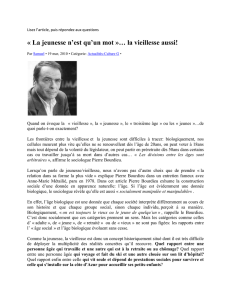Télécharger - l1sociologie

1
Chapitre 4. L’analyse sociale de la politique selon Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu
1
est né en 1930 et mort en 2002. Il a d’abord été philosophe de formation. Il
renvoie à toute une série de travaux connexes à la politique, ce qui est précieux pour apporter
des éclairages nouveaux sur le sujet.
Section 1. Les conditions sociales de la compétence politique
Dans un article
2
, Bourdieu dissèque le problème de l’abstention en se demandant quelles sont
au fond les conditions sociales pour qu’une réponse soit faite à une question politique. Ce
phénomène de l’abstention a été observé depuis longtemps, mais les politologues n’en ont pas
pour autant tiré de conséquences. Quelles sont sociologiquement les conditions qui permettent
à un individu d’exprimer ou simplement d’avoir des opinions politiques ? Cela consiste à se
demander quelle est la compétence minimale nécessaire pour produire une opinion. La
réponse minimale produite devant être replacée dans un ensemble d’opinions qui circulent
déjà la plupart du temps, qui sont déjà présentes dans la société. Pour réfléchir à cette
question, il faut tenir compte, d’un côté de ce que Pierre Bourdieu appelle le champ de
production idéologique (l’univers qui permet de produire des idées sur ou relevant de la
politique), et d’un autre côté des individus (les « agents ») qui occupent de fait des positions
sociales différentes dans la société, c’est-à-dire dans un espace social loin d’être homogène, et
qui est de fait hiérarchisé.
Il est nécessaire de tenir compte de cet univers
3
relativement autonome où s’élaborent, où se
conçoivent des outils de pensée du monde, disponibles à un moment donné, et qui définissent
du même coup le champ du pensable politiquement ou la « problématique légitime ». Les
agents sociaux ont une capacité plus ou moins grande de reconnaître la question politique
comme politique et donc de la traiter comme telle et non sur un autre plan (éthique,
religieux…). Cette capacité est inséparable d’un sentiment d’être compétent, c’est-à-dire
d’être socialement reconnu comme habilité, légitimé à répondre à cette question, à donner son
opinion, à s’occuper et à intervenir sur les affaires politiques, voire à modifier ou tenter de
modifier le cours des choses. On peut supposer que la compétence, au sens de capacité
technique c’est-à-dire au sens de culture politique, varie comme la compétence au sens de
capacité socialement reconnue. L’inverse de la capacité socialement reconnue c’est
l’impuissance, et cela entraîne l’exclusion objective (« ce n’est pas mon affaire ») et
subjective (« je m’en fiche »). Dans l’article, il reprend les analyses de sondages effectués par
IFOP et SOFRES entre 1968 et 1976. Il considère que la probabilité de répondre aux
questions d’un institut de sondage se définit dans chaque cas dans la relation entre une
question et un agent défini par une compétence déterminée. Bourdieu ajoute qu’on
comprendrait beaucoup mieux l’intérêt ou l’indifférence pour la politique si l’on savait voir
que la propension à répondre aux questions et donc à user d’un pouvoir politique est à la
mesure de la réalité de ce pouvoir. Les politologues ont tendance à ne pas analyser que
lorsqu’il y a absence de réponse ce n’est la plupart du temps que le résultat d’une
impuissance à appréhender la question politique. Pour Bourdieu, les politologues ne
comprennent pas que cette compétence technique dépend fondamentalement de la
1
Bibliographie indicative : La production de l’idéologie dominante, Pierre Bourdieu et Luc Boltansky, Editions
Raisons d’agir. Noblesse d’Etat, Grandes écoles et esprit de corps, Pierre Bourdieu. Introduction à une
sociologie critique – Lire Bourdieu, Alain Accardo.
2
Publié en 1977 dans le numéro 16 de la revue Actes de la recherche en sciences sociales (fondé par lui-même
en 1976)
3
Champ de production idéologique.

2
compétence sociale et du sentiment corrélatif d’être statutairement fondé et appelé à exercer
cette capacité spécifique. Il s’agit de comprendre une relation étroite qui existe entre ce que
Bourdieu appelle le « capital scolaire » et la propension à répondre aux questions politiques.
Il pose l’existence d’une relation à analyser. La difficulté est double : il ne s’agit pas
seulement de la capacité à comprendre le discours politique, ou de la capacité à reproduire un
point de vue politique, il faut également faire intervenir ce qui autorise et encourage chez les
individus ce sentiment d’être autorisé à parler politique, à donner son avis, c’est-à-dire à
mobiliser des principes de classement et d’analyse explicitement politiques au lieu de
répondre au coup par coup selon des principes d’un autre ordre (éthiques, religieux…)
A propos des principes éthiques ou moraux, Bourdieu fait remarquer que ce qu’on appelait
avant l’intelligence c’est aussi ce au nom de quoi nombre d’intellectuels du 19ème siècle ont pu
dénoncer les dangers du suffrage universel. Il prend un contre-exemple : méfions-nous de ces
questions de compétences intellectuelles, car en certaines époques certains intellectuels ne se
sont pas privés de faire comprendre que les affaires politiques méritaient une certaine
intelligence donc qu’on ne pouvait pas donner au peuple le suffrage universel car il n’était pas
doté de cette intelligence propre à gérer les phénomènes collectifs ou de société. En notre
époque, c’est cette même foi en la légitimité que confère cette compétence intellectuelle qui
pousse les intellectuels à se sentir obligés et autorisés à professer leur opinion sur les grandes
questions du moment. Si l’on prolonge ces réflexions sur l’analyse de cette question de la
compétence : on peut mieux comprendre que déplorer l’abstention, l’indifférence comme ont
pu le faire un certain nombre de commentateurs politiques pour mieux clamer les bienfaits de
la démocratie cela ne contribue pas à éclairer les faits politiques. Ces déplorations, ces
regrets cachent en réalité combien l’intérêt pour la politique dépend de la définition
sociale de la compétence politique réelle. Dans les commentaires, la plupart du temps, fait
défaut l’analyse des chances réellement garanties de participer vraiment à la politique.
Il
4
reprend un sondage où les gens étaient invités à exprimer spontanément leur point de vue
sur le système d’enseignement. Bourdieu s’arrête sur ce que les sondeurs appellent les non-
réponses à certaines questions. Phénomène banal, qu’on peut rapprocher du phénomène
d’abstention. Il y a là matière à déploration rituelle, et même un obstacle au bon
fonctionnement de la démocratie. Les non-réponses peuvent atteindre des taux supérieurs aux
taux des réponses exprimées. On rejette donc une information très précieuse : par le fait de
recalculer les pourcentages en éliminant les non-réponses, on crée quelque chose d’artificiel.
Tout groupe qui est placé devant un problème est susceptible d’avoir une opinion sur ce
problème et est susceptible de répondre positivement ou négativement sur ce problème. Il faut
mesurer le taux de légitimation sociale dans l’expression des réponses et non-réponses.
Le mécanisme selon lequel s’exprime l’opinion, à commencer par le vote, est un mécanisme
censitaire caché. Il faut poser la question sur ce qui détermine les personnes à répondre ou à
s’abstenir. Prendre au sérieux les silences, les abstentions, les non-réponses, c’est faire un
constat important dans l’analyse sociologique : faire ce constat c’est « construire un objet
nouveau ». Autrement dit, ce qui est objet de l’analyse sociologique est moins dans le
contenu, dans la nature des réponses, que dans la forme. Ce qui fait question c’est de savoir ce
que signifie le fait de soumettre un groupe à un sondage, à une enquête. C’est en quelque sorte
renverser les choses et c’est « construire l’objet de l’analyse sociologique ».
Les taux de réponses et non-réponses varient en fonction de la place occupée dans la société
par les agents. On débouche sur le poids des stratifications sociales, sur l’importance des
4
Droit à la parole, notion de compétence sociale, cf. conférence culture et politique, Lyon, Pierre Bourdieu.

3
positions occupées dans l’espace social, sur les « inégalités sociales » ou « dissymétries
sociales ». La compétence qui fait défaut n’est pas seulement technique, et c’est ce qui devrait
être interrogé, ce que tous les commentateurs politiques ont fortement tendance à éliminer.
Derrière ces corrélations se déploie en réalité une logique sociale qui conduit de manière
infaillible à ce mécanisme censitaire caché. Cela conduit donc à poser le problème de
l’analyse sociologique du système éducatif qui contribue pour une grande part à former cette
capacité sociale et à légitimer la parole. La production de cette compétence sociale est
l’expression ou le produit singulier d’un travail social
5
qui opère à travers l’Ecole et les
concours. Une « magie sociale » qui opère comme la religion parce que comme la religion
cette magie sociale a comme propriété d’instaurer une frontière entre le sacré et le profane. La
religion n’étant qu’un cas particulier de tous les actes d’institution de frontières qui instaurent
des différences de nature entre des réalités qui sont séparées en réalité par des différences
infinitésimales.
Section 2. L’opinion publique
6
Bourdieu a soulevé la question de la compétence statutaire. Il s’est alors déplacé vers la
thématique de l’opinion. Celle-ci est en permanence convoquée pour justifier de telle ou telle
décision ou proposition. C’est une critique des sondages, de leur usage et des chercheurs qui
les conçoivent et les réalisent, mais aussi des politiques qui s’en servent plus ou moins pour
assurer leur maintien.
Bourdieu met ainsi en lumière la « dépossession politique subie », selon des mécanismes
cachés, et d’autant plus cachés que nous sommes, en principe, dans des régimes
démocratiques dits de libre-opinion, où existe un suffrage universel... Les individus libres se
déchargent la plupart du temps sur des représentants.
Cette critique intervient à un moment où les chercheurs en sciences sociales sont de plus en
plus soumis aux demandes administratives ou politiques. Au début des années 1970 on est
dans un contexte de recherche, notamment de la recherche appliquée. Un psychosociologue,
Jean Stoetzel, dirige à Paris I un laboratoire de sciences sociales et l’IFOP. La critique que
formule Bourdieu ne vise pas à démolir les sondages. Le texte « L’opinion publique n’existe
pas » est intéressant parce qu’il pointe des questions qui sont à la fois des problèmes de
méthode et des problèmes épistémologiques qui posent la question du statut même de la
sociologie :
- Quand on lance une enquête de type « sondage d’opinion » on part du principe
que tout le monde peut produire une « opinion » sur tout et n’importe quoi, que
cela est à la portée de tous et que cela va de soi. Or cela ne va pas de soi, précisément.
- Les enquêteurs présupposent une équivalence stricte des opinions. Toutes les
opinions sont possibles, toutes les opinions se valent. Bourdieu explique qu’il n’en est
rien, plus encore en juxtaposant des pourcentages de oui et de non, de femmes et
d’hommes, donc en juxtaposant des opinions qui n’ont pas la même force et pas le
même impact dans la société, on est conduit à créer des images artificielles, des
artefacts.
- En lançant un sondage on fait l’hypothèse en posant simplement la même question à
tout le monde, qu’il existe un consensus sur ce qui constitue la question du
5
Une production collective de la société
6
L’opinion publique n’existe pas, Pierre Bourdieu et Textes de Pierre Bourdieu, rassemblés par Franck Poupeau,
aux éditions Agone, Sciences sociales et action politique.

4
sondage. On présuppose donc qu’un accord a été réalisé sur les problèmes qui
méritent (ou non) d’être étudiés.
Ces trois postulats impliquent toute une série de distorsions. Certains biais tiennent aux
conditions mêmes dans lesquelles sont amenés à travailler les enquêteurs. Des
commanditaires imposent en amont une problématique spécifique : cela peut être lié à une
conjoncture particulière, mais cela renvoie surtout dans la plupart des cas au fait que des
problèmes de société ont réussi à être traduits en termes politiques.
Ce que pointe Bourdieu, c’est le poids des préoccupations politiques des professionnels de
la politique. Entre ce qui fait question réellement pour les agents sociaux et les questions
qu’on leur fait se poser par les enquêtes d’opinion, les différences sont et demeurent
irréductibles. Il y a toujours le risque d’importer des perceptions dans la population étudiée.
Du point de vue du résultat de l’analyse critique formulée par Bourdieu, l’important est moins
dans les contenus détaillés des réponses que dans le déploiement même de cet outil
prétendument d’enquête. En réalité les sondages d’opinion se révèlent être de formidables
instruments politiques au service de « l’entreprise de domination politique », du
« travail politique ». On peut reporter cela au grand développement de l’outil sondage qui est
une façon d’enserrer le monde environnant dans un filet d’opinions tendu d’un extrême à
l’autre. Le sondage d’opinion est un moyen de pression politique qui ressemble à une
addition de réponses individuelles qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre, et cela pour créer
une image artificielle de l’opinion, à un moment donné, qui serait « l’opinion publique ».
Le propre de tout rapport de force c’est de n’être efficace que dans la mesure où il se
dissimule. « Dieu est avec nous » devient aujourd’hui « l’opinion publique est avec nous ».
Cette opinion publique, opinion « moyenne », serait le consensus autour d’une question,
cependant c’est un artefact qui cherche à dissimuler que ce qu’on représente avec un
pourcentage, l’état de l’opinion à un moment donné, n’est rien d’autre qu’un faisceau de
forces tendues en interaction entre elles et que cette opinion moyenne, cette doxa,
n’existe pas. D’autre part, il est à noter que les gens ne comprennent pas tous les questions de
la même façon, surtout si ce sont des questions qu’ils ne se sont jamais posées. Il serait
impératif de se demander à quelles questions les diverses catégories de répondants ont cru
répondre :
- Problème de la compétence politique : cette compétence technique n’est pas
universellement répandue, elle varie notamment selon le niveau d’instruction.
- Le principe de l’éthos de classe : terme qu’on englobe de façon plus systématique
sous le concept d’habitus. Derrière ce concept, Bourdieu renvoie à tout ce qui
concerne ce système de valeurs implicites qu’on a intériorisées depuis l’enfance,
système autour duquel nous produisons des réponses aux questions qui se posent à
nous dans notre vie quotidienne. Il s’agit là de toute l’éducation de la prime enfance, et
également des expériences personnelles que l’on accumule au fil de notre vie. Cela
détermine notamment nos affinités, nos goûts… Bourdieu souligne que l’on apprend
« par corps » : tout ce que nous vivons depuis notre plus tendre enfance nous
influence, donc on pourra repérer des différences en fonction de la classe sociale
d’origine, des différences de culture, de revenus…
- plus les individus sont intéressés par un problème donné, plus il y a de chances qu’une
opinion puisse être produite. Cela revient à dire qu’existent des opinions constituées,
des opinions mobilisées, et selon Bourdieu « essentiellement sous forme de groupes,
voire de groupes de pression ». C’est une des manifestations du travail politique, qui
revient à définir politiquement certains problèmes précis.

5
Cette opinion publique, pur produit des instituts de sondages, n’existe pas. C’est bel et bien un
pur artefact, ce qui ne contredit pas le fait que cette « opinion publique » se déploie à travers
l’enquête d’opinion et surtout à travers le développement de son usage au service des hommes
politiques. On pointe ici tout le travail de communication ou marketing politique qui sous-
tend actuellement la redéfinition de la politique
7
.
Au travers de cette question se superposent tout un ensemble de techniques qui visent à
déplacer, voire à décrédibiliser toute l’importance de l’échange et de la délibération en
politique. Déjà en 1972, dans un article paru dans la revue Minuit, Bourdieu soulignait le
phénomène de dépolitisation, de dépossession de la politique qu’il constatait à l’époque.
Section 3. Lutte politique et travail politique
La politique, considérée sous l’angle des affrontements, surtout si on prend comme cadre la
compétition électorale, n’est pas une lutte où se déploie un « débat d’idées ». La lutte
politique n’est pas forcément le débat d’idées. Contre cette illusion, il importe de saisir ce qui
constitue le poids ou la force des idées qui semblent circuler ou s’échanger librement dans
l’arène politique. L’idée politique, pour Bourdieu dans l’article Questions de politique
8
est
plutôt une idée-force qui a d’autant plus de chances de peser qu’elle peut s’appuyer sur un
groupe social nombreux et puissant. Ce qui compte, du point de vue des idées en circulation
dans le monde politique, c’est la force du groupe qui est concerné, visé, mobilisé. Il faut en
revenir au travail politique spécifique conduit par les « professionnels de la politique », le
travail de représentation.
Comment interroger ce travail de représentation ?
C’est ce travail que les agents sociaux ne cessent d’accomplir pour imposer leur vision
du monde ou leur identité sociale. La perception du monde social implique un acte de
construction qui se réalise pour l’essentiel dans la pratique. Ce qui va compter ici c’est la
position occupée par les agents dans l’espace social. Les catégories à travers lesquelles
nous percevons le monde social expriment ce que nous avons intériorisé de la structure de
l’espace social.
Ces catégories de perception conduisent les agents à prendre le monde social tel qu’il est, à
l’accepter comme allant de soi, au lieu de se rebeller ou de lui opposer d’autres possibles. En
fait, on peut dire que les rapports de force sont également présents dans nos consciences
justement sous la forme des catégories de perception de ces rapports. La connaissance du
monde social, les catégories qui rendent possible et pensable cette connaissance, ce sont
l’enjeu par excellence de la lutte politique, lutte inséparablement théorique et pratique pour
conserver ou transformer le monde social grâce au travail sur ces représentations. Loin de la
compréhension routinière de la politique, l’un des enjeux majeurs de la politique renvoie à la
connaissance, à la compréhension du monde. Bourdieu montre ce qui s’accomplit de la
manière la plus criante, mais aussi la plus banalisée, cette expérience quotidienne qui est celle
du langage et de ses propriétés singulières.
Autre façon de dire les choses : l’une des dimensions fondamentales du travail politique
réside dans ce travail insoupçonné d’énonciation, de description, de commentaire. Ce travail
7
Patrick Champagne, Faire l’opinion, le nouveau jeu politique, éditions de minuit.
8
Dans Questions de sociologie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%