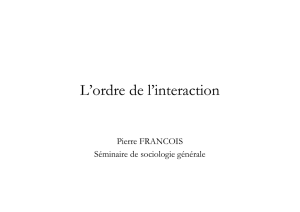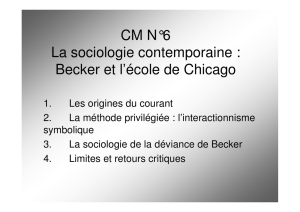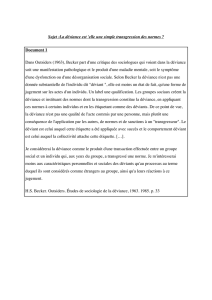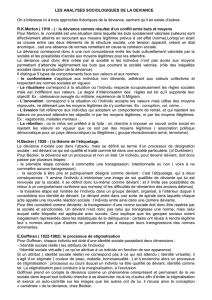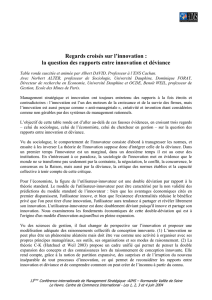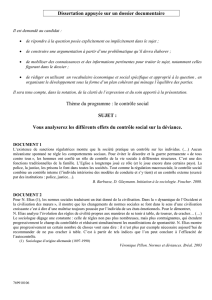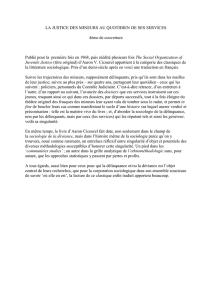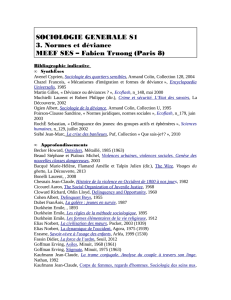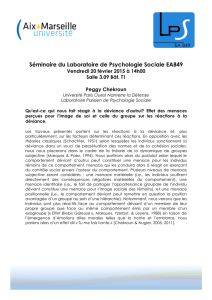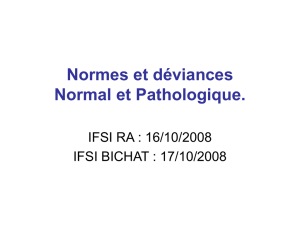Interactionnisme symbolique et ethnométhodologie

1
INTERACTIONNISME SYMBOLIQUE ET ETHNOMETHODOLOGIE
INTRODUCTION : UN VIRAGE DANS LES CONCEPTIONS SOCIOLOGIQUES
Dès sa fondation, la discipline sociologique a été pensée comme une science générale
des sociétés. Et, depuis lors, plusieurs paradigmes se croisent dans l’optique d’expliquer les
« faits sociaux », leurs relations fonctionnelles, leurs facteurs déterminants, etc. Or, dès la fin
du XIXe siècle, d’autres courants se sont développés en parallèle, sur la base d’une méthode
« qualitative » : l’Interactionnisme symbolique et l’Ethnométhodologie. Deux courants
connexes qui trouvent, entre autres, leurs origines dans ce que l’on appelle l’Ecole de
Chicago et la sociologie phénoménologique.
En effet, si la sociologie classique, relevant d’une démarche « objectiviste » et
« holiste », vise une explication des faits sociaux (pourquoi ?), en tant que « choses »
extérieures aux « agents », l’interactionnisme et l’ethnométhodologie ont pour principale
caractéristique de réintroduire le point de vue des acteurs dans l’analyse des phénomènes
sociaux. Cette démarche, qui radicalise la discipline par sa posture davantage « subjectiviste »
et « individualiste », souhaite par là comprendre le sens des phénomènes et des rapports
sociaux (comment ?), ceci via les interactions et la communication propres à la vie
quotidienne – dans la lignée de la sociologie de l’action sociale de M. Weber. Passant d’un
modèle hypothético-déductif à un modèle empirico-inductif, ce courant met en liaison la
sociologie et l’ethnologie d’une part (méthodes), et la psychologie d’autre part (sujets en
interaction). Avec la sociologie qualitative, qui s’arme des méthodes et des outils de
l’anthropologie (observations, entretiens, récits de vie…), on passe donc d’une analyse
quantitative (statistique) et macrosociale à une perspective empirique et microsociologique.
Par opposition au « déterminisme » de la sociologie dominante, on peut dire que
l’interactionnisme symbolique et l’ethnométhodologie relèvent d’un paradigme
« constructiviste », en ce qu’ils portent le regard sur les constructions sociales qui découlent
des interactions entre les individus, les acteurs, les membres… Contradictoires,
complémentaires, voire conflictuelles (Cf. G. Simmel), ces interactions humaines dynamisent
la « chose » sociale, elles la construisent au jour le jour. E. Goffman, auteur influent de ce
paradigme, considère que les individus ne peuvent être réduits à de simples « agents » des
institutions sociales (Cf. P. Bourdieu). Pour lui, l’individu sociologique se définit comme :
« Un être capable de distanciation, c’est-à-dire capable d’adopter une position intermédiaire
entre l’identification et l’opposition à l’institution et prêt, à la moindre pression, à réagir en
modifiant son attitude dans un sens ou dans l’autre pour retrouver son équilibre. » (Goffman,
Asiles, 1968).
À partir des années 1950, l’interactionnisme symbolique renouvelle la tradition dite de
l’« Ecole de Chicago », courant qui plonge ses racines dans le pragmatisme du philosophe J.
Dewey, la sociologie des « formes » de G. Simmel, les approches psychosociologique de
G.H. Mead, etc.
L’ECOLE DE CHICAGO ET LES ETAPES FONDATRICES DE L’INTERACTIONNISME
L’université de Chicago et son département de sociologie ouvrent en 1892. Dès l’abord,
la discipline se tourne vers l’observation et l’analyse du monde contemporain et des
phénomènes singuliers qui traversent, à cette époque, la ville de Chicago. Contexte :
subissant, à la fin du XIXe siècle, un accroissement démographique et industriel important, la
ville de Chicago rencontre dans le même temps un flux migratoire massif qui s’accompagne

2
de problèmes liés à l’emploi et de conflits ethniques périodiques entre les anciens et les néo-
immigrants, voire d’émeutes violentes. Chicago est alors le théâtre de multiples « problèmes
urbains » : pauvreté, zones d’habitats délabrés, délinquance, criminalité, conflits
interculturels… Ces problèmes traduisent un profond malaise social.
Les sociologues de la première période de l’Ecole de Chicago, relayés par les
travailleurs sociaux, décident d’intervenir pour régler ces problèmes. Il s’agit de comprendre
pour répondre à une demande sociale. Ils se placent au cœur de la vie des populations
déracinées, afin de mieux comprendre leur rapport à la société. Ils occupent l’espace,
observent la déviance, les gangs, les migrants, la marginalité, les minorités ethniques, le
crime, etc. Ainsi mobilisée, la sociologie doit être moins académique, plus pratique, ne serait-
ce que pour entrer au cœur des « lieux » et des problèmes, pour en dénouer les logiques et les
enjeux. En étudiant la ville, le monde urbain, l’immigration et la déviance, les chercheurs de
Chicago forgent un des courants les plus influents de la sociologie américaine.
Avant de se systématiser dans l’Interactionnisme, la sociologie empirique de Chicago
fut initiée et institutionnalisée par A.W. Small (fondateur du département et de la revue
American Journal of Sociology), W. Thomas (auteur avec F. Zaniecki du livre Le Paysan
polonais en Europe et aux Etats-Unis, 1918) ou encore R. Park (journaliste reconverti à la
sociologie et ancien étudiant de Simmel) et E.W. Burgess.
Jusqu’aux années 1920 et 1930, ce courant tient une place centrale dans la sociologie
américaine. Park, N. Anderson (Le hobo, 1923) ou F. Trasher (les « gangs de quartier »
comme forme de réorganisation sociale) poursuivent une analyse microsociologique de la
ville et des formes concrètes de la vie urbaine. On parle alors d’écologie urbaine. Car
l’urbanité engendre un mode de vie particulier : autonomie individuelle et anonymat ;
contacts incessants mais superficiels, impersonnels et fragmentés ; distinction des attitudes ;
etc. La ville est de fait l’espace d’un processus de compétition et de sélection pour
l’appropriation d’un territoire. L’écologie urbaine s’intéresse aux « aires » de répartition des
populations, à leur occupation, leurs transformations. Car les vagues successives de migrants
transforment la ville, d’où une instabilité de l’équilibre urbain qui s’illustre par une
« désorganisation-réorganisation ».
La ville de Chicago est qualifiée de « laboratoire social ». Au moyen de l’observation
participante in situ, les sociologues analysent les interactions sociales. Ces descriptions des
interactions s’accompagnent d’un recueil du ressenti, des représentations, des définitions
qu’en donnent les acteurs... catégories au moyen desquelles les acteurs interprètent et donnent
du sens à la vie sociale. Thomas parle d’une « définition de la situation » : « Quand les
hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs
conséquences. » (Thomas, The child in America, 1932) Par la suite, Goffman définira les
interactions comme un « système social en miniature » : « L’influence réciproque que les
partenaires exercent sur leurs actions respectives lorsqu’ils sont en présence physique
immédiate les uns des autres » (Goffman, Les cadres de l’expérience, 1974).
La seconde période de la tradition de Chicago (de l’entre-deux guerres aux années
1950), dont H. Blumer (à l’origine de l’expression « interaction symbolique », 1937) et E.
Hughes sont les figures centrales, affirme la démarche empirique inaugurée par leurs
prédécesseurs. À ceux-ci viennent se lier deux anthropologues, L.W. Warner et R. Redfield,
qui apporteront leurs savoirs quant à la méthode ethnographique. Blumer insiste sur le fait que
les individus agissent en fonction des significations qu’ils donnent à leurs actions. C’est ce
regard porté sur le « sens vécu » des expériences et sur les divers « cadres » sociaux qui
conduiront plus tard Goffman à dire que : « Les sociologues doivent parler du point de vue

3
des gens qu’ils étudient parce que c’est depuis cette perspective que se construit le monde
qu’ils analysent ».
L’INTERACTIONNISME SYMBOLIQUE
Les principaux apports de l’interactionnisme tiennent à différentes figures de la
philosophie pragmatiste, comme J. Dewey, et de la psychologie sociale avec G.H. Mead et
C.H. Cooley. Pour eux, la « réalité » n’est pas donnée, elle relève d’une « transaction »
constante et variant en fonction des interactions. Ces chercheurs de « terrain » pensent que la
connaissance, sociale ou scientifique, s’acquiert et s’éprouve dans et à l’épreuve d’une
expérience.
Mead, dont Blumer reprendra la chaire, tient parmi les théoriciens les plus influents de
ce courant. On lui doit d’avoir étayé le concept de socialisation. Il aborde la « construction de
soi » sous l’angle psychosociologique, c’est-à-dire en rupture avec le modèle déterministe de
la socialisation par inculcation sur un sujet passif. Selon lui, le « soi » s’élabore dès le plus
jeune âge dans un rapport dialectique entre le « moi » et le « je ». Chaque individu se
constitue dans un maillage entre le psychique, le groupal et le sociétal : « Le ‘je’ est la
réponse de l’organisme aux attitudes des autres ; le ‘moi’ est l’ensemble organisé d’attitudes
que je prête aux autres. Les attitudes des autres constituent le ‘moi’ organisé et on réagit
alors face à cela en tant que ‘je’ ». (Mead, L’esprit, le soi, la société, 1934). Mead élabore un
modèle dynamique de la socialisation du sujet, un sujet actif dont « l’esprit n’est que le
développement et le produit d’une interaction sociale ».
Au cours du processus de socialisation/éducation, le sujet intériorise ce que Mead
appelle des « symboles » : langage, « gestes significatifs » et des « rôles » sociaux incarnés
par des « autrui significatifs » (père, mère, professeur…) Au cœur de la communication
interindividuelle, ces « symboles » nous permettent d’entrer en interaction et, après
interprétation, de « prendre la place de l’autre ». De cette analyse naîtra l’appellation
Interactionnisme symbolique.
Selon Mead, l’interprétation émerge très tôt chez l’enfant. En s’identifiant, par le biais
de jeux de rôles libres, à des autrui significatifs, les enfants intériorisent peu à peu leur
environnement socioculturel. De fait, ils s’identifient symboliquement à ce qu’il nomme
« autrui généralisé » (groupe, communauté, société, club, bande…) À cela, trois principes :
c’est le sens qui guide l’individu dans différentes directions ; ce sens naît ou glisse des
interactions ; et il subit enfin une interprétation.
Depuis les années 1950, l’interactionnisme a donné lieu à une pléthore d’enquêtes
empiriques, lesquelles ont largement renouvelé le regard sociologique. Différents concepts et
théories en ressortent avec une certaine prégnance, travaux qui, avec Becker et Goffman,
portent notamment sur la déviance et la stigmatisation.
H. S. BECKER ET LA THEORIE SOCIOLOGIQUE DE LA « DEVIANCE »
Le terme « déviance » est d’un usage récent (années 1960). Dans son sens
psychologique, il signifie « comportement qui échappe aux règles admises par la société ».
Plus précisément, cet adjectif permet de désigner une « personne dont le comportement
s’écarte de la norme sociale admise ». De fait, pour que déviance il y est, il faut trois
éléments : une norme ; une transgression de la norme ; une désignation de cette transgression.
Les normes (du latin norma, équerre, règle) représentent l’ensemble des règles qui régissent
les conduites individuelles et collectives. Pendant la socialisation, les individus intériorisent

4
l’ensemble des prescriptions et des normes de leur société, culture, religion… Par ce fait
même, ils respectent l’ordre social et, pour une grande majorité, ils ne transgressent pas les
limites.
La statistique désigne la déviance comme un écart par rapport à la moyenne, mais
l’approche interactionniste de Becker en fait un concept dynamique (relation). Car normes et
déviances sont deux notions relatives. Elles varient dans le temps, l’espace, les groupes, les
sociétés… Elles ne sont pas instituées définitivement et sont l’objet d’un contrôle (société) et
d’une régulation (groupe). Ainsi, les Etats comme les communautés veillent à leur respect,
auquel cas tout individu s’expose à des sanctions mises en œuvre par des instances coercitives
(police, système judiciaire…) Becker considère qu’un acte n’est pas en soi déviant, c’est la
réaction des autres qui le catégorise comme une déviance. La déviance est donc un construit
social qui résulte d’une interaction entre les « déviants » et ceux qui le constatent. De plus,
certaines personnes créent des normes qui un jour entreront dans les usages, voire généreront
des lois.
La sociologie américaine (depuis les années 1950) s’intéresse à la déviance et se
demande pourquoi les normes sont transgressées. La recherche de Becker intitulée Outsiders
(étranger à la société) constitue une étape importante du développement de la sociologie de la
déviance, puisqu’elle élargit les études sur la délinquance. Becker, ancien élève de Hughes, se
donne pour objectif d’analyser l’ensemble des relations qu’entretiennent toutes les parties
impliquées dans le procès de la déviance. Il part de la question suivante : comment les
groupes sociaux ou la société en arrivent-ils à créer de la déviance ?
Jusqu’au début des années 1960, les études sur la déviance portaient sur le milieu social
dudit déviant et sur sa personnalité. Ainsi l’écologie urbaine interprétait la déviance à partir
de la désorganisation sociale. Le courant culturaliste mettait, pour sa part, en évidence
l’existence de sous cultures délinquantes. Enfin, R. Merton, suivant une perspective
fonctionnaliste, a emprunté le concept d’« anomie » pour expliquer le phénomène.
Dans Outsiders, on constate que l’élément constitutif de la déviance n’est plus le
comportement en tant que tel de l’individu déviant mais le fait que la société le qualifie ainsi :
« Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès », dit Becker qui pose
trois hypothèses : a) Les groupes créent la déviance en créant des normes dont la
transgression constitue la déviance. b) Le caractère déviant ou non d’un acte dépend de la
manière dont les autres réagissent – la déviance n’est pas le comportement, mais l’interaction
entre le déviant et les non-déviants. c) Les normes sont l’objet de désaccords et de conflits.
Elles relèvent en outre d’un processus sociopolitique.
Types de comportements déviants (Becker, Outsiders, 1963) :
Obéissant à la norme
Transgressant la norme
Perçu comme déviant
Accusé à tort
Pleinement déviant
Non perçu comme déviant
Conforme
Secrètement déviant
Becker propose une analyse dynamique de la déviance. Il recourt pour cela au concept
de « carrière » — développé par Hughes — et construit un modèle « séquentiel » qui prend en
compte les changements du comportement déviant. Toutes les causes n`agissent pas au même
moment. La compréhension du comportement final passe par la mise en évidence de chaque
phase intermédiaire de la « carrière » déviante : a) L’individu commet une première

5
transgression. b) Celle-ci est « étiquetée » par les proches et les instances du contrôle social.
c) Cet étiquetage empêche le transgresseur de continuer à agir dans le cadre légal. d)
L’individu en vient peu à peu à s’apprécier comme déviant en intériorisant l’image de soi que
lui renvoie la société. d) L’étiquetage pousse l’individu à commettre de nouvelles
transgressions, et à rencontrer d’autres transgresseurs plus chevronnés pour s’initier plus
avant. Becker ajoute ceci : « Ce ne sont pas les motivations déviantes qui conduisent au
comportement déviant mais à l`inverse c`est le comportement déviant qui produit au fil du
temps la motivation déviante ». (Becker, Outsiders, 1963). En montrant « comment on devient
fumeur de marijuana », il expose les différents temps qui rythment la pratique : a)
L’apprentissage de la technique. b) Celui de la perception des effets. c) Celui du goût pour les
effets.
Les grandes étapes de sa théorie de l’« étiquetage » sont les suivantes : a) L’auteur
précise le double sens du terme « outsiders » : il englobe les situations où la norme est
transgressée et celles où on la fait appliquer. D’où un nécessaire double point de vue :
« accusés » (stigmatisés) et « accusateurs ». b) Définition de la déviance qui inclue la réaction
d’autrui sur le phénomène. Becker parle du « produit d`une transaction », d’une propriété de
l’interaction entre le transgresseur et la personne qui réagit à cet acte. c) Le concept de
« carrière » permet à Becker de déterminer le cheminement de la déviance d’un individu, sa
trajectoire.
De manière à comprendre l’autre versant du phénomène, Becker a porté le regard sur ce
qu’il a appelé « les entrepreneurs de moral ». Ces « gens qui élaborent et font appliquer les
normes auxquelles ces déviants ne se conforment pas » sont, selon lui, au coeur du
phénomène de déviance. L’intérêt est de voir qui établit les normes et par quel processus on
les fait respecter. Il constate que, jusqu’à son application, la norme relève d’un processus : a)
Un esprit d’entreprise et un entrepreneur sont nécessaires. b) L’infraction doit ensuite être
rendue publique. c) Ces entrepreneurs y trouvent un avantage, un intérêt personnel. Dans le
cas de l’usage de la marijuana et de sa législation, Becker constate que l’idée de la création
d’une norme et de sa mise en vigueur est liée aux initiatives personnelles des « entrepreneurs
de morale ». Il y en a deux types : a) Les premiers, qui créent les normes, cherchent à
supprimer le « vice » et souhaitent « aider ceux qui sont en dessous d’eux à améliorer leur
statut ». b) Les seconds, une fois la norme élaborée et les lois créées, les font appliquer.
Avec Becker, on voit bien que la déviance est le résultat des réactions et des initiatives
d’autrui. La société crée de la déviance, par réaction aux transgressions, puis en instituant des
normes dont le non-respect entraîne la déviance. Becker ajoute même que sans les réactions
d’autrui et sans leurs initiatives normatives, la déviance ne saurait exister. La théorie de
« l’étiquetage » (labelling theory), que Becker préfère nommer « théorie interactionniste de la
déviance » a reçu de nombreuses critiques. Et, notamment, celle de prendre
« subjectivement » le parti des supposés « déviants » et de soutenir ouvertement ces normes
non conventionnelles.
E. GOFFMAN ET LE CONCEPT DE « STIGMATE »
Dans son ouvrage Stigmate, les usages sociaux des handicaps (1963), Goffman (1922-
1982) s’intéresse aux « différences » qui tendent à discréditer socialement les individus. Ainsi
Goffman, qui suivra les cours de Hughes et de Blumer, pose la question de la norme et de la
marginalité (anormalité), et, plus largement, celle de la construction de l’identité sociale. On
lui doit en outre le modèle de l’acteur social dramaturge et de la ritualité de la vie
quotidienne : la vie sociale comme une scène sur laquelle l’acteur social joue son rôle dans
une représentation où il ne doit pas « perdre la face ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%