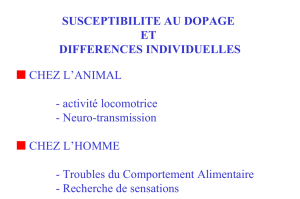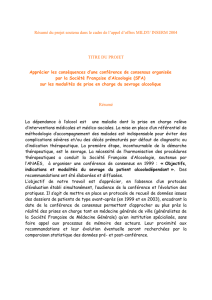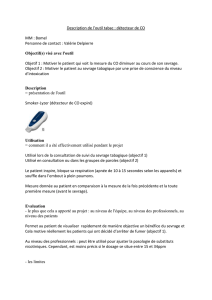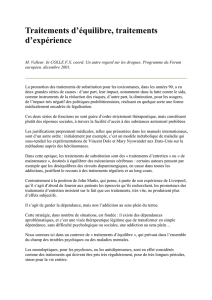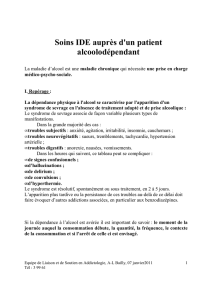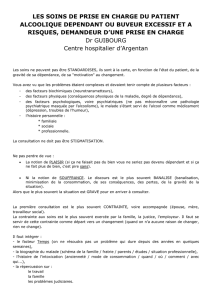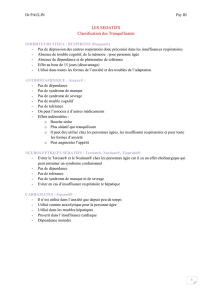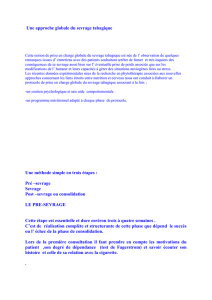Les conduites addictives : alcool, tabac, médicaments, drogues

Les conduites addictives : alcool, tabac, drogues illicites
Les conduites addictives se définissent par le besoin impérieux et répétitif d’utiliser une ou
plusieurs substances psychotropes. Par analogie, elles concernent aussi des troubles du
comportement, tout aussi impérieux et répétitifs, alimentaire (boulimie-anorexie) ou sociaux
(jeux, sexe,…..). Il s’agit de maladies, chacune avec son cortège de pathologies physiques et
psychiques. La sémiologie et la prise en charge du versant physique sont en général bien
codifiées. Il n’en est pas de même pour le versant psychique, propre à chaque patient
dépendant et à chaque dépendance, à chaque relation soignant soigné, à chaque médecin. Ce
dernier est souvent mis en échec par la répétition des rechutes qui témoignent de la
dépendance. Le médecin peut prendre seul en charge un patient dépendant. Dans certaines
circonstances, il est nécessaire qu’il s’entoure d’une équipe de professionnels (de santé ou
sociaux) compétents dans la dépendance concernée.
La dépendance
Quel que soit le type de dépendance, elles se manifestent sous 2 formes : physique et
psychique.
La dépendance physique se traduit par la survenue de symptômes pathologiques dans les
suites d’une abstinence inhabituellement longue, qu’elle soit volontaire ou accidentelle. Ces
symptômes sont regroupés en syndrome de sevrage dont les plus spectaculaires se voient chez
les alcoolodépendants physiques et les héroïnomanes. Les symptômes liés au sevrage
physique durent moins d’une semaine. Une prise en charge codifiée permet de passer ce cap.
La dépendance psychiques se traduit par un besoin intense, une pulsion difficilement
répressible, de renouveler la prise du produit ou le trouble du comportement , sans que ce soit
nécessairement pour éviter un syndrome de sevrage. Il s’agit d’une maladie comportementale
complexe, souvent douloureuse pour le patient et son entourage. Contrairement au sevrage
physique, le sevrage psychique est long. Après un sevrage de plusieurs jours, les rechutes sont
dues à la dépendance psychique. Un malade dépendant reste psychiquement dépendant, donc
à risque de rechute, toute sa vie. Cette réalité est bien rendue par « la roue du changement »,
décrite par Proschaska et DiClemente.

La dépendance psychologique, la roue de Proschachka
Elle retrace le parcours inévitable d’un dépendant vers le sevrage, en sachant que la durée de
chaque période varie considérablement selon le malade et le moment. Elle montre aussi que
tant que le malade n’a pas désir de changement ou de comportement, il est illusoire de lui
proposer un sevrage. Il est raisonnable de lui proposer d’y réfléchir !
L’alcool
La quantité d’alcool consommé par habitant décroît régulièrement depuis les années 1950. De
1984 à 1994, la consommation d’alcool chez les adultes de plus de 15 ans est passée de 14,3 à
11,4 litres par an. Néanmoins, l’alcool reste une dépendance extrêmement fréquente. Les
études épidémiologiques ont montré que 18% des patients adultes consultants en médecine
générale, présentaient un problème d’alcool. La répartition est très inégale selon les sexes
puisque 25% des hommes sont concernés (dont 50% d’alcoolodépendants) contre 10% des
femmes (dont 2,5% d’alcoolodépendantes).
Le repérage du mésusage de l’alcool se fait par le recueil de la consommation déclarée
d’alcool (CDA). Au même titre que bien d’autres renseignements et paramètres qui
remplissent le dossier d’un patient, la consommation d’alcool est un item qu’il est nécessaire
de renseigner lors des premières consultations. Il est difficile, sauf pour les patients abstinents,
de recueillir la consommation hebdomadaire exacte de boissons alcooliques. C’est pourquoi,
la consommation déclarée d’alcool est la valeur standard utilisée pour chiffrer une
consommation d’alcool. Cette question de la recherche de la consommation soulève
fréquemment celle de la « mauvaise foi » du consommateur. En réalité, si elle concerne
parfois le système défensif des alcoolodépendants, rien n’autorise à penser que le
consommateur en mésusage non dépendant refuse de répondre ou donne volontairement une
réponse fausse. La question posée simplement et l’acceptation sans a priori de sous estimation
volontaire sont les éléments de base du repérage (1).
Les seuils de CDA définis par l’OMS sont moins de 21 « verres » par semaine en usage
régulier pour un homme, moins de 14 « verres » pour une femme, et jamais plus de 4
« verres » par jour en usage ponctuel. Le « verre» standard est l’unité internationale d’alcool
(UIA), consommation en référence du commerce, soit environ 10 grammes d’alcool pur.
Médicalement on distingue 2 types de consommations d’alcool, aiguë et chronique.
Les alcoolisations aiguës, dont les ivresses, prédominent chez les moins de 30 ans. Sur le plan
médical, elles se traduisent essentiellement par des accidents et des traumatismes. Le médecin
installé dans une zone urbaine les rencontre peu car elles sont essentiellement prises en charge
pas les services d’urgences.
Les alcoolisations chroniques sont le pain quotidien de tous les médecins. La tâche
primordiale est de la rechercher soit de façon systématique, soit face à un symptôme ou un
problème physique ou social permettant de l’évoquer. Hormis les situations caricaturales, peu
fréquentes, la notion de dépendance est difficile à affirmer lors de la première rencontre. Ces
patients consultant plus souvent que la moyenne, les évocations répétées autour de la CDA
affineront la position du malade vis-à-vis de l’alcool. Pour les non dépendants, le rôle du
médecin est de mettre en garde le patient sur sa consommation, et sans doute de lui conseiller
de la diminuer sous les seuils fixés par l’OMS.
La prise en charge du malade dépendant est complexe (2). Elle s’adapte aussi bien aux
souhaits du malade qu’aux compétences du médecin. L’objectif à transmettre et à atteindre est
l’abstinence totale et définitive. L’alcoolodépendant doit en être convaincu. Il n’y a pas
d’urgence à obtenir ce sevrage. Pour l’atteindre dans les meilleures conditions, il convient de
réfléchir au(x) meilleur(s) modalité(s) d’accompagnement par l’entourage et le médecin. Le
recours à des intervenants extérieurs dépend de la gravité de la dépendance, de l’histoire du

malade, de l’existence d’un entourage facilitant, de ses préférences pouvant venir de
tentatives antérieures de sevrage et de l’existence d’une alcoolodépendance physique
(antécédent de delirium tremens, de convulsion généralisée, tremblements matinaux calmés
par l’ingestion d’alcool, sueurs profuses…) qui impose une courte hospitalisation. Que le
sevrage soit réalisé en ambulatoire ou en institution, un réseau de prise en charge, dont le
médecin traitant est le pivot, peut comprendre un alcoologue, un centre de cure ambulatoire
en alcoologie (CCAA, anciennement CHAA), un centre de cure et de post cure, une assistante
sociale, un groupe d’anciens buveurs, un psychothérapeute, le médecin du travail … Si les
patients ne sont pas forcément les mêmes, le taux de réussite à un an est identique quels que
soient la structure ou le médecin intervenants.
Les traitements médicamenteux peuvent accompagner la prise en charge de ces malades.
Trois molécules sont spécifiques de l’alcoolodépendance :
le disulfiram, peu utilisé maintenant du fait de ces effets secondaires et dont
l’efficacité en terme de sevrage à un an n’est pas significativement différente du placebo
l’acamprosate dont l’AMM actuelle est « médicament indiqué dans le maintien de
l’abstinence chez le patient alcoolodépendant. Il doit être associé à la prise en charge
psychologique»
la naltrexone, dont l’AMM est « traitement de soutien dans le maintien de l’abstinence
chez les patients alcoolodépendants
Les traitements psychotropes, essentiellement les benzodiazépines, trouvent une place en
début de sevrage, à côté des indispensables vitamines B1 et B6 malheureusement non
remboursées par l’assurance maladie.
Le tabac
En France, classiquement, la consommation de tabac aboutit à 60 000 décès par an. Aux
horizons de 2020, l’OMS prévoit que la bronchopneumopathie chronique obstructive passe de
la 5° à la 3° cause de mortalité dans les pays développés. La consommation quotidienne de
tabac –qui diminue nettement avec l’âge – touche 33% des hommes et 26% des femmes.
Contrairement à l’alcool pour lequel il est admis une consommation non dangereuse, la
consommation de tabac est, quelle que soit la dose, considérée comme néfaste. Ceci est du au
très grand pouvoir toxicomanogène de la nicotine.
Le repérage du patient fumeur est aisé : la déclaration et la quantification spontanée ou la
demande très systématique du médecin. Partant du principe qu’il n’existe pas de « fumeur
heureux », l’attitude à adopter face à un fumeur est simple : lui conseiller d’arrêter (3). Ce
conseil sera répété aussi souvent que nécessaire, jusqu’à ce que le désir d’arrêter se fasse jour
chez le patient. Cette méthode, dites de l’intervention brève, a fait preuve de son efficacité
(arrêt du tabac pendant au moins un an) auprès de 2% des patients fumeurs.
La période précédant un éventuel sevrage peut être mise à profit pour réfléchir aux modalités
« techniques » de celui ci. Les préférences émises par le patient, issues des ses sevrages
précédents ou de l’observation de son entourage doivent être prises en compte car elles sont
parties intégrantes de la réussite et du maintien du sevrage. Le sevrage tabagique est un
domaine dans lequel a fleuri de nombreuses techniques de prises en charge, dont très peu ont
fait la preuve de leur efficacité. Le rôle de conseiller du médecin est là primordial pour éviter
des déconvenues psychologiques et financières.
Seules 2 méthodes de sevrages ont montré une efficacité supérieure au placebo :
- les médicaments, accompagnés d’un soutien psychologique qu’il vienne du médecin ou de
l’entourage du fumeur. Deux types de médicaments existent : soit la substitution nicotinique
orale ou transcutanée en vente libre en pharmacie, soit le bupropion délivré sur ordonnance.
- les thérapies comportementales individuelles ou en groupe.
Deux objections fréquemment émises par les fumeurs doivent être prévenues par le médecin :

- la fréquence des rechutes. Elles témoignent de la dépendance et ne doivent pas décourager le
fumeur car plus celui ci aura essayé de s’arrêter de fumer, plus il a des chances d’y arriver.
- la prise de poids. Elle est réelle et inévitable, autour de 3 kg. Si le patient sevré doit faire
attention, si possible, à ce qu’il mange en particulier hors des repas pour compenser le
manque, la préparation un sevrage doit lui faire prendre conscience que de toutes façons il va
prendre quelques kilos.
Dans tous les cas, ce n’est pas la méthode choisie qui réussit -ou échoue-, c’est le fumeur.
Les drogues illicites
Tous les toxicomanes rencontrent dans leur parcours un médecin généraliste. Même si la
légalisation de la substitution a profondément changé la relation entre les toxicomanes et les
médecins, ceux ci ne sont pas obligés de prendre en charge les patients toxicomanes s’ils se
sentent en « danger » ou mal à l’aise. Au minimum, l’objectif est de diriger le patient sur un
autre médecin ou une structure d’accueil compétents pour l’accueil et le soin des patients
toxicomanes (4).
Il existe une multitude de produits illicites utilisés à des fins toxicomaniaques. Le plus connu
est l’héroïne, dangereuse tant pour son pouvoir immédiat de dépendance que pour les risques
liés à son usage en intraveineux (VIH, VHB, VHC).
Lors d’une première rencontre, la demande d’un patient toxicomane n’est pas forcement
claire. Il peut s’agir d’une demande de sevrage, de substitution ou un simple « dépannage ».
La relation va se construire à partir de la capacité du médecin à comprendre la vraie demande
et la façon d’y répondre. Le médecin doit se positionner en professionnel de santé et proposer
à la fois une prise en charge de la toxicomanie de la santé d’une personne exposée à de
nombreuses pathologies mais aussi des problèmes sociaux fréquents chez ces patients
désinsérés. La réponse du patient toxicomane à cette attitude du médecin et le respect d’un
contrat thérapeutique sur le rythme des consultations, au moins hebdomadaire au début,
précisent la volonté de sevrage ou de substitution au long cours.
C’est là que la notion de réseaux autour du médecin prend toute sa valeur. Au premier rang,
citons le pharmacien dont le nom et l’adresse figure sur l’ordonnance, le biologiste pour le
suivi des sérologies, éventuellement un psychiatre pour un avis sur l’existence d’un trouble
grave de la personnalité, le dentiste, les personnels sociaux, un centre de prise en charge des
toxicomanes qui seul à le droit d’initier un traitement à la méthadone pour la substitution à
l’héroïne.
Le traitement de substitution à base de buprénorphine ne s’adresse qu’aux héroïnomanes. Il
est prescrit par le médecin. Ce n’est pas un traitement de sevrage. Pour être efficace, il doit
être pris à des doses suffisantes (au début 8 à 16mg/j), pour une longue période (si besoin
plusieurs années), sous la langue en une prise quotidienne (le principe actif passe par voie
sublinguale). Les doses seront diminuées très lentement en accord avec le patient. Ces
éléments seront très précisément expliqués au toxicomane, afin d’éviter des rechutes ou des
incompréhensions dans le suivi.
Au total, la prise en charge des patients dépendants nécessite de la part du médecin une
compréhension du fonctionnement de leur maladie et une disponibilité « tranquille ». Face à
la rechute ou à la persistance de la prise du produit dangereux -témoins de la dépendance- , il
ne doit pas se sentir remis en cause ou personnellement visé. La persistance de la relation et
l’écoute permettant au malade de dire ses difficultés et ses préoccupations sont la base
indispensable de la réussite.

Mots clés : conduites addictives, alcool, tabac, drogues
Références bibliographiques
1) Kiritze Topor P, Benard JY. Le malade alcoolique. Paris : Masson, 2001:233p.
2) Anaes, conférence de consensus. Objectifs, indications et modalités du sevrage des patients
alcoolodépendants. Paris 1999.
3) Anaes, conférence de consensus. Arrêt de la consommation du tabac. Paris 1998.
4) Observatoire français des drogues et des toxicomanies
1
/
5
100%