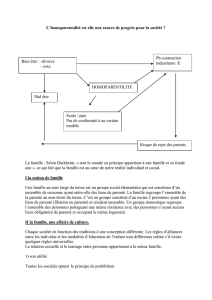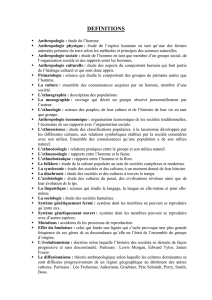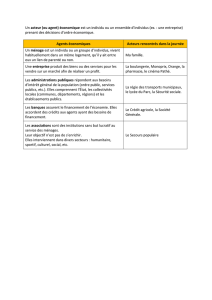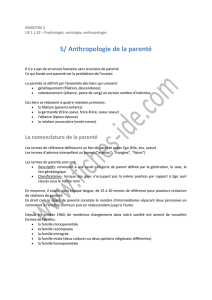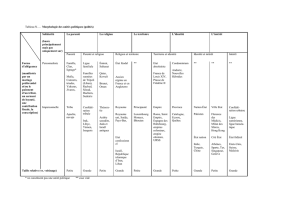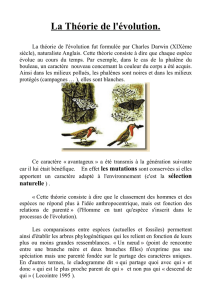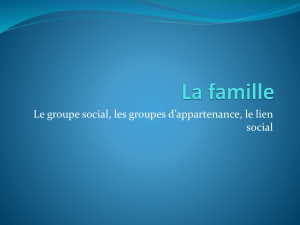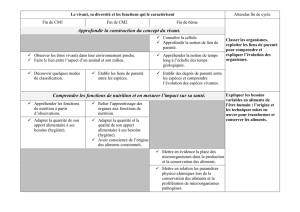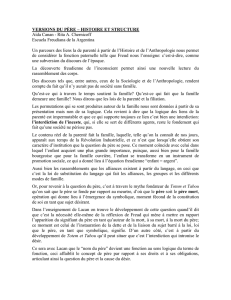Document

1
Cours du 30/03/06 PAP CM 3
(De la Parenté à la Parentalité)
Toutes la théorisation de Totem et Tabou (passage du primitif à la vie en société), pour
chaque famille, chaque individu va passer par le primitif pour pouvoir vivre en société. Freud
s’est appuyé par Frazer (anthropologue), on a reproché à Frazer d’avoir été derrière son
bureau sans aller sur le terrain, on comprend donc la polémique du livre Totem et Tabou de
Freud. Malinowski (chef de file de toute l’anthropologie américaine), Il a mis en doute
l’universalité de l’oedipe en disant que ce complexe est dépendant de la structure et de la
culture d’une société donnée. Malinowski à travaillé auprès des Trobriandais (société des
Trobriand), il a fait une observation sur cette société dont la structure sociale est matrilinéaire
c'est à dire que la transmission de l’appartenance au groupe s’effectue de mère à fille et c’est
la mère biologique et son frère (oncle maternel) qui élève l’enfant qu'elle a conçue avec un
autre homme (père biologique) sans qu'il n’y ai aucune reconnaissance de ce lien biologique
entre l’homme et son enfant. Freud fut beaucoup atteint par cette polémique de l’école
structuraliste. Il a demandé à Géza ROHEIM (alors qu'il était de souffrant) de vérifier si toutes
ses théories étaient universelles ou non. Il a étudier une culture proche des Trobriandais et il a
remarquer que l’enfant avait de l’amour vis à vis de la mère et vis-à-vis de l’oncle : il a
conclut de l’universalité de l’oedipe qui a un rapport avec la prohibition de l’inceste. On
retrouve les tabous organisateurs de la société qui sont à l’œuvre pour organiser la famille.
Chaque individu va répliquer ceux-ci qui seront les tabous de l’inceste originel et la pulsion
de mort (et primitif). « Ontogénie culturelle » : répétition de l’organisation de la société qui
passe pour chaque individu pour sa construction du sujet
Liens de filiation parenté et parentalité.
C’est la démarche anthropologique qui nous permet de pensée la famille en terme de
liens tissés entre les individus qui la compose. Parmi tous ces liens, le lien essentiel de la
filiation est celui qui permet de distinguer des groupes au sein d’une société donnée
1
. Cette
filiation peut-être différente d’une société à l’autre
2
mais elle est toujours définie, conscrit et
reconnue. Dans les sociétés matriarcales, elle bilatéral c'est à dire que l’individu est apparenté
de la même manière à son père et à sa mère. Ailleurs, elle peut être unilinéaire soit
patrilinéaire, soit matrilinéaire (c'est à dire appartenir qu'à la lignée du père et qu'à la lignée de
la mère). Le lien de filiation n’est pas systématiquement superposable au lien biologique du
coup, le père ou la figure paternelle dominante (ou d’affiliation) n’est pas toujours le géniteur.
Selon les sociétés, l’engendrement et la filiation soit coïncident soit sont dissociés. De même,
il faut dissocié le sexe biologique et le sexe social qui peuvent être différent selon les sociétés.
En effet, dans les sociétés humaines, les notions de père et de mère sont définies selon un
modèle propre. Le statut de père se décline en père biologique (père de sexe biologique), père
de sexe social et père d’affiliation (de même pour la mère).
1
C’est surtout Claude Lévy Strauss qui parle des structures élémentaires de la parenté.
2
Le modèle de la société matrilinéaire est fondé sur la structure du matriarcat (de même avec la société
patrilinéaire et le patriarcat). La parentalité est un concept qui a été bouleversé par les mutations et les
changements sociaux qui ont fait qu'il y eut un glissement vers le concept de parenté.

2
La parenté
La parenté se définit par une relation de consanguinités, d’alliances qui unie deux ou
plusieurs personnes entre elles, c’est aussi un lien juridique qui unit des personnes qui
descendent l’une de l’autre ou alors qui descendent d’un ancêtre commun. L’ethnologie et
l’anthropologie se sont beaucoup intéressées à la notion de parenté. Laburthe-Tolra définie la
parenté comme étant « l’étude de l’organisation institutionnelle de la famille et de la parenté
au moyen de l’alliance »
3
. Un monde sans parenté ne peut pas exister, en effet tout individu né
dans un groupe humain constitué de personnes qui entretiennent les unes avec les autres des
rapports de parenté. L’anthropologie montre que la parenté à plus d’importance dans les
sociétés traditionnelles que dans celles dites modernes. Les liens de parenté peuvent être réels
ou fictif dans le cas de l’adoption. En fait, la parenté qui s’appuie sur les relations de l’enfant
avec son père et de l’enfant avec sa mère met en évidence que la paternité est une construction
symbolique, économique, sociale, culturelle, juridique, éthique d’un lien. Chaque système
sociale marque, à l’aide de termes spécifiques et de rîtes particuliers, la place du père. Cette
place a beaucoup variée à travers les siècles. On est passé (en tout cas, dans les sociétés
occidentales traditionnelles) d’un père tout puissant à une sorte de crise de la paternité. La
paternité constitue un thème essentiel car la construction psychique de l’enfant, sa libido, son
affirmation identitaire
4
dépendent aussi des rapports à son père. Le concept de l’identité est
primordial dans la psychologie culturelle. Ceci nous amène à resituer les différents rôles,
fonctions et places que le père a connu à travers les époques :
Sous l’empire romain, la paternité biologique importait peu, ses la volonté de
reconnaissance de l’enfant par le père qui compte. Le père a droit de vie et de mort sur ses
enfants pour quelque raison que ce soit, il pouvait même vendre ses enfants. A Rome,
l’Homme est la référence essentielle. La femme dépend de son père puis de son mari (les
mentalités ne fonctionnent pas aussi rapidement que l’histoire (transmission
intergénérationnelle) c’est pour cela que la femme ne s’est pas révolté de suite de cette société
esclavagiste). La femme ne pouvait pas choisir son mari, c’est le père qui le choisit. Le
pouvoir de l’homme (« Postetas ») n’est acquis par l’homme qu'au décès de son propre père.
En fait le Pater Familias est dépositaire du patrimoine.
Au moyen âge, c’est le droit canonique qui s’impose alors, la vie ecclésiastique
rentrait dans l’intimité du sujet. Le mariage permet à l’Homme d’inscrire sa lignée dans une
autre lignée qui est celle de l’épouse et de s’inscrire dans une communauté. Le père est défini
par la place que lui confère l’institution du mariage, la fidélité conjugale est une obligation
découlant du mariage. Du coup, le mari doit s’assurer dans la virginité de la femme. Le
mariage ne peut se concevoir sans enfantµ. Le droit du mariage se fonde sur des concept
religieux, ; l’existence du lien charnel est une constitution juridique du mariage (c’est la seule
forme permise des relations sexuelles). L’impuissance du marie ou le refus de l’union sont
une cause de nullité du mariage, un mariage n’a de valeurs que dès lors qu'il est consommé.
Le rôle du père, avec le sacrement du mariage et le devoir conjugal qui en est la conséquence,
vont même inspirer le droit français de l’époque et le rôle du père relève alors de la morale et
du droit qui fixe les obligations, les pouvoirs et les devoirs ; dès lors la paternité est
institutionnalisé.
A la renaissance, au 16ème siècle, apparaît le courant humaniste qui véhicule un idéal
de sagesse et une philosophie de vie. La paternité devient plus empreinte de pédagogie qu'au
3
Cf. Claude Lévy Strauss.
4
Identification première, construction du moi je qui se construit qu'en interaction du moi nous, on va retrouver la
place sociale, culturelle grâce à la place de la mère et du père symbolique : se situer par rapport au sexe masculin
et au sexe féminin. C’est lorsque la crise d’adolescence perdure elle ne permet pas de passé de l’adolescent à
l’adulte

3
cour des siècles précédents. Alors, le père doit faire passer les valeurs de l’érudition de la
sagesse, de la générosité, de l’humilité... L’éducation doit permettre à l’enfant de mener une
vie vertueuse (les contact physique entre le père et l’enfant n’est pas de mise). Le père se
souci d’entretenir sa filiation grâce à un fils qui fera plus tard autorité morale, religieuse et
culturelle. Le masculin reste le représentant suprême, le père jouit d’une autorité incontestée
et il se doit de construire son fils. Les tâches et les rôles sont nettement différenciés entre le
père et la mère et ceci dès l’éducation des enfants et de manière différenciée selon les sexes.
La sensibilité, la douceur sont apprises par la fille les prises de rôle sont apprise par le fils.
Les repères sociaux et culturels de la différence étaient protégés par l’institutionnalisation de
la famille, par la domination et la hiérarchisation des rapports entre les sexes.
Du 16 au 19ème siècle : âge d’or des pères.
1
/
3
100%