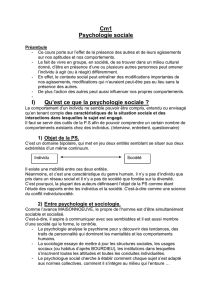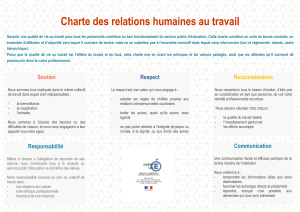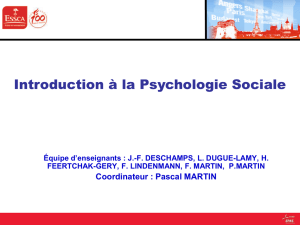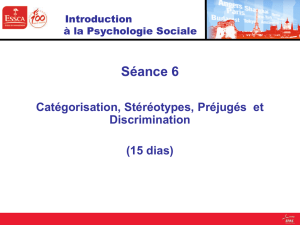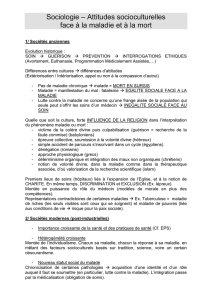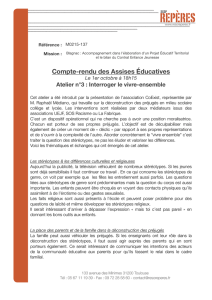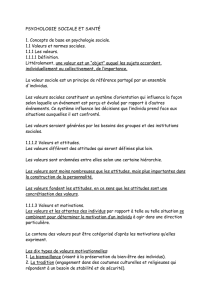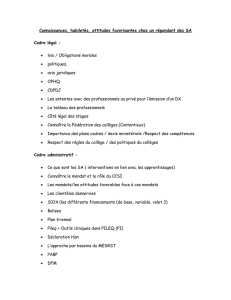Gestion de groupes Cm1 Psychologie sociale

Gestion de groupes
Cm1
Psychologie sociale
Préambule
- Ce cours porte sur l’effet de la présence des autres et de leurs agissements
sur nos aptitudes et nos comportements.
- Le fait de vivre en groupe, en société, de se trouver dans un milieu culturel
donné, d’être en présence d’une ou plusieurs autres personnes peut amener
l’individu à agir (ou à réagir) différemment.
- En effet, le contexte social peut entraîner des modifications importantes de
nos agissements, modifications qui n’auraient peut-être pas eu lieu sans la
présence des autres.
- De plus l’action des autres peut aussi influencer nos propres comportements.
-
I) Qu’est ce que la psychologie sociale ?
Le comportement d’un individu ne semble pouvoir être compris, entendu ou envisagé
qu’en tenant compte des caractéristiques de la situation sociale et des
interactions dans lesquelles le sujet est engagé.
Il faut se servir des outils de la P.S afin de pouvoir comprendre un certain nombre de
comportements existants chez des individus. (Interview, entretient, questionnaire)
1) Objet de la PS.
C’est un domaine bipolaire, qui met en jeu deux entités semblant se situer aux deux
extrémités d’un même continuum.
Il existe une mobilité entre ces deux entités.
Néanmoins, et c’est une caractéristique du genre humain, il n’y a pas d’individu que
pris dans un réseau social et il n’y a pas de société que fondée sur la diversité.
C’est pourquoi, la plupart des auteurs définissent l’objet de la PS comme étant
l’étude des rapports entre les individus et la société. C'est-à-dire comme une science
du conflit individu/société.
2) Entre psychologie et sociologie.
Comme l’avance MAISONNOEUVE, le propre de l’homme est d’être simultanément
sociable et socialisé.
C'est-à-dire, il aspire à communiquer avec ses semblables et il est aussi membre
d’une société qui le forme, le contrôle.
- La psychologie analyse le psychisme pour y découvrir des tendances, des
traits de personnalité qui dominent les mentalités et les comportements
humains.
- La sociologie essaye de mettre à jour les structures sociales, les usages
sociaux (ou habitus d’après BOURDIEU), les institutions dans lesquelles
s’inscrivent toutes les attitudes et toutes les conduites individuelles.
- Le psychologue social cherche à établir comment chaque sujet s’est adapté
aux normes collectives, comment il s’intègre au milieu qui l’entoure …
… quel rôle il y joue, quelle représentation il s’en construit, quelle inflence
éventuelle il y exerce.
- son objet propre sera l’interaction et la relation : interaction des influences
sociales et des personnalités singulières, relation des individus entre eux et
des groupes entre eux.
3) Attitudes et actions.
Individu
Société

Les attentes des individus au sein du réseau social sont souvent différentes des
attentes de la société.
- Par exemple : chez les étudiants, il existe des différences entre les
orientations ou les formations poursuivies et les besoins de la société.
- Cela donne lieu à une régulation de la part de la société : sélection par
concours.
Pour de nombreux auteurs, tous les conflits ont lieu par apport à l’idéologie.
Définition de idéologie : « un système des représentations et d’habitudes que les
individus et les groupes se forment pour communiquer. » - stéréotypes.
Définition de stéréotypes : une sorte de schéma perceptif associé à certaines
catégories de personnes ou d’objets, cristallisés autour de mots qui les désignent et
intervenant systématiquement dans les représentations et la caractérisation des
spécimens ».
Définition d’attitudes : « des croyances et des sentiments qui orientent nos réactions
envers des objets, des personnes ou des événements » (MYERS)
… ou un état mental et neuropsychologique de préparation à répondre, organisé à la
suite de l’expérience et qui exerce une influence directrice ou dynamique sur la
réponse de l’individu à tous les objets et à toutes les situations qui s’y rapportent.
(ALLPORT).
a) Nos attitudes guident-elles nos actions ?
La pression sociale peut brouiller la connexion sous jacente entre nos attitudes et
nos actions en affectant soit ce que nous disons, soit ce que nous faisons.
- Expérimentation : DECHONDHY : confirmation et obéissance.
- Quand une idéologie est attaquée par d’autres opinions, cette idéologie a
tendance à se renforcer. (Renforcement des liens du groupe)
- L’appartenance à des groupes détermine les actes et les idées et par
conséquence le fonctionnement cognitif des personnes.
- Les représentations issues de l’idéologie à laquelle nous adhérons vont donc
influencer les choix, les attitudes et les comportements de chacun.
-
b) Nos comportements guident-ils nos attitudes ?
Plusieurs observations confirment que les attitudes se mettent en place après le
comportement.
Par exemple : les rôles sociaux affectent nos attitudes.
Définition de rôle sociaux : « un ensemble d’action prescrite qui sont les
comportements qu’on attend de ceux qui occupent une position sociale particulière »
(MYERS).
Lorsque vous adoptez un nouveau rôle, vous vous efforcez de suivre les
prescriptions sociales associées à ce nouveau rôle.
Au début, les comportements peuvent sembler faux, parce que vous jouez le rôle.
Mais ensuite votre comportement ne paraîtra plus forcé.
- Expérimentation ZIMBARDO : évaluation de l’attitude avant et après l’adoption
d’un nouveau rôle. Etudiant dans deux situations : prisonnier vs gardien.
Après seulement un ou deux jours, la simulation devient réelle, trop réelle !
- Grâce aux techniques d’influence sociale, nous sommes tous susceptibles de
nous transformer en tortionnaire… ou plus simplement d’adopter un
comportement dont nous n’avons pas envie au départ (ex : acheter tel ou tel
produit).
-
c) L’étude de MILGRAM (1974).
- Objectif : mettre en évidence les mécanismes qui amènent à la soumission et
l’influence du groupe sur l’individu.
- Protocole : sujet payé, le sujet devait punir l’élève lorsque celui-ci se trompait.
La punition est donnée sous forme de décharge électrique de 15 à 450 Volts.
- Résultat : 60% des sujets vont jusqu’à 450 Volt !!
Caractéristiques des chocs électriques par les sujets.

Caractéristiques des chocs administrés par les sujets dans les diverses conditions de
proximité de la victime.
variante
Indice d’obéissance
Choc max
% de sujet obéissant
FB à distance
450 Volts
65%
FB vocal
360 V
62.5%
Proximité
300 V
40%
Contact
255V
30%
A savoir :
1 - définir la psychologie sociale, quel est le rôle du psychologue social ?
2 - définir le concept d’attitude, quel est l’impact de la pression sociale sur les
attitudes des individus ?
3 - décrivez l’étude de MILGRAM.
II) La notion de groupe.
Préambule : parmi tous les phénomènes sociaux peuvent influencer nos attitudes,
nos comportements, la psychologie sociale s’intéresse également aux rapports des
individus appartenant à un groupe. C'est-à-dire relation intergroupe
Définition de groupe : ensemble d’individus orientés vers l’effectuation d’une tâche,
mais aussi aux rapports entre les groupes (i.e. relation intergroupe).
En résumé, la désobéissance des sujets ne dépend pas uniquement de leur morale,
elle dépend aussi de la situation sociale.
Le taux d’obéissance varie aussi en fonction de :
- liens sujet/victime.
- Source d’autorité.
- La présence ou non de public.
Par contre, il n’y a pas de différence quand :
- le cadre du labo est moins prestigieux.
- Les sujets sont de sexe féminin.
-
A) Structuration des groupes – les relations intragroupes.
Pour parler de groupe, il faut au moins deux personnes, mais ce simple critère ne
suffit pas pour parler de « groupe ».
Par exemple : dix personnes dans un ascenseur forment ce qu’on appelle un agrégat
de personne et pas vraiment un groupe.
65%
Mort

Pour qu’une collection d’individus mis ensemble forme un groupe il faut qu’elle
remplisse trois conditions :
- une tache commune
- une interaction réciproque pour la réalisation de la tâche.
- Une interdépendance réciproque pour la réalisation de la tâche.
1) Les différents types de groupes.
Groupe formel et groupe informel.
Le groupe « formel » est un groupe qui a pour fonction de s’acquitter d’un travail
spécifique et bien défini (MAIILLET, 1988) – orientation vers la tâche.
A l’inverse le groupe « informel » se développe naturellement selon des préférences
ou des intérêts communs (SAVOIE, 1993) – l’orientation sociale.
Le groupe primaire et le groupe secondaire.
Le groupe primaire est celui qui nous touche personnellement avec qui nous avons
des contacts intimes et réguliers (i.e. famille, amis) tandis que le groupe secondaire
désigne un ensemble de personnes plus vaste et qui ont de contacts plus
sporadiques (i.e. lycée, syndicat,…)
Les groupes d’appartenance et les groupes de référence.
Bien que les deux types de groupes se confondent la plupart du temps, le groupe de
référence peut être un groupe dont on ne fait pas partie, mais qui nous sert de
modèle et auquel on rêve d’appartenir un jour.
Le groupe restreint, la catégorie sociale, la foule.
On parle de « groupe restreint » pour désigner « un groupe relativement structuré qui
est composé d’un petit nombre d’individus ayant des contacts face à face de façon
plus ou moins réguliers » (ANZIEU et MARTIN, 1976).
A l’inverse, on parlera de « catégorie sociale » ou de foule pour faire référence à un
groupe très grand, relativement peu structuré, composé de centaine voir de milliers
de personnes et où il n’est pas question de parler d’interaction face à face entre ces
différents membres.
Groupe minoritaire – groupe majoritaire.
2) Groupe et identité sociale.
L’une des questions fondamentales dans l’étude de la psychologie des groupes
concerne l’explication de la formation des groupes. Il existe globalement trois
grandes approches du problème de la formation des groupes.
Le modèle fonctionnaliste :
Soi l’appartenance à un groupe s’explique parce que ce groupe permet de combler
certains besoins.
Le modèle de la cohésion sociale :
Dans cette approche, c’est l’attirance que les individus éprouvent les uns pour les
autres qui les conduit éventuellement à former un groupe. Dans ce contexte, le
concept central est celui de la cohésion, i.e., la force des liens qui unissent les
différents membres d’un groupe.
Le modèle de l’identité sociale :
Ici, l’appartenance à un groupe s’explique à partir de phénomènes ayant un base
perceptuelle ou cognitive, et non sur une base affective comme dans le modèle de la
cohésion sociale.
Entre identification et différentiation : le groupe comme élément essentiel de la
formation de la personnalité individuelle dans le groupe.
La construction de l’identité d’un individu s’accomplit par un double mouvement :
- Le processus d’identification : « Processus selon lequel un individu construit
sa personnalité selon le modèle de quelqu’un d’autre », in J-P REY, 2001.

- Le processus de différenciation sociale : « Besoin qu’a un individu de se
différencier des autres pour construire son identité sociale », in J-P REY,
2001.
Et si l’identité sociale peut se définir comme : « le sentiment d’être reconnu et de
jouer un rôle tout en se percevant comme différent des autres ».
On peut dire que les différents groupes (famille, l’école, …) auxquels un individu
appartient constituent un vecteur essentiel de la construction de cette identité.
Par exemple : l’estime de soi d’un sujet se construira en fonction des comparaisons
successives qu’il effectuera avec d’autres membres de son ou ses groupes
d’appartenance.
L’EPS ou le sport de manière plus général, sont particulièrement riches par apport à
cette construction car :
1/ les différentes pratiques sportives intègrent des formes de groupement riches et
variés.
2/ l’enseignement de cette matière se fonde sur des relations sociales très riches et
très différentes dans lesquelles un élève est amené à tenir différents rôles sociaux
(acteur, observateur, arbitre, …).
Conformisme et fonction normative du groupe :
Il existe une période pendant laquelle l’indentification au groupe est particulièrement
importante pour les individus : la période de l’adolescence. Durant cette période, la
pression du groupe (celui du groupe de paire) peut être plus ou moins importante.
- des manifestations de conformisme (de comportement, vestimentaire, de
langage, …).
-
Définition : le conformisme « se manifeste par le fait qu’un individu modifie ses
comportements, ses attitudes, ses opinions pour les mettre en harmonie avec ce qu’il
perçoit être les comportements, les attitudes, les opinions du groupe dans lequel il
est inséré ou souhaité être accepté », J-P CODOL (in J-P REY).
Cette influence n’est dans la plupart des cas, pas consciente pour la personne. On
parle donc dans ce cas de pression implicite.
Expérience de ASCH (1961).
Celle-ci consistant à présenter à des sujets une tâche expérimentale dans laquelle ils
devaient reconnaître laquelle des trois lignes situées à droite est la plus proche de la
ligne « modèle » située à gauche.
- résultats : lorsque les sujets effectuaient la tâche seuls, ils ne se trompaient
pas. Par contre s’ils répondaient alors qu’ils étaient intégrés à un groupe de
complices qui donnaient des réponses erronées, on observe en moyenne
jusqu’à 37% d’erreurs pour la population des sujets expérimentaux.
- Dans certaines circonstances, on peut donc être amené à dire exactement le
contraire de ce que l’on voit ou pense réellement.
- Si le conformisme facilite les relations interindividuelles et une certaine forme
de socialisation.
Il peut provoquer des comportements peu souhaitables, et cela à l’insu même
de l’individu.
Expérience de SHERIF (phénomène social de la création d’une norme).
Un individu dans la nuit noir doit déterminer la distance qu’a parcourue la lumière.
Elle s’allume puis elle s’éteint. On répète trois fois. Puis le lendemain, on répète
l’expérience avec deux compères qui donnent des résultats faux. On répète cela
pendant plusieurs jours.
Résultat : la lumière ne s’est jamais déplacée. Il a été influencé par la norme des
compères.
A savoir.
4 – Définir la notion de groupe, quelles sont les conditions pour former un groupe ?
5 – Décrivez les différents types de groupes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%