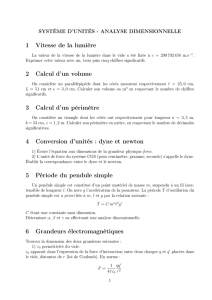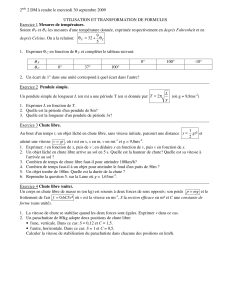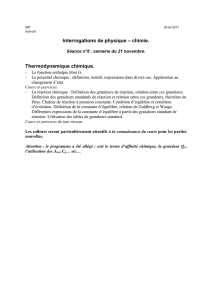La Physique Qualitative

1
La Physique Qualitative
Même si le but avoué de la physique n’est pas “ d’expliquer le réel dans lequel nous vivons mais d’en donner une
modélisation cohérente satisfaisant l’intelligence humaine ”, cette entreprise n’est pas souvent aisée. En effet, la réalité, de par
son unité, est tellement complexe que le moindre fait anodin de la vie de tous les jours ne peut, la plupart du temps, pas être
rigoureusement interprété par les théories actuelles. Tout au moins par des théories en qui nous “ croyons fort ”, mettant en jeu
des lois qui nous semblent fondamentales, comme par exemple les lois directement en rapport avec les 4 interactions
fondamentales de la nature (loi de la gravitation, lois de Coulomb, lois donnant les forces électrique et magnétique en fonction
des champs électrique et magnétique...) ou encore la relation fondamentale de la dynamique de Newton.
1) Les limites d’une approche scientifiques rigoureuse: Moi ch’uis en TS ...mais
* Pour s’en convaincre, il suffit de relire quelques intitulés de vos cours de première et terminale bien
révélateurs de leurs limites:
- “ Expression de la force de gravitation pour un objet ponctuel ou à répartition sphérique de masse ”
Qui ce bel intitulé concerne ? Personne de façon précise parce qu’aucun objet n’est rigoureusement
ponctuel et même notre chère planète, aplatie aux pôles (du fait entre autre de sa rotation propre) n’entre
pas vraiment dans la catégorie des “ objets à répartition sphérique de masse ”, comme aucun autre astre
d’ailleurs...
- “ Mouvement de chute libre dans le champ de pesanteur terrestre uniforme ”
Qui cela concerne concrètement ? Rien ni personne car d’une part le référentiel terrestre d’étude n’est pas
rigoureusement galiléen, d’autre part la vraie chute libre (cas où un objet n’est soumis qu’à son poids
comme unique force) n’existe que dans le vide ou l’espace mais sûrement pas sur la Terre où les
frottements de l’air sont inévitables. Tout le monde sait bien, qu’à hauteurs de chute égales, une pierre
tombe plus vite qu’une plume ! Enfin l’uniformité du champ de pesanteur est aussi discutable...
- “ mouvement d’un satellite à trajectoire circulaire: on négligera les forces de gravitation exercées par
la Lune, le Soleil et les autres astres... ”
Un spécialiste en prise avec la réalité concrète ne peut se permettre d’ “ oublier ” toutes ces petites choses
qu’on néglige; et demandez-lui quelle est la proportion de satellites qui ont une trajectoire vraiment
circulaire ? S’il vous répond 1% c’est bien pour vous faire plaisir...
- “ Action d’un champ électrique uniforme et indépendant du temps sur une particule chargée ”
On aurait tout autant pu écrire: “ êtes-vous arrivés à apprivoiser votre proton ? ” En effet, même si les
deux caractéristiques (uniformité et constance) du champ électriques sont facilement réalisables en
laboratoire (mais on s’éloigne de la vie de tous les jours !), il n’est guère possible de réaliser des
expériences avec une seule particule. La physique quantique nous apprend qu’il n’est même pas possible
d’en isoler une et de connaître précisément sa vitesse ! (Une des conditions initiales de tous vos
exercices). Et dès que l’on considère plusieurs particules chargées, on doit tenir compte de leurs
interactions électromagnétiques complexes.
- Même topo pour le champ magnétique...
Le petit-déjeuner qui déprime...
* Une façon plus amusante de s’en convaincre est de commencer sa journée par un bon petit déjeuner.
- Lorsqu’on verse un peu de lait dans son bol de thé, café ou cacao, la situation est déjà terrifiante pour un
physicien perfectionniste, d’autant plus si celui-ci n’est pas bien réveillé: pour pouvoir décrire de la façon
la plus complète possible cette situation triviale, il faudrait connaître précisément les positions et les
vitesses de chacune des milliards de milliards de milliers de molécules entrant dans la composition du thé
et du lait (afin de leur appliquer la relation fondamentale de la dynamique); il faudrait également
connaître les interactions entre ces molécules... Il y a de quoi y passer ses vacances... même pour un
ordinateur !
- Pour des raisons similaires, personne n’est capable de décrire parfaitement l’“ étalement ” de la bonne
confiture de grand-mère sur notre tartine encore toute chaude, ou pire la trajectoire et la déformation
exactes d’un “ rond ” de fumée de cigarette (c’est pas bien de fumer en mangeant !).2) Aux armes
physiciens!
Heureusement, face à cette impuissance provenant du nombre gigantesque d’éléments à considérer dans n’importe-quel cas

2
concret, la physique possède quand même quelques armes:
a) la première est le moyennage (utilisé avec succès par la thermodynamique classique ou la mécanique
des fluides) et qui consiste à raisonner non plus sur chaque élément pris séparément (souvent
microscopique) mais, en posant certaines hypothèses, sur des grandeurs locales moyennes
caractéristiques du système à notre échelle macroscopique.
Par exemple, si la température d’un gaz a assurément quelque chose à voir avec les énergies cinétiques
microscopiques de ses constituants élémentaires (atomes, molécules...), l’attitude de moyennage
permettra de prédire avec une très grande précision la valeur de la température affichée concrètement par
le thermomètre.
b) La seconde est l’arme statistique qui tisse un lien plus serré entre l’élément lui-même et la totalité du
système qui nous est expérimentalement accessible. S’appuyant sur quelques postulats de départ (à
admettre), cette démarche prolonge l’approche précédente en combinant les lois fondamentales (celles
dont nous avons parlé plus haut) appliquées à chaque élément du système et les calculs de probabilités
(témoignant directement de notre impuissance et cachant une certaine forme d’ignorance...). Cette
méthode doit souvent faire appel à des ordinateurs puissants et contient une certaine part d’incertitude: il
n’y a qu’à penser au nombre de fois où la météo nous a fait prendre un parapluie qui ne nous a pas servi !
c) Une troisième possibilité, la plus simple, et que vous utilisez depuis les petites classes est l’approche
phénoménologique.
- Par exemple, pour connaître les propriétés intéressantes d’un vulgaire ressort en acier, il n’est pas utile
de connaître parfaitement les interactions électromagnétiques entre 2 atomes de fer et de les appliquer au
ressort entier constitué d’un nombre d’atomes de l’ordre du nombre d’Avogadro (soit 1023). Il suffit
d’étudier ce système en tant qu’entité. Par exemple, si on décide de l’étalonner avec différentes masses,
on obtiendra une expression phénoménologique de la force de rappel qu’il exerce sur ces masses, c’est-à-
dire une expression (ou loi) déduite des phénomènes observés. En particulier, pour les petites élongations
x, on trouvera F = - k*x où k, appelée constante de raideur du ressort, est directement tirée des
expériences. Libre ensuite à un physicien des solides d’interpréter la valeur de k, selon les matériaux en
termes de structure au niveau microscopique par une approche statistique par exemple.
- La loi d’Ohm en électricité (U = R*I) est également une loi phénoménologique, comme pratiquement
toutes les lois (ou formules) que vous connaissiez avant d’entrer en terminale (les lois plus
“ fondamentales ” ont été découvertes cette année).
* Revenons à la mécanique: l’expression phénoménologique de la force de rappel exercée par un ressort
est nécessaire pour décrire le mouvement d’une masse m attachée au ressort. Par exemple, vous avez vu
en cours que la période propre d’un oscillateur non amorti valait T0 = 2
(m/k). Dans la pratique, les
frottements ne sont jamais nuls et amortissent l’oscillateur d’autant plus qu’ils sont importants. Eux aussi
font intervenir un nombre gigantesque d’éléments microscopiques (molécules de l’air ou d’eau...) et il
faudra donc recourir, là encore, à une expression phénoménologique des forces de frottement. S’il s’agit
de frottement visqueux (se faisant par l’intermédiaire d’un fluide, gaz ou air et non directement de solide
sur solide), l’expérience montre qu’une expression de la forme f = -
*v convient assez bien aux faibles
vitesses et où
est un coefficient qui dépend de la géométrie du système, de sa température. Par
exemple, pour un objet sphérique de rayon R se déplaçant dans un fluide visqueux (comme la glycérine
ou le miel), le physicien Stockes a trouvé pour une expression relativement simple (en faisant varier la
taille de l’objet et la nature du fluide):
= 6
*R*
où
est une caractéristique du fluide appelé
“ coefficient de viscosité ”. Libre ensuite à un physicien des liquides d’interpréter les valeurs de
, selon
la nature du liquide, à l’aide des propriétés des molécules qui le constituent.
L’oscillateur harmonique en mécanique
Cette approche est purement phénoménologique; ainsi, lorsque les vitesses deviennent importantes,

3
l’expérience nous apprend qu’une force de frottement proportionnelle au carré de la vitesse (et non plus à
la vitesse elle-même) convient davantage.
* Considérons une dernière fois l’oscillateur élastique faiblement amorti constitué par la masse et le
ressort. Le cours vous a appris que lorsque le système est soumis à une excitation (force Fe en
l'occurrence) périodique de fréquence variable, on observe un phénomène de résonance (pour des
fréquences excitatrices voisines de la fréquence propre de l’oscillateur) d’autant plus marqué que les
frottements sont faibles (donc que
est petit: résonance aigüe). On peut montrer aussi que la “ largeur de
la résonance ” est proportionnelle à l’intensité de la force de viscosité, plus précisément à
/ m. (On
retrouve la conclusion exprimée en cours à savoir que plus les frottements sont importants (force de
viscosité importante:
grand), plus la résonance est floue (large)).
La situation est décrite par la relation fondamentale de la dynamique qui s’exprime:
F + f + Fe = m*a = - k*x + (-
*v) + Fe
d’où on tire l’expression: m*a +
*v + k*x = Fe soit encore m*(d2x/dt2) +
*(dx/dt) + k*x = Fe
Cet exemple montre les qualités de l’approche phénoménologique qui permet de traiter des problèmes
relativement élaborés (ici la situation mécanique est convenablement décrite par une équation
différentielle du second degré) tout en dégageant les limites de cette approche; dans notre cas, limite des
petites élongations (sinon la relation: F = - k*x n’est plus valable) et des faibles vitesses (sinon c’est la
loi: f = -
*v qui doit être corrigée) .
3) Modèles et analogies
Afin de compléter les propos du § précédent, je vais ici parler de l’utilisation de modèles et d’analogies qui est très fréquente
en physique.
a) Par exemple, pour interpréter les vibrations de molécules diatomiques constituées de deux noyaux
lourds baignant dans une “ mer électronique ” bien dense (un grand nombre d’électrons), on peut utiliser
des modèles mécaniques. Un des plus simples consistera à simuler la liaison entre les deux atomes de la
molécule par un “ ressort équivalent ” aux extrémités duquel on fixera (par la pensée !) les masses
correspondant aux deux noyaux. Un modèle plus sophistiqué simulera l’influence du cortège électronique
par une “ force de viscosité équivalente ”.
Expérimentalement, on étudiera la résonance des molécules de ce type en prenant comme “ force
excitatrice équivalente ” une onde électromagnétique de fréquence variable. De cette étude expérimentale,
on déduira certains paramètres du modèle mécanique comme la constante de raideur du ressort équivalent
ou l’intensité de la force de viscosité équivalente en vue de construire un modèle phénoménologique de
vibration des molécules (renseignant sur l’intensité des liaisons intramoléculaires via la constante de
raideur du ressort équivalent ou encore sur les interactions noyau-cortège électronique via l’intensité de la
force de viscosité équivalente).
* Ce modèle mécanique du ressort et de la masse est fondamental en physique (de par sa simplicité !).
Il est appelé “ approximation de l’oscillateur harmonique ” et est exploité dans tous les secteurs de la
physique: on peut l’appliquer pour modéliser les vibrations des constituants d’un solide (dues à l’agitation
thermique entre autre), l’absorption des ondes sonores ou électromagnétiques dans les solides
(reformulation: comment le son se propage dans un solide et pourquoi les objets en métal sont détectables
aux rayons X ?), la polarisation de la matière sous l’influence d’un champ électrique (pourquoi une règle
en plastique frottée attire de petits morceaux de papier et non des petits morceaux de métal), le
mécanisme de conduction électrique dans les métaux (passage du courant électrique dans un fil de
jonction soumis à une tension), le mouvement périodique des nucléons (protons et neutrons) dans un
noyau, le ....
Bref, tous les mouvements périodiques de faible amplitude autour d’une position d’équilibre stable
ressemblent à celui d’un oscillateur harmonique mécanique, et comme les solutions mathématiques des
équations différentielles du mouvement sont simples, elles se prêtent facilement à des analogies.b) Les
analogies sont le plus souvent suggérées par les formulations mathématiques des problèmes. Les outils

4
mathématiques simples étant en nombre restreint (scalaires, vecteurs, dérivées...avec ça on fait déjà pas
mal de choses!) on retombe vite sur des équations identiques et, aux mêmes équations, les mêmes
solutions! L’analogie est alors prête.
* Par exemple considérons un circuit (R,L,C) série comme celui étudié en cours, constitué de
l’association en série d’une bobine (assimilée à une inductance pure de valeur L), d’un conducteur
ohmique (de résistance R), d’un condensateur (de capacité C) et d’un générateur fournissant la tension Ue.
La loi d’additivité des tensions s’écrit: Ue = UL + UR + UC avec UL, UR et UC les tensions aux bornes
respectivement de la bobine (inductance pure), du conducteur ohmique et du condensateur.
En explicitant ces dernières, cette loi se récrit Ue = L*(di/dt) + R*i + 1/C*q où i est l’intensité du
courant parcourant le circuit et q la charge électrique portée par les armatures du condensateur.
Puisque i = dq/dt, cette relation peut encore s’écrire: L*(d2q/dt2) + R*(dq/dt) + 1/C*q = Ue
Ainsi les phénomènes électriques qui se produisent dans un tel circuit sont régis par une équation qui a
exactement la même “ allure ” que celle décrivant un système masse-ressort amorti par des frottements
fluides et soumis à la force périodique Fe.
Ici, la tension Ue joue le rôle de la force excitatrice Fe ; la charge électrique q celui de l’élongation x; les
grandeurs électriques L, R et 1/C étant les analogues respectifs des grandeurs mécaniques m,
et k.
Connaissant les solutions du problème de l’oscillateur mécanique amorti, on pourra directement les
transposer pour interpréter les circuits électriques et trouver les analogues électriques de certaines
grandeurs comme la période (ou la fréquence) propre du circuit: l’analogue de T0méca = 2
(m/k) est
T0élec = 2
(LC).
Le modèle mécanique permettra d’interpréter la résistance d’un circuit électrique (R) comme une force de
frottements visqueux à laquelle seraient soumis les électrons. Dans les 2 cas de l’énergie est transférée
(perdue) au milieu extérieur et peut provoquer un échauffement de celui-ci: frottements mécaniques et
effet joule que l’on rassemble sous le terme de phénomènes dissipatifs.
Questions: en s’appuyant sur l’analogie électromécanique,
3.1) Donnez le coefficient caractéristique auquel est proportionnelle la “ largeur de la
résonance ” en électricité pour un circuit (R, L, C) série. En déduire comment évolue l’allure de
la courbe de résonance en fonction de R.
3.2) Trouvez les analogues électriques de la vitesse de l’oscillateur mécanique, son énergie
cinétique et son énergie potentielle élastique. Conclusion.
3.3) Trouvez l’analogue mécanique (formule) de l’énergie dissipée par effet joule (R*i2*dt) dans
un circuit (R,L,C) série. D’un point de vue physique, à quoi correspond cette énergie ?
3.4) Pour l’oscillateur mécanique non amorti, on a vu en cours qu’il y a sans cesse transfert
d’énergie potentielle en énergie cinétique de l’oscillateur de façon à conserver l’énergie
mécanique totale constante. Représentez le circuit électrique correspondant à cette situation
mécanique et expliquez les transferts énergétiques qui s’y déroulent. Un tel circuit est-il
“ pratiquement ” réalisable ? Pourquoi ? Conclure en termes de bilan d’énergie.
4) Des formules ! Des formules ! Des formules.... y’en a marre !
Lorsqu’on demande autour de nous à des “ non spécialistes ” quels sont les joyeux souvenirs qu’elles gardent de leur cours de
physique, la réponse est souvent décevante: des formules ! Des formules ! Des formules ! Certaines s’engagent un peu plus et
reprochent à la physique d’avoir recours à des formalismes mathématiques sophistiqués (c’est encore plus vrai en physique
moderne; physique quantique et relativités restreinte et générales) d’une grande abstraction et qui, de ce fait brouille nos
intuitions premières. Je suis d’accord avec vous pour supprimer la moitié des formules du programme de terminale mais...

5
a) Principe numéro zéro de la physique
Enfin, un grand pas sera accompli lorsqu’on commencera à apprendre au lycée le “ principe numéro zéro
de la physique ” de John A Wheeler (un des grands physiciens du 20ème siècle) qu’il énonça ainsi: “ ne
jamais faire de calcul avant d’en connaître le résultat ”
L’idée sous-jacente est la suivante:
- En physique, le risque d’erreur est constant précisément à cause du recours à des formalismes
mathématiques sophistiqués et à des calculs longs et délicats.
- Un bon réflexe consiste à se donner des moyens de contrôle, avant même toute entreprise mathématique,
de façon à prévoir au moins en ordre de grandeur le résultat du calcul entrepris et ainsi évaluer la
plausibilité du résultat obtenu. Plus encore qu’un simple contrôle de qualité (qui pourrait se faire après
coup, une fois le résultat trouvé), ce réflexe doit permettre de tester la pertinence même du processus
théorique utilisé (en clair est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans un complexe et fastidieux
calcul si je n’ai pas à l’avance un minimum de garanties que ce calcul me fournira un résultat
raisonnable?).
Cette physique qualitative (ou physique “ avec les mains ” c’est-à-dire sans équations) peut se révéler
sous différents éclairages: ordre de grandeurs, lois d’échelles, analyse dimensionnelle...
b) Les ordres de grandeur
* Des études ont montré que le cerveau humain ne pouvait se représenter concrètement des valeurs
numériques plus grandes que 1 million (106) ou plus petites qu’un millionième (10-6). Il est évident que
cette fourchette [10-6 - 106] caractérise l’échelle humaine. Au delà de cette gamme numérique, les
valeurs ne nous “ parlent ” plus et sont réduites au vulgaire statut de chiffre dépourvu de signification
concrète.
Par exemple, imaginons qu’à la suite d’une promotion extraordinaire, la masse de tous les constituants
élémentaires de la matière (électrons protons, neutrons...), augmente subitement d’un facteur 1000. Ainsi
les électrons verraient leur masse passer de 10-30 kg (valeur actuelle) à une valeur de 10-27 kg ; de même,
celle d’un nucléon passerait de 10-27 kg à 10-24 kg. Enoncées ainsi, ces modifications brutales ne font
cauchemarder personne... Retranscrites à l’échelle humaine, cela revient à imaginer des individus pesant
tous dans les 100 tonnes ! Ce qui nous interpelle davantage.
* Par nature, le système d’unités international (le fameux système “ SI ”) est bien adapté à nos
expériences journalières et utilise des étalons macroscopiques qui nous sensibilisent: le mètre, le
kilogramme, la seconde et l’Ampère caractérisent précisément notre échelle humaine.
Le mètre représente à peu de chose près la taille de l’Homme; le kilogramme, la masse de nourriture
absorbée en une journée (ou celle que l’on peut soulever sans trop de difficulté); la seconde, la durée entre
deux battements de cœur et l’Ampère, une intensité de courant électrique suffisante pour nous donner la
mort...
* Pour aller plus loin, on peut affirmer que la quasi-totalité de nos journées s’inscrit dans la fourchette
[10-6 - 106] centrée sur des valeurs “ raisonnablement humaines ”.
- Le micron (10-6 m) ou millième de millimètre n’est déjà plus détectable par l’œil humain (l’épaisseur
d’un cheveu moyen atteint plusieurs dizaines de microns). De l’autre côté de la gamme, le millier de
kilomètres (106 m) représente grossièrement la dimension d’un pays, c’est encore la distance maximale
que l’on peut parcourir en une journée avec son automobile. Evidemment l’utilisation d’un avion permet
de parcourir plus de 10 000 km en une seule journée, ce qui nous fait sortir de la gamme évoquée, mais le
recours à cette technologie sophistiquée revêt déjà pour la plupart d’entre nous un caractère exceptionnel;
en d’autres termes, on ne prend pas l’avion tous les jours, tandis que sa voiture si !
- Les plus petits objets observables à l’œil nu (grain de sable, poussière...) ont une masse supérieure au
milligramme (soit 10-6 kg), valeur qui représente, pour l’échelle des masses, la borne inférieures que
nous offre notre expérience quotidienne. De façon similaire, la masse d’une automobile vaut à peu près
une tonne, celle d’un semi-remorque 38 tonnes et 100 tonnes pour la baleine bleue, l’animal le plus lourd
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%