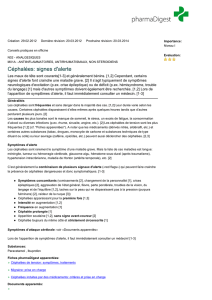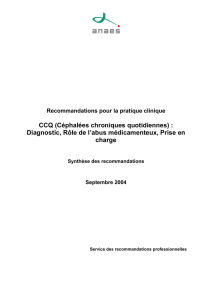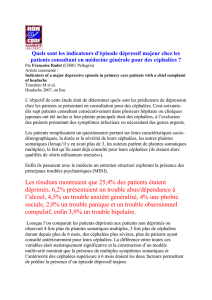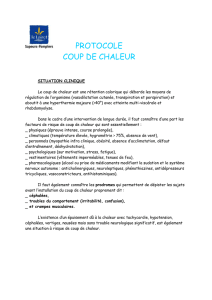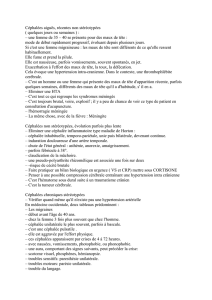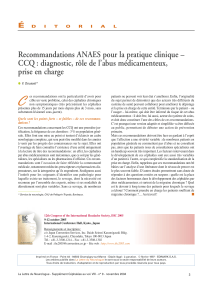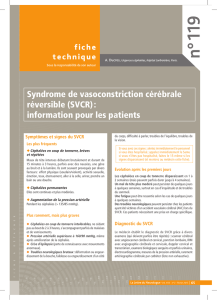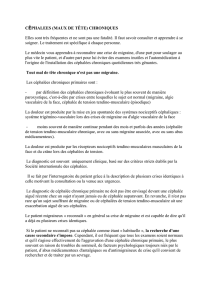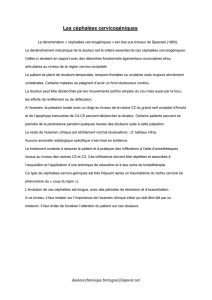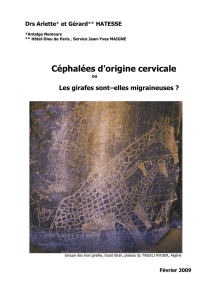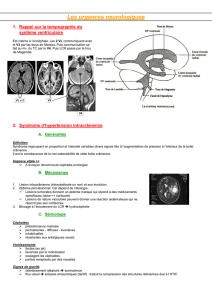Céphalées symptomatiques

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 93
Introduction
Les céphalées symptomatiques, ou secondaires,
sont rares en face des céphalées primitives. Leur
incidence est estimée entre 10 et 20%. Le méde-
cin a donc parfois des difficultés à diagnostiquer
une céphalée symptomatique en tant que telle.
Dans les situations suivantes, le médecin doit
rester à l’écoute de son patient pour poser le bon
diagnostic et lui proposer le bon traitement.
Arguments en faveur des
céphalées symptomatiques
Le caractère de la douleur et les
symptômes d’accompagnement ne sont
pas les mêmes qu’avec les crises céphal-
algiques ou migraineuses précédentes
Les patients souffrant de céphalées symptoma-
tiques indiquent pour la plupart spontanément,
ou répondent à l’anamnèse que le caractère
et/ou la violence de leur mal de tête sont inha-
bituels, ou qu’il y a des symptômes d’accompa-
gnement qu’ils ne connaissaient pas pour leur
céphalée tensionnelle ou migraineuse. Citons
les crises d’amblyopie, témoignant d’une hy-
pertension intracrânienne.
Facteur déclenchant particulier
Si les céphalées n’apparaissent que dans cer-
taines situations, ou surviennent pour la pre-
mière fois après un certain événement, cela doit
faire suspecter une céphalée symptomatique.
Par exemple un traumatisme, ou un mal de tête
uniquement en position debout, disparaissant
en position couchée. Ces céphalées dites ortho-
statiques se voient dans l’hypotension intra-
crânienne.
Céphalée hyperaiguë
Une céphalée survenant sur le mode hyperaigu,
et dont le caractère est inhabituel pour le pa-
tient, doit faire penser à une hémorragie sous-
arachnoïdienne.
Céphalée prolongée
Les crises de céphalées primitives peuvent
durer de 2 à 3 jours. Une céphalée se prolon-
geant de manière inhabituelle doit faire sus-
pecter une pathologie intracrânienne ou une
maladie systémique avec une céphalée comme
symptôme dominant.
Déclenchement à l’effort
Les céphalées migraineuses s’accentuent typi-
quement à l’effort, ou à la toux. En l’absence
d’une anamnèse de migraine, il s’agit de cé-
phalées d’effort. Elles sont pour la plupart bé-
nignes, mais peuvent être le reflet d’une pa-
thologie intracrânienne.
Vomissement
Un vomissement, en jet surtout, tôt le matin et
en l’absence de nausée notable, doit faire pen-
ser à une hypertension intracrânienne et à un
processus expansif intracrânien.
Epilepsie / déficits neurologiques /
altérations neuropsychologiques
Les crises épileptiques, ou les déficits neurolo-
giques ou neuropsychologiques chez des pa-
tients souffrant de maux de tête, doivent tou-
jours faire suspecter une pathologie intracrâ-
nienne, et exigent un diagnostic complémen-
taire en urgence. Cela est vrai surtout pour les
troubles de la conscience et la présence d’un
méningisme.
Pathologie interne ou autre,
non neurologique
Hypertension, infections fébriles, obstruction
nasale ou sécrétions nasales purulentes, mala-
dies inflammatoires non infectieuses, comme
lupus érythémateux disséminé, peuvent avoir
comme seule manifestation ou symptôme cli-
nique d’appel une céphalée. Toute céphalée
atypique exige un examen général.
Quelques maladies dont les
céphalées peuvent être le
symptôme majeur
Le tableau 1 donne un aperçu des maladies se
manifestant par une céphalée symptomatique.
Céphalées posttraumatiques
Après une commotion ou une contusion céré-
brale, il peut y avoir une céphalée sourde, plus
marquée aux niveaux frontal et temporal. Elle
augmente à l’effort et dure toute une journée.
L’importance de la douleur semble être en cor-
rélation inverse avec la durée de la perte de
connaissance. Nul ne peut expliquer pourquoi.
Les analgésiques ne sont pas très efficaces. La
mobilisation précoce et la consommation res-
Céphalées symptomatiques
H. P. Mattlea, M. Sturzeneggera, C. Meyerb
aService universitaire
de Neurologie, Berne
bNeurologue, Baden
Correspondance:
Prof. Heinrich Mattle
Clinique et Policlinique
de Neurologie
Hôpital de l’Ile
CH-3010 Berne

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 94
treinte d’analgésiques sont le meilleur traite-
ment. Le repos peut être contre-productif. Si le
mal de tête se prolonge au-delà de 2 semaines,
le traitement sera le même que pour les cépha-
lées tensionnelles, soit les antidépresseurs tri-
cycliques.
Les céphalées posttraumatiques simples sont
difficiles à distinguer de celles des hématomes
sous-duraux. Un hématome sous-dural résulte
d’une rupture des veines communicantes, avec
hémorragie lente dans l’espace sous-dural.
Plusieurs jours ou semaines après un trauma-
tisme même banal, une céphalée sourde com-
mence, intermittente au début, mais qui de-
vient persistante. Les vieillards sont particuliè-
rement menacés, de même que les personnes
ayant des troubles de la coagulation et les al-
cooliques. S’il y a anamnèse de traumatisme, il
faut évoquer un hématome sous-dural et le
confirmer par neuroradiologie. En l’absence
d’une telle anamnèse, le caractère inhabituel de
la douleur doit faire demander un examen neu-
roradiologique pour préciser le diagnostic. Les
hématomes volumineux, surtout s’ils sont ac-
compagnés de déficits neurologiques ou neuro-
psychologiques, seront drainés chirurgicale-
ment.
Si une artère méningée se déchire lors d’un
traumatisme crânien, il se produit une hémor-
ragie aiguë dans l’espace épidural, ou héma-
tome épidural. Ces patients ne reprennent pas
connaissance après le traumatisme, ou la re-
perdent 1 à 2 heures après le traumatisme. Le
diagnostic doit être rapidement confirmé, et
l’hématome évacué pour prévenir toute invali-
dité permanente.
Anomalies de la production, de la
circulation ou de la réabsorption de
liquide céphalo-rachidien
Une anomalie de la production, de la circula-
tion ou de la réabsorption de liquide céphalo-
rachidien peut se manifester par une céphalée
comme symptôme majeur:
– pseudotumeur cérébrale / hypertension in-
tracrânienne;
– hypotension intracrânienne;
– hydrocéphalie.
Hypertension intracrânienne
Une augmentation de la pression intracrâ-
nienne peut être idiopathique ou secondaire à
– une hydrocéphalie;
– un processus expansif tel que néoplasie, hé-
matome ou œdème cérébral ischémique ou
traumatique;
– une thrombose veineuse ou sinusale;
– ou des substances comme vitamine A,
tétracyclines, etc.
Les symptômes dominants de l’hypertension
intracrânienne sont des céphalées diffuses, uni-
quement matinales au début, puis toute la jour-
née, qui s’accompagneront assez rapidement
de nausée et d’apathie. Les crises amblyo-
piques en sont typiques, ou amputations ou as-
sombrissements du champ visuel d’une durée
de quelques secondes. La papille de stase en est
un signe somatique. Une mydriase unilatérale
ou une paralysie oculomotrice totale sont déjà
des symptômes d’alarme de l’hypertension in-
tracrânienne, reflétant une menace de hernia-
tion du tronc cérébral. D’autres symptômes
d’alarme sont un trouble de la conscience avec
une posture anormale, témoignant d’une dé-
cortication ou d’une décérébration.
L’hypertension intracrânienne idiopathique,
ou «pseudotumeur cérébrale», touche prati-
quement toujours de jeunes femmes obèses.
Elles se plaignent de céphalées type tension-
nelles, migraineuses au début et surtout mati-
nales, puis permanentes et à localisation bi-
frontotemporales. Elles signalent en outre des
acouphènes pulsatiles, des troubles visuels épi-
sodiques, des crises amblyopiques et parfois
une diplopie. Une chute définitive de l’acuité vi-
suelle pouvant aller jusqu’à la cécité est rare et
généralement réversible sous traitement. Il y a
presque toujours un œdème de la papille bila-
téral. Le CT, l’IRM et le LCR sont normaux, mais
la pression du LCR est augmentée.
Pour que le traitement de l’hypertension intra-
crânienne idiopathique soit efficace, il est in-
dispensable que ces femmes perdent du poids.
Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique et
diurétiques de l’anse sont administrés, avec des
injections de stéroïdes et ponctions lombaires à
répétition. Les shunts lobo- ou ventriculo-péri-
Tableau 1.
Maladies et situations dans lesquelles
les céphalées peuvent être le
symptôme dominant.
Posttraumatique
Vasculite
Pathologies intracrâniennes
anomalies de la circulation du LCR
infections
néoplasies
hémorragies intracrâniennes
Toxiques
Infections systémiques
Métaboliques
Pathologies de la colonne cervicale, des yeux,
oreilles, sinus, articulations temporo-mandibulaires
ou dents

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 95
tonéaux, ou la fenestration de la gaine du nerf
optique sont le dernier recours en cas de me-
nace de cécité.
Hypotension intracrânienne
Les céphalées survenant en position debout et
disparaissant en position couchée, ou cépha-
lées orthostatiques, sont caractéristiques du
syndrome d’hypotension intracrânienne. Le
mal de tête survient typiquement dans les 15
minutes suivant le passage en position debout,
et s’améliorent dans les 30 minutes suivant
l’alitement. Il s’accompagne éventuellement de
nausée, vomissement, acouphène, baisse de
l’acuité auditive, photophobie ou diplopie. Les
symptômes objectifs peuvent être un ménin-
gisme ou des parésies du 6enerf crânien. A la
ponction lombaire, la pression est basse, pou-
vant même donner une ponction sèche, ne per-
mettant d’obtenir du LCR que par aspiration à
la seringue. Il présente une pleïocytose avec
augmentation des protéines, pouvant conduire
au diagnostic d’infection intracrânienne. L’IRM
montre parfois un déplacement caudal du tronc
cérébral. Après injection de produit de
contraste, il se produit typiquement une opaci-
fication supra- et infratentorielle dans la dure-
mère (pachyméningite) (fig. 1). Les leptomé-
ninges entre les sillons ne prennent pas de pro-
duit de contraste.
Une hypotension intracrânienne peut être
spontanée. Mais elle est beaucoup plus souvent
symptomatique, reflétant une fuite cryptique de
LCR, après ponction lombaire, anesthésie spi-
nale, traumatisme crânio-cérébral, crânioto-
mie, chirurgie vertébrale ou dans les fissures de
la dure-mère, une rhinorrhée de LCR ou des
shunts atrio-ventriculaires. Un déficit volu-
mique ou une hyperosmolarité font baisser la
pression intracrânienne. Les pathologies s’ac-
compagnant d’une baisse de la production de
LCR, ou d’une réabsorption accrue sont spécu-
latives, et certainement rarement en cause
dans l’hypotension intracrânienne.
Le traitement de l’hypotension intracrânienne
est ciblé sur celui de sa cause, p.ex. par ferme-
ture chirurgicale d’une fistule. Le traitement
symptomatique comprend alitement, patch de
sang autologue épidural, perfusions épidurales
de NaCl, ceinture abdominale, caféine et sté-
roïdes.
Céphalées d’effort
Les céphalées déclenchées à l’effort, ou à la
toux, sont pour la plupart bénignes et réagis-
sent bien aux bêtabloquants. Mais elles peuvent
également témoigner d’un processus expansif,
surtout de la fosse postérieure, d’une anomalie
transitionnelle crânio-cervicale ou de patholo-
gies rares, l’anévrisme basilaire fusiforme no-
tamment. Les céphalées lors de rapports
sexuels («coital headache») en font partie. Si la
douleur apparaît à l’orgasme, il s’agit de re-
chercher soigneusement une pathologie sous-
jacente, comme un anévrisme ou une hémor-
ragie sous-arachnoïdienne. Si elle survient
après l’orgasme, il s’agit dans la plupart des cas
d’une céphalée primitive bénigne.
Céphalées sur pathologies vasculaires et
troubles circulatoires
Les céphalées secondaires à des pathologies
vasculaires et troubles circulatoires sont relati-
vement rares, mais peuvent être le symptôme
dominant d’une thrombose veineuse, d’une ar-
térite à cellules géantes, d’une dissection ou
d’une hémorragie sous-arachnoïdienne. Elles
accompagnent souvent une hémorragie céré-
brale et un infarcissement territorial important,
mais pratiquement jamais un infarcissement
cérébral lacunaire.
Dissections artérielles cérébrales
Les dissections concernent les hommes et
femmes jeunes et d’âge moyen. 80% touchent
les carotides, 20% les artères vertébrales, et
25% touchent plus d’une artère. Les dissections
intracrâniennes sont généralement très rares,
et touchent surtout les jeunes gens. Les trau-
matismes et vasculopathies telles que dysplasie
fibromusculaire ou syndrome de Marfan pré-
disposent aux dissections, voire les déclenchent.
Une dissection carotidienne se présente par
une douleur orbitaire, cervicale ou crânienne,
un syndrome de Horner et des symptômes hé-
misphériques ipsilatéraux (tabl. 2), parfois par
un acouphène pulsatile. La variabilité des défi-
cits neurologiques est importante, allant de
l’obstruction carotidienne asymptomatique à
l’infarcissement territorial médian complet.
Les déficits des nerfs cérébraux postérieurs du
même côté que les symptômes hémisphériques
Figure 1.
Hypotension intracrânienne spon-
tanée s’étant manifestée sous
forme de céphalée orthostatique. Sur
l’IRM en T1, une concentration patho-
gnomonique de produit de contraste
est visible dans les méninges
supra- et infratentoriels, et surtout de
la tente.

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 96
peuvent donner des syndromes centraux et pé-
riphériques croisés, pouvant passer par erreur
pour un problème au niveau du tronc cérébral.
Les dissections vertébrales donnent des cer-
vicalgies ispilatérales avec déficits vertébro-ba-
silaires, le plus souvent un syndrome médul-
laire dorsolatéral. Leur présentation clinique
est généralement très variable. L’un des ex-
trêmes est la douleur isolée au niveau du cou
ou de la nuque, et l’autre une atteinte complète
du tronc cérébral dans la thrombose basilaire.
Les dissections peuvent être suspectées aux ul-
trasons et confirmées par l’IRM. L’hématome
pariétal peut se voir à l’IRM sous la forme d’un
signal falciforme hyperintense (fig. 2). Le dia-
gnostic à temps d’une dissection permet la plu-
part du temps de prévenir un infarcissement
cérébral embolique par une anticoagulation.
Thromboses cérébrales veineuses et sinusales
Les thromboses cérébrales veineuses et sinu-
sales concernent surtout les jeunes femmes. Il
s’agit la plupart du temps du sinus longitudinal
supérieur et du sinus latéral, plus rarement des
sinus droit et caverneux, et des veines corti-
cales. Les symptômes cliniques sont présentés
dans le tableau 3. Etiologiquement, il faut dis-
tinguer les thromboses secondaires à des in-
fections intracrâniennes et systémiques des
non infectieuses. Toutes les étiologies médi-
cales des thrombo-embolies sont à envisager,
gynécologiques-obstétricales chez les femmes,
la fumée, la pilule et l’obésité, et chez les
hommes la maladie de Behçet. Neuroradiologi-
quement, il y a des infarcissements hémorra-
giques uni- ou bilatéraux. La plupart de ces
thromboses se voient au CT avec produit de
contraste ou à l’IRM, et certaines uniquement à
l’angiographie (fig. 3). L’imagerie diagnostique
de choix est l’IRM.
Encéphalopathie hypertensive
Il s’agit de troubles cérébraux lors d’une crise
hypertensive, avec ou sans hypertension chro-
nique préalable. Les céphalées en sont le symp-
tôme majeur, pouvant s’accompagner de nau-
sée, vomissement, troubles visuels, obnubila-
tion et confusion, crises convulsives focales ou
généralisées, déficits neurologiques focaux. Au
fond d’œil, il y a un œdème de la papille et de
la rétine, et des vasospasmes artériolaires.
L’encéphalopathie hypertensive est une situa-
tion d’urgence, imposant une baisse tension-
nelle rapide et éventuellement un traitement
anticonvulsivant. Une hypertension artérielle
n’évolue pas toujours de manière aussi drama-
tique. Mais si elle fait des symptômes cliniques,
il s’agit beaucoup plus souvent de céphalées dif-
ficiles à distinguer des céphalées tensionnelles.
Tableau 2.
Symptômes dominants de la
dissection carotidienne et vertébrale.
Céphalées ou algies faciales du même côté que la
dissection
TIA ou infarcissement dans le territoire irrigué par
l’artère
Syndrome de Horner
Acouphène pulsatile, bourdonnement artériel
Tableau 3. Symptômes dominants
d’une thrombose sinusale et veineuse.
Céphalées inhabituelles
Crises épileptiques focales ou généralisées
Œdème de la papille et autres signes d’hyperten-
sion intracrânienne
Déficits sensitivo-moteurs, éventuellement
controlatéraux
Artérites, artérite à cellules géantes
Les vasculites forment un groupe de maladies
étiologiquement et morphologiquement hétéro-
gène, primitives (c.-à-d. sans étiologie connue)
ou secondaires à certaines maladies. Dans la
plupart des vasculites, la manifestation SNC
n’est qu’une partie de la maladie, et les mani-
festations extracérébrales dominent le tableau
clinique. Elles touchent également le système
nerveux périphérique, avec des poly- et mono-
neuropathies, la rétine ou la cochlée. Dans les
angéites isolées et granulomateuses du SNC, la
vasculite se limite au système nerveux central.
Les symptômes neurologiques majeurs des vas-
culites sont des céphalées, des troubles cogni-
tifs et des déficits neurologiques focalisés suite
à de multiples petits infarcissements. La for-
Figure 2.
Dissection de la carotide droite.
L’hématome pariétal falciforme se
voit sur le cliché IRM avec technique
de suppression de la graisse comme
une structure hyperintense.

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 97
mule sanguine est généralement inflamma-
toire, mais pas toujours. Les anticorps reflétant
une certaine maladie ou un certain syndrome
peuvent aider au diagnostic. Il y a également
des signes d’inflammation dans le LCR. L’an-
giographie montre parfois des altérations vas-
culaires inflammatoires. Mais parfois seule une
biopsie cérébrale ou méningée permet de poser
le diagnostic.
L’artérite à cellules géantes touche essentiel-
lement des vieillards. Son étiologie est incon-
nue. Céphalée, fatigue, myalgies, tendance dé-
pressive et douleurs des masséters à la masti-
cation en sont les symptômes majeurs. Les ar-
tères temporales peuvent être douloureuses à
la pression, indurées et non pulsatiles. Une VS
très accélérée met sur la voie du diagnostic. Les
ultrasons permettent souvent de visualiser une
paroi artérielle épaissie, mais pas toujours, et
le diagnostic sera confirmé par biopsie et his-
tologie. Les stéroïdes sont le traitement de
choix, à hautes doses au début et à doses faibles
pendant plusieurs mois.
Infarcissement cérébral secondaire à la migraine
L’infarcissement cérébral secondaire à la mi-
graine est rare. Il concerne la plupart du temps
le territoire de l’artère cérébrale postérieure et
se caractérise comme suit:
– symptômes neurologiques identiques à ceux
des crises migraineuses précédentes;
– survenue lors d’une crise migraineuse;
– autres causes d’infarcissement exclues.
Céphalées des néoplasies
Les céphalées ne sont que rarement le symp-
tôme dominant dans les néoplasies intracrâ-
niennes. Les symptômes dominants sont beau-
coup plus souvent des crises épileptiques ou des
déficits neurologiques ou neuropsychologiques
focaux. Mais lorsque ces néoplasies atteignent
un certain volume, les céphalées diffuses, sou-
vent frontales et irradiant dans l’ensemble du
neurocrâne sont des symptômes d’accompa-
gnement fréquents. Dans l’infiltration néopla-
sique des méninges par des carcinomes, sar-
comes ou lymphomes (méningite néoplasique),
les céphalées sont par contre un symptôme do-
minant précoce.
Céphalées de la méningite, de l’encépha-
lite et des infections systémiques
Les infections peuvent être hématogènes ou
toucher le système nerveux par continuité, et
provoquer une inflammation des méninges
(méningite), du parenchyme (encéphalite) ou
des foyers purulents (abcès intracérébral, em-
pyème sous-dural, abcès épidural).
La symptomatologie clinique classique de la
méningite consiste en céphalées, fièvre et rai-
deur de nuque (méningisme). Ces céphalées
peuvent être intenses, diffuses, ou évent. bila-
térales et plus volontiers occipitales. Dorsal-
gies, myalgies, photophobie, nausée et vomis-
sement en sont d’autres symptômes. Elle peut
être à l’origine de crises épileptiques, de défi-
cits des nerfs crâniens, d’une somnolence pou-
vant aller jusqu’au coma. Il peut y avoir un
œdème de la papille. Chez les enfants, les im-
munodéprimés ou les vieillards, le méningisme
et la température peuvent parfois être très dis-
crets, les céphalées et/ou les vomissements do-
minant le tableau clinique.
Figure 3.
Jeune femme souffrant de cépha-
lées sur thrombose du sinus longi-
tudinal supérieur. Le thrombus est
bien visible sur le cliché IRM sagit-
tal. Il se situe juste en dessous et
dans l’os compact de la calotte crâ-
nienne sans signal, et par rapport
au parenchyme cérébral, il est en
partie iso- et en partie hyperintense.
Tableau 4. Infections intracrâniennes.
Méningite aiguë purulente ou bactérienne
Méningite aiguë non purulente ou virale
Méningite chronique (voir méningite néoplasique)
tuberculose
champignons
syphilis
borréliose
VIH
sarcoïdose
LED
Encéphalite
Inflammation paraméningée
Les encéphalites sont la plupart du temps vi-
rales, et se présentent comme les méningites
avec fièvre, céphalées et méningisme. A cela
viennent pratiquement toujours s’ajouter une
perturbation de la conscience et de la person-
nalité, avec des troubles focaux tels qu’aphasie,
ataxie, hémiparésie, déficits des nerfs crâniens,
du champ visuel, crises généralisées ou focales
et papilles de stase.
Un abcès cérébral est un processus purulent
focal dans le parenchyme cérébral, rare. Les cé-
phalées surviennent comme manifestation d’une
hypertension intracrânienne, plus rarement
lorsque des symptômes infectieux généraux ac-
 6
6
 7
7
1
/
7
100%