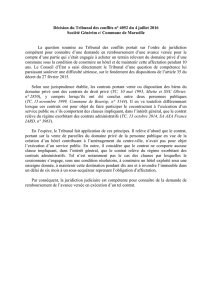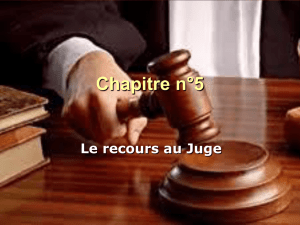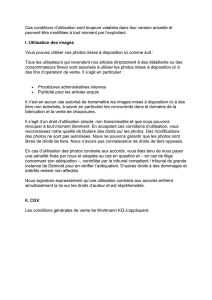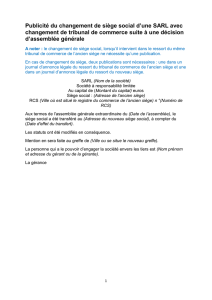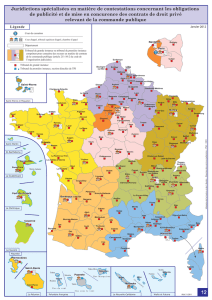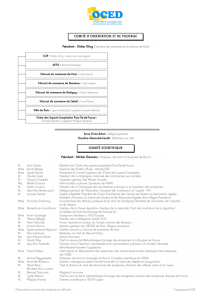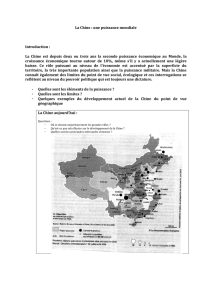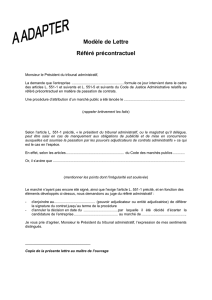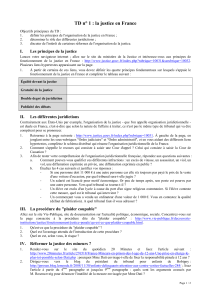La peine de mort en Chine

Amnesty International
D
DO
OC
CU
UM
ME
EN
NT
T
P
PU
UB
BL
LI
IC
C
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Des exécutions « conformes au droit » ?
La peine de mort en Chine
Index AI : ASA 17/003/2004
•
ÉFAI
•
RAPPORT

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : ASA 17/003/2004
DOCUMENT PUBLIC
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Des exécutions « conformes au droit » ?
La peine de mort en Chine
Résumé *
D’après les informations recueillies par Amnesty International, la République
populaire de Chine exécute plus de personnes que tous les autres pays du monde
réunis. En outre, bien qu’étant le pays le plus peuplé de la planète, elle semble
détenir l’un des plus forts taux d’exécution par habitant au monde, à une époque
où de nombreux pays renoncent à ce châtiment.
Derrière cette réalité se trouve un système judiciaire contraire au droit
international et aux normes reconnues en matière de peine de mort : une grande
part des « crimes les plus graves », dont les auteurs encourent la peine de mort en
Chine, sont des infractions non violentes ; la définition des crimes est souvent
élargie pour appliquer la peine de mort à des catégories toujours plus vastes de
personnes déclarées coupables ; et, en janvier 2003, la Chine aurait exécuté une
personne pour un crime commis alors qu’elle était mineure.
Même si la Chine respectait à la lettre la procédure pénale prévue par son propre
droit interne, elle serait encore en deçà des normes internationalement reconnues
en la matière. Par exemple, la loi chinoise ne garantit pas aux détenus le droit à
une représentation judiciaire immédiate – ce n’est qu’après le premier
interrogatoire que ce droit est reconnu à l’accusé ; les « aveux » arrachés sous la
torture, fréquente lors des interrogatoires préliminaires, sont souvent utilisés à
charge par les tribunaux alors qu’ils sont illégaux ; et c’est l’accusé qui doit
prouver son innocence devant le tribunal, alors qu’il devrait incomber à
l’accusation d’établir sa culpabilité.
* La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International,
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,
sous le titre : PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. EXECUTED « ACCORDING TO LAW » ? THE DEATH
PENALTY IN CHINA.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - mars 2004
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org
Embargo : 22 mars 2004

Chine. Des exécutions « conformes au droit » ? La peine de mort en Chine ASA 17/003/2004 - ÉFAI -
- 2 -
D’autre part, les personnes accusées de crimes capitaux se voient le plus souvent
infliger la peine de mort par des juges aux compétences juridiques minimales, ou
nulles. Ces mêmes juges sont couramment soumis à des pressions politiques qui
les incitent à appliquer les règles du Parti plutôt que celles de l’état de droit.
L’appel interjeté après une condamnation à mort se résume parfois à une
procédure administrative à huis clos et le tribunal qui rejette l’appel est aussi celui
qui procède à l’ultime examen et à la confirmation de l’exécution.
Pour les accusés passibles de la peine de mort sur la base d’accusations touchant à
des questions politiques ou religieuses qui gênent l’État chinois, les procédures
juridiques se déroulent parfois sans la présence d’observateurs, au motif que
l’affaire mettrait en jeu des « secrets d’État ». L’exclusion des observateurs
interdit l’accès aux éléments de preuve et sert souvent d’écran à des procès
particulièrement inéquitables.
En plus d’enfreindre les lois et normes internationales relatives à la peine de mort,
la justice chinoise exécute aussi des personnes dans le cadre de procédures qui
violent son propre droit interne. Malgré son interdiction par la législation
chinoise, la torture est souvent utilisée pour arracher des « aveux » aux suspects,
qui sont fréquemment détenus bien au-delà des limites légales ; des éléments de
preuve à charge, de toute évidence fabriqués ou falsifiés, sont admis par les
tribunaux ; et des condamnés sont exhibés au public avant d’être escortés
jusqu’au lieu d’exécution.
Le présent document s’intègre dans le travail permanent d’Amnesty International
visant à sensibiliser l’opinion publique internationale au recours à la peine de
mort en Chine. En soulignant certains aspects du droit et des pratiques qui, dans
ce pays, permettent de multiplier les exécutions, il vise aussi à susciter et nourrir
le débat des juristes chinois sur la peine de mort.

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : ASA 17/003/2004
DOCUMENT PUBLIC
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Des exécutions « conformes au droit » ?
La peine de mort en Chine
SOMMAIRE
Introduction ........................................................................................................ 2
Observation sur les sources ............................................................................. 5
1. Les normes internationales relatives à la peine de mort ............................. 6
2. Le champ d’application de la peine de mort en Chine ................................. 7
2.1 Catégories de personnes non passibles de la peine de mort en Chine ........... 7
2.2 Les « crimes des plus graves » .......................................................................... 10
2.3 Le nombre de crimes passibles de la peine de mort ....................................... 11
3. Les violations des droits humains entraînées par les failles
de la procédure pénale .................................................................................... 12
3.1 La torture et les mauvais traitements en détention provisoire ....................... 13
3.2 Les entraves aux pieds et aux jambes et autres moyens de contrainte
assimilables à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ........ 17
3.3 La détention prolongée et la détention au secret ............................................. 18
3.4 La représentation en justice ............................................................................... 20
3.5 L’inculpation et la préparation du procès ......................................................... 25
4. Les procès en première instance ................................................................ 28
4.1 L’ingérence politique ........................................................................................... 31
4.2 La présomption d’innocence .............................................................................. 33
5. L’appel .......................................................................................................... 34
5.1 La révision d’une sentence en appel ................................................................. 35
5.2 L’arrêt portant révision d’un jugement ou renvoyant l’affaire
pour un nouveau jugement ....................................................................................... 36
6. Le réexamen et la confirmation des condamnations à mort par le
Tribunal populaire suprême ............................................................................ 40
7. La « supervision de la décision » définitive par le Tribunal populaire
suprême ............................................................................................................ 44
8. L’exécution ................................................................................................... 45
8.1 L’exécution par balle ........................................................................................... 47
8.2 L’exécution par injection létale .......................................................................... 49
9. Le prélèvement d’organes ........................................................................... 52
Conclusion et recommandations .................................................................... 55
Recommandations ........................................................................................... 55
Embargo : 22 mars 2004

Chine. Des exécutions « conformes au droit » ? La peine de mort en Chine ASA 17/003/2004 - ÉFAI -
- 2 -
Introduction
Ce document décrit le parcours judiciaire qu’impose le système pénal chinois aux
personnes soupçonnées d’avoir commis un crime passible de la peine de mort,
depuis leur interpellation jusqu’à leur exécution, à l’aide d’exemples provenant
des recherches d’Amnesty International et d’informations parues dans la presse
officielle chinoise.
Il montre que tous les stades de la procédure pénale menant à l’exécution laissent
le champ libre à la violation de droits humains de l’accusé. Par exemple, le droit
de bénéficier dès la garde à vue et sans délai de l’assistance d’un avocat et celui
de disposer des moyens nécessaires pour préparer ensuite une défense sont
fréquemment ignorés ; le risque de torture ou d’autres formes de sévices afin
d’obtenir des « aveux » qui pourront être utilisés par un tribunal est omniprésent ;
les verdicts et les prononcés de jugements sont parfois établis par des comités
internes de l’appareil judiciaire, avant toute audience ; les accusés n’ont pas le
droit de contre-interroger les témoins lors des procès, qui sont souvent écourtés ;
un appel peut être rejeté après un examen sommaire de l’affaire par des juges
siégeant à huis clos. Les personnes déclarées coupables sont alors soumises à la
pire forme de châtiment cruel, inhumain et dégradant – l’exécution – et à la
négation de leur droit à la vie.
L’article 5 du texte d’application des Garanties pour la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort (ECOSOC, 1989/64) « prie instamment
les États membres de publier […] des renseignements sur le recours à la peine de
mort, y compris le nombre des personnes condamnées à mort, le nombre des
personnes effectivement exécutées [et] le nombre des personnes sous le coup
d'une condamnation à mort […] »
L’article 212-5 du Code de procédure pénale de la République populaire de Chine
(1996) précise que « l’exécution des condamnés à mort fait l’objet d’une annonce
publique […] »
La République populaire de Chine continue de considérer les chiffres relatifs à la
peine de mort comme un « secret d’État », en dépit des instruments acceptés par
la communauté internationale qui demandent à tous les États ayant encore recours
à ce châtiment de publier des statistiques sur le sujet.
Il reste donc impossible de savoir combien de personnes sont exécutées chaque
année en Chine. Depuis les années 90, Amnesty International publie un relevé
annuel (annual log) des cas de peine de mort et des exécutions dans ce pays,
établi principalement sur la base d’informations publiées par les médias.
L’organisation a par exemple enregistré un total de 1 060 exécutions en Chine en
2002, mais le nombre réel est certainement largement supérieur. Seule une
fraction des condamnations à mort et des exécutions est signalée au public ; de
plus, l’ampleur et la précision des informations, délivrées de manière sélective par
les autorités concernées, varient beaucoup d’une année à l’autre. Les chiffres
d’Amnesty International reflètent donc la quantité d’information disponible plutôt
que la réalité dans toute ses dimensions.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
1
/
59
100%