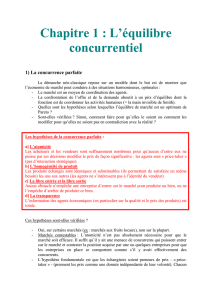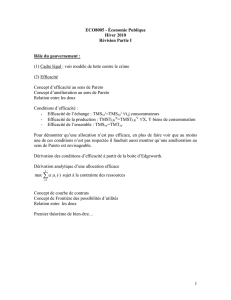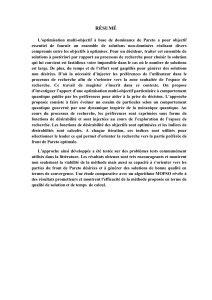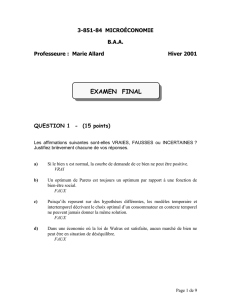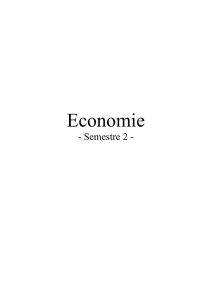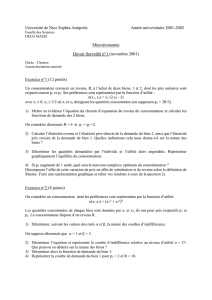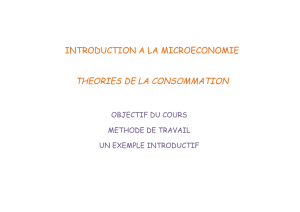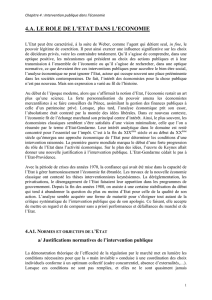- 1 -
ECONOMIE PUBLIQUE
Cours et Exercices Corrigés
Chapitre 1. Optimum, Equilibre général et décentralisation des décisions
I. Les caractéristiques de l’économie
1- Les choix des consommateurs
2- Les choix des producteurs
II. L’équilibre général walrasien
1- La notion de point fixe
2- Définition de l’équilibre général walrasien
3- Existence de l’équilibre général
III. La réalisation décentralisée d’une allocation optimale des ressources
1- L’optimum au sens de Pareto
2- La correspondance entre les concepts parétien et walrasien
Chapitre 2. La production optimale de biens collectifs dans une économie décentralisée
I. La notion de bien collectif
1-la potentialité d’une exclusion d’usage
2-Propriétés des biens collectifs
3-Les autres phénomènes de concernement collectif
II. L’allocation optimale des ressources dans une économie avec bien collectif pur
1- Définition de l’optimum
2- Propriétés de l’optimum
III. La décentralisation par les prix : l’équilibre de Lindahl (1919)
1- Définition d’un équilibre de Lindahl
2- Propriétés de l’équilibre de Lindahl
VI. Les autres modalités d’affectation des biens collectifs
1- La souscription
2- L’équilibre politico-économique
3- La coopération
Chapitre 3. Les Effets externes

- 2 -
Chapitre 4. Information imparfaite et Economie publique
I. Asymétrie d’information et allocation des ressources ; quelques exemples
d’illustration
II. La révélation des préférences pour les biens collectifs
III. Mécanisme optimal en stratégies dominantes
IV. Les Mécanismes de Clarke- Vickrey- Groves
BIBLIOGRAPHIE
Laffont J-J. (1988), Fondements de l’économie publique, vol 1, Cours
de théorie Microéconomique, Economica, Paris
Mougeot M(1989), Economie du secteur public, Economica, Paris
Picard, P (2011), Eléments de Microéconomie : Théorie et applications,
Montchrestien

- 3 -
INTRODUCTION
Ce cours a pour objet, l’analyse de l’intervention de l’Etat dans le cadre de l’équilibre
général. Dans son interprétation la plus large, l’économie publique est l’étude de l’intervention
de l’Etat dans l’économie. En d’autres termes, c’est l’étude des politiques économiques en
rapport particulier avec la taxation. En effet, cette discipline s’est développée dans les années
1950, à partir de l’économie des finances publiques et elle est devenue autonome au début des
années 1970.Cette caractérisation reflète une extension du domaine de l’économie publique de
son rôle initial sur la collecte et la distribution des revenus à son objet actuel concernant tous
les aspects de l’intervention de l’Etat dans l’économie. Le but de ce manuel est de fournir une
introduction à la vaste littérature sur l’économie publique, en soulignant les fondements sur
lesquelles les recherches futures peuvent être menées.
L’économie publique a une longue histoire en tant que discipline de la science
économique et d’éminents économistes ont écrit sur le sujet. C’est le cas par exemple, de
Ricardo (1817), qui a analysé les effets de la dette publique, l’incidence de la taxation sur un
marché de concurrence imparfaite a été analysée par Cournot (1838), Edgeworth (1925) a
considéré les effets de la taxation sur les firmes multi produits et Pareto (1909) a établi les
fondements des décisions sociales.
Le développement de cette branche de l’économie se fait en parallèle avec le
développement de la théorie microéconomique et de la théorie macroéconomique. L’approche
adoptée dans ce cours est une approche microéconomique. L’analyse microéconomique
traditionnelle étudie les échanges marchands dans un cadre dit de concurrence parfaite. Dans
ce cadre, chaque bien ou service s’échange sur un marché spécifique sur lequel se rencontre
des acheteurs et des vendeurs. Un marché est en concurrence parfaite s’il vérifie les conditions
suivantes : atomicité ; homogénéité des biens échangés ; libre entrée ; la transparence ; le
principe d’exclusion ; absence d’effets externes.
L’analyse microéconomique fait un grand usage de la notion d’allocation efficace
(encore appelée allocation optimale au sens de Pareto). Cette expression désigne une situation
dans laquelle il est impossible d’améliorer la satisfaction d’au moins un individu sans diminuer
celle d’un autre. Un des principaux apports de la microéconomie traditionnelle est de parvenir
à démontrer qu’une économie dans laquelle tous les marchés fonctionnent selon les hypothèses
de la concurrence parfaite aboutit précisément à une allocation efficace des ressources (cf. le
modèle. Arrow-Debreu [1954]). Ce résultat ne signifie pas que le laisser-faire entraîne

- 4 -
automatiquement une situation efficace et que, par conséquent, toute intervention de l’Etat
s’avère inutile, voire même, nocive.
Penser que l’absence d’intervention de l’Etat dans l’économie permet d’instaurer la
concurrence parfaite est une aberration qu’aucun économiste sérieux n’a jamais soutenue. La
question essentielle est pourquoi l’Etat intervient-il et joue-t-il un rôle important dans la vie
économique ? Et comment doit-il intervenir ?
Dans une économie décentralisée, la plupart des ressources sont allouées à travers les
marchés sur lesquels la majorité des transactions se font entre agents privés (ménages et
entreprises). La microéconomie part du principe selon lequel les individus engagés dans des
échanges marchands adoptent un comportement rationnel. Ce principe de rationalité signifie
que les individus agissent en utilisant au mieux les ressources dont ils disposent, compte tenu
des contraintes qu’ils subissent. En d’autres termes, l’individu rationnel de la microéconomie
cherche à maximiser son bien-être dans la limite des possibilités qui lui sont offertes. L’Etat y
joue cependant un rôle important dans la fixation de certaines règles, l’achat des biens et
services, la distribution des revenus, etc. En outre, par sa fiscalité et ses emprunts, l’Etat exerce
une influence sur les prix, la production et les taux d’intérêt. Tous les développements récents
de l’analyse économique invitent à penser qu’un fonctionnement parfaitement concurrentiel
des marchés ne peut être obtenu que grâce à l’intervention de l’Etat dans de nombreux
domaines. Par exemple, l’Etat doit maîtriser les conséquences des externalités ; prendre en
charge la production de biens publics ; réduire les inégalités en redistribuant les ressources.
En Afrique, au début des années d’indépendance, les Etats ont annoncé des
nationalisations dans les différents secteurs de l’économie. Mais depuis le milieu des années
1980, on a privatisé une bonne partie de ces entreprises et tous les secteurs sont encours de
libéralisation. On assiste à l’émergence de nouvelles structures de marché avec le
désengagement de l’Etat.
La réalité aujourd’hui est que nous vivons désormais dans des économies mixtes dans
lesquelles l’utilisation des ressources ressortit à la fois aux décisions privées et aux choix
publics. C’est cette caractéristique fondamentale qui justifie une analyse économique de
l’intervention de l’Etat dans l’économie. Dans une économie mixte, l’Etat et le secteur privé
interagissent pour résoudre les problèmes économiques. L’Etat contrôle une partie importante
de la production par l’impôt, les transferts et la fourniture de biens et services publics. Il
réglemente aussi la mesure dans laquelle les individus peuvent poursuivre leur intérêt.
L’Etat est donc en charge de l’intérêt général. Concrètement, l’Etat ce sont les hommes
politiques, des haut-fonctionnaires mettant en œuvre les orientations, des institutions

- 5 -
publiques, … Avec la mondialisation, beaucoup de modes d’intervention de l’Etat perdraient
de leur signification dans l’économie. Les privatisations et les libéralisations sont une remise
en question de l’intervention de l’Etat. Toutefois, pour certains services publics, il y a des
missions d’intérêt général. Comment les financer ? Est-ce-aux entreprises privées de supporter
les coûts de ce genre de missions ? C’est la problématique des contrats de partenariat public-
privé.
Avec l’échec des privatisations en Afrique (même en Europe), l’Etat doit intervenir
dans les activités dans lesquelles l’action des entreprises privées ne va pas servir l’intérêt
général. Il convient de souligner ici que les analyses qui hier étaient valables dans une
économie fermée ont évolué à cause du progrès technique. Ce qui était vrai historiquement
dans un contexte économique et technique donné, n’est plus forcément vrai aujourd’hui. Il y a
un objectif d’intérêt général, mais plusieurs moyens d’y parvenir (autre que le monopole
public). Les défaillances du marché impliquent que l’Etat doit produire ce que le marché ne
produit pas et prendre en compte les notions d’externalité et de biens collectifs. L’Etat peut
aussi avoir des objectifs sociaux. En effet, dans une économie de propriété privée, même si le
marché fonctionne parfaitement, certains agents économiques peuvent avoir de faibles
revenus. L’Etat doit effectuer des redistributions. Or les prélèvements de l’Etat engendrent des
distorsions dans l’économie. Il faut choisir la politique qui minimise les effets négatifs.
L’Etat peut intervenir lorsque le marché n’est pas satisfaisant (concurrence
monopolistique ; inefficacité ; rente de monopole). Deux solutions sont envisageables. La
nationalisation ou la réglementation (les entreprises restent privées, mais l’Etat impose des
règles aux monopoles). L’intervention de l’Etat permet d’éliminer des rentes de monopole.
Mais cette intervention engendre d’autres types de rentes (exemple : rentes bureaucratiques) à
l’origine d’inefficacités au moins aussi grandes.
Quand l’Etat intervient, il n’a pas toujours les bonnes informations sur les paramètres.
C’est par exemple le cas du coût marginal de production d’une entreprise. L’existence des
asymétries d’information conduit à une défaillance dans l’intervention de l’Etat. Le rôle de
l’information est crucial en économie publique. En effet, la disponibilité de l’information
privée des agents détermine la nature de l’équilibre du marché sans l’intervention de l’Etat et
les informations dont dispose le gouvernement déterminent les instruments des politiques à
mettre en œuvre. L’asymétrie d’information entre les agents conduit vers l’inefficacité des
résultats du marché. L’Etat peut améliorer les résultats s’il n’est pas soumis aux mêmes
contraintes informationnelles. L’économie publique moderne s’est développée par la prise en
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
1
/
77
100%