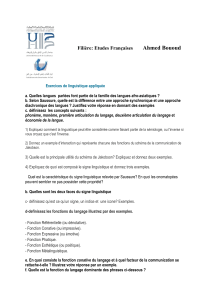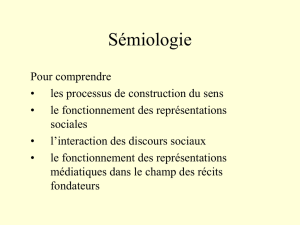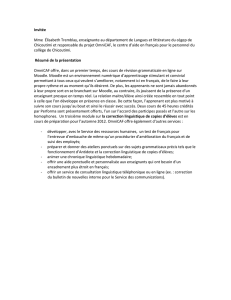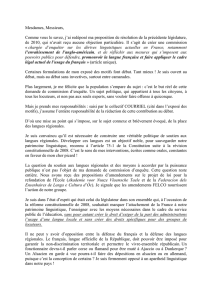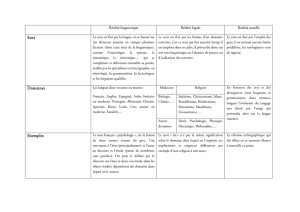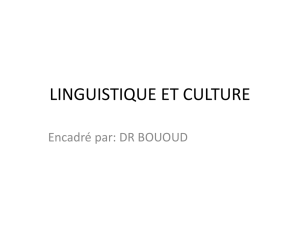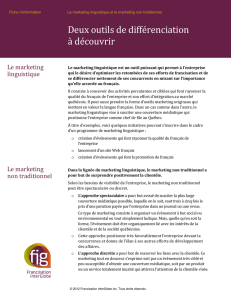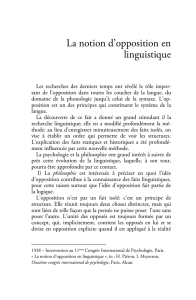Préparation à l'examen de linguistique : Histoire, Phonétique, Lexicologie
Telechargé par
Ena Simeunović

UNIVERSITE PARIS 7 DENIS DIDEROT
U.F.R. Etudes Interculturelles de Langues
Appliquées (EILA) Découverte des parcours 48U7DC11
INTRODUCTION A LA LINGUISTIQUE 48 EC LG11
Resp. M. Pecman
CORRIGE DE L’EXERCICES EN VUE DE LA PREPARATION DE L’EXAMEN FINAL
1.
HISTOIRE DES LANGUES
,
APPROCHES EN LINGUISTIQUE ET DISCIPLINES DE LA LINGUISTIQUE
a. Quelles langues actuellement parlées font partie de la famille des langues germaniques ?
anglais, allemand, néerlandais, danois, islandais, luxembourgeois, suédois, norvégien et afrikaans
(ex. de quelques dialectes romans : alsacien, flamand, lorrain francique…)
b. Selon Saussure, quelle est la différence entre une approche synchronique et une approche
diachronique des langues ? Justifiez votre réponse en précisant à quelle approche on a affaire
dans les cas suivants :
1. Le substantif français chef vient du latin caput où il signifiait « tête ». En ancien français, le mot
chief avait conservé le sens latin. Aujourd’hui, le mot chef renvoie à la notion d’autorité ou de
perfection (par ex. chef d'État, chef d'orchestre, chef de file, chef-d’œuvre…) mais le sens
primitif a survécu dans l’expression couvre-chef.
2. La langue française possède de nombreuses expressions pour désigner la quantité : un kilo de, un
nombre de, un bon nombre de, la plupart de, une foule de, une multitude de, une myriade de,
une bouchée de, une gorgée de, etc. Toutefois, contrairement aux linguistes anglais, les
linguistes français ne rangent pas ces éléments de la langue dans la classe des « quantifieurs »
mais dans la classe des « déterminants indéfinis », auprès d’autres éléments de la langue aussi
variés que : aucun, nul, pas un, plus d’un, maint, beaucoup de, peu de, chaque, tout, certain,
plusieurs, autre, même, quelque, différents...
Synchronie désigne l’étude d’un état de langue, tel qu’on peut l’isoler à un moment déterminé (exemple 2),
et diachronie l’étude de l’évolution historique de cette même langue (exemple 1).
c. Commentez ces propos d’André Martinet en définissant clairement les concepts suivants :
phonème, monème, première articulation du langage, deuxième articulation du langage et
économie de la langue. Vous expliquerez notamment en quoi ces concepts nous aident à
comprendre l’organisation de la langue, dont parle Martinet. N.B. Votre commentaire ne doit
pas excéder une page et demi.
Les unités que livre la première articulation, avec leur signifié et leur signifiant, sont des signes, et des signes
minima puisque chacun d’entre eux ne saurait être analysé en une succession de signes. Il n’existe pas de
terme universellement admis pour désigner ces unités. Nous emploierons ici celui de monème. Comme tout
signe, le monème est une unité à deux faces, une face signifiée, son sens ou sa valeur, et une face signifiante
qui la manifeste sous sa forme phonique et qui est composée d’unités de deuxième articulation. Ces dernières
sont nommées des phonèmes. (…) Le type d’organisation que nous venons d’esquisser existe dans toutes les
langues décrites jusqu’à ce jour. Il semble s’imposer aux communautés humaines comme le mieux adapté
aux besoins et aux ressources de l’homme. Seule l’économie qui résulte des deux articulations permet
d’obtenir un outil de communication d’emploi général et capable de transmettre autant d’information à son
bon compte. Si la première articulation n’existait pas, toute émission correspondrait à un type défini
d’expérience de telle sorte qu’une expérience nouvelle, inattendue, serait incommunicable.
André Martinet, Eléments de linguistique générale, 1970

Les morphèmes constituent la première articulation du langage. Ce sont les plus petits éléments linguistiques
qui possèdent à la fois une forme et un sens. Les phonèmes constituent la deuxième articulation du langage.
Ce sont les éléments non significatifs. Ils ont une forme mais aucun sens). Le concept d’économie de la
langue désigne le fait que toutes les langues permettent de construire à partir d’un nombre limité d’éléments
de la 2ème articulation (phonèmes) un nombre illimité d’éléments de la 1ère articulation (morphèmes, mots,
syntagmes, phrases). Ces concepts nous aident de comprendre que la langue est un système combinatoire
dont la spécificité est de permettre à partir d’un nombre limité d’éléments la construction d’un nombre
illimité de mots et de phrases.
2.
FONCTIONS DU LANGAGE
a. En quoi consiste la fonction conative du langage et à quel facteur de la communication,
selon Romain Jakobson, se rattache-t-elle ? Illustrez votre réponse par un exemple.
Elle vise à faire agir ou à faire pression sur l’interlocuteur. Selon le schéma de la communication de Romain
Jakobson, elle se rapporte au récepteur. Ex. « Tu veux bien m’écouter ? ».
b. Quelle est la fonction du langage dominante des phrases ci-dessous ? Expliquez pour
chaque fonction relevée à quel facteur de la communication, selon Jakobson, elle correspond.
1. Je m’excuse d’interrompre cette réunion, mais je dois malheureusement partir.
2. ... ça va ?
3. Je ne comprends pas pourquoi il y a un "s" à "conclus".
4. Il sera à Paris pour les vacances de Noël.
5. Dim : c’est mâle c’est bien !
6. Regarde ce que tu as fait !
1. Emotive => locuteur
2. Phatique => canal
3. Métalinguistique => code
4. Référentielle => référent
5. Poétique et conative => message et récepteur
6. Conative => récepteur
3.
PHONETIQUE
a. Quels traits phonétiques caractérisent le son [Ɨ
ƗƗ
Ɨ] en français que l’on rencontre à l’initial
des mots joueur, genou et Jacqueline ?
Les traits phoniques qui caractérisent le son [R] sont : consonne, constrictive, apico-alvéolarie, sonore
b. Quel trait phonétique distingue le son [R] tel qu’il est prononcé en français et en anglais ?
En français, le son [R] est une consonne constrictive uvulaire, tandis qu’en anglais c’est une consonne
latérale à battement dorso-alvéolaire. Le mode et le lieu d’articulation sont donc différents.
4.
LANGUE EN TANT QUE REPRESENTATION
ET LEXICOLOGIE
a. Déterminez pour chacun des cas suivants s’il s’agit d’un indice, d’une icône ou d’un
symbole, en précisant pour ce dernier si l’on est en présence d’un signe linguistique.
1. le buste de Marianne
2. du sang et du verre brisé sur la chaussée
3. la suite phonique [byst]
4. le dessin de votre meilleur ami
5. la suite graphique ami
1. symbole
2. indice
3. symbole : signe linguistique
4. icône
5. symbole : signe linguistique

UNIVERSITE PARIS 7 DENIS DIDEROT
U.F.R. Etudes Interculturelles de Langues
Appliquées (EILA) Découverte des parcours 48U7DC11
INTRODUCTION A LA LINGUISTIQUE 48 EC LG11
Resp. M. Pecman
b. Quelles sont les deux faces du signe linguistique ? Illustrez votre réponse à l’aide du signe
vol tel qu’il apparaît dans la phrase suivante : « Un vol à été commis tard dans la nuit. »
D’après les linguistes, le signe linguistique est dit arbitraire ? Expliquez pourquoi.
Les deux faces du signe linguistique sont signifiant et signifié, signifiant étant le graphème vol et le signifié
« action par laquelle on s’approprie qch qui ne nous appartient pas ». Le lien entre les deux est arbitraire car
d’une langue à l’autre un même signifié donne lieu à de différents signifiants (vol en français, robbery ou
theft en anglais).
c. Analysez les matrices lexicales à l’œuvre dans les unités OS, se connecter, partage, logiciel,
peer-to-peer, logithèque, indéniablement, préexistant, serveur, montrer patte blanche, disque dur,
gigaoctet, internaute et site web
telles qu’elles apparaissent dans ce texte adapté du Nouvel
Observateur.
Partager ses fichiers sur Internet
Les fervents défenseurs de Linux, Mac OS ou Windows finissent toujours par se connecter aux mêmes
réseaux de partage de fichiers. Kazaa, Gnutella et Edonkey tiennent toujours la corde, s’il l’on se réfère aux
logiciels peer-to-peer les plus téléchargés depuis la logithèque de ZDNet. Si l'on préfère un réseau pour le
nombre d’abonnés, Kazaa est indéniablement le meilleur. Les réseaux préexistants sont peu à peu
abandonnés par les internautes à son profit. Pour accéder à des contenus plus thématiques, Direct Connect est
un choix à méditer. Les serveurs proposent des contenus plus ou moins ciblés. Mais là, il faut souvent
montrer patte blanche avant de pouvoir accéder au contenu de disques durs, à savoir disposer du nombre
de gigaoctets requis. D’autres internautes préfèrent s’échanger des adresses de sites web, éphémères pour
certains, lesquels recensent des liens de fichiers Bittorrent. Nouvel Observateur, Janvier 2004
OS emprunt de l’anglais (en anglais, c’est un sigle de Operating System)
se connecter dérivation impropre : changement du mode du verbe connecter intr. → se connecter
pron. utilisé spécifiquement pour désigner l’action de se connecter à un réseau de
type Internet
partage mot dérivé, dérivation par suffixation sur le verbe partir + suffixe age
logiciel mot composé par amalgame ou mot valise de logiq(ue) + (matér)iel
peer-to-peer emprunt de l’anglais (en anglais, c’est un composé par juxtaposition sur peer)
logithèque mot composé (plus précisément c’est une composition savante logi(ciel)+thèque sur
le modèle biblio+thèque, vidéo+thèque (ang. software library)
indéniablement mot dérivé, dérivation par suffixation sur le adj. indéniable + suffixe ment
préexistant mot dérivé, dérivation par préfixation sur le adj. existant et à l‘aide du préfixe pré
serveur métaphore de ressemblance de fonction (sens propre : Homme ou femme chargé de
servir les clients dans un bar, dans un restaurant./ sens second : Un ordinateur ou un
programme informatique qui rend service aux ordinateurs et logiciels qui s'y
connectent à travers un réseau informatique, les clients. Ce service peut consister à
stocker des fichiers, transférer le courrier électronique, héberger un site Web, etc.)
montrer patte blanche expression idiomatique formées par composition et métaphore
disque dur calque sur l’anglais hard disc
gigaoctet mot composé par juxtaposition de
giga + d’octet
internaute inter+nautes mot composé sur astro+naute (ang. Net surfer)
site web calque sur l’anglais web site
5.
PRAGMATIQUE ET LINGUISTIQUE DE L
’
ENONCIATION
a. Qu’est-ce que un acte illocutoire ? Illustrez votre réponse par un exemple.
L’acte illocutoire désigne tout acte de parole réalisant ou tendant à réaliser l’action dénommée. Ex. Je te
jure !

b. Trouvez les marques énonciatives dans les énoncés suivants. Proposez un classement pour
les marques relevées selon les catégories de l’appareil formel de l’énonciation de Benveniste.
1. Je vous jure que je ne l’ai pas vu de la journée, mais il était apparemment ici ce matin même.
2. Continue à travailler ! Tu dois faire plus d’effort si tu veux réussir.
3. Il n’est pas impossible que ce problème s’aggrave davantage si l’on en ne se mobilise pas
rapidement, en tout cas avant la fin de l’année en cours.
1. Je vous jure que je ne l’ai pas vu de la journée, mais il était apparemment ici ce matin même.
2. Continue à travailler ! Tu dois faire plus d’effort si tu veux réussir.
3. A mon avis, il n’est pas impossible que ce problème s’aggrave si l’on ne se mobilise pas rapidement,
en tout cas avant la fin de l’année en cours.
1. Embrayeurs
Pronoms et possessifs : je, vous, mon, tu
Déictiques : ce (ex ; ce problème, ce matin)
Locutions adverbiales de temps : ce matin, l’année en cours
Adverbes de lieu : ici
Temps verbaux : présent (ex. je vous jure), passé (ex. il était)
2. Modalisateurs
Verbes modaux : devoir, vouloir
Adv., locutions modale : apparemment, à mon avis, il n’est pas impossible que
Structures syntaxiques : exclamative ou, plutôt jussive ou imperative, et affirmative)
Intensifieurs même, rapidement (ex. ce matin même)
3. Marques de tensions
Imperatif: continue
Performatifs : je vous jure
1
/
4
100%