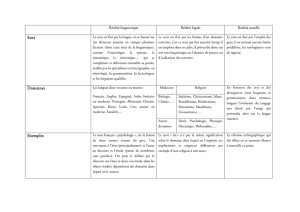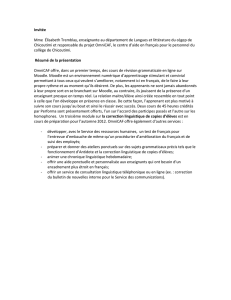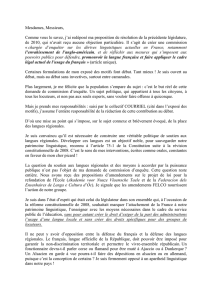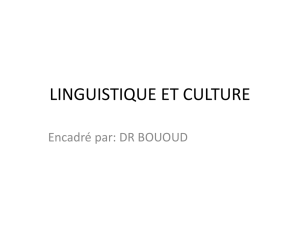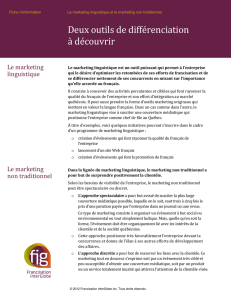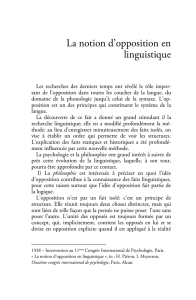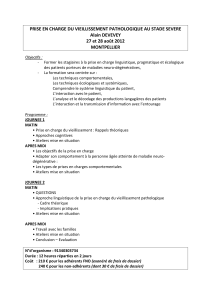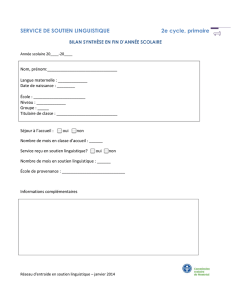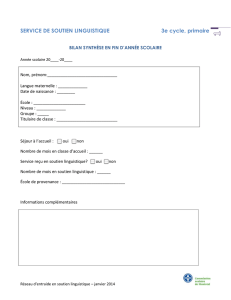Linguistique Appliquée : Enseignement aux États-Unis, France, RU
Telechargé par
shadis523

Histoire Épistémologie Langage
La linguistique appliquée à l’enseignement des langues
secondes aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne
Michel Berthet
Citer ce document / Cite this document :
Berthet Michel. La linguistique appliquée à l’enseignement des langues secondes aux États-Unis, en France et en
Grande-Bretagne. In: Histoire Épistémologie Langage, tome 33, fascicule 1, 2011. Linguistique appliquée et
disciplinarisation. pp. 83-97;
doi : https://doi.org/10.3406/hel.2011.3208
https://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_2011_num_33_1_3208
Fichier pdf généré le 16/01/2019

Abstract
Since the 1950s, French scholars have played an important role in the renewal of language
teaching techniques and have contributed to the emergence of a discipline dedicated to second
language teaching : applied linguistics. In the late 1970s, most French scholars interested in
language teaching began to move beyond linguistics and towards establishing a new discipline,
which would be known as «didactique des langues » . This article analyses the reasons for this
evolution through a comparison of the situation in three countries : France, Great Britain and the
United-States. Three primary themes will be explored : language policies, structures of academic
research, and epistemological traditions.
Résumé
Dès les années 1950, la France joue un rôle important dans le renouvellement des méthodologies
de l’enseignement des langues et participe à l’émergence de la discipline destinée à prendre pour
objet ce type d’enseignement : la linguistique appliquée. A partir de la fin des années 1970, la
majorité des spécialistes français de l’enseignement des langues cherche ailleurs que dans la
linguistique les bases d’une discipline nouvelle, bientôt appelée la didactique des langue. Cet
article analyse les raisons de cette évolution en comparant la situation en France, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis. Trois axes essentiels à la comparaison sont explorés : les politiques
linguistiques, les structures de la recherche linguistique et les traditions épistémologiques.

83
L’enseignement des langues maternelles et étrangères est un des premiers domaines
auxquels les savants qui ont contribué (souvent en tant que phonéticiens) au
renouvellement des études sur le langage et les langues ont songé à « appliquer »
leurs recherches. L’enseignement ou plutôt l’apprentissage1 des langues secondes
est encore aujourd’hui un des principaux objets d’étude d’un très grand nombre de
spécialistes de linguistique appliquée.
1 S’étant d’abord occupés principalement de méthodologie d’enseignement des langues
vivantes, les chercheurs en linguistique appliquée se sont de plus en plus intéressés aux
questions d’apprentissage et d’acquisition. Ce tournant a été plus marqué aux États-Unis
qu’en France.
LA LINGUISTIQUE APPLIQUÉE À L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
SECONDES AUX ÉTATS-UNIS, EN FRANCE ET EN GRANDE-BRETAGNE
Michel Berthet
Université Paris-Sorbonne Nouvelle, Université de Marne la Vallée
RÉSUMÉ : Dès les années 1950, la France joue
un rôle important dans le renouvellement des
méthodologies de l’enseignement des langues
et participe à l’émergence de la discipline
destinée à prendre pour objet ce type
d’enseignement : la linguistique appliquée. A
partir de la fin des années 1970, la majorité
des spécialistes français de l’enseignement
des langues cherche ailleurs que dans la
linguistique les bases d’une discipline
nouvelle, bientôt appelée la didactique des
langue. Cet article analyse les raisons de
cette évolution en comparant la situation en
France, en Grande-Bretagne et aux États-
Unis. Trois axes essentiels à la comparaison
sont explorés : les politiques linguistiques, les
structures de la recherche linguistique et les
traditions épistémologiques.
ABSTRACT : Since the 1950s, French scholars
have played an important role in the renewal
of language teaching techniques and have
contributed to the emergence of a discipline
dedicated to second language teaching :
applied linguistics. In the late 1970s, most
French scholars interested in language teaching
began to move beyond linguistics and towards
establishing a new discipline, which would
be known as « didactique des langues ». This
article analyses the reasons for this evolution
through a comparison of the situation in
three countries : France, Great Britain and
the United-States. Three primary themes will
be explored : language policies, structures
of academic research, and epistemological
traditions.
MOTS-CLÉS : Linguistique appliquée ; Ensei-
gnement des langues ; États-Unis ; France ;
20e s. ; Grande-Bretagne ; Méthodologie
KEY WORDS : Applied linguistics ; Language
teaching ; USA ; France ; 20th century ; Great
Britain ; Methodology
Histoire Épistémologie Langage 33/I (2011) p. 83-97 © SHESL

84
Bien que de nombreux chercheurs français et francophones aient contribué,
dès la fin des années 1950, à son élaboration disciplinaire (pour ne pas dire encore
épistémologique) et institutionnelle, la linguistique appliquée n’a pas donné lieu,
en France, à des développements comparables à ceux qu’elle a connus dans les pays
anglophones. Si l’AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée)
conserve son acronyme d’origine, les chercheurs français qui y occupent une
place active sont rares. C’est que la linguistique appliquée au sens étroit du terme,
c’est-à-dire comme projection de la linguistique structurale dans le champ de
l’enseignement des langues secondes, a perdu en France une grande partie de
sa raison d’être depuis que cet enseignement est devenu l’objet d’une discipline
particulière, la didactique des langues étrangères, discipline dont on a voulu établir
la légitimité en dehors du champ des sciences du langage. Selon Véronique (2009,
p. 51) :
on ne peut qu’être frappé par l’émergence tardive de la linguistique appliquée
[
...] et par la brièveté de son ascendance en matière d’enseignement des langues.
En France, cette discipline ne vivra guère plus d’une décennie.
Ce petit préambule a pour fonction de situer le cadre disciplinaire de cet article. Le
point de vue sera celui d’un « didacticien » (c’est-à-dire d’un chercheur dont l’objet
d’étude est l’enseignement / apprentissage des langues secondes), un didacticien qui
cherche à comprendre pourquoi il n’est pas, comme ailleurs ou comme en d’autres
temps, un linguiste appliqué ; un didacticien qui se demande également si le temps
n’est pas venu de réfléchir à une redéfinition de sa discipline. La disciplinarisation
de la linguistique appliquée sera donc confrontée ici à la disciplinarisation, en
France, de la didactique des langues. Pourquoi la linguistique appliquée n’a-t-elle
pas connu en France les mêmes développements qu’en Grande-Bretagne et aux
États-Unis ?
Il nous a semblé devoir chercher les raisons des particularités nationales autour
de trois axes : celui des politiques linguistiques, celui des structures de la recherche
scientifique, et celui des traditions épistémologiques.
S’intéresser à l’histoire de la linguistique appliquée, ce peut être se poser la
question de la naissance de cette discipline. Un rapide regard rétrospectif montre
qu’il n’est pas aisé de distinguer les « pures » analyses de leurs applications :
les grammairiens indiens ou les premiers rhétoriciens devaient répondre à des
impératifs pratiques2, des applications. Jusqu’à une période très récente, on admet
aussi qu’une forte « solidarité conceptuelle » caractérise la « constitution des
savoirs linguistiques / scolaires » (Chiss 1995, p. 37). On peut se demander si cette
solidarité conceptuelle ne commence pas justement à être remise en cause par les
travaux de ceux qui ont véritablement donné naissance à la linguistique appliquée
(Linn 2008) en contribuant à la définition d’une discipline nouvelle, différente
à la fois de la grammaire comparée et distincte des grammaires scolaires : la
linguistique. À partir de la fin du 19e s., une linguistique « pure » commence à
se constituer, permettant l’émergence d’une véritable linguistique appliquée.
Ce mouvement prend une tournure particulière aux États-Unis, au cours des
années 1940. Notre première partie sera consacrée à cette période clé qui voit des
2 Des linguistes comme Brumfit (1995, p. 27), définissant la linguistique appliquée, parlent
volontiers de « real-world problems ».
MICHEL BERTHET

85
linguistes se consacrer à des applications, mais sans pour autant pousser bien avant
leur questionnement sur ce qu’on fait lorsqu’on « applique » la linguistique, sans
demander s’il est possible d’envisager une discipline plus ou moins autonome, la
linguistique appliquée.
1. ÉTATS-UNIS (1940-1945) :
UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA LINGUISTIQUE APPLIQUÉE
1. 1. L. Bloomfield
Leonard Bloomfield occupe une position centrale dans le champ de la linguistique
nord-américaine avant la seconde guerre mondiale. Il contribue activement à la
fondation en 1925 de l’ALS (American Linguistic Society) et à l’élaboration de
la linguistique structurale3 qui, aux cours des années 1930, cherche à devenir une
discipline légitime et autonome dans le cadre académique.
La place considérable que Bloomfield vient à occuper dans le champ des sciences
du langage aux États-Unis explique le rôle qu’il va jouer, à partir de 1942, dans la
mise en place par l’armée d’un programme d’enseignement intensif des langues
vivantes. Il ne faut pas attendre l’attaque surprise de Pearl Harbour pour que les
autorités américaines prennent conscience du péril stratégique lié à l’incapacité des
soldats de comprendre et de parler une plus grande variété de langues étrangères.
Dès avant la seconde guerre mondiale, l’American Council of Learned Societies
(ACLS), représenté par Mortimer Graves, insiste sur la nécessité de développer
l’enseignement des langues, absentes des programmes scolaires et universitaires.
L’ACLS obtient un financement (100.000 $) de la Rockefeller Foundation et lance
en 1941 un Intensive Language Program (ILP) dirigé par J. M. Cowan, trésorier de
l’American Linguistic Society. En 1943, ce programme va permettre de financer
56 cours, portant sur 26 langues, dans 18 universités, pour un public composé de
700 étudiants. Ces fonds vont aussi contribuer à financer les linguistes qui œuvrent
à renforcer la légitimité de leur discipline. Selon Newmeyer (1986, p. 52), la quasi
totalité des linguistes américains ont participé à ce programme qui a duré jusqu’à
la fin de la guerre :
Grave’s organizational skill in providing funding, employment, and research
opportunities to the linguists of the United-States was a major factor in the
development of the field.
Trois revues naissent ainsi à l’occasion du financement de cet effort de guerre :
Studies in Linguistics, Word, Romance philology.
L’ILP de l’ACLS s’est d’abord intéressé aux langues rares pour des raisons
d’urgence (elles étaient fort peu enseignées aux États-Unis à cette époque) mais
aussi pour des raisons institutionnelles : il semblait difficile de remettre en question
les lourdes traditions éducatives en ce qui concernait l’enseignement des grandes
3 Certains linguistes français parlent volontiers de linguistique structurale américaine,
comme si cette linguistique ne pouvait pas être simplement structurale parce que pas assez
saussurienne, tandis que certains linguistes américains parlent de « structural linguistics »
tout court, considérant parfois que les travaux menés en Europe ne sont pas toujours purement
linguistiques. Voir par exemple à ce sujet Newmeyer (1986) The Politics of Linguistics.
LINGUISTIQUE APPLIQUÉE : ÉTATS-UNIS, FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%