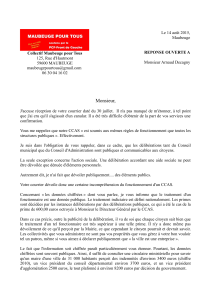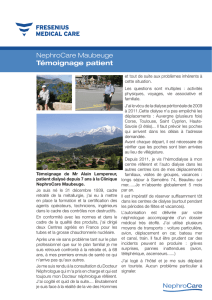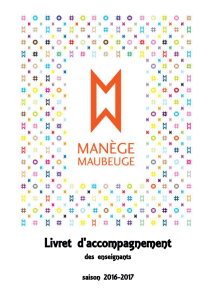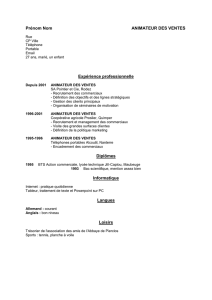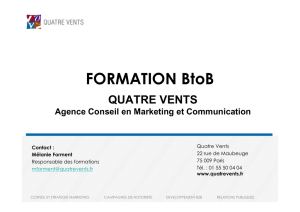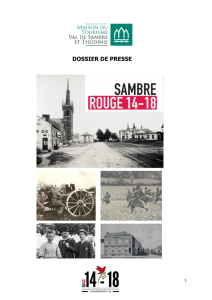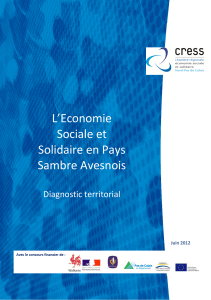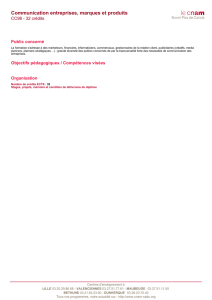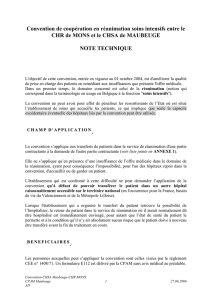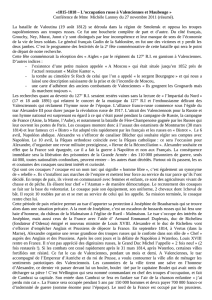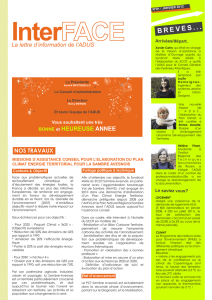Un bref aperçu de l`Histoire de Maubeuge

Maubeuge
L’installation des usines Chausson en 1971, qui
deviendront Maubeuge Construction Automobile,
filiale de Renault, a donné un second souffle à l’activité
industrielle de Maubeuge.
Le Bassin de la Sambre va connaître une période de
récession de 1975 à 1990. Mais Maubeuge a su renaître
de ses cendres et a entamé sa reconversion avec
les industries de pointe. Les efforts de reconversion
industrielle et de diversification sont passés par la
création d’une ruche destinée à favoriser la création
d’entreprises et par la volonté municipale de déve-
lopper l’enseignement et les activités de recherche.
Maubeuge dispose ainsi, sur la zone du Champ de
l’Abbesse, de centre de recherches spécialisées dans
les matériaux nouveaux.
Maubeuge a également accéléré sa reconversion en
se dotant d’une structure culturelle sans précédent :
le Centre Culturel Transfrontalier Le Manège. Cinquiè-
me scène nationale, il propose une programmation
éclectique et quatre festivals annuels de renommée
internationale.
Maubeuge propose aussi tout au long de l’année un
large panel de manifestations sportives, culturelles et
historiques. Actuellement, Maubeuge se dote d’un
pôle universitaire et d’un complexe cinématographique
de qualité.
Soucieuse de la préservation de son environnement
et de l’amélioration constante de son cadre de vie,
Maubeuge est la première Ville Porte du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois. Ville fleurie reconnue au niveau
régional, Maubeuge est avant tout une ville verte qui
manie avec talent le concept de « ville à la campagne ».
RéPONSE : Non ! Elle est rattachée au
Royaume de France en 1678, grâce au traité de
Nimègue !
La ville de Maubeuge
a-t-elle toujours
été française ?
Devinette
es origines de Maubeuge remontent au IIIe
siècle après Jésus-Christ. Les Francs tenaient
leurs assises judiciaires, les « Mahal », en un
lieu appelé « Boden » pour discuter de l’élec-
tion d’un chef, entreprendre une guerre ou juger des
différents entre tribus. Le siège de ces assemblées
tenues une fois l’an devint « Malboden ».
Ce nom fut transformé à l’ère médiévale par le bas-
latin en « Malbodium », lorsque Sainte-Aldegonde
fonda un monastère vers 661, au milieu de la forêt
marécageuse des bords de la Sambre. Sainte-
Aldegonde devient alors la mère fondatrice légendaire
de notre ville.
Commence alors la période de tous les changements :
en effet, André Lurçat, nommé « Architecte en chef du
bassin de la Sambre » par le Ministre de la Reconstruc-
tion, va entreprendre une reconstruction de la ville
sans précédent. André Lurçat propose un programme
complet, basé sur l’utilisation des ressources premières
du territoire pour favoriser la relance économique et
la préservation du patrimoine ancien. Ainsi il s’oppose
au démantèlement complet des fortifications de
Vauban. Attaché à gommer les disparités sociales
intra-urbaines, André Lurçat fait table rase des tracés
du passé, il abaisse le niveau de la ville haute et
remonte celui de la ville basse.
Dès la fin de la guerre, plusieurs industries renommées
sont venues s’installer dans la Bassin de la Sambre.
Mais dès 1953-54, des difficultés surgissent, qui se
précisent dans les années 60. De 1962 à 1968, le
Bassin de la Sambre subit une forte récession. Il
semble indispensable de reconvertir les activités et de
les diversifier. L
Usine Chausson.
Avenue Jean Mabuse.
Crédit photo : Ville de Maubeuge. Andrea Di Nola (couverture). Conception graphique & illustration : William Sandras 06 88 96 76 23.

l’emploi de plus de 8000 hommes, 120 000 m3 de terres et
de pierrailles, 189 000 m3 de maçonnerie ont été nécessaires
à la construction des remparts.
La Manufacture d’Armes, créée en 1701, travailla à l’armement
des troupes françaises, notamment durant la Révolution et
l’Empire. Elle fut supprimée en 1836.
Maubeuge, engagée au service de la France, connaîtra
une vie plus paisible au cours du XVIIIème siècle. Mais cet
intermède dure peu car la place forte ne tarde pas à subir les
conséquences des guerres de la Révolution et de l’Empire. En
1792, les Autrichiens se heurtent aux avant-postes de l’armée
du Nord, réunie par La Fayette. En 1793, la ville est attaquée
par les Autrichiens, mais la victoire de Wattignies, les 15
et 16 octobre, permet le déblocus du camp retranché par
l’armée du Nord avec Carnot, Jourdan et Duquesnoy. D’après
Napoléon, « ce fait d’armes est le plus extraordinaire de la
Révolution ».
Le monastère fondé par Sainte-Aldegonde fut
détruit au IXème siècle par les Normands et au
Xème siècle par les Hongrois puis l’archevêque
de Cologne le transforma en un chapitre noble et séculier.
Ainsi, pendant près de huit siècles, des chanoinesses
issues des plus nobles familles européennes sont venues
à Maubeuge.
Du Xème siècle à la fin du XIIIème siècle, Maubeuge fut une
cité drapière réputée. Malheureusement, sous le règne de
Jean II d’Avesnes qui imposa des taxes trop lourdes, cette
industrie très prospère entra en décadence, pour cesser
définitivement en 1478 après l’incendie de la ville par
Louis XI.
La ville de Maubeuge fut, jusqu’à son rattachement à la
France en 1678, saccagée et pillée plus de vingt fois. Elle
fut comprise dans le royaume d’Austrasie que gouvernait
la reine Brunehaut, puis fit partie du Comté du Hainaut
sous les premiers rois carolingiens. En 843, lors du
partage des états de Louis le Débonnaire, la ville passa
dans le royaume de Lotharingie et fut rattachée avec le
Hainaut en 870 au royaume de France par le traité de
Mersen. En 925, le Hainaut devint province indépen-
dante, gouvernée sous la suzeraineté des Empereurs
d’Allemagne jusqu’en 1425. La province passa aux Ducs
de Bourgogne jusqu’en 1477, à la Maison d’Autriche de
1478 à 1513 et à la Maison d’Espagne de 1513 à 1678.
Maubeuge fut définitivement rattachée à la France en
1678 par le Traité de Nimègue, qui mit fin à la guerre de
Hollande opposant le royaume d’Espagne au royaume de
France. La ville va alors vivre une période de calme relatif,
Louis XIV ayant chargé Vauban, en 1679, d’en faire une
place forte, à la fois offensive et défensive, au point le plus
exposé de la frontière de la France. Ainsi de 1679 à 1685,
En 1818, l’économie de la ville redémarre. La Révolution
industrielle se concrétise dans le bassin de la Sambre qui
facilite l’approvisionnement en charbon depuis Charleroi.
Les hauts-fourneaux et les laminoirs se multiplient,
notamment dans le quartier de Sous-le-Bois dès 1837.
La Première Guerre Mondiale va éprouver à nouveau
la cité sambrienne. En 1914, Maubeuge résiste sous la
direction du Général Fournier et en 1918, elle sera délivrée
par les Britanniques. Les destructions seront mineures.
La Seconde Guerre Mondiale aura par contre un effet
désastreux sur Maubeuge. Dès mai 1940, les Allemands
incendient la ville à l’aide de grenades incendiaires, ce qui
détruit le cœur historique de Maubeuge à plus de 90%.
Le 2 septembre 1944, la cité est libérée de l’occupation
allemande par les Américains commandés par le général
Rose.
L
Vue aérienne des nouveaux
immeubles de la ville haute.
Entrée des chars américains à Sous-le-Bois en 1945.
1
/
2
100%