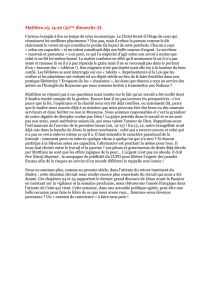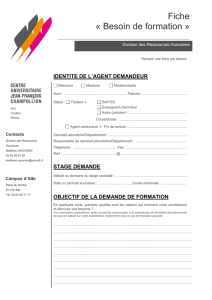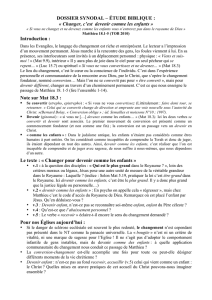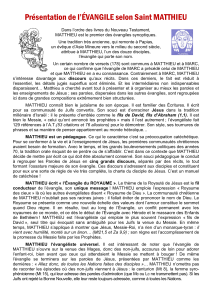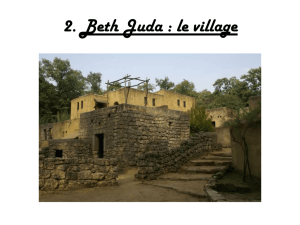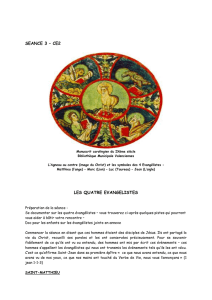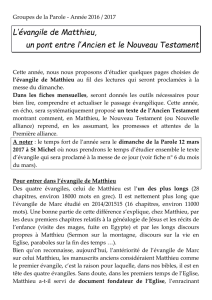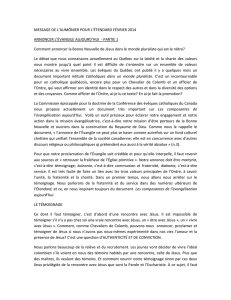la substance des evangiles - BUISSON ARDENT

1
LA SUBSTANCE DES EVANGILES
Introduction
Pour comprendre la substance d’un livre, il est nécessaire de connaître au préalable
plusieurs éléments constitutifs du livre.
Pour ce faire, nous allons nous doter d’un certain nombre d’outils qui nous permettrons de
parvenir à cette fin.
Ces outils sont les suivants :
L’identité de l’auteur ;
Les destinataires ;
Le lieu de la rédaction ;
La date de parution ;
Le contenu du livre ;
Les raisons pour lesquelles l’auteur a écrit ;
Le plan littéraire ;
Lire un livre c’est lui faire produire un sens. C’est bien ce que nous faisons naturellement ;
nous disons : « voilà ce que me dit le livre ; ce qui me frappe dans le livre ; ce que je retiens
comme leçon ; etc. »
Et c’est à une telle lecture que nous devons finalement parvenir. Mais nous sentons le
danger : est-ce qu’on peut faire dire n’importe quoi à un livre ? C’est ici que commence
notre recherche de l’essence d’un livre (de la Bible), notamment des évangiles.
Les évangiles sont justement les livres de la Bible que nous connaissons bien à telle enseigne
que nous les survolons souvent et répétons ce qu’on a toujours entendu dire sur eux.
I. Qui est l’auteur ?
Cet évangile serait écrit par Matthieu (Mt9.9), né en Galilée, le même qui est appelé Lévi, le
fils d’Alphée, un publicain, collecteur d’impôts à Capharnaüm, employé au péage d'Hérode
(Mc2.13-14 ; Lc5.27-28).
Un collecteur d’impôt était un collaborateur des armées romaines d’occupation. Détesté par
tout le monde, ce collaborateur devait probablement laisser au vestiaire sa personnalité
juive pour s’intégrer à la culture des occupants. Son travail exploitait systématiquement des
compatriotes qu’il avait en quelque sorte reniés.
Matthieu parlait aussi bien l’araméen que le grec. Il savait lire l’hébreu. C’était un homme de
lettre et de chiffre.
Saint Matthieu, apôtre et scribe du Christ (en langue araméenne) se trouverait parfaitement
défini, à la fin du discours parabolique : « ...scribe devenu disciple du Royaume des Cieux...
semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. » (Mt 13,52). Certains
exégètes (Bible de Jérusalem) ont cru trouver là une signature discrète de l'évangéliste
primitif. D'autres passages de l'évangile selon Matthieu sont relatifs à l'argent.
L'évangile de Matthieu est le seul qui évoque la redevance du Temple acquittée par
Jésus et Pierre : on peut voir là une notation propre au collecteur d'impôt qu'était

2
Matthieu. Il donnait à la monnaie de l'impôt son nom technique de « didrachme ». En
véritable spécialiste des finances, Matthieu explique qu'un statère valait deux
didrachmes (soit encore un tétradrachme) pour payer l'impôt susdit et qu'il suffirait
donc pour deux personnes (Mt17.24-27).
L'évangile de Matthieu seul rapporte ainsi des paraboles spécifiques relatives à
l'argent : parabole du débiteur impitoyable ou des talents (Mt18.23-35 ; 25.14-30).
L'évangile de Matthieu, dans la prière du Notre Père, évoque la remise des dettes et
les débiteurs (Mt 6,12), tandis que Luc mentionne pour sa part la remise des péchés
et le devoir de remettre à quiconque nous doit (Lc 11,4).
L'évangile de Matthieu seul donne le prix de la trahison de Judas : « Trente pièces
d'argent » (Mt 26,14-16), c'est-à-dire trente sicles (et non trente deniers comme on
le dit souvent), la valeur d'un esclave (Ex 21,32), tandis que Marc (14,11) et Luc (22,5)
ne font état que d'une certaine somme d'argent. De même Matthieu seul précise que
Judas aurait rapporté cette somme : « les trente pièces d'argent, aux grands prêtres
et aux scribes » (Mt 27,3) puis les auraient jetées, saisi de désespoir, non dans le
tronc mais dans le sanctuaire même (naos) du Temple (cf. Mt 27,5).
L'évangile de Matthieu seul, dans le récit de la Résurrection, affirme que les grands
prêtres et les anciens « donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, avec cette
consigne : 'Vous direz ceci : ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant
que nous dormions'. » (Mt 28,12-13).
II. Les destinataires
Le plus ancien témoignage que nous avons sur la composition des évangiles est celui de
Papias, évêque de Hiérapolis, en Phrygie, qui composa vers 130 une « interprétation
(exégèse) des oracles du Seigneur » en cinq (05) livres.
Selon lui, Matthieu aurait écrit en hébreu, terme qui pourrait aussi s’appliqué à l’araméen,
puis son œuvre aurait été traduite en grec.
Matthieu écrivit pour une communauté de chrétiens issus du judaïsme. En effet :
La présentation de la généalogie de Jésus est très marquante pour les Juifs. Matthieu
le fait pour des destinataires qui le comprennent très bien. Exemple : Ne7.61-64 ;
Matthieu utilise l’expression « fils de David » dix (10) fois dans son ouvrage ;
Il fait beaucoup référence à la TORAH (la loi juive). Exemple du chapitre 2. Ce livre est
celui du Nouveau Testament à faire abonder beaucoup de citations de l’Ancienne
Alliance ;
Il n’explique pas les coutumes juives contrairement à Marc : la présence de l’ami de
l’époux aux noces dans la controverse sur le jeûne (Mc2, 19), les purifications
rituelles avant les repas (Mc7, 3-4), les préparatifs du repas pascal (Mc14, 12) et la
nécessité d’ensevelir le corps de Jésus avant le début du sabbat (Mc15, 42).
Etc.

3
III. Où se trouvait Matthieu quand il écrivait ?
Les sources antiques affirment qu'à l'époque où Pierre et Paul affermissaient la communauté
chrétienne de Rome (vers l'an 60 ou 61), Matthieu qui évangélisait les « Hébreux » de
Palestine et de Syrie, fut prié de rédiger une version synthétique de la vie et de
l'enseignement de Jésus.
Ainsi, Eusèbe de Césarée affirme : « Matthieu prêcha d'abord aux Hébreux. Comme il devait
aussi aller vers d'autres, il confia à l'écriture, dans sa langue maternelle, son évangile,
suppléant du reste à sa présence par le moyen de l'écriture, pour ceux dont il s'éloignait. »
Toujours selon Eusèbe de Césarée, Papias aurait écrit vers 125 : « Matthieu réunit donc en
langue hébraïque les logia (les "dits" de Jésus) et chacun les traduisit comme il en était
capable. » (Histoire ecclésiastique III, 39, 16). De même saint Irénée avait écrit, vers 180 :
« Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite
d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. »
C'est donc la perspective de son départ qui déclencha le processus. Pour ce travail,
l'intervention d'un témoin de la première heure avait paru indispensable. Le premier
évangile, condensé de la catéchèse apostolique, était plus réduit que l'évangile selon
Matthieu actuel. Pantène (v. 140 - v. 206), qui dirigea l'Académie d'Alexandrie, trouva à son
arrivée aux Indes cet évangile en caractère hébreux. Il aurait été apporté par l'apôtre
Barthélémy aux populations locales, qui l'avaient depuis précieusement conservé.
Dans ce cas-ci, il fallait l'adapter aux besoins des nouveaux auditoires pagano-chrétiens.
« Chacun, écrit Papias vers 120, les traduisit comme il en était capable. » Il y eut au moins
deux traductions, avec des retouches et des additions. L'une d'elles fut conçue à Antioche,
l'un des lieux d'évangélisation les plus importants du Proche-Orient.
Après le départ de Matthieu, un de ses disciples, scribe, appartenant à un milieu juif
hellénophone, vivant probablement en Syrie, très attaché à la Bible hébraïque, compléta le
préévangile grec d'Antioche et lui donna sa touche finale.
Et donc l'évangile selon Matthieu a été composé en Palestine. Il dénote une connaissance
précise de ce pays. L'auteur apparaît à plus d'une reprise comme un fin connaisseur de la
Palestine. Il lui arrivait même de corriger discrètement la géographie un peu approximative
de Marc, ou même de Luc. Ainsi en Mt 8,28 il précisait que Jésus, débarqué sur l'autre rive,
était parvenu au pays des Gadaréniens et non pas au territoire des Géraséniens (cf. Mc 5,1 ;
Lc 8,26). Il précise donc que la ville de Gadara, en Décapole, était bien plus proche du lac de
Tibériade que la ville de Gérasa.
En Matthieu 15,39, l'auteur change le nom de Dalmanoutha, donné par Marc (8,10) et
inconnu des géographes, en celui de Magadan. Certes Magadan était tout aussi impossible à
situer sur les cartes : mais précisément plus d'un exégète y voyait une corruption, due à un
copiste, du nom de "Magdala", bourgade fort bien identifiée des bords du lac.
En Matthieu 27,7, l'auteur affirme que les grands prêtres achetèrent avec les trente sicles de
Judas le "champ du potier", bien connu des habitants de Jérusalem (Ac 1,19), comme lieu de
sépulture pour les étrangers. "Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le

4
'Champ du Sang'" (Mt 27,8). Le renseignement était d'une grande acribie géographique. Et il
correspondait parfaitement à l'indication livrée par Luc dans les Actes.
IV. Quand Matthieu a-t-il écrit l’évangile ?
En considérant la difficulté particulière que présentent les évangiles synoptiques,
notamment sur leur date de parution, la plupart des exégètes catholiques comme
protestants expliquent l’origine de ces évangiles par la théorie des deux (02) sources.
L’une de ces deux (02) sources serait l’évangile de saint Marc (qui aurait connu une
triple tradition). Marc aurait écrit son évangile le premier. Matthieu et Luc l’on utilisé
comme support pour leur évangile. Mais justement, Matthieu et Luc offrent aussi de
nombreuses sections, spécialement des « paroles » du Christ (sermon inaugural de
Jésus par exemple), inconnu de Marc (double tradition).
L’autre est la suivante. Comme ces deux évangiles sont indépendants l’un de l’autre,
il faudrait admettre qu’ils aient puisés dans une autre source que l’on appelle Q
(initiale du mot allemand « QUELLE » qui veut dire source).
Quand aux sections propres soit à Matthieu, soit à Luc elles proviendraient de sources
secondaires qui seraient connu de ces deux (02) évangélistes.
Peu d'indices dans l'évangile lui-même permettent de déterminer sa date de composition.
Néanmoins plusieurs critères sont pris en compte, en particulier la manière dont Matthieu
rend compte de la prophétie de Jésus concernant la destruction du Temple (Mt 25) et le
rapport de Matthieu au judaïsme.
C’est ainsi qu’on arrive à situer la date de parution de l’évangile de Jésus-Christ selon saint
Matthieu dans la fourchette des années 80 à 90 de notre ère, (1er siècle après J-C) sous
l'empereur romain Vespasien et le 3ème Pape Saint Clet.
V. Quelle est la substance du livre ?
Le premier évangile s'adresse avant tout aux juifs et aux rabbins de la synagogue, pour leur
démontrer à l'aide des Écritures, l'Ancien Testament, que Jésus-Christ est réellement le Fils
de Dieu et l'Emmanuel, Dieu avec nous depuis le début, le fils de David, l'héritier de tous les
rois d'Israël et le Messie qu'ils espéraient. Dès l'entrée, Jésus est présenté comme Sauveur
(Mt 1,21), Emmanuel (1,23), roi (2,2), Messie ou Christ (2,4), Fils de Dieu (2,15), en
accomplissement de toutes les prophéties.
Le titre de Fils de Dieu intervient aux tournants importants du récit, dès l'enfance, au
baptême, à la confession de Pierre, à la transfiguration, au procès de Jésus et à la crucifixion.
Le nom de fils de David, qui lui est associé, et qui revient en dix (10) occurrences, démontre
que Jésus est le nouveau Salomon : en effet Jésus s'exprime comme la Sagesse incarnée. En
vertu du titre de Fils de l'homme, qui parcourt l'évangile, et qui provient tout droit du
prophète Daniel, Jésus se voit doté de toute autorité divine sur le Royaume de Dieu, aux
cieux comme sur la terre.

5
Matthieu grec, écrivant pour une communauté de chrétiens venue du judaïsme, et discutant
sans doute avec les rabbins, s'attache avant tout à montrer dans la personne et dans l'œuvre
de Jésus l'accomplissement des Écritures. Il confirme par des textes scripturaires : sa race
davidique (1,1-17), sa naissance d'une vierge (1,23), sa naissance à Bethléem (2,6), son
séjour en Égypte (2,15), son établissement à Capharnaüm (4,14-16), son entrée messianique
à Jérusalem (21,5.16). Il le fait pour son œuvre de guérisons miraculeuses (11,4-5) et pour
son enseignement (5,17). Tout aussi bien il souligne que l'échec apparent de la mission de
Jésus était annoncé par les Écritures, et que les abaissements du Fils de l'homme
accomplissent la prophétie du Serviteur souffrant d'Isaïe (12,17-21).
Matthieu se présente donc beaucoup moins comme une simple biographie de Jésus, ce
qu'ont fait de leur côté excellemment Marc et Luc, que comme une thèse parfaitement
construite et documentée adressée aux juifs hellénistes, les croyants pour les conforter
dans leur foi, les incrédules ou les opposants pour les réfuter.
Elle s'inscrit bien dans ce climat de tension qui prévalait dans la Palestine d'avant la
destruction du Temple, tel qu'il nous est décrit dans les Actes des Apôtres, où la persécution
menaçait sans cesse : martyre d’Étienne à l'instigation de la synagogue, dispersion des
apôtres, qui seraient suivis par le martyre de Jacques le mineur.
En appliquant, d’une manière caricaturale Ez1.10 et Ap4.7-8, aux quatre évangiles, celui de
Matthieu serait le lion : c’est-à-dire l’évangile du roi.
Nous pouvons alors bien remarquer que Matthieu insiste particulièrement sur le thème du
« Royaume des Cieux » à tel enseigne qu’on pourrait le caractérisé comme une instruction
narrative sur le « Royaume des Cieux ». Il utilise cinquante (50) fois le terme « Royaume » et
trente (30) fois l’expression « Royaume des Cieux ». L’expression « fils de l’homme »
qu’utilise Matthieu se trouve d’ailleurs en rapport étroit avec celui du Royaume (Dn7.13-14).
Jésus dira lui-même à la fin du livre : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre »
(Mt18.18).
VI. Pourquoi Matthieu a-t-il écrit ?
Après la mort de Jésus, l’annonce de l’évangile du salut par les premiers apôtres à fait naître
beaucoup de personnes dans la foi au Christ. Mais le contact permanent avec les judaïsants
dans un climat conflictuel ébranle bien souvent plus d’un dans sa foi au Seigneur Jésus-
Christ. C’est donc dans le double but de conforter les chrétiens dans leur foi mais aussi de
faire taire les Juifs qui s’attachent au judaïsme en refusant que Jésus soit le Christ que
Matthieu a écrit son évangile.
VII. Quel est le plan ?
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%