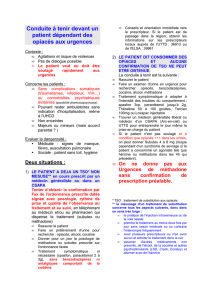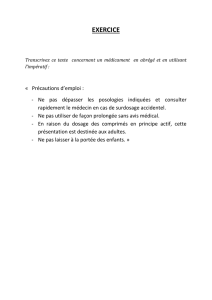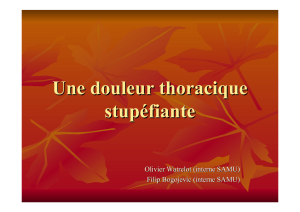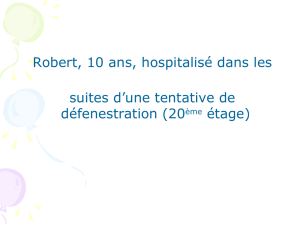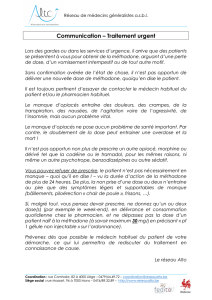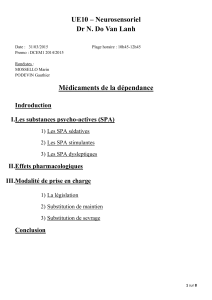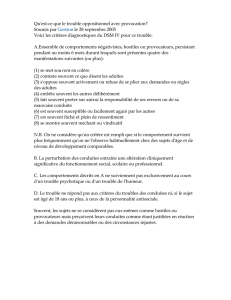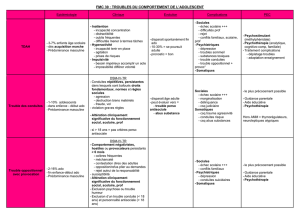R Posologies de méthadone made in USA E

REVUE DE PRESSE
8
Le Courrier des addictions (2), n° 1, mars 2000
REVUE DE PRESSE
Posologies de méthadone
made in USA
Les traitements de substitution par la
méthadone ont prouvé leur efficacité
dans les dépendances à l’héroïne
depuis les premières études cliniques
de Dole et Nyswander de 1965. Mais
aux États-Unis, des points de discus-
sion persistent sur les modalités de
prise en charge, les posologies opti-
males, les détournements de doses ou
les abus de cocaïne ou d’alcool en
cours de traitement. Les évaluations
américaines privilégient depuis une
dizaine d’années les différences de
politique des programmes en termes
d’efficacité et surtout de compliance
aux soins et de rétention. Toutefois,
les études récentes de comparaison de
posologies restent rares.
•Strain et Bigelow ont ainsi réalisé
une étude randomisée comparant l’ef-
ficacité respective de posologies de
40 à 50 mg versus 80 à 100 mg de
méthadone au cours d’un essai de
40 semaines en double aveugle parmi
192 patients dépendants de l’héroïne
dans un centre de Baltimore et sur une
période d’inclusion de trois ans et
demi. Les augmentations étaient limi-
tées dans les deux groupes par paliers
de 2 mg ou de 10 mg respectivement,
après une dose d’induction de 30 mg,
et la stabilisation a été obtenue en
quatre semaines. Les consommations
avouées d’opiacés ont diminué dans
les deux groupes (jusqu’à 90 %), en
référence aux consommations précé-
dant l’essai clinique. Au cours de cet
essai, le groupe des fortes doses rap-
portait une consommation en moyen-
ne d’une fois par semaine, alors que
dans le groupe plus faiblement dosé,
la consommation moyenne rapportée
était de deux à trois fois par semaine.
Les analyses d’urine retrouvaient le
même type de résultat avec des diffé-
rences significatives au cours du
temps dans les deux groupes, les
patients les plus dosés ayant moins de
résultats positifs (53 % versus 62 %).
Les auteurs s’appuient sur une métho-
dologie puissante (essai randomisé en
double aveugle) et soulignent la supé-
riorité des fortes posologies tout en
notant déjà des résultats cliniques
avec des doses réduites.
La situation clinique qui conduit au
cours du programme méthadone à
reconsidérer la posologie, après la
phase d’induction et après stabilisation
clinique en face d’une consommation
persistante d’opiacés, n’est pas rare.
Trois stratégies sont employées aux
États-Unis. Certaines équipes remet-
tent en question la continuité des soins
et préconisent de diminuer les posolo-
gies. D’autres équipes favorisent dans
ces phases une prise en charge psycho-
logique et sociale accrue. Enfin,
d’autres cliniciens, qui continuent à voir
la méthadone comme un traitement
médical de la toxicomanie, défendent
l’idée d’une augmentation des posolo-
gies jusqu’à réduction du “craving”.
Des arguments pharmacologiques
sont venus pourtant réorienter ces
adaptations cliniques. L’étude des
méthadonémies résiduelles montrait à
la fin des années 80, que des taux de
100 ng/ml permettaient d’espérer une
réduction des signes objectifs du
manque et des concentrations de 200
à 400 ng/ml et d’obtenir la disparition
du “craving”. Ces examens sanguins
sont devenus de pratique courante
dans le suivi des patients qui présen-
tent des signes subjectifs de manque
ou dont les consommations persistent
après la phase de stabilisation.
•Shinderman, à Chicago, défend
depuis longtemps l’idée de posolo-
gies élevées jusqu’à saturation des
récepteurs, et bien au-delà des recom-
mandations admises. Il a comparé un
groupe de 164 patients recevant en
moyenne 211 mg/j (étendue de 110 à
780 mg/j) à 101 sujets témoins rece-
vant en moyenne 65 mg/j. Le taux
d’examens d’urines positives diminue
de 87 % avant l’augmentation à plus
de 100 mg/j, à 3 % avec les posolo-
gies plus élevées et stabilisées, alors
que l’on retrouve dans la population
contrôle une diminution de 54 à 37 %
avant traitement et après stabilisation.
Les patients étudiés ont bien supporté
sur le plan clinique les très fortes
posologies de méthadone. Ils se dis-
tinguaient des sujets témoins par une
plus forte comorbidité psychiatrique
(63 % contre 32 % des témoins) par
des consommations initiales d’héroï-
ne plus élevées et des abus d’alcool et
de benzodiazépines en cours de traite-
ment. Ces données essentiellement
cliniques suggèrent que de très fortes
posologies permettent de réduire des
conduites addictives persistantes
(héroïne mais aussi alcool et benzo-
diazépines) et de stabiliser des
troubles psychiatriques.
•La méthadone représente un mélan-
ge racémique de deux formes d’énan-
tiomères : la forme R et S. Et on doit
à des équipes européennes le dévelop-
pement de nouveaux aspects pharma-
cologiques sur leur métabolisme
(Eap, Deglon). Les dosages standards
de méthadonémies mesurent la somme
des deux énantiomères, alors que la
forme R semble cinquante fois plus
active. Il semble exister une grande
variabilité interindividuelle pour des
posologies équivalentes entre les rap-
ports des deux énantiomères. Ces
variations pourraient être attribuées au
métabolisme de la méthadone par les
systèmes du cytochrome P450.
•Pourtant Blaney et Craig, en suivant
265 patients sous traitement de métha-
done, n’ont pas trouvé de différence
significative en termes d’usage de
produit, de compliance aux soins en
comparant les posologies délivrées
(40 mg versus 90 mg). Mais ils met-
tent l’accent sur des particularités
liées aux thérapeutes eux-mêmes,
avec des différences de résultats cli-
niques en relation avec la qualité de la
relation thérapeutique. Cette étude
souligne que, pour évaluer une dimen-
sion clinique particulière d’une prise en
charge globale, encore faut-il que l’en-
semble des acteurs partagent une
vision commune et soient d’une grande
cohérence dans les modalités théra-
peutiques.
– Strain E., Bigelow G., Lebson I., Stitzer
M. Moderate versus high dose methadone
in the treatment of opioid dependence.
JAMA 1999 ; 281, 11 : 1000-5.
– Maxwell S., Shinderman M. Optimising
response to methadone maintenance treat-
ment : use of higher-dose methadone. J.
Psychoactive Drugs 1999 ; 31, 2 : 95-104.
– Blaney T., Craig R. Methadone main-
tenance : does dose determine diffe-
rences in outcome ? J. Substance Abuse
Treatment 1999 ; 16, 3 : 221-8.

Un syndrome de manque
pour le cannabis
À l’heure actuelle, aucun syndrome de
manque n’est défini pour le cannabis,
dans les classifications internationales.
Pourtant, on dispose d’expériences et de
descriptions cliniques allant dans le sens
d’un authentique phénomène de tolé-
rance avec réaction de sevrage. Les cri-
tères de dépendance au cannabis sont de
même souvent discutés et sans doute
assez lointains des modes d’utilisation
des plus jeunes. Une équipe du Vermont
a réalisé une analyse exhaustive de la lit-
térature pour repérer et préciser l’inci-
dence de ce syndrome. Vingt-cinq à
85 % des patients dépendants décrivent
des symptômes de manque. Les auteurs
ont évalué, à partir d’une liste de signes
cliniques de vingt-deux items, l’intensité
des troubles parmi 44 adultes consul-
tants pour leur dépendance.
Cette liste tenait compte de l’intensité
des signes, et 57 % des sujets présen-
taient au moins six symptômes d’inten-
sité modérée, 47 % plus de quatre signes
d’intensité sévère. Il existait une corréla-
tion entre l’intensité des signes de
manque et l’existence de signes psychia-
triques, mais aussi des paramètres de
consommation.
Le cannabis garde encore une image
d’une substance assez peu responsable de
dépendance. Ce type de liste peut per-
mettre de développer des évaluations plus
fines pour les usages multiples du canna-
bis en précisant les incidences d’authen-
tiques syndromes de dépendance.
– Budney A., Novy P., Hughes J.
Marijuna withdrawal among adults see-
king treatment for marijuna dependence.
Addiction 1999 ; 94, 3 : 1311-21.
Limites des critères de la
personnalité antisociale
Les premières descriptions de la psy-
chopathie mettaient l’accent sur des
traits de personnalité pathologiques,
notamment le manque de culpabilité,
d’anxiété ou de respect des normes. Elle
se caractérisait par des passages à l’acte,
des crises violentes déclenchées par la
moindre frustration, des phases dépres-
sives et souvent associées à des
conduites toxicophiles. Les critères de
la dernière classification du DSM met-
tent davantage l’accent sur des
conduites déviantes, des comporte-
ments antisociaux. Les premiers travaux
réalisés parmi des sujets masculins per-
mettaient de retrouver une grande
constance entre les conduites de l’en-
fance et celles de l’adulte, amenant à
considérer la personnalité antisociale
comme un syndrome qui débute dans
l’enfance et continue à évoluer chez
l’adulte. Si l’on compare les différents
systèmes diagnostiques de cette person-
nalité, on s’aperçoit que les classifica-
tions DSM (III, III-R, ou IV), ou RDC
(“Research Diagnosis Criteria”) néces-
sitent trois conduites antisociales avant
l’âge de 15 ans. Le DSM IV inclut des
critères de comportement plus violent.
Des arrestations ou des contacts avec les
systèmes juridiques pour enfant et ado-
lescent ne sont mentionnés que dans la
classification de Feighner.
Rutherford s’est intéressé à la concor-
dance des différents systèmes diagnos-
tiques de la personnalité antisociale dans
une population de 137 femmes dépen-
dantes de la cocaïne. Trente-huit pour
cent répondaient aux critères de
Feighner, 11 % à ceux du RDC, 61 % à
ceux du DSM III, 31 % à ceux du DSM
III-R, et on comptait seulement 25 %
pour le DSM IV. Les critères nécessaires
au diagnostic mais débutant dans l’en-
fance influencent cette distribution. Ils
contribuent probablement à sous-esti-
mer ce trouble de la personnalité chez
les femmes qui ne débutent pas, comme
chez les garçons, par des conduites
délictueuses dès l’enfance. Mais ce type
d’approche souligne surtout l’hétérogé-
néité de la personnalité antisociale qui
reste trop souvent amalgamée à la psy-
chopathie. Enfin, il faut noter que l’évo-
lution de la classification américaine
amène avec ces différents remaniements
à sous-estimer la fréquence de ce trouble
de la personnalité chez les femmes.
– Rutherford M., Cacciola J., Alterman A.
Antisocial personnality disorder and psy-
chopathy in cocaïne-dependent women.
Am. J. Psychiatry 1999 ; 156, 6 : 849-
55.
REVUE DE PRESSE
9
Humeur : Irritabilité, nervosité,
dépression, colère.
Comportement : Appétence pour le
produit, instabilité motrice, trouble
du sommeil, diminution d’appétit,
rêves étranges, augmentation de
l’appétit, accès de violence.
Physique : Céphalées, tremble-
ments, rhinorrhée, sueurs, bouf-
fées de chaleur, fièvre, diarrhée,
nausées, spasmes musculaires,
frissons, hoquet.
Personnalité antisociale DSM IV
A. Mode général de mépris et de transgression des droits d’autrui qui survient depuis
l’âge de 15 ans, comme en témoignent au moins trois des manifestations suivantes :
◗incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comporte-
ments légaux, comme l’indique la répétition de comportements passibles
d’arrestation ;
◗tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiquée par des mensonges
répétés, l’utilisation de pseudonyme ou des escroqueries ;
◗impulsivité ou incapacité à planifier à l’avance ;
◗irritabilité ou agressivité, indiquée par la répétition de bagarres ou d’agressions ;
◗mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d’autrui ;
◗irresponsabilité persistante, indiquée par l’incapacité répétée d’assumer un
emploi stable ou d’honorer des obligations financières ;
◗absence de remords, indiquée par le fait d’être indifférent ou de se justifier
après avoir blessé, maltraité ou volé autrui ;
B. Âge au moins égal à 18 ans ;
C. Manifestation d’un trouble des conduites débutant avant l’âge de 15 ans ;
D. Comportements antisociaux ne survenant pas pendant l’évolution d’une
schizophrénie ou d’un épisode maniaque.
(DSM IV, Paris, Masson 1996 : 283, traduction J.D. Guelfi et coll.)

REVUE DE PRESSE
10
Le Courrier des addictions (2), n° 1, mars 2000
Et si la cigarette rendait
psychopathe ?
Deux études importantes recourant à des
méthodologies rigoureuses présentent en
même temps des résultats concordants
qui vont certainement intriguer la plupart
des lecteurs des respectables journaux
qui en publient les résultats.
•Brennan a suivi une cohorte de 4 169
garçons, nés entre 1959 et 1961 à
Copenhague, en évaluant les consomma-
tions de cigarettes pendant leurs gros-
sesses. En recherchant les arrestations sur
les registres de la criminalité danoise
lorsque ces garçons avaient atteint l’âge
de 34 ans, les auteurs ont pu comparer le
nombre des délits en fonction des
consommations de leurs mères, des
conditions sociales, des suivis de grosses-
se, des antécédents psychiatriques ou cri-
minels des parents et des conditions de
rejets familiaux. Une analyse par régres-
sion logistique amène à reconnaître un
facteur dose-dépendant de l’utilisation de
tabac en cours de grossesse comme
déterminant l’apparition de conduites
délictueuses à l’âge adulte, indépendant
des autres variables.
• Rasanen a suivi pour sa part une
cohorte de 5 636 garçons jusqu’à 28 ans,
en Finlande, avec une méthodologie
assez comparable. Les fils de mères qui
ont fumé pendant leur grossesse ont un
risque de commettre des délits à l’âge
adulte multiplié par deux. Le fait de
fumer pendant la grossesse intervient à
lui seul dans 4 % de la variance associée
aux conduites délictueuses, mais lors-
qu’il est associé à une grossesse précoce
(âge de la mère de moins de 20 ans), une
famille monoparentale, une grossesse
non désirée, le risque est alors multiplié
par 9 pour des délits avec violence et par
14 pour des délits répétés.
Les auteurs s’avancent assez peu sur le
terrain des hypothèses qui permettraient
de comprendre ce phénomène. Encore
faut-il se souvenir que d’autres auteurs
avaient pu montrer auparavant une in-
fluence de la consommation de cigarettes
pendant la grossesse sur le développe-
ment d’un syndrome d’hyperactivité avec
déficit de l’attention chez l’enfant et que
celui-ci peut souvent s’accompagner de
troubles des conduites qui, à l’âge adulte,
évoluent en partie vers d’authentiques
troubles de la personnalité antisociale
avec des conduites de délinquance.
– Rasanen P., Hakko H., Isohanni M.,
Hodgins S., Tiihonen J. Maternal smoking
during pregnancy and risk of criminal
behavior among adult male offspring in the
northern Finland 1996 birth cohort. Amer.
J. Psychiatry 1999 ; 156, 6 : 857-62.
– Brennan P., Grekin E., Mednick S.
Maternal smoking during pregnancy
and adult male criminal outcomes. Arch.
Gen. Psychiatry 1999 ; 56 : 215-22.
Dépendance à la cocaïne
et traitements
L’usage de cocaïne s’est développé aux
États-Unis dans les années 80, en deve-
nant en dix ans un problème de santé
publique majeur. Cette vague de consom-
mation et d’abus est apparue à une
époque où on ne disposait que de peu
d’éléments pour comprendre son poten-
tiel de dépendance et où il n’existait pas
de traitements spécifiques efficaces. On
doit finalement à cette évolution des
consommations, des travaux plus fonda-
mentaux sur la dépendance. Pour simpli-
fier, on est passé d’un modèle de la
dépendance comme un trouble des récep-
teurs (par exemple dans l’héroïnomanie) à
des phénomènes plus complexes d’appé-
tence irrépressible pour un produit. On
traite un manque, puis on finit par essayer
de traiter des envies ou leur réalisation.
Des interventions psychothérapeutiques,
pharmacologiques et psychosociales ont
été préconisées mais les résultats de ces
prises en charge restent souvent discutés.
Des études nationales récentes et soute-
nues par le NIDA relancent le débat.
• Crits-Cristoph propose une étude mul-
ticentrique d’efficacité de quatre formes
d’interventions psychosociales, dans une
population de 487 patients dépendants de
la cocaïne. Par tirage au sort, les patients
ont été soumis à l’une de ces modalités et
suivis sur un an : un counselling indivi-
duel (IDC) et de groupe sur la cocaïne
(GDC), une thérapie cognitive associée au
GDC, une psychothérapie dynamique de
soutien et d’expression associée au GDC
et au counselling de groupe (GDC). Le
suivi est essentiellement évalué à partir
des scores de l’ASI (“Addiction severity
index”) et cette étude ne dispose pas
d’examens d’urines. Les résultats de cette
évaluation sont très fortement en faveur
de la supériorité des techniques de coun-
selling sur les psychothérapies en termes
de consommations mais aussi de réten-
tion. Les études précédentes sur l’efficaci-
té des psychothérapies étaient réalisées en
majorité sur des patients recevant de la
méthadone ou sur des sous-groupes pré-
sentant des troubles psychiatriques plus
importants, par exemple des personnalités
antisociales. Elles reconnaissaient une
plus grande efficacité des thérapies cogni-
tives aux thérapies dynamiques mais sans
réelle différence d’efficacité avec le coun-
selling. Mais il est vrai que pour juger de
l’efficacité de psychothérapies sur des
populations randomisées, on peut sous-
estimer des effets dans des populations
plus ciblées. Il reste évident, à travers ces
données, que pour soigner des dépen-
dances à la cocaïne, il faut pouvoir très
simplement aborder avec les patients leur
mode de consommations.
• Simpson a évalué, là encore dans une
étude multicentrique, le devenir à un an
de 1 605 patients initialement dépendants
de cocaïne et sortant des programmes
communautaires. Cinq cent quarante-
deux d’entre eux avaient suivi des traite-
ments résidentiels en communauté théra-
peutique pour des durées de quatre à six
mois. Quatre cent quatre-vingt-cinq
patients étaient admis dans des pro-
grammes ambulatoires, en moyenne de
six mois. Six cent cinq patients avaient
été hospitalisés pour des durées en
moyenne de 25 jours. Vingt-trois pour
cent de l’ensemble des patients utilisaient
à nouveau de la cocaïne après un an. Dix-
huit pour cent étaient revenus à un pro-
gramme de traitement. Les taux de
rechutes les plus élevés étaient corrélés
avec la sévérité des consommations ini-
tiales et avec des durées de traitement
inférieures à 90 jours. On est donc tenté
de proposer, dans les cas de dépendance
à la cocaïne, une évaluation fine des
besoins des patients et, pour les cas les
plus sévères, d’orienter les propositions de
soins sur des durées longues et dépassant
de toute façon notre classique sevrage hos-
pitalier d’une semaine. Cette étude suggè-
re en tout cas que l’influence de prises en
charge des dépendances à la cocaïne ne
peut se décliner en semaines de traitement.
– Crits-Christoph P., Siqueland L., Blaine J.
Psychosocial treatments for cocaine
dependence. Arch. Gen. Psychiatry
1999 ; 56 : 493-501.
– Simpson D., Joe G., Fletcher B., An-
glin D. A national evaluation of treatment
outcomes for cocaine dependence. Arch.
Gen. Psychiatry 1999 ; 56 : 507-12.
J.B.
REVUE DE PRESSE
1
/
3
100%