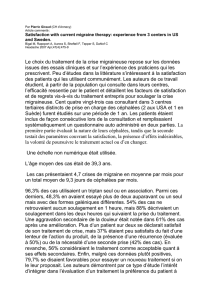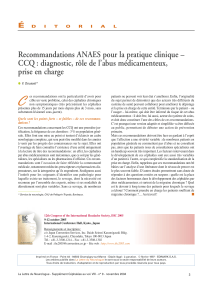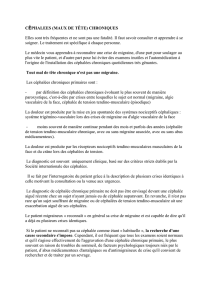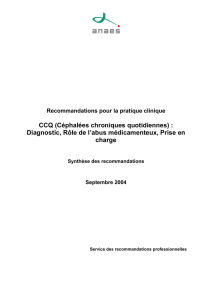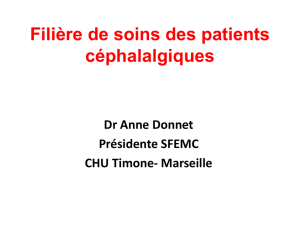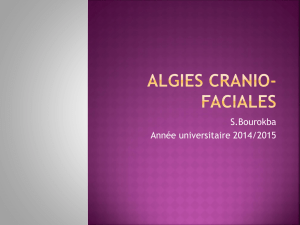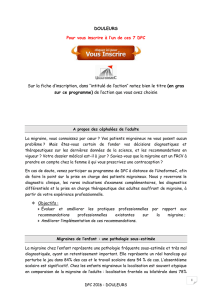ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES CÉPHALÉES
EN URGENCE : LES DIVERSES SOLUTIONS
Dominique Valade (Centre des urgence céphalées, hôpital Lariboisière,
Paris), André Pradalier (Service de neurologie, hôpital Louis-Mourier,
Colombes), Nelly Fabre (Service de neurologie, hôpital Rangueil,
Toulouse).
Le 12 septembre 2000 s’ouvrait à Lariboisière, sous l’égide de l’Assistance
publique, la première unité médicale en Europe consacrée à l’accueil et
au traitement en urgence des céphalées. Elle répondait à un véritable
besoin de santé publique et visait à améliorer en priorité la prise en
charge médicale des patients atteints par des céphalées spécifiques qui
nécessitaient un diagnostic urgent et la mise en œuvre d’un traitement
rapide plutôt que des patients touchés par des céphalées chroniques pour
lesquelles il existait déjà des structures spécialisées de prise en charge
de la douleur.
Si ce type de centre avait sa justification dans le bassin de population de
13 millions d’habitants de la région parisienne, il n’en est pas de même
obligatoirement pour toutes les régions françaises.
Au vu de cette expérience, il semble qu’elle soit intéressante si le bassin
de population pour le même périmètre que celui d’Île-de-France atteint
au moins les deux millions d’habitants, ce qui limite les zones à 4 en
France : Lille-Roubaix-Tourcoing, Lyon-Saint-Étienne, Marseille-
Toulon, Nice et les multiples villes limitrophes. Pour le reste des régions
françaises, cette prise en charge en urgence des céphalées pourrait par-
faitement être calquée sur celle des Stroke Centers que l’on devrait
retrouver dans chaque CHU, et l’organisation de la prise en charge de
celles-ci, dont près de 30 % sont des céphalées relevant d’une cause vas-
culaire (hémorragie méningée, thrombophlébite cérébrale, dissection des
gros troncs, etc.), ferait l’objet d’un centre de réception et d’une garde
commune. Les médecins titulaires du DIU neurovasculaire qui géreraient
le Stroke Center du CHU pourraient être aussi titulaires du DU migraine-
céphalée, complément nécessaire pour prendre en charge les 70 % des
céphalées primaires qui viendraient en crise, en urgence.
Si la prise en charge des céphalées secondaires, après leur passage aux
urgences, ne présente pas de difficultés du fait de leur hospitalisation
quasi systématique, il n’en est pas de même pour les céphalées primaires
où l’aval pose un large problème. Il sera donc nécessaire d’organiser une
prise en charge en posturgence, dans les services de neurologie des CHU
qui auraient adopté ce système pour pouvoir juguler le flot de consultations
de céphalées primaires qui va découler de cette prise en charge en urgence
où les patients ne devront être vus qu’une seule fois, d’où la nécessité,
à côté de l’organisation de consultations céphalées (hors urgence), de la
mise en place d’un réseau ville-hôpital de neurologues et de généralistes
formés plus spécifiquement à la prise en charge des céphalées.
Pour les centres hospitaliers régionaux non universitaires, il serait utile
que, sur le long terme, ils puissent bénéficier, tant aux urgences qu’à la
consultation de médecine interne, d’un référent ayant fait le DU migraine
céphalée qui puisse donner un avis lorsque le collègue recevra une
céphalée pouvant poser problème, tant sur le plan diagnostique que
thérapeutique, mais aussi en s’appuyant, par exemple, sur les réseaux
douleurs existant déjà.
Et peut être qu’avec beaucoup de courage et de bonne volonté, on arrivera
à améliorer la prise en charge des quelque 12 millions de céphalalgiques
français.
QUI DEVRAIT PRENDRE EN CHARGE LES CÉPHALÉES
COMME STRUCTURE DE RECOURS ?
Dominique Valade (Centre d’urgence céphalées, hôpital Lariboisière,
Paris), Christian Lucas (Service de neurologie, hôpital Roger-Salengro,
Lille), Nelly Fabre (Service de neurologie, hôpital de Rangueil, Toulouse),
Michel Lantéri-Minet (Centre antidouleur, hôpital Pasteur, Nice).
LA PAGE DE LA SFEMC
Voilà qui est fait ! Les Recommandations ANAES pour la prise en charge de la migraine chez l’adulte et chez l’enfant sont rédigées ; elles ont
été validées par le conseil scientifique de l’ANAES et sont actuellement sous presse.
Bien que destinées avant tout aux médecins généralistes, la primeur de leur diffusion se fera dans le monde neurologique : elles paraîtront de
façon simultanée sur le site Internet de l’ANAES et dans la Revue neurologique : dans la section FMC du numéro de janvier 2003 pour les
Recommandations “courtes”, dans un supplément de la revue pour le texte long avec argumentaire, tableaux et références. Ce numéro spécial
devrait paraître au début 2003.
Enfin, les Recommandations seront présentées aux JNLF de Nantes en avril 2003, à l’occasion de la réunion commune SFEMC-SETD.
Certains membres du conseil d’administration de la SFEMC ont rédigé pour ce bulletin des billets d’humeur sur des sujets d’actualité portant
sur les céphalées. Ils expriment leur opinion personnelle. Si vous désirez réagir à ces prises de position, n’hésitez pas à nous écrire, à moi-même ou
au secrétaire Christian Lucas. Nous nous engageons à faire paraître votre intervention dans le prochain bulletin de la Société.
Cordialement vôtre,
Pr Gilles Géraud
(Service de neurologie, CHU Rangueil, Toulouse)
Le mot du Président
NDLR : le contenu de La page de la SFEMC est sous l’entière responsabilité de ses auteurs.

S’il ne fait de doute pour personne que la céphalée secondaire trouvera
sa place à l’hôpital, quel que soit le praticien qui l’aura vue en première
intention, il n’en est pas de même pour les céphalées primaires.
Celles-ci errent de généralistes en spécialistes souvent sans bien trouver
celui qui mettra un coup d’arrêt à ce nomadisme médical involontaire,
et qui, rapidement si on n’est pas en présence d’un patient tenace, se ter-
minera par “c’est une fatalité” ou “personne ne peut rien pour moi”.
Ce comportement médical explique les quelque 20 à 30 % de patients
qui ont consulté pour leur céphalée et qui se situent dans la catégorie
“non satisfaits de leur prise en charge”.
Doit-on continuer, face à un céphalalgique, d’accepter qu’en fin de
consultation pour un autre motif chez son généraliste, ce dernier se
contente d’ajouter 2 ou 3 boîtes d’antalgiques, voire d’AINS ou d’anti-
migraineux spécifiques sur la même ordonnance sans motiver le patient
à prendre un rendez-vous de consultation pour mettre en route une prise
en charge “réelle” de sa céphalée ?
Certes les recommandations de l’ANAES, en diffusant les critères IHS,
devraient permettre au généraliste – toujours en première ligne – d’affiner
son diagnostic et d’assurer son traitement. Mais au moindre doute,
plutôt que faire le tour des différents spécialistes (ophtalmologiste, ORL,
stomatologiste, rhumatologue, etc.), ne vaudrait-il pas mieux adresser le
patient à un neurologue correspondant qui, lui, sera plus à même de faire
le tri, évitant au patient des consultations marathons avec retour à la case
départ ? Ces différents allers-retours avec attente de rendez-vous multi-
plient les prescriptions d’antalgiques faisant bien souvent le lit de la
céphalée quotidienne chronique (céphalée quotidienne chronique par
abus médicamenteux inclus).
Certains de nos confrères neurologues n’accordent pas toujours un grand
intérêt à cette pathologie, certes bénigne mais handicapante pour le
patient et au coût socio-économique considérable pour la société au vu
du nombre de céphalalgiques. Peut-être qu’une meilleure information,
voire une formation spécifique (le DU migraine céphalées a été créé
pour cela), viendra à bout de ces préjugés.
Il n’en reste pas moins qu’à terme, la majorité des céphalées primaires
devra être prise en charge en première intention par le généraliste (devant
être plus sensibilisé et mieux formé), et le neurologue ne devra être en
première ligne, avant tout autre spécialiste, que lorsque le généraliste
aura échoué dans une prise en charge bien menée.
MIGRAINE ET PLAN MINISTÉRIEL DOULEUR
M. Lantéri-Minet (Centre antidouleur, hôpital Pasteur, Nice), G. Géraud
(Service de neurologie, hôpital Rangueil, Toulouse).
Le 8 octobre 2002 s’est tenue au ministère de la Santé, de la Famille et
des Personnes handicapées une journée intitulée “Organisation de la
prise en charge de la douleur : repères pour les décideurs”. Cette journée,
organisée à l’initiative de la Direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins, avait pour objectif de présenter le programme national
2002-2005 de lutte contre la douleur aux responsables des agences régio-
nales d’hospitalisation (ARHs) et aux cadres hospitaliers. Compte tenu
de cet objectif, les interventions et les débats qui ont animé cette journée
ont souvent été généraux, abordant la prise en charge de la douleur chro-
nique dans sa globalité. Néanmoins, lors de son allocution d’ouverture,
M. Jean-François Mattéi, ministre de la Santé, de la Famille et des
Personnes handicapées, a insisté sur le fait que la migraine était une des
priorités clairement identifiées dans le programme ministériel.
De plus, dans la session qui avait pour thème “Les structures de prise en
charge de la douleur chronique rebelle”, la spécificité de la prise en
charge de la migraine a été clairement cernée par les interventions du
Pr B. Laurent (“Problématiques des centres de prise en charge de la douleur
chronique rebelle”) et du Dr M. Lantéri-Minet (“Prise en charge de la
migraine : état des lieux et perspectives”). Les échanges autour de ces
interventions ont permis de revenir sur les chiffres clés de l’épidémiologie
française de la migraine (prévalence de 17% dans la population générale
adulte, coût direct de 5 milliards de francs au début des années 1990 et
dont le quart est produit par des hospitalisations, coût indirect estimé entre
15 et 20 millions de journées de travail perdu), que certains “décideurs”
ont probablement découverte dans la mesure où la migraine était rare-
ment, jusqu’à ce jour, un sujet de débats dans l’institution hospitalière.
Une présentation des “équipes migraine” hospitalières a également été réa-
lisée, ce qui a permis d’illustrer la nature essentiellement neurologique
de la prise en charge de la migraine, de rappeler l’importance d’une
action synergique entre les services de neurologie et les structures de
prise en charge de la douleur chronique (avec l’exemple des expériences
bordelaise, niçoise et stéphanoise) et d’insister sur l’expérience positive
du Centre urgences céphalées de Lariboisière.
Cette présentation s’est accompagnée de la description de l’environne-
ment mettant en exergue la place de la SFEMC en tant que société
savante représentative, le développement d’un enseignement spécifique
avec le DU migraines et céphalées, la publication prochaine des recom-
mandations sur la prise en charge de la migraine par l’ANAES, et la
mise en route d’un véritable “observatoire hospitalier de la migraine”
avec l’utilisation du dossier commun Intranet.
À partir de cet état des lieux, les perspectives discutées ont été multiples.
En termes d’environnement, plusieurs pistes ont été évoquées, comme
le développement d’une complémentarité entre la SFEMC et la SETD,
la possible transformation du DU en diplôme interuniversitaire afin de
lui donner une dimension nationale et la nécessaire poursuite des efforts
pour définir des standards de prise en charge au travers de recomman-
dations ANAES portant sur des thèmes plus spécifiques, comme les
céphalées chroniques quotidiennes. En termes de structures, l’officiali-
sation et le renforcement des équipes existantes ont été discutés, sans
négliger la nécessaire création d’une consultation migraine dans chaque
CHU et même dans chaque “gros” CHG. Dans cette dernière perspec-
tive, la synergie entre les services de neurologie, les structures de prise
en charge de la douleur chronique et les services d’urgence a été mise
en avant. Plutôt qu’envisager un modèle unique, il faut maintenant que
les projets fleurissent en tenant compte des acquis et de l’environnement
loco-régional. Dans ce dessein, les interlocuteurs privilégiés sont les
ARHs qui, au-delà d’une dotation budgétaire globale de plus de 11 mil-
lions d’euros pour l’année 2002 (pour l’ensemble du programme qui,
outre la migraine, comprend la douleur provoquée et la douleur de l’en-
fant comme priorités), ont été sensibilisés à la migraine.
AU-DELÀ DU MÉDICAMENT
F. Radat (UTDC, CHRU Pellegrin Tripode, Bordeaux),A. Autret (Service
de neurologie, CHU Bretonneau, Tours).
Tel Monsieur Jourdain ignorant qu’il était l’auteur de sa propre prose, le
médecin moderne n’a plus la conscience que son action dépasse largement
le principe actif du médicament qu’il prescrit. Est-ce la conséquence du
nécessaire réductionnisme de la méthodologie scientifique? Quoi qu’il
en soit, la réflexion “politiquement correcte” sur notre action est focali-
sée sur sa seule partie démontrable, celle qui est indépendante de l’effet
placebo. L’art de prescrire sent le soufre. Et pourtant, dans le domaine
de la migraine, quel enseignement ne peut-on pas tirer des études sur
l’effet des placebos? Ne retenons que le travail de Diener et al., 1999,
montrant que l’effet placebo croît en raison inverse de la taille relative
des groupes contrôles. Bref, il y a de quoi convaincre le plus intransigeant
des méthodologistes que la façon de donner l’emporte largement sur ce
La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 9 - vol. VI - novembre 2002
20
LA PAGE DE LA SFEMC

que l’on donne. Arrêtons-nous à ce propos : il est de nos jours icono-
claste, et pourtant tellement vrai.
Allons plus loin : on doit reconnaître que souvent l’art du thérapeute est
valorisé dans les prises en charge non médicamenteuses. Est-ce du fait
de l’implication, voire de la croyance de ceux qui les pratiquent ou de la
signification des diverses techniques pour ceux qui les reçoivent ? Et ces
techniques foisonnent : relaxation, sophrologie, biofeedback, thérapie
comportementale et cognitive de gestion du stress, hypnose, mésothérapie,
acupuncture, phytothérapie (à base de gentiane, feverfew des Anglo-
Saxons), homéopathie, auriculothérapie mais aussi manipulations rachi-
diennes cervicales, massages, neurostimulation transcutanée, oxygéno-
thérapie hyperbare, champs électromagnétiques pulsés, etc.
On trouve tout au rayon des thérapies non médicamenteuses proposées
dans la migraine. Certaines de ces techniques ont fait la preuve de leur
efficacité, certaines s’appuient sur un rationnel scientifique suffisamment
étayé pour que l’on puisse espérer que des études prouveront un jour leur
efficacité, d’autres ont montré que leur efficacité n’excédait pas celle du
placebo, d’autres encore sont fantaisistes.
Cet engouement pour les thérapies non médicamenteuses montrent bien
que l’on a affaire à des représentations sociales faisant échapper la
migraine du champ de l’allothérapie classique, voire même du champ
des maladies classiques. L’étude FRAMIG 1999 prouve, si besoin en est,
que pour un nombre non négligeable de personnes (55 % d’un échan-
tillon de migraineux issus de la population générale), la migraine n’est
pas une vraie maladie ! Cette étude montre aussi que 93 % des personnes
interrogées pensent qu’elles peuvent se traiter seules, 56 % qu’une
consultation n’est pas utile pour la migraine et 45 % qu’il n’y a pas vrai-
ment de traitement pour la migraine (Lucas et al. 2001).
Schématiquement, il y a deux grands groupes de thérapies non médica-
menteuses : celles qui passent par la parole, celles qui passent par le
corps. Ainsi, il semble clair que la première des thérapies non médica-
menteuses à utiliser avec les migraineux est l’information et la pédagogie.
Les thérapeutes comportementalistes savent bien l’utilité de cette étape
qui est incluse dans toute prise en charge et s’accompagne d’une auto-
observation. En ce qui concerne les migraineux, l’auto-observation
semble une étape essentielle qui accompagnera l’information sur la
maladie. Elle est d’autant plus importante qu’un nombre non négligeable
de patients ont tendance à surconsommer les antalgiques (du simple
mésusage à l’addiction vraie), chronicisant de ce fait leurs céphalées.
L’intérêt d’une bonne auto-observation pour une prescription juste est
même relayée par l’industrie pharmaceutique qui propose aux médecins
des agendas de migraines à remettre à leur patients. Le patient informé
de sa maladie, qui se connaît, saura quels facteurs précipitants éviter sans
se retrancher dans des comportements phobiques excessifs. Il saura avoir
recours au bon médicament au bon moment et gérera ainsi son traitement.
Dans le meilleur des mondes, on pourra parler d’une automédication
encadrée. À un degré de plus se placent les prises en charge psycho-
thérapeutiques plus ou moins élaborées, dont il faut discuter avec les
patients s’ils semblent demandeurs. Ne jamais oublier que la consultation
pour céphalée est parfois un appel au secours.
Pour d’autres patients, on sentira la nécessité d’une solution qui passe
par le corps. Ce peut être simplement la valorisation ou l’incitation à la
pratique d’activités plus ou mois physiques relaxantes régulières; à un
degré de plus, la relaxation (quelle qu’en soit la méthode), du biofeedback
et des thérapies de gestion du stress. Ces techniques ont été bien étudiées :
sur 355 articles publiés, 39 répondent à des standards méthodologiques
suffisants pour que soit réalisée une méta-analyse (Campbell 2000). Si
l’efficacité est relativement modeste (c’est de toute façon le cas de la plupart
des traitements de fond), elle n’en est pas moins réelle, en particulier
chez les patients anxieux. Chez l’enfant, l’efficacité de la relaxation est
même supérieure à celle du traitement de fond par bêtabloquants (Olness
1987).
Ces thérapies agissent probablement de façon complexe en améliorant
la tension anxieuse mais aussi en améliorant des variables psycho-
logiques comme l’efficacité personnelle et le contrôle perçu. Ces
variables sont liées à l’appréciation subjective de la douleur; on a montré
chez les douloureux chroniques qu’elles se modifiaient chez les patients
pour lesquels la relaxation était efficace.
En ce qui concerne l’acupuncture et l’homéopathie, la littérature ne permet
pas encore de conclure, et il faut probablement s’en tenir au précepte que
si les patients s’en trouvent soulagés, il ne convient pas de les décourager.
Les manipulations vertébrales doivent faire la preuve à la fois de leur
efficacité et de leur innocuité.
On ne dispose pas à l’heure actuelle de preuves suffisantes pour juger
des autres thérapies citées, mais il pourrait s’agir, pour certaines d’entre
elles, de pistes intéressantes. L’oxygénothérapie hyperbare et les champs
électromagnétiques pulsés seront peut être un jour des alternatives inté-
ressantes aux traitements médicamenteux.
Ainsi, il faut conclure qu’en matière de traitement d’une affection
bénigne mais chronique et invalidante comme l’est la migraine, la relation
médecin/malade est un ingrédient indispensable qui permettra de mener
à bien, d’une part, une information complète et comprise sur la maladie,
d’autre part, une auto-observation du patient. Il s’agit là déjà d’étapes
thérapeutiques, les migraineux ne pouvant qu’être soulagés de voir enfin
leur affection sortir du maquis des faiblesses nerveuses. L’arsenal des
thérapies non médicamenteuses sera ensuite mis à la disposition du
patient, en sachant que les relaxations, le biofeedback et la gestion du
stress ont fait la preuve incontestable de leur efficacité. Il reste du devoir
de la communauté médicale, et en particulier des spécialistes des cépha-
lées, de tout faire pour préciser, malgré les difficultés méthodologiques,
l’efficacité propre à chacune de ces techniques non médicamenteuses.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
❒Campbell JK, Penzien DB, Wall EM. Evidence based guidelines in the primary
care setting. Behavioral and physical treatments. St Paul : AAN ; 2000.
❒Diener H-C, Dowson A, Ferrari M et al. Unbalanced randomization influences
placebo response : scientific versus ethical issues around the use of placebo in
migraine trials. Cephalalgia 1999 ; 19 : 699-700.
❒Olness K, MacDonald JT, Uden DL. Comparison of self-hypnosis and propranolol
in the treatment of juvenil classic migraine. Pediatrics 1987 ; 79 : 593-7.
❒Lucas C, Lanteri-Minet M, Chaffaud C. Comportements thérapeutiques des
migraineux. Douleurs 2001; 2 (5) : 240-3.
VIE DE LA SOCIÉTÉ
C. Lucas (Service de neurologie, hôpital Roger-Salengro, Lille), G.
Géraud (Service de neurologie, hôpital Rangueil, Toulouse).
JNLF, Nantes 9-12 avril 2003. Journée officielle de la SFEMC en
partenariat avec la société d’étude et de traitement de la douleur
(SETD)
Elle concernera les actualités dans les thématiques céphalées et douleurs.
Concernant la migraine seront présentées les Recommandations ANAES
pour la prise en charge de la migraine chez l’adulte et chez l’enfant.
Axes de recherche clinique en réseau
La SFEMC a initié une recherche clinique fédératrice sur le plan national
avec des projets de recherche. Un codage diagnostique commun et une
banque de données informatisées homogènes mettant en réseau 12 CHRU
impliqués dans la prise en charge des céphalées ont été mis au point et
La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 9 - vol. VI - novembre 2002 21
LA PAGE DE LA SFEMC

sont opérationnels depuis le début octobre 2002. Cela va permettre l’éta-
blissement de données épidémiologiques prospectives. La première thé-
matique de recherche prospective concernera les céphalées chroniques
quotidiennes avec abus antalgiques en centres tertiaires.
3es journées d’enseignement supérieur de la SFEMC couplées à
la première réunion francophone céphalées-migraine. Marrakech,
19-22 septembre 2002
Ces journées ont permis de rassembler plus de 200 neurologues. Outre
les désormais traditionnelles journées d’enseignement supérieur (JES)
de la SFEMC a été organisé pour la première fois un congrès franco-
phone dédié aux céphalées, ayant permis de réunir des neurologues du
Maghreb, d’Afrique noire, du Bénélux, du Canada et de France.
La thématique retenue des JES concernait les “Algies vasculaires de la
face et formes apparentées” avec 6 conférences :
– V. Dousset. Épidémiologie et clinique de l’AVF ;
– N. Fabre. Céphalées trigémino-autonomiques : aspects cliniques ;
– M. Lantéri-Minet. Physiopathologie des algies vasculaires de la face ;
– A. Ducros. CAT devant un premier épisode d’algie vasculaire de la face ;
– A. Pradalier. Traitements des algies vasculaires de la face et des céphalées
trigémino-autonomiques ;
– A. Donnet. Traitements non médicamenteux des AVF.
Deux ateliers avec cas cliniques interactifs ont eu lieu, concernant les
céphalées d’origine infectieuse (D. Valade,Y. Boussougant) et les céphalées
circonstancielles (A. Autret, C. Lucas).
Les communications libres, orales et affichées du congrès francophone
ont été très nombreuses.
Par ailleurs, des conférences plénières ont permis d’aborder une grande
partie de la thématique avec, par exemple, la place des céphalées dans
la neurologie tropicale (M. Dumas), l’épidémiologie des céphalées dans
les pays du Sud (M. Mrabet), les céphalées et pathologies vasculaires
cérébrales (M.G. Bousser), la problématique de la prise en charge thé-
rapeutique dans les pays du Sud (A. Tehindrazanarivelo), les céphalées
chroniques quotidiennes au Canada (J.G. Joly), etc.
Ces journées se sont terminées par une manifestation sportive avec un
tournoi de football opposant 4 équipes. Les matchs se sont déroulés dans
un parfait fair-play et ont montré que les neurologues avaient “la tête et
les jambes”…
Ces journées avaient été précédées la veille par les Universités de la
migraine, organisées par les laboratoires GSK et dont la thématique
concernait l’aura migraineuse avec 2 conférences plénières portant sur
la spreading depression (H. Chabriat) et l’hyperexcitabilité corticale
(Van den Heede) et avec l’organisation de 4 ateliers interactifs concernant
les prodromes (G. Mick et M. Lantéri-Minet), les auras atypiques
(G. Géraud et N. Fabre), les auras prolongées (H. Chabriat et C. Lucas)
et les illusions, hallucinations (A. Donnet et F. Bartholoméï).
Recommandations des pratiques cliniques dans la migraine selon
l’ANAES
La SFEMC avait suggéré il y a plus d’un an d’initier un travail de recom-
mandations des pratiques cliniques dans la migraine de l’enfant et de
l’adulte selon la méthodologie ANAES. Ces recommandations vont être
désormais disponibles sur le site Internet de l’ANAES à partir de la
mi-novembre et seront largement diffusées par la suite (voir le mot du
président). Nous invitons les lecteurs à en prendre connaissance.
La SFEMC soumet pour l’année 2003 un deuxième projet de recom-
mandations à l’ANAES concernant les céphalées chroniques quoti-
diennes, important problème de santé publique.
Mentions légales
PUB ZOMIG
La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 9 - vol. VI - novembre 2002
22
LA PAGE DE LA SFEMC
1
/
4
100%