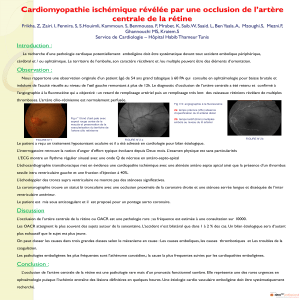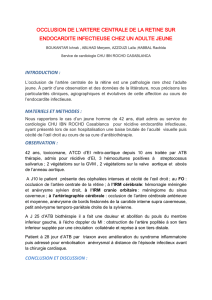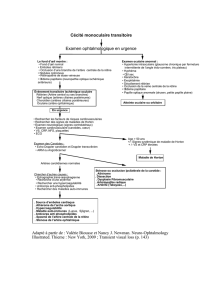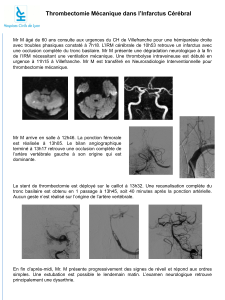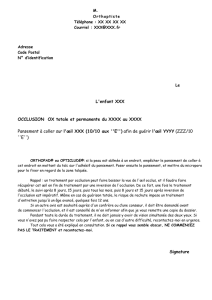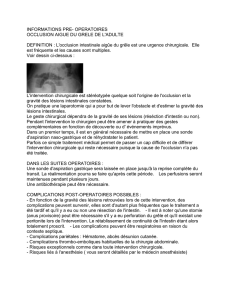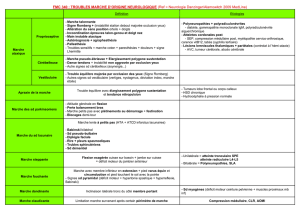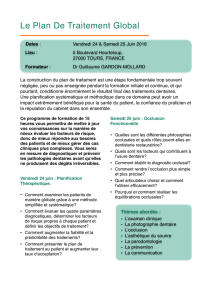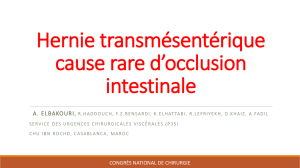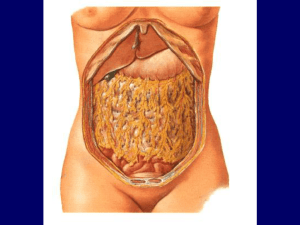Doppler transcrânien et thrombolyse M

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004
224
L
a thrombolyse intraveineuse par l’activateur tissulaire
du plasminogène (tPA) proposée dans les trois heures sui-
vant l’installation des symptômes est le traitement de
référence de l’infarctus cérébral aigu. L’efficacité du traitement
repose sur une recanalisation précoce et définitive de l’artère res-
ponsable, dont l’occlusion est démontrée dans 80 % des cas (1).
Cette recanalisation est obtenue entre 50 et 60 % des cas sur des
séries angiographiques. Contrairement au bénéfice observé dans
l’infarctus du myocarde avec une normalisation de l’ECG et une
disparition des douleurs, le bénéfice du traitement thromboly-
tique i.v. n’a pu être démontré qu’à 3 mois et non à 24 heures.
Dans ces conditions, l’échec du traitement thrombolytique peut
être lié à différents phénomènes :
– absence de recanalisation de l’artère responsable ;
– réocclusion de l’artère responsable ;
– nécrose précoce de l’ensemble du territoire ischémié (absence
de pénombre ischémique) ;
– transformation hémorragique.
Dans les deux premiers cas, des traitements complémentaires, bien
que non validés, sont parfois proposés en urgence pour tenter de
pallier l’inefficacité du traitement thrombolytique. Inversement, le
bénéfice du traitement thrombolytique doit être pondéré par le
risque de transformation hémorragique symptomatique (environ
6 %) chez un patient déficitaire dont l’artère responsable s’est déjà
recanalisée. Ainsi, la perméabilité de l’artère responsable est un des
paramètres majeurs dans la surveillance du patient thrombolysé.
L’angiographie par résonance magnétique nucléaire (ARM) ou
l’angiographie conventionnelle apportent des informations pré-
cieuses sur l’état de la vascularisation cérébrale. Cependant, ces
techniques restent ponctuelles, limitées à certains centres et ne per-
mettent pas de surveiller de façon continue la réponse “vasculaire”
* Service de neurologie et centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale,
hôpital Bichat, Paris.
Doppler transcrânien et thrombolyse
Transcranial Doppler and Thrombolysis
●
J.M. Olivot*
■Le Doppler pulsé transcrânien est un outil non invasif
utilisable au lit du patient.
■Il permet le diagnostic de l’occlusion artérielle, de sur-
veiller sa recanalisation.
■Il a permis de mettre en évidence, une fois sur trois, une
réocclusion précoce en cas de recanalisation partielle ou
complète.
■Une recanalisation constitue d’autant plus un facteur de
bon pronostic qu’elle est précoce, complète et durable.
■L’écho-doppler transcrânien en codage énergie permet
d’améliorer la sensibilité du Doppler pulsé transcrânien.
■Les fréquences ultrasons utilisées en pratique quotidienne
potentialisent seules ou en association avec le rtPA la disso-
lution du thrombus responsable de l’infarctus cérébral.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
Since 1982, transcranial Doppler (TCD) imaging allows
clinician to investigate intracranial arteries. During thrombo-
lysis, it confirms the diagnosis of artery occlusion, allows the
monitoring of its recanalisation and sometimes detects reoc-
clusion. All these findings are critical for the prognosis of
treated patients. Actually, an early complete and stable reca-
nalization of the artery is one of the best prognosis marker of
a good neurological recovery. Recently the development of
transcranial color duplex sonography has improved the sensi-
tivity of ultrasound imaging of intracranial artery, especially
for the diagnosis of occlusion. Several experimental studies
SUMMARY
SUMMARY
have demonstrated that ultrasound frequency used for dia-
gnosis could increase endogenous or tPA induced thrombo-
lysis. Hence several ongoing clinical trial are testing the effect
of continuous artery insonation during thrombolysis in
human.
As a conclusion, TCD is now an essential diagnosis, prognosis
and possibly therapeutic tool for the management of thrombo-
lysis in brain infarction.
Key words : Thrombolysis – Ultrasound – Acute Stroke Care.
…/…
…/…

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004 225
au traitement thrombolytique. À l’inverse, le Doppler transcrânien
(DTC) permet au lit du patient de diagnostiquer l’occlusion et de
surveiller la recanalisation de l’artère responsable. Ainsi, il pourra
orienter la prise en charge thérapeutique du patient, en renforçant
le traitement en l’absence de recanalisation ou, inversement, en
évitant d’exposer le patient à un risque hémorragique supplémen-
taire en cas de recanalisation précoce. Enfin, plusieurs travaux
expérimentaux ont suggéré que les fréquences d’ultrasons utilisées
lors d’un DTC à visée diagnostique pourraient renforcer l’effet
thrombolytique du tPA.
RAPPEL
Le DTC a été introduit en 1982 par Rune Aaslid (2). Fondé sur
l’utilisation du Doppler pulsé, il se pratique à l’aide d’une sonde
à basse fréquence (2 MHz). Le traitement automatique du signal
permet d’obtenir différents paramètres :
– vitesses : pic systolique (VS) ;
– moyenne (VM) et diatolique (VD) ;
– index de pulsatilité : (VS-VD)/VM ;
– index de résistance : (VS-VD)/VS, etc.
La voie d’abord (transtemporale, transorbitaire ou sous-occi-
pitale) la profondeur (40-100 mm) et le sens du flux (positif
ou négatif) permettent de repérer les différentes artères intra-
crâniennes.
Les résultats obtenus doivent être interprétés en fonction de plu-
sieurs paramètres susceptibles de modifier le flux mesuré :
– L’absence de fenêtre temporale est un élément limitant, sa fré-
quence varie entre 6 et 15 % des cas (3).
– L’état de la circulation en amont : une occlusion ou une sténose
serrée de l’origine de l’artère carotide interne (ACI) doivent être
systématiquement recherchées en échographie et/ou en Doppler
continu pour une interprétation cohérente des flux observés sur
les artères intracrâniennes.
– L’examen Doppler est un examen comparatif et certaines situa-
tions physiologiques et pathologiques susceptibles de modifier
les vitesses intracrâniennes doivent être prises en compte pour
une interprétation correcte, qu’il s’agisse d’une accélération des
vitesses liée à une anémie, à une hyperthyroïdie (âge < 40 ans),
à une fièvre, à une préménopause, etc., d’une augmentation des
résistances d’aval secondaire à une hypertension intracrânienne
ou artérielle, ou d’un amortissement des flux entraîné par une
diminution de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (rétré-
cissement aortique serré, etc.), à une hypotension, etc.
UN OUTIL DIAGNOSTIQUE
Occlusion
(4)
Le diagnostic d’occlusion artérielle est, comme nous l’avons vu
précédemment, un élément majeur dans le suivi des patients
thrombolysés. En comparant le DTC à l’angiographie conven-
tionnelle, plusieurs signes ont été décrits ; nous en résumerons
quelques-uns ici.
En fonction du site d’occlusion artérielle, différents signes doivent
être recherchés (figure 1) :
– En aval : absence de flux enregistrée en aval du siège de l’oc-
clusion. L’absence de signal dans une artère correspond à une occlu-
sion si un signal peut être retrouvé dans d’autres artères en utili-
Figure 1.
ACM normale
VS = 90 ± 17 cm/s
VM = 58 ± 11 cm/s
VD = 32 ± 9 cm/s
IP = 0,92 ± 0,25 30 65 mm
Artère cérébrale moyenne (ACM) normale
Occlusion de l’ACM
Occlusion ACM
Flux de diversion/ACA Accélération
controlatérale

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004
226
sant la même fenêtre osseuse. En cas d’occlusion de l’artère céré-
brale moyenne (ACM), il faudra rechercher l’ACA homolatérale
ou l’ACM controlatérale (entre 80 et 100 mm de profondeur).
– En amont : un flux de “diversion” correspondant à la redistri-
bution du flux sanguin dans les artères situées en aval de l’occlu-
sion (par exemple : ACA ou perforantes en cas d’occlusion de
l’ACM) peut être retrouvé. Il se traduit par une augmentation du
flux dans cette artère comparativement à l’artère controlatérale.
En 1989, Zanette et al. ont validé, comparativement à l’angio-
graphie, des critères d’occlusion de l’ACM (5) :
•occlusion proximale de M1 : absence de flux sur toute la profon-
deur de l’ACM avec présence d’un flux sur l’ACM controlaté-
rale et l’ACA homolatérale en utilisant la même fenêtre tempo-
rale ;
•occlusion distale de M1 ou occlusions multiples de branche cor-
ticale : asymétrie des vitesses systoliques > 30 % sur le tronc de
l’ACM (55 mm de profondeur) ;
•occlusion isolée de branche : pas de retentissement sur le flux
du tronc de l’ACM.
– Sur les autres axes : l’ouverture de la communicante antérieure
avec une inversion de l’ACA peut être retrouvée en cas d’occlusion
de l’ACI. L’ouverture de l’artère communicante postérieure est un
des signes les plus fréquents en cas d’occlusion du tronc basilaire.
Comparativement à l’angiographie conventionnelle, la sensibi-
lité et la spécificité du Doppler transcrânien dans le diagnostic
des occlusions de l’ACM sont excellentes (sensibilité 93 % ; spé-
cificité 96 %) et, au mieux, augmentées par son association avec
une technique d’angiographie non invasive, type angio-IRM,
limitant ainsi l’angiographie conventionnelle à des gestes de
revascularisation invasive (thrombolyse intra-artérielle ou angio-
plastie). Inversement, les résultats obtenus sur la circulation
vertébrobasilaire sont beaucoup plus décevants. Ainsi, la circu-
lation antérieure, et l’ACM en particulier, a fait l’objet de nom-
breuses études dans l’application du DTC au cours de la throm-
bolyse et nous centrerons notre propos sur le sujet.
Recanalisation
En comparant directement les résultats du DTC avec ceux d’une
angiographie réalisée dans les suites immédiates d’une thrombo-
lyse i.v., Burgin et al. ont développé un score permettant d’évaluer
la recanalisation de l’artère occluse (6).
Par analogie avec les grades TIMI (Thrombolysis in Myocardial
Infarction) développés dans la pathologie coronaire, les auteurs ont
établi 3 stades de recanalisation artérielle en DTC TIBI (Thrombo-
lysis in Brain Infarction) : occlusion, recanalisation partielle et
complète, elles-mêmes subdivisées en 2 grades (grades TIBI 0-5).
Ils ont comparé ces grades Doppler aux stades angiographiques
Figure 2. Grades de recanalisation de l’ACM.
TIBI
0
1
2
3
4
5
Occlusion complète
Recanalisation complète
Recanalisation partielle
Flux en aval de l’occlusion
Absence de flux
Minime flux systolique ; pas de flux télédiastolique
Pic systolique retardé et < 30 cm/s ;
flux télédiastolique présent
Diminution de > 30 % du pic systolique/ACM controlatérale
Accélération du flux systolodiastolique :
hyperhémie ou sténose résiduelle
Flux normal
Burgin WS et al. Stroke 2000;31:1128-32.

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004 227
correspondants (figure 2).
La sensibilité et la spécificité des grades 4-5 pour la détection
d’une recanalisation complète en DTC (91 et 93 %) étaient excel-
lentes. Inversement, le stade recanalisation partielle (grade 2-3)
correspondait plus d’une fois sur deux à une occlusion persistante
en angiographie diminuant la sensibilité du grade 0-1 (occlusion
complète) à 50 %, pour une spécificité à 100 %, et la spécificité
du grade 2-3 (occlusion partielle) à 76 %, pour une sensibilité à
100 %. Ainsi, la persistance d’un flux amorti avec une diminution
de plus de 30 % de la VS comparativement au côté opposé peut
correspondre à une occlusion persistante de l’artère et justifier,
en l’absence d’amélioration clinique et de lésion hémorragique
au TDM cérébral, un examen angiographique urgent.
UN OUTIL PRONOSTIQUE
Après la validation des critères TIBI, les auteurs ont analysé leur
relation avec l’évolution du déficit neurologique quantifiée par
le score NIHSS. Ainsi, une occlusion complète avant la throm-
bolyse était associée non seulement à un déficit neurologique
plus important mais aussi à une mortalité significativement supé-
rieure à celle observée en cas de recanalisation partielle ou com-
plète (22 % versus 5 %).
L’utilisation d’un casque spécifique a permis de surveiller, par un
enregistrement en continu, la recanalisation de l’artère au cours
d’une thrombolyse. En cas d’occlusion démontrée de l’ACM, la
recanalisation était observée entre 70 % et 78 % des cas (7). Le
délai moyen de recanalisation était de 250 mn, survenant dans
75 % des cas pendant l’administration du traitement par tPA. De
plus, chez les patients présentant une récupération majeure (dra-
matic recovery) sous traitement thrombolytique (NIHSS ≤3 ou
diminution de plus de 10 points du score [22 % des cas]), une
recanalisation complète de l’artère était observée dans 58 % des
cas versus 14 %. Le mode de recanalisation avait aussi son impor-
tance. Ainsi, une recanalisation brutale (< 1 mn) était associée
dans 80 % des cas à une récupération neurologique quasi com-
plète (NIHSS ≤3) à 24 h alors que celle-ci n’était retrouvée que
dans 13 % des cas de recanalisation lente (≥30 mn).
Mais si la fréquence de recanalisation de l’artère occluse chez ces
patients était nettement supérieure à celle observée dans les séries
“angiographiques” (1), la surveillance continue par DTC a permis
de mettre en évidence, chez un patient sur trois ayant présenté
une recanalisation partielle ou complète, une réocclusion précoce
survenant dans les 2 heures suivant l’administration du traitement
thrombolytique i.v. (7). Cette réocclusion s’accompagnait d’une
réaggravation du déficit neurologique dans 50 % des cas. Dès
lors, le dépistage et le traitement de la réocclusion artérielle
deviennent une des cibles majeures pour le renforcement du trai-
tement thrombolytique de l’infarctus cérébral.
En conclusion, une recanalisation précoce, brutale et stable est un
élément de bon pronostic lors d’une thrombolyse. Le tableau
résume le rôle pronostique de l’état de perméabilité de l’artère
dans les 2 heures suivant l’administration du bolus de tPA (7).
D’autres facteurs ont également démontré leur rôle, comme
les signes précoces d’ischémie sur le scanner cérébral (score
ASPECTS), la glycémie, l’importance du déficit initial et la pres-
sion artérielle.
À côté du DTC, l’écho-doppler énergie transcrânien est un outil
de développement récent particulièrement intéressant pour la
visualisation directe des artères potentialisées par l’injection de
produit de contraste (8). Cet outil est particulièrement intéressant
en l’absence de fenêtre temporale. Il a été utilisé dans le moni-
toring de la recanalisation de l’ACM (9). Cintas et al. ont décrit
la recanalisation progressive de l’ACM en codage énergie. Ainsi,
en cas d’occlusion proximale de M1, les auteurs ont décrit une
réapparition progressive du signal dont l’amplitude augmente au
fur et à mesure de la recanalisation de l’artère. La persistance
d’un ralentissement du flux suggérait une occlusion distale. Ces
résultats furent obtenus en l’absence de traitement par rtPA, sug-
gérant un effet thrombolytique direct des ultrasons focalisés sur
le thrombus par l’échographie.
PERSPECTIVES : ULTRASON, UN ALLIÉ
POUR LA THROMBOLYSE…
(10)
Depuis 1992, plusieurs travaux ont démontré que les ultrasons
aux fréquences utilisées pour le diagnostic accélèreraient la
thrombolyse induite par les activateurs du plasminogène comme
le tPA. Les ultrasons utilisés à cette fréquence favoriseraient la
pénétration du tPA au sein de la fibrine et l’exposition des sites
de liaison à cet enzyme. D’autres travaux ont suggéré un effet
direct des ultrasons sur le thrombus potentialisé par l’action de
micro-bulles stabilisées. Enfin, le taux élevé de recanalisation
observé dans les séries de patients suivies en DTC, comparative-
ment aux résultats obtenus dans les études contrôlées par angio-
0
NIHSS 0-3
2 h NIHSS 0-3
24 h Rankin 0-1
3 mois Survie
3 mois
20
40
60
80
100
10
30
50
70
90
Occlusion persistante (n = 13)
Réocclusion précoce (n = 16)
Recanalisation stable (n = 31)
Tableau. Pronostic des patients en fonction de la recanalisation de
l’artère occluse (7). Les résultats sont exprimé en pourcentages de
patients dans chaque groupe.

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004
228
graphie, ont suggéré un bénéfice lié aux ultrasons. Ainsi, plusieurs
études randomisées et contrôlées sont actuellement en cours pour
tenter de confirmer le bénéfice de l’insonation permanente de
l’artère occluse au cours d’une thrombolyse i.v.
CONCLUSION
Le Doppler transcrânien est devenu un outil indispensable lors
du traitement thrombolytique de l’infarctus cérébral. C’est un
précieux outil diagnostique, pronostique et probablement théra-
peutique. Les limites de l’examen restent l’absence de fenêtre
temporale, le diagnostic d’une occlusion dans le territoire vertébro-
basilaire et celui d’une recanalisation partielle de l’ACM. Son
bénéfice thérapeutique est en cours d’évaluation. Le dévelop-
pement des techniques d’écho-doppler transcrânien en codage
énergie est une perspective intéressante permettant de visualiser
directement l’artère occluse en y associant les données hémody-
namiques du Doppler pulsé.
■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1.
Del Zoppo GJ, Poeck K, Pessin MS et al. Recombinant tissue plasminogen
activator in acute thrombotic and embolic stroke. Ann Neurol 1992;32:78-86.
2.
Aaslid R, Markwalder TM, Nornes H. Noninvasive transcranial Doppler ultra-
sound recording of flow velocity in basal cerebral arteries. J Neurosurg 1982;57:
769-74.
3.
Alexandrov AV, Demchuk AM, Wein TH, Grotta JC. Yield of transcranial Doppler
in acute cerebral ischemia. Stroke 1999;30:1604-9.
4.
Demchuk AM, Christou I, Wein TH et al. Specific transcranial Doppler flow
findings related to the presence and site of arterial occlusion. Stroke 2000;31:
140-6.
5.
Zanette EM, Fieschi C, Bozzao L et al. Comparison of cerebral angiography
and transcranial Doppler sonography in acute stroke. Stroke 1989;20:899-903.
6.
Burgin WS, Malkoff M, Felberg RA et al. Transcranial Doppler ultrasound cri-
teria for recanalization after thrombolysis for middle cerebral artery stroke. Stroke
2000;31:1128-32.
7.
Alexandrov AV, Grotta JC. Arterial reocclusion in stroke patients treated with
intravenous tissue plasminogen activator. Neurology 2002;59:862-7.
8.
Baumgartner RW. Transcranial color duplex sonography in cerebrovascular
disease: a systematic review. Cerebrovasc Dis 2003;16:4-13.
9.
Cintas P, Le Traon AP, Larrue V. High rate of recanalization of middle cere-
bral artery occlusion during 2-MHz transcranial color-coded Doppler continuous
monitoring without thrombolytic drug. Stroke 2002;33:626-8.
10.
Daffertshofer M, Hennerici M. Ultrasound in the treatment of ischaemic stroke.
Lancet Neurol 2003;2:283-90.
I. Quels sont les signes docclusion isole du tronc
de lartre crbrale moyenne ?
a. Disparition du flux en aval de locclusion.
b.Acclration ou persistance du flux dans lACA homo-
latrale enregistr par la mme fentre temporale.
c.ACM controlatrale permable enregistre par la mme
fentr e temporale.
d. Inversion de lartre ophtalmique.
e. Ouver ture de lar tre communicante antrieure.
II. Concernant la recanalisation de lartre
occluse lors dun traitement thrombolytique :
a. La sensibilit des grades 2-3 de Burgin est excellente.
b. Elle est retrouve dans 70 % des cas.
c. Elle survient majoritairement aprs la fin de ladministration
du tPA.
d. Elle se complique une fois sur trois dune rocclusion prcoce.
e. Elle est identique celle observe dans les sries angio-
graphiques.
AUTO-ÉVALUATION
AUTO-ÉVALUATION
Rsultats : 1 : a, b, c ; II : b, d.
Destiné aux médecins neurologues, rhumatologues, électrophysiologistes, étudiants
inscrits à un DES de neurologie ou tout médecin intéressé par cet enseignement.
L’objectif principal est de permettre la prise en charge des patients atteints des affections
du système nerveux périphérique (physiopathologie, diagnostic et traitement).
Responsables de l’enseignement : Pr G. Saïd, Pr D. Adams
Clotûre des inscriptions :10 novembre 2004
Début de l’enseignement :25 novembre 2004 ; 1 jeudi par mois de 10 h à 17 h.
Sélection des candidats : sur dossier composé d’une lettre de motivation + CV
adressé au Pr Adams, service de neurologie, hôpital de Bicêtre,
78, rue du Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre.
Renseignements :secrétariat
Tél : 01 45 21 26 18 (Mme Bosse) ou 01 45 21 27 11– Fax : 01 45 21 28 53
E-mail : [email protected]
DU de pathologie
du système nerveux
périphérique 2004-2005
Faculté de médecine Paris-sud
Le Kremlin-Bicêtre
1
/
5
100%