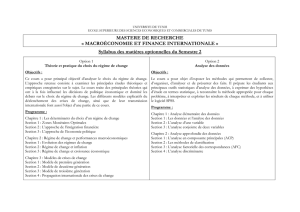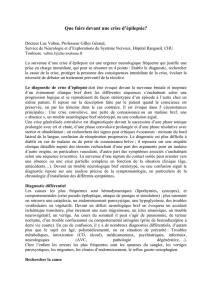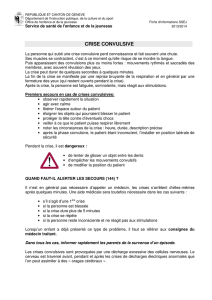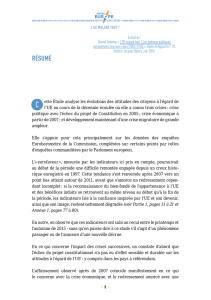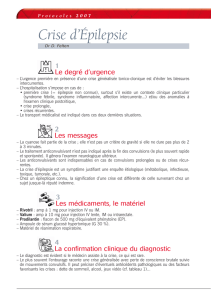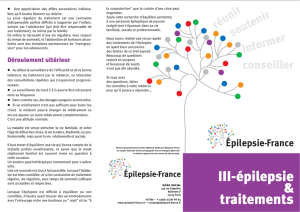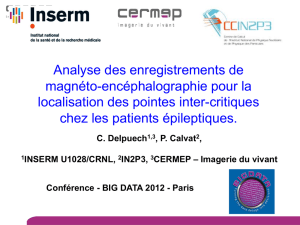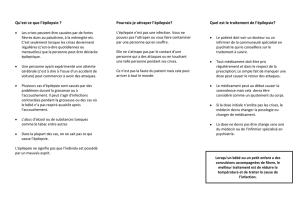L Quand doit-on proposer l’arrêt d’un traitement antiépileptique ?

198 | La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 7 - septembre 2008
MISE AU POINT
Quand doit-on proposer
l’arrêt d’un traitement
antiépileptique ?
When should antiepileptic treatment be withdrawn?
M. Lemesle-Martin*
* Laboratoire d’exploration du
système nerveux, service de neuro-
logie, Hôpital général, Dijon.
L
e traitement antiépileptique a pour objectif de
réduire la fréquence des crises et de permettre
la meilleure insertion scolaire, sociale et
professionnelle possible. La plupart des patients
seront équilibrés avec une seule molécule et, après
plusieurs années sans crise, la réduction, voire l’arrêt
du traitement peuvent être discutés. La décision sera
d’autant plus facile que le syndrome épileptique aura
été bien identifi é et que le patient sera équilibré
grâce à une monothérapie.
Rémission et facteurs de risque
de récidive
L’épilepsie peut être considérée en rémission lorsque le
patient est libre de crises depuis une période suffi sante,
conventionnellement entre 2 et 5 ans. Le Medical
Research Council a suivi 1 013 patients traités et libres
de crises depuis au moins 2 ans. Sur les 509 patients qui
avaient arrêté les antiépileptiques, 59 % étaient libres
de crises à 2 ans, contre 78 % parmi les 504 patients qui
avaient continué leur traitement. Cependant, à 5 ans,
la différence se réduisait entre les patients ayant arrêté
leur traitement et ceux qui l’avaient poursuivi. Les
principaux facteurs de risque de rechute sont rapportés
dans le tableau I (1). L’âge de début de l’épilepsie est
incriminé chez la plupart des auteurs. J.F. Annegers et
al. (2) rapportent 51 % de rémissions pour les épilep-
sies commençant avant l’âge de 10 ans, 40 % pour un
début entre 10 et 19 ans et 28 % pour un début entre
20 et 59 ans. La probabilité de maintien de rémission
des crises après arrêt d’un traitement antiépileptique
semble meilleure chez l’enfant (entre 66 et 96 % à
1 an et entre 61 et 91 % à 2 ans chez 2 758 enfants
issus d’une revue de 28 études (comparativement à
celle des adultes) entre 39 et 74 % à 1 an et entre 35 et
57 % à 2 ans chez 1 020 adultes issus de cette même
revue) [3]. Plus l’histoire épileptique active est courte
(entre le début de l’épilepsie et le début de la phase
de rémission), plus le risque de récidive est faible. Un
grand nombre de crises avant la rémission, la nécessité
de prendre plusieurs médicaments pour contrôler les
crises et la présence de deux ou trois types de crises
différentes sont des facteurs de risque de récidive. Plus
la période traitée sans crise est longue et moins le
risque de récidive est grand. Après 5 ans sans crise,
le risque de récidive est inférieur à 10 %. Si les crises
persistent au-delà de 2 ans après la mise en route du
traitement, la probabilité de rester au moins 1 an sans
crise se réduit de moitié. Le type et la sévérité de l’épi-
lepsie, ainsi que son étiologie, infl uencent le pronostic
évolutif. La sévérité de l’épilepsie est souvent appré-
ciée sur la fréquence des crises. Un nombre d’environ
5 crises par an semble être déterminant, aggravant le
risque de récidive épileptique quel que soit le syndrome
épileptique. La durée des crises (supérieure à 15 mn)
Tableau I. Facteurs prédictifs de récidive de crise.
Âge de début des crises > 10 ans
Sévérité de l’épilepsie (fréquence, durée, notion d’état de mal)
Délai de réponse au traitement antiépileptique
Type de crises (tonico-cloniques, myocloniques)
Délai long avant la mise en route du traitement
Signes neurologiques, retard mental
Anomalies électroencéphalographiques avec décharges
de pointes-ondes
Délai court depuis le contrôle des crises
Étiologie connue (épilepsie symptomatique)

La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 7 - septembre 2008 | 199
Points forts
et la survenue d’un état de mal épileptique sont des
facteurs déterminants importants en faveur du risque
d’aggravation de l’épilepsie. La présence d’un défi cit
neurologique ou d’un retard psychomoteur diminue
nettement les chances de rémission et aggrave le risque
de récidive. L’intérêt de l’électroencéphalogramme
pour prédire l’évolution est controversé. La persistance
de pointes-ondes chez les patients souffrant d’une
épilepsie généralisée idiopathique est certainement
la caractéristique électroencéphalographique la plus
utile, témoignant d’un haut risque de récidive, et remet
en cause l’arrêt du traitement (risque de rechute de
57 à 59 %) [4]. L’association d’au moins deux de ces
différents facteurs augmente le risque de récidive
(supérieur à 70 %). Avec un seul facteur positif, le
risque de récidive reste inférieur à 40 %.
Rémission en fonction
des syndromes épileptiques
Épilepsies généralisées idiopathiques
Lorsque l’épilepsie-absence répond aux critères de
défi nition de ce syndrome, le pronostic est excellent
et permet souvent un arrêt du traitement 2 ans après
la dernière crise. Cependant, les absences peuvent
persister de façon isolée (7 % des cas) ou être asso-
ciées à des crises tonico-cloniques (36 %). Elles
peuvent disparaître et laisser place à des crises convul-
sives généralisées. Les facteurs de risque de rechute à
l’âge adulte sont le début tardif des absences (après
8 ans), la présence d’une composante sémiologique
clonique, atonique ou myoclonique, de myoclonies
des paupières ou périorales, l’association avec des
crises tonico-cloniques, l’existence d’atypies EEG,
la présence d’une photosensibilité et la mauvaise
réponse au traitement. Le traitement est alors pour-
suivi plus longtemps et sa réduction sera prudente.
L’épilepsie myoclonique bénigne de l’adolescent est
sensible au traitement, mais le risque de rechute après
arrêt du traitement est élevé et impose un traitement de
longue durée, souvent supérieur à 10 ans sans crise.
Les crises tonico-cloniques généralisées peuvent être
isolées ou s’associer à d’autres types de crises. Elles
sont en général peu fréquentes et de bon pronostic,
avec un taux de rechute faible de l’ordre de 8 à 20 %. La
durée du traitement est fonction de l’âge de début de
l’épilepsie, de la fréquence des crises et de la présence
d’anomalies sur l’EEG, et d’une photosensibilité. Les
crises survenant au réveil sont de meilleur pronostic
que celles qui surviennent pendant le sommeil. Sauf
en cas d’anomalies EEG, l’arrêt du traitement peut
se discuter après 3 à 4 ans sans crise.
En cas d’association de multiples crises dans le cadre
d’une épilepsie généralisée et surtout en présence
d’une photosensibilité, le risque de rechute apparaît
plus élevé : 22 % en cas de crises tonico-cloniques
associées à des absences ou à des myoclonies contre
19,2 % en cas de crises tonico-cloniques seules et
7,7 % en cas d’absences isolées. Un traitement plus
long, de l’ordre de 10 ans au lieu des 2 à 4 ans habi-
tuels, est alors recommandé.
Épilepsies partielles idiopathiques
et cryptogéniques
Dans l’épilepsie à paroxysmes centrotemporaux, la
faible fréquence des crises permet parfois de ne pas
proposer de traitement pendant la phase évolutive.
Ce syndrome épileptique guérit à la puberté avec
normalisation de l’EEG. Si un traitement antiépilep-
tique a été instauré, il sera indispensable de prévoir
son arrêt à l’adolescence.
L’évolution de l’épilepsie à paroxysmes occipitaux est
plus délicate. Sa guérison à l’âge adulte est habituelle
et l’arrêt du traitement est proposé de façon plus
prudente dès la fi n de l’adolescence.
Les épilepsies partielles cryptogéniques ont un
moins bon pronostic, avec un taux de rémission de
l’ordre de 35 % à 20 ans (2). Les crises partielles
complexes conduisent à davantage de rechutes que
les crises partielles simples. En cas de crises partielles
complexes, il est déconseillé d’essayer d’arrêter le
traitement. L’association avec des crises généralisées
aggrave le risque de rechute.
Épilepsies symptomatiques
Le risque de récidive épileptique est plus élevé dans les
épilepsies symptomatiques que dans les épilepsies idio-
Mots-clés
Antiépileptiques
Arrêt du traitement
Épilepsie
Rémission
Highlights
The decision to withdraw
antiepileptic treatment is
particularly diffi cult in adults
for whom considerations
such as driving and employ-
ment may be affected by a
recurrence of seizures. The
patient should be counselled
about the risk of relapse and
its consequences. Usually
patients should have been
seizure free for at least two
years before drug withdrawal
is attempted. Drugs should be
withdrawn slowly over a period
of several months. Factors infl u-
encing the likelihood of relapse
include the duration of epilepsy
prior to seizure control, the
duration of remission, seizure
type (idiopathic versus symp-
tomatic epilepsy, epileptic
syndrom) and the presence
of additional handicaps. The
majority of relapses following
drug withdrawal occurs within
one year.
Keywords
Antiepileptic drugs
Withdrawal
Epilepsy
Remission
L’arrêt du traitement antiépileptique est proposé après 2 à 4 ans sans crise. »
L’arrêt du traitement antiépileptique est conditionné par la rémission des crises. »
L’identification du syndrome épileptique est essentielle pour évaluer le pronostic d’épilepsie. »
L’arrêt du traitement antiépileptique est souvent possible chez les enfants ayant souffert d’épilepsie idiopathique. »
L’arrêt du traitement antiépileptique est risqué en cas d’épilepsie symptomatique lésionnelle. »
Le risque de récidive épileptique après arrêt du traitement antiépileptique doit être évalué individuellement. »
Des facteurs sociaux, professionnels et individuels interviennent dans la décision d’arrêt du traitement antiépileptique. »
La décision du patient est primordiale dans le choix d’arrêter le traitement antiépileptique. »
L’arrêt du traitement antiépileptique doit se faire progressivement en fonction de la molécule utilisée et de
»l’ancienneté du traitement.
En cas de rechute, les crises réapparaissent souvent dans la première année qui suit l’arrêt du traitement antiépileptique. »

200 | La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 7 - septembre 2008
Quand doit-on proposer l’arrêt
d’un traitement antiépileptique ?
MISE AU POINT
pathiques (risque relatif : 1,55 ; IC95 : 1,21-1,98) [4], avec
des évolutions variables en fonction de l’étiologie.
Les crises postopératoires surviennent le plus souvent
dans les 6 mois à 1 an qui suivent l’intervention ;
elles sont rares et souvent sensibles au traitement.
Les lésions les plus épileptogènes sont celles qui se
développent lentement et impliquent précocement
le cortex des régions frontales, rolandiques ou tempo-
rales mésiales. Les abcès cérébraux, les méningiomes
et les tumeurs gliales de bas grade sont liés à un risque
de crises plus élevé que les gliomes de haut grade et
les métastases (5). Un traitement prophylactique peut
ne pas prévenir le risque de survenue de crises. Lorsque
ce traitement est instauré en phase préopératoire – ce
qui est le plus souvent le cas – et en l’absence de crise,
l’arrêt du traitement doit être envisagé rapidement,
en général dans les 6 à 24 mois après le début du
traitement. Dans les accidents vasculaires cérébraux,
les crises contemporaines de l’accident sont des crises
symptomatiques aiguës qui ne justifi ent pas le main-
tien d’un traitement antiépileptique à long terme. En
revanche, les crises tardives nécessitent la poursuite
d’un traitement antiépileptique, souvent effi cace en
monothérapie. Après une période de rémission des
crises, le risque d’aggravation neurologique qui pour-
rait résulter d’une nouvelle crise doit imposer une
certaine prudence et conduire à ne proposer l’arrêt
du traitement que chez certains patients au-delà de
5 ans sans crise.
Le risque d’épilepsie posttraumatique repose sur
plusieurs facteurs : profondeur et durée des troubles
de conscience, lésions parenchymateuses, œdème
cérébral, présence de signes neurologiques défi citaires,
saignement intracrânien, signes électroencéphalogra-
phiques. L’arrêt du traitement sera fonction de ces
différents facteurs et peut être proposé entre 2 et
5 ans après le traumatisme, en l’absence de crise.
Comment arrêter le traitement
antiépileptique ?
Il n’existe pas de consensus sur les modalités d’arrêt
du traitement antiépileptique. Le risque individuel
de récidive épileptique, l’impact social lié au traite-
ment (stigmatisation, limitation de certaines activités
sociales et professionnelles…), la toxicité à long terme
de la molécule (souvent méconnue et parfois révélée)
et les implications émotionnelles d’un arrêt potentiel
du traitement ou de son maintien doivent être évalués.
Enfi n, le choix du patient et le niveau de risque auquel
il accepte de se soumettre conditionnent la décision
fi nale. Il devra être conscient que cet arrêt du traite-
ment n’est pas obligatoirement synonyme de guérison
défi nitive. La diminution ou l’arrêt du traitement doit
être lentement progressif et s’accompagner de la pour-
suite des précautions hygiéno-diététiques usuelles
auxquelles le patient était soumis. Une réduction sur
6 mois, voire sur plus de 12 mois selon les situations,
peut paraître nécessaire pour respecter des paliers de
réduction prudents (particulièrement pour les barbi-
turiques, les benzodiazépines et la carbamazépine)
[tableau II] (6). Le simple non-respect de ces recom-
mandations peut être source de rechute. Une seule
molécule à la fois doit être arrêtée. Des signes cliniques
en rapport avec le sevrage peuvent apparaître pendant
cette période (nervosité, tremblements, tachycardie,
palpitations, angoisse, insomnie, etc). Un suivi régulier
rassurera le patient. Au cours de ces consultations, la
réalisation d’un électroencéphalogramme surveillera
l’absence de réapparition d’anomalies paroxystiques
épileptiques qui remettrait en cause la poursuite de la
régression thérapeutique. Après l’arrêt du traitement,
le suivi clinique du patient se poursuit (sans contrôle
EEG), d’autant plus que la majorité des rechutes
surviennent la première année et principalement dans
les 6 premiers mois.
Les crises au cours du sevrage ou après la fin du
sevrage ont, en général, les mêmes caractéristiques
cliniques et physiologiques que les crises habituelles
et sont souvent assimilées à une rechute. Il faut refaire
un électroencéphalogramme, vérifi er si les consi-
gnes de réduction ont été respectées et rechercher
un facteur déclenchant. Leur délai de survenue est
fonction de la demi-vie de la molécule utilisée (3 à
4 semaines qui suivent l’arrêt de la molécule pour
les barbituriques et les benzodiazépines). En cas de
rechute, soit la dose est augmentée au dernier palier
où le patient n’avait pas rechuté, soit la reprise du
traitement à sa dose initiale est préconisée. En cas de
rechute, l’essai d’un nouvel arrêt sera plus diffi cile à
Tableau II. Réduction de dose à respecter toutes les
4 semaines pour chaque molécule (mg/j).
Carbamazépine 200 Clobazam 10
Clonazépam 1 Éthosuximide 250
Felbamate 300 Gabapentine 400
Lamotrigine 100 Lévétiracétam 500
Oxcarbazépine 300 Phénobarbital 30
Phénytoïne 50 Piracétam 1 600
Primidone 125 Tiagabine 10
Topiramate 100 Valproate 200
Vigabatrine 500

La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 7 - septembre 2008 | 201
MISE AU POINT
proposer. Il peut également être suggéré de maintenir
la dose à laquelle est survenue la crise en contrôlant
l’électroencéphalogramme, et de temporiser la pour-
suite de la réduction thérapeutique en respectant des
paliers d’observation plus longs avant de proposer
une nouvelle réduction de dose.
Conclusion
Qu’il soit proposé par le médecin ou qu’il soit demandé
par le patient, l’arrêt du traitement antiépileptique
repose sur une concertation entre médecin et patient.
Différents facteurs seront pris en compte pour guider
la pratique et choisir l’attitude qui semble la mieux
adaptée à un patient donné. La décision fi nale devra
donc prendre en compte, en plus des facteurs pronosti-
ques liés au syndrome épileptique, les facteurs sociaux
(permis de conduire, travail, activités de loisir, etc.)
et les facteurs personnels et émotionnels (crainte
de rechute, contexte de stress, etc.), qui conduiront
à une décision individuelle en concertation avec le
patient et sa famille. Après l’arrêt du traitement, le
patient doit être suivi pendant au moins 1 an. ■
1. Randomised study of antiepi-
leptic drug withdrawal in patients
in remission. Medical Research
Council Antiepileptic Drug
Withdrawal Study Group. Lancet
1991;337(8751):1175-80.
2. Annegers JF, Hauser WA, Elve-
back LR. Remission of seizures and
relapse in patients with epilepsy.
Epilepsia 1979;20:729-37.
3. Specchio L.M., Beghi E. Should
antiepileptic drugs be withdrawn
in seizure free patients? CNS
Drugs 2004;18(4):201-12.
4. Todt H. The late prognosis of
epilepsy in childhood: results of
a prospective follow-up study.
Epilepsia 1984;25:137-44.
5. Lemesle-Martin M. Traitements
antiépileptiques dans les lésions
cérébrales : quelles sont les indi-
cations et les principales attitudes
pratiques ? Ann Fr Anest Réanim
2001;20:115-22.
6. Shorvon SD. Three general
principles of treatment in
epilepsy. Handbook of epilepsy
treatment. Blackwell Science
2000:34-84.
Références
bibliographiques
Secrétariat scientifique
Professeur Thierry Kuntzer
Service de Neurologie
CHU Vaudois - 1011 Lausanne, Suisse
E-mail : thierry.kuntzer@chuv.ch
Secrétariat d'organisation
Renseignement organisation
Tél. : 01 70 94 65 20 - Fax : 01 70 94 65 01
E-mail : [email protected]
Renseignement inscription
Tél. : 01 70 94 65 22 - Fax : 01 70 94 65 25
E-mail : [email protected]
@
www
www.b
.b-
-c
c-
-a.fr/jsfm2008
a.fr/jsfm2008
1
/
4
100%