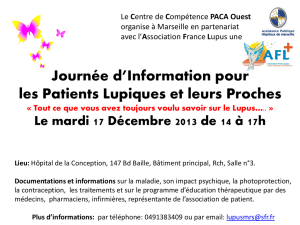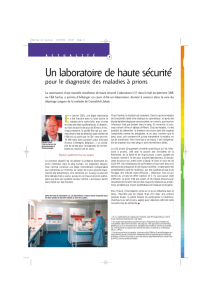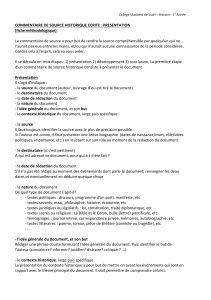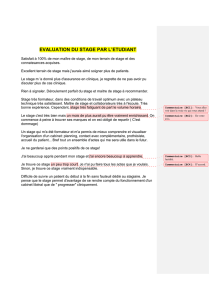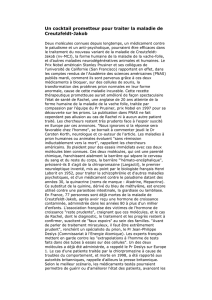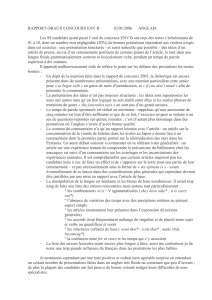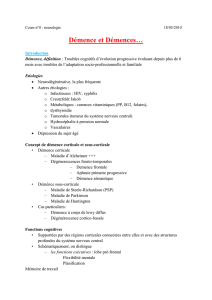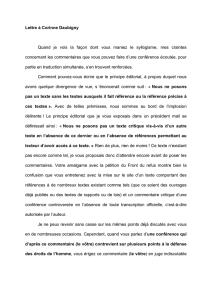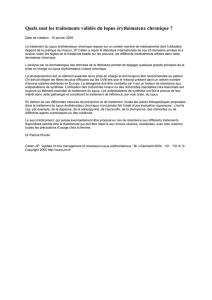■ Il n’y en a toujours que pour la carotide !

La Lettre du Neurologue - n° 1 - vol. VIII - janvier 2004 17
Il n’y en a toujours
que pour la carotide !
■
Et pourtant, l’artère vertébrale irrigue
aussi des structures cérébrales, certes
moins nobles, mais vitales ! Une seule
étude prospective publiée jusqu’alors pour
estimer le risque de récidive après un
premier accident ischémique vertébro-
basilaire (AICVB). Les autres : des abs-
tracts.
Dans cet article, les auteurs font la méta-
analyse de ces études (n = 43) représen-
tant 36 cohortes indépendantes ayant
inclus 12 196 patients plus les données de
5 études de patients individuels, totalisant
4 643 patients. Dans les études qui ont
inclus les patients dans les 7 jours suivant
le premier événement vertébro-basilaire,
le risque était augmenté de 47 % (1,47
[1,1-2,0] ; p = 0,014). Dans les études
de population, les patients qui avaient
un premier AICVB avaient un risque
d’AVC augmenté de 48 % (1,48 [1,1-2,0] ;
p = 0,025), avec un test d’hétérogénéité
négatif.
Commentaire. Cette analyse montre que
les patients qui ont un AICVB ne sont pas
à plus bas risque que ceux qui ont eu un
AIC carotidien, et que ce risque est pro-
bablement plus élevé que pour la carotide à
la phase aiguë. Comme le concluent les
auteurs, les AICVB nécessitent un traite-
ment préventif actif !
P. Amarenco,
centre d’ATAC
et service de neurologie,
hôpital Bichat, Paris.
Encéphalopathie posté-
rieure
■
L’encéphalopathie postérieure, affec-
tion dont la physiopathologie est mal
connue, est caractérisée par des céphalées,
des troubles de la conscience, des crises et
des troubles visuels progressifs. En imagerie
par résonance magnétique, des lésions bila-
térales, corticales et sous-corticales pré-
dominant dans les régions postérieures sont
observées. Les auteurs rapportent 3 obser-
vations de patients présentant des signes
cliniques et des anomalies en imagerie carac-
téristiques d’une encéphalopathie posté-
rieure. La symptomatologie s’est manifestée
72 heures après une intoxication à la digi-
toxine (observation n° 1), 16 jours après un
accouchement (observation n° 2) et chez
une patiente traitée par corticoïdes pour une
maladie de Crohn (observation n° 3). Le bilan
d’imagerie a comporté une angiographie
digitalisée des 4 axes à destinée cérébrale et
des examens IRM comprenant des séquences
de diffusion avec cartographie ADC. Dans
les 3 observations, des zones d’hypersignal
pariéto-occipitales, cortico-sous-corticales
et symétriques ont été observées. La carto-
graphie ADC a révélé la valeur du coefficient
apparent de diffusion variable, traduisant la
présence d’œdèmes vasogénique et cyto-
toxique. En angiographie, un rétrécissement
diffus des artères intracrâniennes, légèrement
plus marqué dans la circulation postérieure,
a été noté. Sur les examens IRM de sur-
veillance, une nécrose laminaire corticale a été
observée alors que les lésions de substance
blanche étaient résolutives, à l’exception de
celles des territoires artériels de jonction.
Commentaire. Les observations rapportées
sont intéressantes à plusieurs titres : 1) elles
sont parfaitement documentées ; 2) pour la
première fois, semble-t-il, une intoxication
à la digitoxine est incriminée dans la sur-
venue d’une encéphalopathie postérieure ;
3) une encéphalopathie postérieure peut être
secondaire à un vasospasme particulière-
ment sévère.
J.F. Meder,
hôpital Sainte-Anne, Paris.
VRM pelvienne dans le
bilan d’un accident isché-
mique cérébral (AIC) ?
■
La fréquence des AIC d’origine indé-
terminée est d’environ 30 %. La pré-
sence d’une communication interauriculaire
est plus fréquente au cours des AIC d’origine
indéterminée ; l’hypothèse d’embolies para-
doxales d’origine veineuse envisagée depuis
longtemps n’a jamais été réellement étayée.
Quatre-vingt-quinze patients ayant eu un
accident ischémique cérébral ont eu une
veinographie par résonance magnétique du
bassin à la recherche d’une thrombose pel-
vienne dans les 72 heures après la survenue
d’un infarctus cérébral. Ces examens étaient
relus par deux radiologues spécialisés. Les
auteurs de cette étude rapportent une plus
grande fréquence de thrombose veineuse pel-
vienne chez les patients ayant eu un infarctus
cérébral de cause indéterminée. Cependant,
une échographie cardiaque ne fut réalisée que
chez 92 % des patients, et aucun bilan étendu
de l’hémostase ne fut obtenu chez 23 % des
patients (prot C, S, ATII, APL). Trente-neuf
pour cent des patients avaient un foramen
ovale perméable. Une plus grande fréquence
de thrombose veineuse pelvienne fut détectée
chez les patients ayant un accident ischémique
sans cause retrouvée (20 % versus 4 %).
Une différence aussi grande était retrouvée
en présence d’un foramen ovale perméable
(21 % versus 0 %), mais cette différence
n’atteignait pas le seuil statistique.
Commentaire. Les résultats de cette étude
suggèrent que des thromboses veineuses pro-
fondes pourraient expliquer certains AIC par
embolie paradoxale en présence d’une com-
munication interauriculaire. Ils doivent être
confirmés, car la définition de l’AIC crypto-
génique ou de cause indéterminée ne repo-
sait pas, dans cette étude, sur un bilan iden-
tique et complet chez tous les patients, et
des biais importants ont pu survenir lors de
l’inclusion, qui n’était pas contrôlée. Nous ne
pouvons non plus exclure que la présence
d’une thrombose veineuse profonde ne soit
que le reflet d’un état prothrombotique sans
rapport direct avec l’événement ischémique
au niveau cérébral.
H. Chabriat,
hôpital Lariboisière, Paris.
La protéine prion présente
dans la rate et les muscles
dans la maladie
de Creutzfeldt-Jakob
sporadique…
■
Dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob
sporadique, la protéine prion patho-
logique (la PrPSc) a été identifiée unique-
ment dans le système nerveux central et les
voies olfactives. Les auteurs ont utilisé une
méthode très sensible de détection par mesure
de la concentration de la PrPSc par précipi-
tation différentielle avec l’acide phospho-
tungstique sodique – multipliant la sensibilité
du Western-Blot par un facteur trois – dans
les organes de 36 patients atteints de maladie
de Creutzfeldt-Jakob sporadique. La PrPSc
REVUE DE PRESSE
Dirigée par le Pr P. Amarenco
✔
Floßmann E, Rothwell PM. Prognosis of verte-
brobasilar transient ischaemic attack and minor
stroke. Brain 2003 ; 126 : 1940-54.
✔
Weidauer S, Gaa J, Sitzer M et al. Posterior
encephalopathy with vasospasm : MRI and angio-
graphy. Neuroradiology 2003 ; 45 : 869-76.
✔
Cramer et al. Increase pelvic vein thrombi in
cryptogenic stroke. Results of the paradoxical
emboli from large veins in ischemic stroke
(PELVIS). Stroke 2004 ; 35 : 46-50.

La Lettre du Neurologue - n° 1 - vol. VIII - janvier 2004
18
REVUE DE PRESSE
était présente dans tous les cerveaux, 10 rates
sur 28 et 8 muscles sur 32. Trois patients
avaient la PrPSc à la fois dans la rate et les
muscles. Les patients ayant une localisation
extraneurologique de la PrPSc avaient une
évolution significativement plus longue.
Commentaire. Un tiers des patients atteints
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob spora-
dique ont de la PrPSc en dehors du système
nerveux central, avec une corrélation signi-
ficative à la durée d’évolution. La biopsie
musculaire pourrait servir d’outil diagnos-
tique, mais la sensibilité de la méthode reste
insuffisante. Même si le taux de la PrPSc
dans la rate et les muscles est très faible,
des mesures de prévention en chirurgie,
voire en EMG, pourraient s’avérer néces-
saires si cette donnée se confirmait.
D. Dimitri,
GH Pitié-Salpêtrière, Paris.
… et dans le système ner-
veux sympathique dans le
nouveau variant de la
maladie
de Creutzfeldt-Jakob
■
Le lien entre l’encéphalopathie spon-
giforme bovine et le nouveau variant de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob a eté établi
sur des bases épidémiologiques et grâce à
l’identification de la même souche de prion
dans les deux maladies. Cependant, les
mécanismes de neuro-invasion du prion
après ingestion orale sont inconnus chez
l’homme. Les auteurs ont étudié l’expres-
sion de la PrPSc par immunohistochimie dans
les ganglions sympathiques de 3 patients
décédés du nouveau variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (2 hommes de 29 et
35 ans et une femme de 36 ans), de 2 patients
décédés de maladie de Creutzfeldt-Jakob
sporadique et d’un patient décédé d’une
maladie de Creutzfeldt-Jakob iatrogène. La
PrPSc était exprimée dans les neurones sym-
pathiques des ganglions mésentériques supé-
rieurs, cœliaques et stellaires des 3 patients
atteints de nvMCJ et non chez les 3 patients
contrôles.
Commentaire. Cette étude confirme le rôle
du système nerveux autonome dans la neuro-
invasion par le prion, suspecté et établi chez
l’animal mais jamais prouvé jusque-là chez
l’homme.
DD
Le lupus est-il un facteur
de risque cardiovasculaire ?
■
L’étude cas-témoins de Roman et al.
portant sur 197 patients lupiques et
197 contrôles a comporté un écho-doppler
carotidien, une échographie cardiaque et
la recherche de facteurs cardiovasculaires.
Ceux-ci étaient similaires entre les lupiques
et les contrôles. L’athérosclérose mesurée
par la présence de plaque carotidienne était
plus fréquente chez les lupiques (37,1 %
versus 15,2 %, p < 0,001). En analyse multi-
variée, seuls l’âge, la présence de lupus (odds-
ratio à 4,8 ; IC de 2,6 à 8,7) et une cholestéro-
lémie élevée étaient liés de façon indépen-
dante à la présence de plaque. En analyse
multivariée chez les lupiques, les facteurs
prédictifs indépendants de la présence de
plaque étaient une durée d’évolution plus
longue, un score de sévérité du lupus plus
important, une incidence moins élevée du
traitement par prednisone, hydroxychloro-
quine et cyclophosphamide, et l’absence
d’anticorps anti-Smith et d’anticorps anti-
cardiolipides. Asanuma et al. ont recherché
des calcifications coronariennes par tomogra-
phie à faisceau d’électrons chez 65 lupiques
et 60 contrôles appariés sur l’âge, le sexe et la
race. Les calcifications coronariennes étaient
plus fréquentes chez les lupiques (20 sur 65,
31 %) que chez les contrôles (6 sur 69,9 %)
(p = 0,002). La sévérité des calcifications
était significativement plus importante chez
les lupiques. L’hypertension artérielle était
significativement plus fréquente chez les
lupiques, et le taux de triglycérides et d’homo-
cystéine significativement plus élevé par
rapport aux contrôles ; le taux de cholestérol
total, LDL- et HDL-cholestérol ne différait pas
entre les 2 groupes. L’odds-ratio pour le risque
d’avoir des calcifications des coronaires chez
les lupiques par rapport aux contrôles était de
9,8 (p = 0,001) après ajustement sur l’âge, le
sexe, le nombre de paquets-années, la présence
ou non d’une hypertension artérielle, les taux
de triglycérides et d’homocystéine. Chez les
lupiques, les patients ayant des calcifications
étaient plus âgés (p < 0,001) et de sexe mas-
culin (p = 0,008) par rapport aux lupiques
n’ayant pas de calcifications, mais le score de
sévérité du lupus était similaire dans les deux
groupes. Il n’y avait pas de différence signi-
ficative quant à l’utilisation de corticoïdes.
Commentaire. Ces deux études suggèrent que
le lupus est un facteur indépendant d’athéro-
sclérose précoce. Les femmes lupiques ont un
risque relatif d’athérosclérose de 5 par rapport
à la population générale et de 50 pour les
lupiques de moins de 45 ans. Dans les deux
études, les marqueurs d’athérosclérose étaient
positifs pour 31 à 37 % des patients, contre
9 à 15 % des contrôles, avec une prévalence
de près de 33 % chez les lupiques âgés de
moins de 50 ans. Les corticoïdes au long
cours n’augmentaient pas le risque, voire le
diminuaient, suggérant un effet anti-inflam-
matoire protecteur. Les mécanismes d’athéro-
genèse restent inconnus dans le lupus, mais
l’inflammation est incriminée, comme elle
l’est d’ailleurs dans l’athérosclérose dans la
population générale. Des études longitu-
dinales avec des marqueurs de l’inflamma-
tion sont nécessaires pour établir cette
relation entre l’inflammation et l’athéro-
sclérose dans le lupus.
DD
L’écoute du patient
■
Cette étude clinique a étudié la perti-
nence et la valeur spécifique des données
anamnestiques pour poser le diagnostic
d’épilepsie du lobe temporal. Quatre-vingt-
huit patients en cours d’évaluation pré-
chirurgicale pour une épilepsie pharmaco-
résistante du lobe temporal ont été pros-
pectivement inclus dans cette étude. Lors de
l’EEG-vidéo, il a été demandé aux patients
de tenir un calendrier détaillé et descriptif de
la survenue de tout élément clinique jugé
anormal. Ces données purement descrip-
tives émanant du patient ont été soumises à
deux épileptologues en double aveugle, qui
devaient décider, selon la description, s’il
s’agissait ou non d’événements épileptiques
et, si oui, les classer selon la classification
internationale des crises. L’enregistrement
concomitant en EEG-vidéo permettait la
classification définitive des malaises et ser-
vait de gold-standard. Sur la seule descrip-
tion des crises, 94 % des malaises ont été
correctement identifiés. Dans l’ensemble,
les épileptologues se trompaient rarement
sur l’identification des crises comitiales
(sensibilité de 96 %), mais avaient tendance
à étiqueter “comitial” des événements qui
ne l’étaient pas (spécificité de 50 %). La
classification des crises en crises partielles
complexes ou généralisées secondairement
était correcte dans tous les cas.
Commentaire. L’anamnèse du patient et
Dirigée par le Pr P. Amarenco
✔
Glatzel M, Abela E, Marisse M et al. Extraneural
pathologic prion protein in sporadic Creutzfeldt-
Jakob disease. N Engl J Med 2003 ; 349 : 1812-20.
✔
Haïk S, Faucheux BA, Sazdovitch V et al. The
sympathic nervous system is involved in variant
Creutzfeldt-Jakob disease. Nature Med 2003 ; 9 :
1121-3.
✔
Roam MJ, Shanker BA, Davis A. Prevalence and
correlates of accelerated atherosclerosis in systemic
lupus erythematosus. N Engl J Med 2003 ; 349 :
2399-406.
✔
Asanuma Y, Oeser A, Shintani AK et al. Premature
coronary-artery atherosclerosis in systemic lupus
erythematosus. N Engl J Med 2003 ; 349 : 2407-15.
✔
Hahn BV. Systemic lupus erythematosus and
accelerated atherosclerosis. N Engl J Med 2003 ;
349 : 2379-80.

La Lettre du Neurologue - n° 1 - vol. VIII - janvier 2004 19
de son entourage est l’un des éléments les
plus déterminants d’une consultation d’épi-
leptologie. Cette étude montre à quel point ce
premier temps est crucial et permet le plus
souvent de poser un diagnostic adéquat (tout
à la fois de l’épilepsie et de sa localisation).
Néanmoins, les épileptologues ont parfois
tendance à “surdiagnostiquer” l’épilepsie.
L’EEG-vidéo représente alors l’élément clé
pour authentifier le caractère comitial des
malaises décrits par les patients.
S. Dupont, unité d’épileptologie,
GH Pitié-Salpêtrière, Paris.
La gabapentine
(Neurontin®) dans le trai-
tement
des céphalées chroniques
quotidiennes (CCQ)
■
Un groupe australien a étudié la gaba-
pentine dans le traitement des CCQ via
un essai multicentrique en double-insu contre
placebo avec cross-over. Le critère principal
d’efficacité était le pourcentage de jours sans
mal de tête sur chacune des périodes étudiées.
Il s’agissait de 133 patients (41 hommes,
92 femmes) âgés en moyenne de 43 ans et
souffrant tous depuis au moins 6 mois, et plus
de 15 jours par mois, durant plus de 4 heures
à chaque fois (migraine 25 %, céphalée de
tension 21 %, combinaison des 2 : 65 %). Un
des critères importants d’exclusion était l’abus
de dérivés de l’ergot ou de triptans. Chaque
période (gabapentine jusque 2 400 mg ou
placebo séparés par une période de 7 jours
de washout) comportait 2 semaines de titra-
tion et 6 semaines de prise régulière. Sur les
95 patients évaluables, la proportion de jour-
nées sans mal de tête était de 10 % avant
randomisation, de 17,5 % sous placebo et de
26,6 % sous gabapentine (p = 0,0005). La
gabapentine se révélait également efficace
sur le nombre de jours sans mal de tête, la
sévérité, les symptômes associés (nausées),
le handicap en général et la qualité de vie.
Commentaire. Cet essai a le mérite d’attester
de l’efficacité de la gabapentine à 2 400 mg
dans cette situation si courante des céphalées
chroniques, et de justifier son utilisation –
certes hors AMM – dans cette indication.
Soulignons néanmoins le coût (120 €/mois),
l’efficacité relative (– 9 % de journées sans
mal de tête), qui doit rendre modeste dans les
espoirs thérapeutiques, et la fréquence des
effets secondaires de la gabapentine (vertiges
21 % versus 5 %, somnolence 18 % versus
5 %), conforme à ce qui est observé habi-
tuellement avec cette molécule. Voici donc
un traitement de plus dans notre arsenal théra-
peutique, lequel, fort disparate, contient à la
fois plusieurs molécules (amitryptiline, clona-
zépam, valproate, IRS, etc.), une bonne dose
d’empathie, de patience et d’accompagne-
ment psychologique, et les diverses méthodes
de relaxation corporelle.
J. d’Anglejan-Chatillon, Versailles.
Stimulation sous-thala-
mique dans la maladie de
Parkinson.
Résultats à distance
■
Il s’agit de l’expérience grenobloise
en matière de stimulation bilatérale à
haute fréquence du noyau subthalamique
chez 49 patients atteints de maladie de Par-
kinson dopa-sensible, tous choisis, opérés et
suivis dans le même centre. Les évaluations
cliniques ont été réalisées chez tous les
patients avec et sans médicaments à inter-
valles réguliers en utilisant des échelles
validées et standardisées permettant une
comparaison au fil du temps. Seuls sept
patients ont été perdus de vue, dont trois sont
décédés (un suicide). Les résultats montrent
qu’à cinq ans, la stimulation sans médica-
ments supprime les dyskinésies, améliore
de 54 % les scores moteurs et de 49 % les
échelles de qualité de vie. Cependant, les
signes axiaux (troubles de la voix et postu-
raux) s’aggravent progressivement à un an
et à cinq ans, ce qui plaide pour l’aggrava-
tion de la maladie. Le traitement médica-
menteux n’est pas plus actif sur ces symp-
tômes. En ce qui concerne le déclin cognitif,
qui est présent pour un petit nombre de
patients (trois), la stimulation, comme les
médicaments, ne le prévient pas et il est
probable qu’il s’agisse de patients atteints
d’une maladie un peu différente. Sur le plan
psychiatrique, les scores de dépression sont
stables. En conclusion, l’amélioration des
symptômes parkinsoniens secondaires à
la stimulation subthalamique bilatérale se
maintient cinq ans après l’intervention.
Cependant, la maladie continue d’évoluer.
Commentaire. Il s’agit de la première
grande série publiée, évaluée pendant 5 ans
sérieusement, mais sans groupe contrôle.
Cet article confirme l’impression que la
stimulation du noyau subthalamique est
aussi efficace que la L-dopathérapie, mais
dépourvue de ses complications motrices.
Cependant, elle n’empêche pas l’évolution
de la maladie, avec l’installation de signes
témoignant d’une atteinte des systèmes non
dopaminergiques.
C. Karachi, service de neurochirurgie,
GH de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
L’encéphalite léthargique :
une maladie auto-immune
des ganglions de la base ?
■
En 1917, von Economo a décrit l’en-
céphalite léthargique (EL), touchant
le mésencéphale et les ganglions de la base,
s’installant de façon subaiguë après une
pharyngite. L’épidémie dévastatrice euro-
péenne d’EL (1916-1927) a été contempo-
raine de la pandémie de grippe du virus
influenza en 1918, et les deux maladies ont
été rapprochées. Cependant, on n’a pas pu
retrouver, dans le cerveau de malades atteints
de l’EL historique, de traces de l’ARN du
virus d’influenza de la pandémie de 1918.
En revanche, une réponse immunitaire sous
forme de bandes oligoclonales intrathécales
a été rapportée dans des formes sporadiques,
et certains malades ont été améliorés sous
traitement par corticoïdes, ce qui a suscité
l’hypothèse d’une maladie auto-immune.
Récemment, une équipe anglaise a examiné,
en trois ans, 20 malades de 2 à 69 ans, la
majorité étant des enfants ou de jeunes
adultes présentant un syndrome d’encé-
phalite léthargique, précédé d’une pharyn-
gite pour 55 % d’entre eux. Le phénotype
était similaire à celui de l’EL historique :
troubles du sommeil (somnolence, inversion
du rythme du sommeil, insomnie), léthargie,
syndrome parkinsonien, dyskinésies et symp-
tômes neuropsychiatriques. Un malade est
décédé et quatre ont dû être ventilés (et
seraient probablement décédés à l’époque
de l’épidémie historique, qui avait une mor-
talité de 20 à 40 %). Cinq malades ont bien
récupéré ; les autres ont gardé des séquelles.
L’analyse du LCR révélait des bandes oligo-
clonales chez 70 % des malades. Une encé-
phalite virale et les autres causes de syn-
drome parkinsonien d’installation aiguë ont
été exclues. L’IRM cérébrale montrait des
signes inflammatoires au niveau des gan-
glions de la base dans 40 % des cas. Les
titres antistreptolysine O étaient élevés chez
65 % des malades. Quatre-vingt-quinze pour
cent des malades avaient des anticorps contre
des antigènes des ganglions de la base contre
2 à 4 % dans une population contrôle.
Les auteurs concluent que l’EL doit tou-
jours faire partie du diagnostic différentiel
en neurologie, et suggèrent qu’il s’agit
✔
Deacon C, Wiebe S, Blume WT et al. Seizure
identification by clinical description in temporal
lobe epilepsy : how accurate are we ? Neurology
2003 ; 61 (12) : 1686-9.
✔
Spira PJ et al. Neurology 2003 ; 61 : 1753-9.
✔
Krack P et al. Five-year follow-up of bilateral sti-
mulation of the subthalamic nucleus in advanced
Parkinson’s disease. N Engl J Med 2003 ; 349 (20) :
1925-34.

La Lettre du Neurologue - n° 1 - vol. VIII - janvier 2004
20
REVUE DE PRESSE
d’une maladie auto-immune postinfec-
tieuse comme la chorée de Sydenham ou le
PANDAS.
Commentaire. Si cette épidémie récidivait
actuellement, comment s’adapteraient les
services d’urgence ?
P. Krack, département de neurologie,
CHU de Grenoble.
Stenting pour les dissec-
tions carotides : une nou-
velle thérapeutique en cas
d’aggravation sous hépari-
nothérapie ?
■
La prise en charge thérapeutique des
dissections carotides repose sur l’anti-
coagulation dans la plupart des centres, même
si cette thérapeutique n’a pas été évaluée par
des études randomisées. L’aggravation de
patients sous traitement anticoagulant a
conduit certaines équipes à proposer un trai-
tement endovasculaire en cas de retentisse-
ment hémodynamique d’aval ou d’accidents
thromboemboliques récidivants. Cohen et
al. rapportent 3 cas de stenting à la phase
aiguë de dissections carotides spontanées,
chez des patients dont le déficit neurologique
s’est aggravé ou a récidivé sous traitement
anticoagulant. Les explorations neuroradio-
logiques effectuées chez ces patients ont
montré une hypoperfusion significative ou
une large pénombre documentées par un
mismatch en IRM de diffusion/perfusion
et/ou par des arguments angiographiques
d’ischémie lors de la parenchymographie.
Dans tous les cas, l’angiographie a mis en
évidence une sténose de la lumière artérielle
de 99 %. La mise en place d’un stent, réalisée
de quelques heures jusqu’à 2 semaines après
le début de la symptomatologie, a permis
de normaliser le diamètre luminal et de
régulariser l’hémodynamique d’aval. Les
suites ont été favorables, sans complications
pendant et au décours de la procédure.
Commentaire. Pour les patients qui ont
une dissection carotide et qui s’aggravent
sous traitement anticoagulant, le traitement
endovasculaire représente une opportunité
thérapeutique dans un contexte où le traite-
ment médical atteint ses limites. Cette théra-
peutique endovasculaire, qui doit être éva-
luée, ne devrait concerner qu’une faible
proportion des patients avec une dissection
carotide.
M. Mazighi,
service de neuroradiologie interventionnelle,
hôpital Lariboisière, Paris.
Angioplastie intracrâ-
nienne, la population cible
reste à définir…
■
En fonction des populations étudiées,
l’athérosclérose intracrânienne est
responsable de 10 à 29 % des infarctus
cérébraux (IC). Alors qu’il n’existe pas, à
l’heure actuelle, de consensus sur la prise en
charge thérapeutique des sténoses athéro-
scléreuses intracrâniennes, le traitement
endovasculaire de ces lésions, dont la
faisabilité a été rapportée sur de petites
séries, est de plus en plus pratiqué. Gupta
et al. rapportent l’expérience d’un centre
sur des patients hospitalisés pour des IC
mineurs et instables neurologiquement.
Cette étude rétrospective a été réalisée, entre
1997 et 2002, sur 18 patients (21 lésions
intracrâniennes) dont la pathologie a réci-
divé sous traitement médical maximal
(anticoagulant ± antiagrégant plaquettaire).
Les lésions athéroscléreuses traitées ont
été : l’artère carotide interne distale (n = 8),
l’artère cérébrale moyenne (n = 6), l’artère
vertébrale intracrânienne (n = 4) et le tronc
basilaire (n = 3). La restitution de la lumière
artérielle a été complète dans 5 cas et par-
tielle dans 14 cas. Pour un patient, la sté-
nose n’a pu être franchie, et, dans un autre
cas, l’angioplastie s’est compliquée d’une
occlusion artérielle. Au total, 28 % des
patients ont eu une complication liée à la
procédure sous la forme d’un accident vas-
culaire cérébral majeur (IC invalidant :
11 % ; hémorragie cérébrale : 16,6 %), avec
une mortalité globale de 17 %. Dans 22 %
des cas, une hémorragie extracrânienne
majeure (nécessitant une transfusion) a été
observée.
Commentaire. Dans cette série, le taux de
complications est plus important que dans
la littérature, mais illustre bien le fait que
l’angioplastie des artères intradurales est
une procédure à haut risque. Ce traitement
endovasculaire n’est à proposer qu’aux
patients symptomatiques à risque élevé, et
les patients asymptomatiques ne devraient
pas être traités en dehors d’études rando-
misées.
MM
Dirigée par le Pr P. Amarenco
✔
Dale RC et al. Encephalitis lethargica syndrome :
20 new cases and evidence of basal ganglia auto-
immunity. Brain 2004 ; 127 : 21-33.
✔
Cohen JE et al. Emergent stenting to treat
patients with carotid artery dissection – Clinically
and radiologically-directed therapeutic decision
making. Stroke 2003 ; 34 : e254-e257.
✔
Gupta R et al. Urgent endovascular revasculari-
zation for symptomatic intracranial atherosclerotic
stenosis. Neurology 2003 ; 61 : 1729-35.
Claudie Damour -Terrasson, entourée de son équipe, vous présente ses vœux les plus sincères
Groupe de presse et d’édition santé
pour une nouvelle année 2004
NOUS FAISONS DE VOS SPÉC IALITÉS NOTRE SPÉCIALITÉ
●Les Lettres
et leurs suppléments
Les Actualités
●Les Correspondances
●Les Courriers
●Professions Santé
●Les Pages de la Pratique Médicale
1
/
4
100%