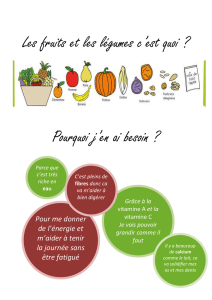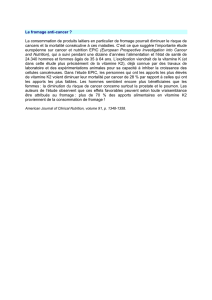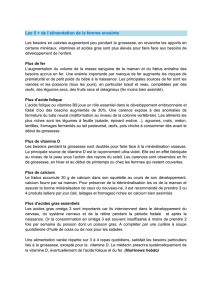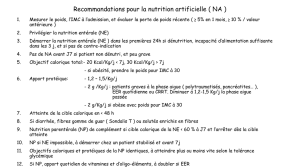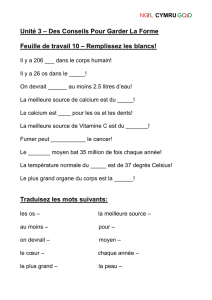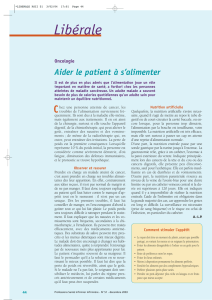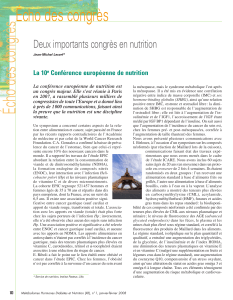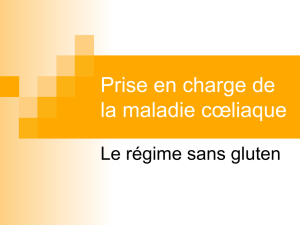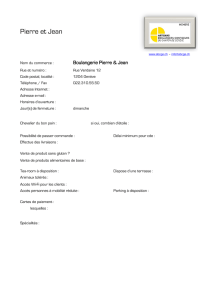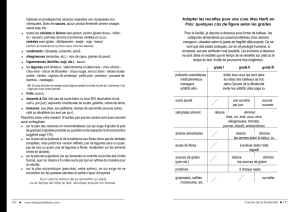L Maladie cœliaque et dermatite herpétiforme : intolérance au gluten

Le gluten est une protéine de réserve contenue
dans certaines céréales : blé, seigle, avoine,
orge, épeautre.
La maladie cœliaque
La maladie cœliaque est une malabsorption in-
testinale liée au gluten. Elle concerne de façon
plus spécifique l’une des fractions protéiques du
gluten, la gliadine. De type allergique, la réponse
conduit à une atrophie des villosités intestinales
situées sur les parois de l’intestin grêle. Elle s’ac-
compagne de diarrhées, douleurs abdominales,
amaigrissement, anorexie, anémie, etc.
La maladie cœliaque peut se manifester à tout
âge, chez le jeune enfant, l’adolescent comme
l’adulte. En France, elle concerne une personne
sur 1 500.
Il n’existe aucun traitement médicamenteux. Le
seul traitement de la maladie cœliaque consiste
à suivre un régime strict sans gluten.
La dermatite herpétiforme
Souvent associée à l’intolérance au gluten, la
dermatite herpétiforme se traduit par une érup-
tion cutanée chronique due à une maladie in-
flammatoire de la peau. Elle provoque de vives
démangeaisons, ainsi qu’une altération de la
muqueuse intestinale.
Au traitement médicamenteux de la dermatite
est associé un régime d’exclusion du gluten.
Le régime sans gluten
Un régime sans gluten doit être suivi de façon
stricte. Le respect de ce régime pose des difficul-
tés, surtout dans les crèches, cantines et restau-
rants. L’Afdiag (voir encadré) publie une liste des
produits sans gluten. En effet, celui-ci peut être
présent sous forme directe (farine, chapelure...) ou
masquée (amidon, amidon modifié, produits
amylacés).
M.B.
Maladie cœliaque et dermatite
herpétiforme : intolérance au gluten
25
Mangez du poisson
En suivant pendant 30 ans plus de 2 000 hommes âgés de 40 à 55 ans, des médecins américains sont arrivés
à la conclusion qu’il existe une association entre consommation de poissons et diminution de la mortalité car-
diovasculaire (étude publiée dans le New England Journal of Medicine, 10 avril 1997). La diminution porte sur-
tout sur les morts non subites par infarctus du myocarde.
Les personnes suivies étaient des employés d’une entreprise en électricité de Chicago, avec une
majorité de “cols bleus”. Les auteurs de l’étude ont réparti les hommes en fonction de leur consommation de
poisson (0,1 à 17 g/jour, 18 à 34 g/jour et plus de 38 grammes par jour en moyenne). Sur les 430 décès par
maladie cardiovasculaire observés pendant les trente ans de l’étude, 293 étaient dus à des infarctus, dont 196
étaient des morts subites. La relation inverse entre consommation de poisson et ces risques est spécialement
nette pour les morts non subites, avec une diminution de 70 %. La relation est “dose-dépendante” : les gros
mangeurs de poisson sont plus “protégés”. Des résultats qui concordent avec ceux de plusieurs études
précédentes.
M.B.
L'Association française
des intolérants au gluten
L'Association française des intolérants au gluten
(Afdiag) a pris le relais, en 1989, de l'Association
des malades cœliaques, créée en 1978. L'Afdiag
édite Afdiag Info, un bulletin d'information trimes-
triel. Des bénévoles de l'Afdiag contactent les fa-
bricants de produits alimentaires afin de savoir si
les ingrédients entrant dans leur composition
contiennent ou non du gluten. Ces renseigne-
ments sont consignés tous les deux ans dans leur
liste des produits sans gluten vendus dans le com-
merce. Ils publient aussi une liste des médicaments
contenant du gluten.
L'association organise des ateliers de cuisine, des
séjours sportifs pour les adolescents, et des ré-
unions régionales d'information.

Cité
des Sciences
et de l’Industrie
La Villette
Paris
21-22 novembre 2000
21-22 novembre 2000
“Ensemble,
donnons
du sens au soin”
10es
10es
“Ensemble,
donnons
du sens au soin”

Mardi 21 novembre
CANCÉROLOGIE
CLa recherche
et l’actualité thérapeutique
CA1 Les plaies cancéreuses
CA2 Les soins palliatifs
CA3 La prise en charge à domicile
CA4 La qualité de vie et la douleur
NEUROLOGIE
NLa recherche
et l’actualité thérapeutique
NA1 La sclérose en plaques
NA2 La maladie de Parkinson
NA3 L’hygiène et la prise en charge
des blessés médullaires
(pansements, incontinence...)
NA4 L’Alzheimer
BLOC
BLes différents axes
de la chirurgie
BA1 L’hygiène et la stérilisation
BA2 L’anesthésie
BA3 La douleur postopératoire
BA4 Les dispositifs et le matériel
RESPONSABILITÉ
RL’évolution de la responsabilité
est-elle compatible avec les risques
nécessaires à la pratique soignante ?
RA1 La surveillance du malade
et le respect de ses libertés
RA2 La gestion de l’écrit
dans la pratique soignante
RA3 Les droits de l’enfant
RA4 L’information préalable
et le consentement
Mercredi 22 novembre
GÉRIATRIE
GLa prise en charge
de la personne âgée
(à domicile, handicap, démence...)
GA1 Les droits des personnes âgées
GA2 La violence en institution
GA3 La nutrition
GA4 L’hygiène et la qualité de vie
DOULEUR
DLes différentes perceptions
de la douleur selon que l’on soit
soignant ou soigné
DA1 La douleur de l’enfant
DA2 La douleur en rhumatologie
DA3 La douleur dans le soin des plaies
DA4 La douleur chez le brûlé
PSYCHIATRIE
PLes nouvelles orientations
des soins
PA1 Les soins dans l’urgence
PA2 La précarité et l’exclusion
PA3 Les violences subies par l’enfant
PA4 Faire face à l’agression
ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
EComment le “social” a transformé
la prise en charge du patient
EA1 L’avenir de la profession libérale
EA2 Vers une spécialisation des soins
EA3 Pourquoi appartenir à un réseau ?
EA4 Les nouvelles technologies
au service des soignants
Une formation complète
pour une application immédiate au quotidien
Pré-programme
Chaque journée est conçue en deux sessions distinctes et complémentaires :
LE MATIN : la conférence plénière pour une formation scientifique
“la recherche, l’actualité thérapeutique, les pratiques de soins...”
et aussi “les nouvelles orientations de la profession...”
L’APRÈS-MIDI : les ateliers pratiques sur les soins quotidiens.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Droit d’inscription
1 jour 2 jours
Établissement : 110 F (90 F) 200 F (160 F)
Individuel : 60 F (50 F) 100 F (80 F)
Je suis : abonné à Professions Santé infirmier-infirmière
ou salarié APHP : 40 F (30 F) 60 F (50 F)
Étudiant : 1 jour offert 60 F (50 F)
Inscription avant le 30 juin 2000 : prix rouges
MODE DE PAIEMENT
❑
par virement bancaire à réception de facture
(réservé aux établissements, merci de nous adresser un bon de commande)
❑
par chèque (à l’ordre de CDTM Éditions)
❑
par carte Visa, No
Eurocard Mastercard
Date d’expiration
:
Signature :
✁
A retourner à
CDTM Éditions, 62-64, rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 45
Matin
LES CONFÉRENCES
1conférence au choix
Après-midi
LES ATELIERS
DE FORMATION
2 ateliers au choix*
Mardi 21 novembre
La conférence Les ateliers
□
C
Cancérologie :
□
CA1
□
CA2
□
CA3
□
CA4
□
N
Neurologie :
□
NA1
□
NA2
□
NA3
□
NA4
□
B
Bloc :
□
BA1
□
BA2
□
BA3
□
BA4
□
R
Responsabilité :
□
RA1
□
RA2
□
RA3
□
RA4
Mercredi 22 novembre
□
G
Gériatrie :
□
GA1
□
GA2
□
GA3
□
GA4
□
D
Douleur :
□
DA1
□
DA2
□
DA3
□
DA4
□
P
Psychiatrie :
□
PA1
□
PA2
□
PA3
□
PA4
□
E
Évolution professionnelle :
□
EA1
□
EA2
□
EA3
□
EA4
Cochez par ordre de préférence de à
les ateliers auxquels vous souhaitez assister.
* Nous tenterons de respecter vos choix d’ateliers en fonction des impératifs horaires et du nombre limité de places.
41
M., Mme, Mlle : Prénom : Pratique :
□
hospitalière
□
libérale
□
autres :
Adresse : Code postal :
Ville : Tél. : Fax :

28
Nutrition
L’éducation du patient en diabétologie constitue un soin à part
entière. Elle requiert du temps pour les soignants et des moyens
pédagogiques. Cette éducation s’inscrit dans un projet
multipartenarial, établi par l’équipe médicale et paramédicale.
Diabète : éduquer le patient
L’ éducation du diabétique fait partie inté-
grante de l’ensemble des soins infirmiers.
Lors de la “formation initiale” du patient comme
lors du suivi, les explications données par l’in-
firmière répondront à ses besoins en termes de
matériel, de conseils ou d’éducation, etc. Le
suivi éducatif, en évaluant les acquis, permet de
compléter l’éducation et de corriger les erreurs.
L’avis d’un médecin ou d’un diététicien peut être
demandé.
Ainsi, des services hospitaliers proposent aux
patients de réaliser des exercices diététiques pra-
tiques. Certains leur donnent l’occasion de “s’en-
traîner” en ayant la possibilité de se servir, selon
leurs goûts, à un buffet tenant compte des indi-
cations de leur régime.
Dans certaines structures hospitalières recevant
des patients diabétiques, c’est un “infirmier édu-
cateur”, spécialisé dans ce domaine, qui est res-
ponsable de l’éducation du diabétique, déchar-
geant d’autant, mais aussi dépossédant un peu
l’équipe de cette tâche. Détaché de l’équipe, il in-
tervient en salle et en consultation, et participe
au programme d’enseignement (ateliers, infor-
mations). Il assure cette consultation infirmière
spécialisée et peut en outre intervenir à la de-
mande d’un autre service. Des discussions plu-
ridisciplinaires, au sein de l’équipe médicale et
paramédicale, permettent de préciser les objec-
tifs à atteindre pour chaque patient, ainsi que les
stratégies à utiliser et les difficultés rencontrées.
L’infirmier éducateur assure la transmission des
actions de soins sur le dossier de soins et sur la
fiche d’évaluation à l’infirmière concernée.
Mais le rôle crucial de l’alimentation du diabé-
tique ne saurait être lié au seul hôpital. Si le dia-
bète touche environ un million de personnes en
France, la prise en charge de 91% de ces patients
est assurée par le généraliste. Dans un rapport
remis en 1998 à Martine Aubry et Bernard
Kouchner, un groupe de travail animé par le
Dr Gilles Errieau proposait, pour l’éducation des
patients, la création de “conservatoires de santé”
dans les communes ou les chefs-lieux de canton,
afin d’accueillir en un même lieu éducateurs, as-
sistantes sociales, infirmières, psychologues et
médecins généralistes. Ce projet devait repré-
senter une “rupture de la logique hospitalo-cen-
trée” qui demeure “prééminente”. Ces conserva-
toires ne devaient pas être des structures de
soins. Il convenait au contraire de créer des lieux
capables d’accueillir les demandes précises des
patients, d’offrir une écoute et une réponse non
limitées aux objectifs de soins. Une utopie qui ne
s’est pas encore vraiment incarnée...
M.B.
Modes de suivi
Le suivi éducatif peut s’exercer :
•lors d’une réhospitalisation, en tenant compte des
besoins, des attentes et des difficultés du patient, de
ses résistances et de ses incompréhensions ;
•en unité traditionnelle ;
•en unité de semaine :
–pour un bilan annuel avec reprise d’éducation,
–lors d’un “accident de parcours”,
–pour une mise à l’insuline après échec du traite-
ment per os ou associé ;
•en consultation infirmière pour les patients externes :
–à distance d’une réhospitalisation,
–sur rendez-vous, sur place ou par téléphone.
La formation du patient
Une formation du patient à la maîtrise de son ali-
mentation doit lui apporter des connaissances sur :
–la composition des aliments courants, en particu-
lier leur teneur en hydrates de carbone ;
–l'impact de l'alimentation sur la glycémie ;
–la nécessité de répartir les ingesta tout au long de
la journée ;
–l'importance d’une alimentation équilibrée ;
–la définition d’une calorie, les propriétés des
graisses et des alcools ;
–l’aptitude à lire la composition des produits ali-
mentaires à travers les indications mentionnées sur
les étiquettes.

Un VIH entraînant de nombreux symptômes,
le mode nutritionnel semble, soit avoir des
répercussions sur ces manifestations, soit être à
l’origine des facteurs aggravants.
De plus, les médicaments anti-VIH agiraient
aussi sur le statut nutritionnel des patients. Mal
exploré par les scientifiques, ce phénomène
reste non expliqué à ce jour. Ainsi, quand les
patients séropositifs débutent une trithérapie
avec une antiprotéase, dans 65 à 70 % des cas,
les modifications corporelles se traduisent par
une prise de poids ou des transformations de
type augmentation des graisses abdominales,
perte de la graisse des jambes, émaciation du vi-
sage). Ces phénomènes, faute d’études, restent
inexpliqués. Par ailleurs, certains médicaments
(AZT, Videx®) peuvent avoir des effets secon-
daires (nausées, vomissements, diarrhées) plus
ou moins fréquents, retentissant sur l’appétit.
Cependant, la nutrition est devenue un élément
clé de la prise en charge globale du patient infecté
par le VIH. Pour la première fois, un consensus
médical et scientifique insiste sur le lien entre nu-
trition et entretien, voire amélioration, de l’immu-
nité et de l’état général des personnes infectées.
La personne séropositive est confrontée à de
nouvelles exigences alimentaires qu’elle ne peut
toujours comprendre et gérer seule. Une prise en
charge diététique précoce permet de corriger ou
de prévenir la dégradation rapide de l’état nutri-
tionnel des patients. Elle peut aider à ne pas ag-
graver le phénomène d’accumulation de graisses
de réserve.
À l’hôpital
Les premières prises en charge diététiques
des patients VIH ont été effectuées en secteur
hospitalier. Mais, aujourd’hui encore, malgré la
qualité de leur travail, on manque de diététi-
ciens dans les hôpitaux. Il y existe en outre
une forte inadéquation entre le bilan alimen-
taire et les conseils diététiques aux patients
VIH, d’une part, et ce qui arrive sur les plateaux
d’autre part.
Des associations comme AIDES ont souligné
qu’à l’hôpital l’alimentation posait des pro-
blèmes de perte de poids réels. Les premiers ré-
sultats positifs en matière d’alimentation des pa-
tients VIH sont venus des médecins et des
soignants. Des micro-ondes et des réfrigérateurs
ont été rendus accessibles aux patients dans les
services. Il a ainsi été possible de favoriser le
fractionnement des repas. On a même vu la
mise en place de tables de nuit réfrigérantes
pour les patients.
Il faut insister sur la convivialité, autant que sur
la qualité du repas lui-même. A l’hôpital, par
exemple, de nombreux patients fatigués ou dé-
pendants mangent dans leur chambre, seuls.
Les services VIH, à Paris, ne comptent pas de
coins repas permettant de faire manger dix per-
sonnes. Cette situation a conduit les volontaires
d’AIDES à modifier les horaires de leurs perma-
nences à l’hôpital, afin qu’ils rendent visite aux
patients davantage à l’heure des repas. Les asso-
ciations de patients soulignent que cette soli-
tude et ses conséquences en termes de prise ali-
mentaire ne relèvent pas de la mauvaise volonté
des infirmières ou des aides-soignantes, mais
d’un problème de surcharge des services VIH
alors que ce sont des services lourds.
L’existence d’un coin repas dans les services fait
partie des recommandations du rapport Guir-
gand sur l’alimentation à l’hôpital, rendu public
lors de la IIeConférence internationale “Nutri-
tion et VIH” de Cannes, en 1997. Des services
comme celui de l’hôpital Notre-Dame du Per-
pétuel Secours, à Levallois, ont utilisé une part
du couloir pour mettre quelques tables et effec-
tuer un service comme à l’hôtel, avec un menu
écrit sur une carte, même si la nourriture y est
préparée comme dans la plupart des établisse-
ments hospitaliers.
M.B.
VIH
Des besoins spécifiques
Les manifestations cliniques et somatiques dues à l’infection par
le VIH influencent le statut nutritionnel des patients. Elles
engendrent des besoins spécifiques, faisant de la prise en charge
diététique personnalisée un mode de prévention utile et efficace.
29
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%