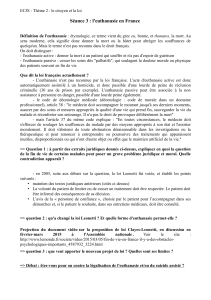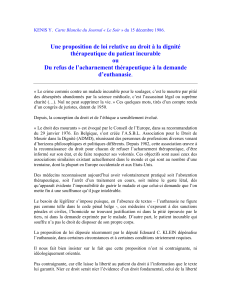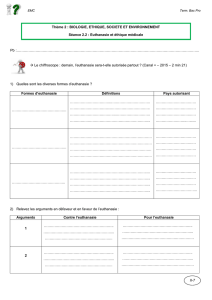Les lois occidentales ont abor-
dé le fait d’aider une person-
ne à mourir comme une forme
d’homicide passible de sanctions.
Pourtant, le mot euthanasie ne
figure pas dans le Code pénal
français.
La jurisprudence l’assimile à un
homicide volontaire. Celui qui
la pratique est passible de trente
ans de prison. Bénéficier de l’ac-
cord du malade, des médecins
et de la famille ne diminue pas
les peines encourues.
Aujourd’hui, on distingue l’eu-
thanasie active, qui implique un
acte déterminé commis par un
tiers de sa propre initiative ou à la
demande du malade, de l’eutha-
nasie passive, qui consiste sim-
plement en l’omission volontaire
de thérapeutiques qui auraient
pu prolonger la vie du malade.
Enfin, on utilise le terme d’eutha-
nasie active indirecte pour dési-
gner un acte thérapeutique
employé délibérément en dépit
des risques très importants qu’il
présente eu égard au diagnostic
vital. Le mot euthanasie est par-
fois associé ou opposé à d’autres
termes tels que l’aide à mourir, le
suicide assisté, la mort dans
la dignité, les soins palliatifs ou
l’acharnement thérapeutique.
Des limites repoussées
Les progrès de la médecine, de
l’hygiène et de la nutrition, ont
permis de prolonger considéra-
blement la durée de la vie
humaine, du moins dans les
pays industriels développés. Les
limites médicales et scienti-
fiques ont été repoussées. La
vieillesse est de moins en moins
considérée comme une fatalité,
plutôt comme une maladie.
Alors qu’au XIXesiècle, une
personne sur dix seulement
atteignait 65 ans, on prévoit, en
l’an 2000, 15 000 centenaires.
La prodigieuse avancée de la
médecine a donné aux soignants
des pouvoirs qui leur permet-
tent actuellement d’avoir un
contrôle quantitatif et qualitatif
des naissances grâce à la géné-
tique et aux diagnostics préna-
tals, de guérir des maladies
réputées jusqu’alors incurables,
de modifier le patrimoine géné-
tique, de remplacer des organes
déficients, de maintenir en sur-
vie artificielle une personne en
coma dépassé et enfin de
repousser la mort ou de mettre
fin à l’agonie par... l’euthanasie.
Les contours d’un mythe
La fin de vie est un domaine
où se mêlent confusément des
considérations juridiques, philo-
sophiques, politiques qui trou-
vent une cristallisation autour de
la notion d’euthanasie.
L’activité et la mission d’une équi-
pe soignante sont placées au
centre de la controverse qui
entoure l’euthanasie. Partisans et
adversaires s’affrontent autour
d’un faux dilemme : être pour ou
contre l’euthanasie, alors que
chaque fin de vie pose des pro-
blèmes strictement individuels ne
pouvant se résumer en une solu-
tion schématique et simpliste.
Toujours est-il qu’il n’est pas de
soignant qui ne soit tôt ou tard
confronté à ces situations et aux
interrogations éthiques qu’elles
suscitent. Y répondre est d’au-
tant plus malaisé que certains de
ces progrès sont trop récents
pour que notre jugement ne soit
pas influencé par la crainte de la
nouveauté ou simplement par
des normes morales qui ne
valent que pour notre époque.
C’est pourtant guidé par cette
ambition que les pouvoirs pu-
blics ont créé en 1983 le Comité
national d’éthique. Pour encadrer
les pratiques de la biologie et de la
médecine, l’État s’est doté de lois
bioéthiques. Parmi les questions
non résolues par une loi, celle de
l’euthanasie resurgit. Car c’est
maintenant surtout à l’hôpital que
l’on meurt (au XIXesiècle, 90 %
des gens mouraient chez eux ; au
cours des vingt dernières années,
la proportion des personnes décé-
dées à l’hôpital ou en institution
est passée de 30 à 70 %).
Du mythe à la réalité
Quelle que soit son qualificatif,
l’euthanasie évoque une situa-
tion difficile pour l’acteur de
soin qu’est le soignant. Acteur de
soin au sens défini par Walter
Hesbeen comme étant «celui qui
par le soin fait œuvre de création,
porte une attention particulière, à
chaque fois qu’il soigne un individu
dans la singularité de la situation
de vie qui est la sienne ».
Périodiquement, la grande pres-
se, le grand public, parlent de
l’euthanasie. Chose frappante,
commente H. Planche, « le goût
d’en parler est infiniment plus
répandu dans le grand public et
chez les littérateurs que chez les
médecins ». Ces propos écrits il y
a près de 50 ans montrent à quel
point le problème de l’euthana-
16
Étude
La mort mérite-t-elle d’être vécue ?
Les cités antiques grecques et latines dans lesquelles
naquirent la philosophie, la médecine et notre droit
ont toujours pratiqué une certaine forme d'eutha-
nasie. La prééminence de religions monothéistes (le
judaïsme, le christianisme et l'islam) a rompu avec cet
usage et conféré à l'euthanasie, quelle que soit sa
forme, un caractère moral et éthique condamnable.
Le dictionnaire
Larousse définit
l’euthanasie
comme
“l’ensemble
des méthodes
qui procurent
une mort sans
souffrance,
afin d’abréger
une longue
agonie ou une
maladie très
douloureuse
àl’issue fatale”.
Dans son sens
étymologique
premier,
l’euthanasie
(eu thanatos)
signifie mort
douce, mort
paisible, mort
sans souffrance.

sie n’est pas nouveau, à cette
différence près qu’aujourd’hui,
ce n’est plus seulement la presse
et le public qui s’y intéressent
mais la classe politique, à travers
la question de l’opportunité
d’une intervention législative.
Le Code pénal, le Code de déon-
tologie et la doctrine religieuse
ne font aucune exception à l’in-
terdiction de l’homicide, hormis
la légitime défense et la guerre.
L’euthanasie n’a donc aucune
place légale dans la pratique des
soignants.
Mais des voix s’élèvent pour
demander la légalisation de l’eu-
thanasie dans notre pays, au
nom de la valeur absolue de l’in-
dividu à disposer lui-même de
sa vie. Ces mêmes voix récusent
une longévité artificielle provo-
quée par l’acharnement théra-
peutique ou “palliatif” et propo-
sent d’aligner notre législation
sur le modèle hollandais, austra-
lien ou américain.
L’ étude des textes adoptés dans
ces pays montre la difficulté
pour le législateur de définir les
limites d’une loi “permissive”.
Une réalité virtuelle
On le sait, la loi française ne
constitue pas un obstacle infran-
chissable pour celui qui, dans le
cadre de ses relations avec le
malade, estime devoir abréger la
vie de celui-ci. Il est vrai qu’en
l’occurrence, le Parquet, comme
les juges du siège, manifestent
une réticence évidente à qualifier
le fait euthanasique de meurtre
ou d’assassinat et préfèrent rete-
nir d’autres qualifications. Lors-
que la qualification de meurtre,
voire d’assassinat, est retenue,
l’analyse des verdicts de cour
d’assises montre que les décisions
sont pour le moins “clémentes”.
De la discordance entre une pra-
tique quotidienne et le droit ou
les positions officielles émerge
un droit coutumier qui repose
sur un processus décisionnel
centré sur le patient et le carac-
tère “laïquement sacré” de la vie.
Sous le terme de processus dé-
cisionnel se mettent en place
des mécanismes d’aide et de
contrôle de la décision qui ont
force de règles et qui, peut-être,
prennent la place de cette
fameuse loi absente.
Les choix sont le fruit de discus-
sions d’équipe et permettent de
mieux éclairer celui qui a la
charge de la décision, de relati-
viser son point de vue person-
nel, incomplet et partial par
définition. S’il arrive que le
médecin se sente, en son âme
et conscience, obligé de com-
mettre des actes qui accélèrent
la mort, il doit le faire en pleine
responsabilité et comme un
geste de transgression excep-
tionnelle, sous le regard de son
jugement intérieur et non pas
comme un exécuteur autorisé
ou dissimulé derrière la légalité.
Jean-Christophe Crusson
Cadre supérieur infirmier
Hôpital Bichat - Claude-Bernard, Paris
Références
•“Mieux vivre sa mort”, Le Monde,
24 septembre 1998, p. 17.
•E. Dunet, J.-M. Lassaunière, L. Hac-
pille, B. Plages, P. Thominet, “Le renon-
cement thérapeutique : aspects médi-
caux et juridiques”, Espace éthique,
Paris, Doin, 1997, p. 148.
•J.-L. Baudoin, D. Blondeau, Ethique de
la mort et droit à la mort, Paris, PUF,
1993, p. 99.
•B. Baerstchi, “Il faut libéraliser
l’euthanasie”, La Recherche, n° 284,
février 1996, pp. 101-102-103. Cf.
annexe n° 16.
•Changer la mort, Paris, Albin Michel,
1997, p. 228.
•L. Schwarzenberg, Requiem pour la vie,
Paris, Le Pré aux Clercs, 1985, p. 206.
•P. Verspieren, Face à celui qui meurt,
Paris, Desclée de Brouwer, 1984, p. 143.
•A.-M. Revol, “Kouchner prend le train
en marche”, Le Figaro, 21 septembre
1998, p. 9.
•W. Hesbeen, Prendre soin à l’hôpital,
Paris, Masson, 1997.
17
Brèves…
Xénogreffe
Les membres du Comité consultatif
national d’éthique ont adopté une posi-
tion très prudente quant à la pratique
clinique des xénogreffes qui, selon eux,
peuvent améliorer la survie des per-
sonnes et même éviter des problèmes
éthiques liés au prélèvement d’organes
chez d’autres personnes. Mais le risque
de transmission à l’homme d’agents
infectieux inconnus issus du xénogref-
fon n’est-il pas trop grand ? En effet,
outre le patient lui-même, celui-ci peut
concerner l’ensemble d’une population,
pouvant même être à l’origine d’une
pandémie. N’y a-t-il pas aussi un risque
de démotivation de la part des donneurs
humains si les animaux peuvent satis-
faire les besoins ? Il serait très préma-
turé aujourd’hui de renoncer aux dons
humains car le recours à des greffons ani-
maux relève pour l’instant d’un nombre
de possibilités très limité. Il ne faut pas
non plus oublier les tabous des peuples
quant à la fusion homme/animal et les
questions, autrement plus importantes,
soulevées du fait du nombre réduit de
sujets qui pourraient en bénéficier. C’est
d’ailleurs peut-être à ce niveau que se
situe le nœud qui interdit pour l’instant
de passer à la pratique clinique.
Douleur
et choix de l’hôpital
Un article publié dans le numéro de
septembre 1999 de la revue américaine
Anesthesia and Analgesia et signé par
une équipe française (Drs F. Larue,
A. Fontiane et L. Brasseur) dresse la syn-
thèse d’une enquête réalisée par l’asso-
ciation Action Douleur, avec le concours
de la Ligue contre le cancer et de la
Fondation de l’avenir pour la recherche
médicale appliquée. Elle a été réalisée
en 1996, soit six ans après un premier
sondage sur les attitudes et les connais-
sances du grand public face à la dou-
leur post-opératoire ou du cancer. Elle
montre une importante évolution en six
ans : aujourd’hui, les patients choisi-
raient un hôpital ou une clinique en
fonction de la qualité de la prise en
charge de la douleur qui y est effectuée.
1
/
2
100%