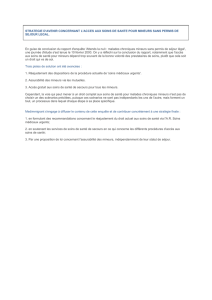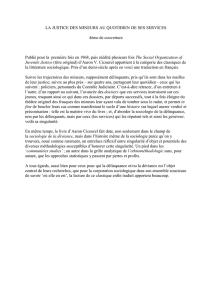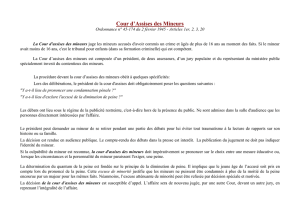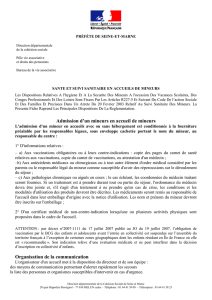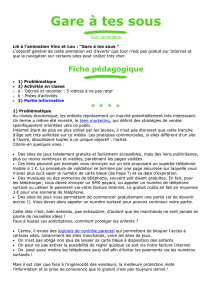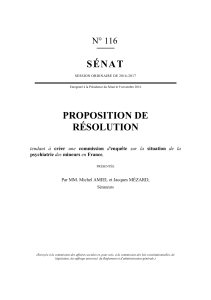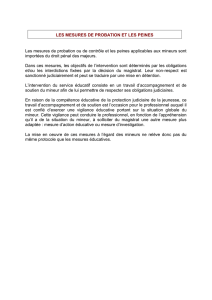Rapport au Premier ministre

Rapport au Premier ministre
Mission interministérielle
sur la prévention et le traitement
de la délinquance des mineurs
Réponses à la délinquance des mineurs
Christine LAZERGES et Jean-Pierre BALDUYCK
Avril 1998

Sommaire
Membres de la mission
Avant-propos
Introduction
Première partie
La délinquance des mineurs : mobiliser les acteurs
de la socialisation
I-1- Agir auprès des acteurs de la socialisation des mineurs
I-1-1- Responsabiliser les parents
I-1-2- Réorienter les moyens de l’Education nationale
I-1-3- Garantir une action efficace des départements
I-1-4- Conforter l’intervention sanitaire publique
I-1-5- Soutenir les initiatives associatives
I-1-6- Sensibiliser les médias
I-2- Placer la socialisation au coeur de la politique de la Ville
I-2-1- Rendre la politique de la Ville plus lisible
I-2-2- Faire de la politique de la Ville un instrument de restauration du lien social
I-2-3- Conjuguer politique de la Ville et politique de sécurité
Deuxième partie
Les mineurs délinquants : renouveler les réponses
de la police et de la justice
II- 1- Oser de nouvelles modalités d’intervention pour la police et la
gendarmerie
II-1-1- Communiquer et agir en partenariat
II-1-2- Prendre en compte la spécificité de la délinquance des mineurs
II-1-3- Maintenir l’implication des forces de l’ordre dans la prévention
II-1-4- Renforcer la présence des forces de sécurité dans les zones sensibles
II-1-5- Lutter contre la criminalité de territoire
II-2- Bousculer le fonctionnement de la justice des mineurs
II-2-1- Appliquer pleinement l’ordonnance du 2 février 1945
II-2-2- Promouvoir une politique pénale des parquets
II-2-3- Réhabiliter les juridictions pour mineurs
II-2-4- Exécuter les décisions de justice
II-2-5- Refonder la Protection judiciaire de la jeunesse
II-2-6- Transformer radicalement les conditions d’incarcération des mineurs

Conclusion
Liste des propositions
Membres de la mission
Parlementaires : Christine LAZERGES
Jean-Pierre BALDUYCK
Rapporteur général :
Philippe CHAILLOU, conseiller à la cour d’appel de Paris
Rapporteurs adjoints :
Emmanuelle MIGNON, auditeur au Conseil d’Etat
Arnaud TEYSSIER, inspecteur de l’administration
Jean-Philippe VINQUANT, inspecteur des affaires sociales
Membres de la commission :
Bruno AUBUSSON de CAVARLAY, ingénieur de recherche au CNRS, centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP)
Docteur Gilles BARRABAND, pédopsychiatre-psychanalyste, centre Jean Wier, chef du 3ème inter-
secteur des Hauts-de-Seine
Lieutenant-colonel Michel BONNIN, adjoint au chef du bureau de police judiciaire à la direction
générale de la gendarmerie nationale
Patrice CHOROWICZ, chargé de mission à la direction de la jeunesse et de la vie associative au
ministère de la jeunesse et des sports
Michel FOUCHARD, proviseur de vie scolaire au rectorat de l’académie de Créteil
Jean-Jacques GLEIZAL, professeur des universités, adjoint au maire de Grenoble
Jean-Louis LANGLAIS, inspecteur général de l’administration
Carole MARIAGE-CORNALI, chargée d’études à l’institut des hautes études et de la sécurité
intérieure, capitaine de police
Manuel PALACIO, bureau des méthodes, direction de la Protection judiciaire de la jeunesse
Lucien PERRET, commissaire divisionnaire, directeur adjoint de la direction départementale de la
sécurité publique de Seine-Saint-Denis
Jack ROS, chef de la mission innovation et territoire à la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV)
Dominique SERAN, président du tribunal pour enfants d’Evry

Avant-propos
Le Premier ministre, par une lettre de mission en date du 1er décembre 1997, nous a invités à
conduire une réflexion en profondeur sur la délinquance des mineurs et sur les réponses à lui
apporter.
Le champ ainsi ouvert était immense, au coeur des questions de société.
La mission s’est placée résolument sur un plan interministériel en s’assurant, par la
constitution d’une commission, le concours de professionnels appartenant à l’ensemble des
institutions concernées par le problème des mineurs ou possédant, dans ce domaine, des
compétences affirmées. Elle anticipait ainsi sur la seule démarche qui puisse se révéler réellement
efficace pour le traitement du phénomène lui-même : l’implication de tous dans un partenariat
conjuguant les compétences et les expériences les plus diverses.
La méthode de travail qui a été retenue s’est inspirée du même souci de proximité avec le
terrain. Pendant trois mois, la mission a procédé, le mercredi, à l’audition de personnalités impliquées
directement dans l’analyse, la prévention ou le traitement de la délinquance des mineurs. Chaque
audition a donné lieu au débat le plus ouvert et le plus franc, au prix, parfois, d’échanges assez vifs.
Parallèlement, la mission a effectué des déplacements sur le terrain, dans plusieurs départements, du
Nord au Sud de la France, pour une confrontation plus directe avec la réalité de la délinquance. Elle a
ainsi pu rencontrer des jeunes en grande difficulté et les acteurs publics et privés sur le lieu même de
leur intervention.
La mission s’est également déplacée dans plusieurs pays voisins, dont la cohésion sociale est
également mise à l’épreuve par la montée de la violence et de l’exclusion chez les jeunes. Elle en a
tiré de très utiles enseignements, fondés sur des approches parfois plus pragmatiques que celles
auxquelles prépare naturellement le tempérament français.
La mission a en outre recueilli de nombreuses contributions écrites d’un réel intérêt, émanant
parfois, de manière spontanée, de non-professionnels.
Enfin, elle a rédigé ses conclusions dans un souci de clarté et de pédagogie, en souhaitant
qu’elles soient accessibles à tous, spécialistes et non spécialistes, tout en maintenant sur le fond la
nécessaire technicité du propos.
La mission a voulu combiner, dans les solutions proposées, la détermination et le
pragmatisme. Détermination dans la mesure où la situation exige que l’ordre public et la sécurité de
tous soient assurés sans faiblesse à travers des réponses systématiques et adaptées. Pragmatisme,
dans la mesure où le problème est des plus complexes et appelle une démarche qui à court, moyen et
long termes, privilégie la souplesse et le réalisme, et fasse la plus large place à l’expérimentation et
l’innovation.

Introduction
La violence à l’école, les incendies de voitures dans les quartiers et la multiplication des actes
d’incivilité se conjuguent aujourd’hui pour donner naissance à " une peur des jeunes ", relayée par une
médiatisation spectaculaire de ces phénomènes. La société ne comprend plus ces jeunes qui, dit-on,
ont " la rage ", " la haine ", qui s’attaquent à n’importe qui et à n’importe quoi, qui, un jour, demandent
de l’attention et, le lendemain, se montrent menaçants.
Cette représentation négative de la jeunesse n’est cependant pas nouvelle, de même
que ne l’est pas l’inquiétude que fait naître la délinquance d’un enfant ou d’un adolescent.
Au 19ème siècle la jeunesse était déjà perçue comme un groupe social instable et
potentiellement dangereux. La description en 1867 des agissements de la " bande à Vitasse ", des
jeunes âgés de 13 à 16 ans, ne déparerait pas dans les comptes rendus de nos hebdomadaires.
Plus tard en 1922 Emile Garçon pouvait écrire : " Quoiqu’il en soit, le problème de l’enfance
coupable demeure l’un des problèmes les plus douloureux de l’heure présente. Les statistiques les
plus sûres comme les observations les plus faciles, prouvent, d’une part que la criminalité juvénile
s’accroît dans des proportions fort inquiétantes, et d’autre part, que l’âge moyen de la criminalité
s’abaisse selon une courbe très rapide ". Souvenons-nous également de la crainte
qu’inspiraient dans les années 50 les bandes de " blousons noirs " puis les " loubards ".
Quelles qu’en soient les causes, cette délinquance est le signe d’un échec de la socialisation.
Il faut toutefois être clair, cette crise de la socialisation n’atteint qu’une faible proportion de mineurs.
D’abord parce qu’il ne faut pas confondre délinquance des jeunes et délinquance des
mineurs. La catégorie des " jeunes " représente un groupe beaucoup plus large que celui des
mineurs. En termes de statut social, on reste un " jeune " jusqu’à 25 ou même parfois 30 ans. La
minorité, elle, est une catégorie juridique qui s’arrête à 18 ans, tant au plan civil qu’au plan pénal. En
réalité, la minorité correspond, dans le langage commun, à l’enfance puis à l’adolescence. A partir de
18 ans, on n’est plus mineur mais jeune adulte. Or c’est pendant cette période, de 18 à 25 voire 30
ans, que la délinquance est, de loin, la plus importante.
Ensuite, parce qu’en dépit de la difficulté et de la fragilité propres à la période de l’enfance et
surtout de l’adolescence, la plupart des mineurs ne souffrent pas de problèmes particuliers. Ainsi, les
enquêtes qui ont été réalisées par l’INSERM montrent que la majorité des adolescents dialoguent
normalement avec leurs parents, ont une scolarité sans heurts et jouissent d’une bonne santé
mentale. N’oublions pas les nombreux jeunes qui s’engagent dans la vie associative, la solidarité, le
refus du racisme.
Une minorité, toutefois, d’enfants et d’adolescents -15 à 20 %- connaît des difficultés
sérieuses. Toujours selon l’INSERM, un adolescent sur cinq déclare avoir été victime de violence, que
cette violence soit physique ou sexuelle. Un élève sur seize entre 11 et 18 ans déclare avoir fait une
tentative de suicide.
Or les jeunes qui ont été victimes de violences pendant leur minorité ont généralement plus de
mal à s’insérer dans la société et sont eux-mêmes plus enclins que les autres à développer des
comportements violents. Pour certains, la succession des échecs et leur progressive exclusion les
conduisent à " l’extrême de la souffrance, de la désespérance et de la délinquance [qui] n’est pas
loin ", pour reprendre les termes du rapport sur " La progression de la précarité en France et ses effets
sur la santé ", établi en février 1998 par le Haut comité de la santé publique.
Il ressort des différentes auditions auxquelles a procédées la commission que trois formes de
comportement délinquant peuvent être identifiés :
- la délinquance " initiatique ", celle des transgressions qui ont toujours été observées
lors du passage de l’adolescence à l’âge adulte ;
- la délinquance " pathologique ", qui tient à des troubles psychologiques fortement
individualisés ;
- la délinquance " d’exclusion ", qui est plus ou moins liée au chômage et à
l’aggravation des problèmes sociaux, et qui se manifeste surtout dans les quartiers difficiles. Les
adolescents y cumulent toutes sortes de handicaps : échec scolaire, précarité familiale, mauvaise
santé, troubles psychologiques, problèmes de logement, errance.
Cette analyse ne doit pas conduire à penser qu’il existe trois catégories étanches de mineurs
délinquants. Preuve en est la question des mineurs toxicomanes. Le simple usage peut parfaitement
relever de la délinquance initiatique, ou au contraire d’usage récréatif devenir toxicomanie et relever
alors d’une délinquance pathologique. Enfin la délinquance d’exclusion peut, elle aussi, générer des
conduites toxicomaniaques - sans parler naturellement du trafic lui-même. L’usage de stupéfiants est
en soi un problème très spécifique chez les mineurs ; c’est avant tout une question de santé publique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
1
/
116
100%