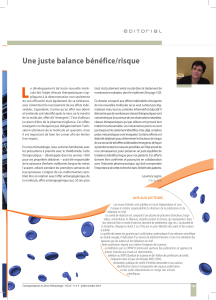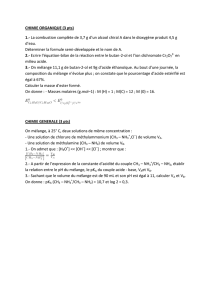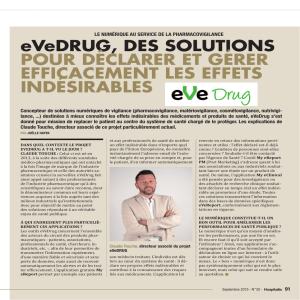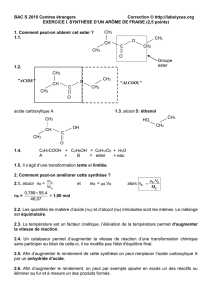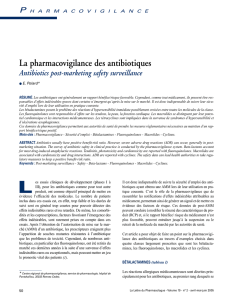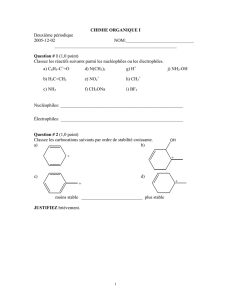La pharmacovigilance des antibiotiques Exemples de quelques effets indésirables rapportés

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006
Mise au point
Mise au point
142
Les antibiotiques ont généralement un rapport bénéfice/risque
favorable. Cependant, comme tout médicament, ils peuvent être
responsables d’effets indésirables graves dont certains n’émer-
gent qu’après la mise sur le marché. Il est donc indispensable de
suivre leur sécurité d’emploi lors de leur utilisation en pratique
courante. Les bêtalactamines posent le problème des réactions
d’hypersensibilité immédiate possiblement croisées entre toutes
les molécules de la classe. Les fluoroquinolones sont responsa-
bles d’effets sur les tendons, la peau, la fonction cardiaque. Les
macrolides se distinguent par leur potentiel cardiotoxique et les
interactions médicamenteuses. Les tétracyclines sont impliquées
dans la survenue de syndromes d’hypersensibilité et d’ulcérations
œsophagiennes. Ces données de pharmacovigilance permettent
aux autorités de santé de prendre les mesures réglementaires
nécessaires au maintien d’un rapport bénéfice/risque positif.
Mots-clés : Pharmacovigilance - Sécurité d’emploi - Bêtalacta-
mines - Fluoroquinolones - Macrolides - Cyclines.
Summary : Antibiotics usually have positive benefit-risk ratio. How-
ever, severe adverse drug reactions (ADR) can occur, generally in post-
marketing situation. The survey of antibiotic safety in clinical practice
is conducted by the pharmacovigilance system. Beta-lactams account
for most drug-induced anaphylactic reactions. Tendinitis, phototoxi-
city and cardiotoxicity are reported with fluoroquinolones. Macroli-
des are associated with cardiotoxicity and drug interactions. ADR are
reported with cyclines. The safety data can lead health authorities to
take regulatory measures to keep a positive benefit-risk ratio.
Keywords: Post-marketing surveillance - Safety - Beta-lactams -
Fluoroquinolones - Macrolides - Cyclines.
[1] Article initialement publié dans La Lettre du Pharmacologue - Volume 18 - n° 2 - avril-
mai-juin 2005 et réactualisé par l’auteur.
* Centre régional de pharmacovigilance, service de pharmacologie, hôpital de Pontchaillou,
Rennes.
La pharmacovigilance des antibiotiques[1]
Exemples de quelques effets indésirables rapportés
avec les bêtalactamines, les fluoroquinolones,
les macrolides et les cyclines
Antibiotics post-marketing safety surveillance:
examples of some adverse drug reactions described with beta-lactams,
fluoroquinolones, macrolides and cyclines
# E Polard*
Les essais cliniques de développement (phases I à III), pour
les antibiotiques comme pour tout autre produit, ont
comme objectif principal de mettre en évidence l’efficacité
des molécules. Le nombre de patients inclus dans ces essais est
en effet trop faible, et les durées de suivi sont en général trop
courtes pour pouvoir détecter des effets indésirables rares et/ou
retardés. De même, les comorbidités et coprescriptions, facteurs
favorisant l’émergence des effets indésirables, sont rarement pri-
ses en compte dans ces essais. Après l’obtention de l’Autorisation
de mise sur le marché (AMM) d’un antibiotique, les prescrip-
teurs craignent plus l’apparition de souches mutantes résistan-
tes à l’antibiotique que les problèmes de toxicité. Cependant, de
nombreux antibiotiques, en particulier des fluoroquinolones,
ont été retirés du marché ces dernières années pour une sur-
venue d’effets indésirables rares ou exceptionnels, mais pouvant
mettre en jeu le pronostic vital des patients (1).
Il est donc indispensable de suivre la sécurité d’emploi des an-
tibiotiques ayant obtenu une AMM lors de leur utilisation en
pratique courante. C’est le rôle de la pharmacovigilance que de
rassembler les notifications d’effets indésirables attribuables au
médicament, permettant ainsi de générer un signal et de mettre
en évidence des facteurs de risque. Ces données de post-AMM
peuvent conduire à modifier le résumé des caractéristiques du
produit (RCP) et, si le rapport bénéfice/risque du médicament
n’est plus favorable, peuvent aller jusqu’à entraîner la suspension
ou le retrait de la molécule du marché par les autorités de santé.
Cet article a pour objet de faire le point sur la pharmacovigilance
des antibiotiques au travers d’exemples choisis dans quatre clas-
ses largement prescrites : les bêtalactamines, les fluoroquinolo-
nes, les macrolides et les cyclines.
BÊTALACTAMINES (tableau I)
Les réactions allergiques médicamenteuses sont décrites prin-
cipalement pour les antibiotiques, au premier rang desquels
se trouvent les bêtalactamines (2-4). Pour ces molécules, dis-
RÉSUMÉ
LPN juil-aout 06.indd 142 25/09/06 12:33:37

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006
Mise au point
Mise au point
143
R-CONH
R-CONH
O=C HN CH3
CH3
S
NH
Protéine
Protéine
COOH
Chaîne
latérale Noyau
bêtalactame
Pénicillines
Déterminants majeurs
Noyau
thiazolidine
OCOOH
CH3
CH3
S
N
N
OOHN CH3
CH3
S
S
COOH
Déterminants mineurs
R
Figure 1.
Structure générale des bêtalactamines et de leurs
principaux métabolites (exemple des pénicillines).
ponibles en thérapeutique depuis de nombreuses années, sont
classiquement décrits deux types d’événements : des exanthè-
mes maculopapuleux, dits “morbilliformes”, le plus souvent
sans critère de gravité (des toxidermies graves de type Stevens-
Johnson ou Lyell ont été décrites), et de plus rares réactions
anaphylactiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Deux
exemples d’effets indésirables ont été choisis : l’allergie immé-
diate et la maladie pseudo-sérique.
Tableau I.
Principaux exemples d’eets indésirables décrits pour les
antibiotiques évoqués.
Classe antibiotique Eets indésirables
Bêtalactamines
pénicillines
céphalosporines
Réactions d’hypersensibilité immédiate
possiblement croisées
Maladie pseudo-sérique
Fluoroquinolones
Troubles neuropsychiatriques
Atteintes tendineuses
Photosensibilisation
Allongement du QT
Réactions d’hypersensibilité
Macrolides
Troubles gastro-intestinaux
Allongement du QT
Potentiel d’interactions médicamenteuses
(inhibition du CYP3A4)
Kétolides
Aggravation de myasthénie
Potentiel d’interactions médicamenteuses
(inhibition du CYP3A4)
Tétracyclines
minocycline
doxycycline
Atteintes auto-immunes (lupus)
Syndrome d’hypersensibilité
Ulcérations œsophagiennes
Allergie immédiate aux bêtalactamines
La pénicilline est la cause la plus fréquente de réactions anaphy-
lactiques dans la population générale ; l’incidence, difficile à éta-
blir car la définition de la réaction anaphylactique et les moda-
lités d’administration des pénicillines sont hétérogènes entre les
études, varie de 0,055 à 0,2 % (2, 5). Le nombre annuel de décès
dus à un choc anaphylactique aux bêtalactamines aux États-Unis
est voisin de 500 et représente les trois quarts des chocs mortels
d’origine médicamenteuse (4).
Ces réactions allergiques sont immunomédiées, donc indépen-
dantes de la dose, imprévisibles, et ne peuvent être anticipées par
les études précliniques (absence de modèles animaux pertinents).
Les métabolites obtenus après biotransformation de la molécule
mère sont souvent impliqués, et la variabilité interindividuelle du
métabolisme sous-tendue par le polymorphisme génétique expli-
que la sensibilité différente des sujets à une molécule (1, 2). L’atopie
n’est pas un facteur de risque de réaction allergique aux bêtalacta-
mines. Toutefois, diverses études ont suggéré que des antécédents
personnels d’atopie pourraient majorer la sévérité des réactions
anaphylactiques, mais sans en modifier la fréquence (4, 5).
Les réactions d’hypersensibilité immédiate observées avec les
bêtalactamines sont médiées par les immunoglobulines E (IgE)
dirigées contre certaines structures chimiques de ces antibioti-
ques (1, 2, 4). Les bêtalactamines comportent en effet différents
déterminants antigéniques (figure 1) : le cycle commun bêtalac-
tame, mais aussi les chaînes latérales, expliquant ainsi les réac-
tions croisées entre différentes pénicillines et entre pénicillines
et céphalosporines. Le cycle bêtalactame a la capacité d’être
immunogène après ouverture et liaison à des protéines : le dé-
terminant antigénique formé, le benzyl-pénicilloyl, est nommé
déterminant majeur. La recherche d’une allergie à ce détermi-
nant peut se faire grâce à des tests cutanés au pénicilloyl poly-
lysine (PPL). Des déterminants dits mineurs, dont la formation
est liée au noyau thiazolidine, sont également impliqués dans les
réactions allergiques IgE médiées. Cependant, les tests cutanés
à visée diagnostique sont peu disponibles pour ces déterminants
mineurs (3).
Le diagnostic des réactions d’hypersensibilité immédiate repose
surtout sur les tests cutanés sous forme de pricks, ou intradermo-
réactions (IDR), dans un délai de 3 à 6 mois après l’événement.
La lecture se fait de la 15e à la 20e minute (4). Un test cutané po-
sitif permet de poser un diagnostic d’allergie à la pénicilline ; un
test négatif ne permet pas de conclure (3). Néanmoins, à ce jour,
aucune réaction anaphylactique n’a été rapportée pour un pa-
tient ayant une histoire clinique positive, mais des tests négatifs
aux déterminants classiquement disponibles en allergologie (2).
Des tests de réintroduction peuvent être envisagés si les bêtalac-
tamines sont jugées indispensables au patient : ils sont réalisés
en milieu hospitalier compte tenu du risque – non nul – de tests
cutanés faussement négatifs (3, 4).
La fréquence des réactions cutanées aux céphalosporines est
plus faible qu’avec les pénicillines, de l’ordre de 1 à 3 %. Les
réactions anaphylactiques sont rares. La connaissance de l’im-
munogénicité des céphalosporines est plus limitée que celle des
LPN juil-aout 06.indd 143 25/09/06 12:33:38

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006
Mise au point
Mise au point
144
pénicillines, et la question demeure du risque de prescrire une
céphalosporine chez un patient avec antécédent d’allergie à la
pénicilline (2, 5). Un patient aux antécédents avérés d’allergie à
la pénicilline a huit fois plus de risques de voir se déclencher une
allergie aux céphalosporines qu’un patient sans antécédent aller-
gique (4, 5). Les pourcentages de réactions croisées pénicillines-
céphalosporines communément admis sont de 5 à 10 %. C’est
pourquoi il est important chez ces patients de mener un inter-
rogatoire complet et, le cas échéant, d’effectuer des tests cutanés
aux pénicillines. Les tentatives de mise au point de tests cutanés
avec les céphalosporines se sont révélées infructueuses et les
tests avec la molécule mère ont une valeur prédictive limitée (2,
5). En revanche, les patients ayant des tests cutanés négatifs aux
pénicillines n’ont pas plus de risques que la population générale
de développer des réactions allergiques aux céphalosporines.
Ces informations sont reprises dans le RCP des céphalospori-
nes à la rubrique “Mises en garde”, où il est précisé que “l’allergie
aux pénicillines étant croisée avec celle aux céphalosporines dans
5 à 10 % des cas, l’utilisation des céphalosporines doit être extrê-
mement prudente chez les patients pénicillinosensibles”.
Parmi les bêtalactamines, on peut distinguer l’aztréonam, mo-
nobactam (structure chimique à un seul cycle). Cette molécule
est proposée par Parmar et Nasser (6) chez des patients atteints
de mucoviscidose et présentant des prick-tests positifs aux péni-
cillines. Cependant, l’aztréonam partage avec la ceftazidime une
chaîne latérale identique, et des cas isolés de réactions croisées
entre ces deux molécules ont été rapportés. Il convient donc,
selon le RCP de l’aztréonam, d’utiliser cette molécule avec une
grande prudence chez les patients présentant une hypersensibi-
lité aux bêtalactamines.
Chez les patients ayant présenté une réaction anaphylactique à
une bêtalactamine, il convient donc de proscrire toutes les bê-
talactamines, compte tenu du risque d’allergie croisée entre les
molécules de toute la classe. Il est ensuite conseillé de prévoir un
bilan allergologique, afin de confirmer le diagnostic, de définir
une liste des médicaments à risque et de proposer le cas échéant
un test de réintroduction ou une désensibilisation sous stricte
surveillance médicale.
Maladie pseudo-sérique
Il s’agit d’un effet indésirable d’apparition retardée par rapport
au début du traitement. La maladie pseudo-sérique survient
essentiellement chez de jeunes enfants (âge ≤ 6 ans) traités
par céfaclor et par les céphalosporines de première généra-
tion proches (4, 7). Elle se manifeste au plan clinique par une
urticaire, de la fièvre et des arthralgies dans un délai d’environ
une semaine après le début du traitement (7). L’évolution est
spontanément favorable. La molécule en cause est alors contre-
indiquée chez le patient, mais sans contre-indication de la classe
des bêtalactamines (4). La survenue de cet effet serait expliquée
par un déficit héréditaire sur la voie métabolique hépatique du
céfaclor (2, 7). Des tests cutanés peuvent être envisagés, de type
patch-test à lecture retardée (48-72 heures) (4).
Dans la série décrite par King et al. (7) sur la période allant du
1er janvier au 31 décembre 1997, le céfaclor était associé à 84 %
des maladies pseudo-sériques attribuables à un traitement anti-
biotique par voie orale, et cette caractéristique a été confirmée
dans le reste du monde. Les auteurs observaient sur la même
période une sous-notification de cet effet indésirable auprès du
système de pharmacovigilance (Adverse Drug Reactions Adviso-
ry Committee [ADRAC] Australia) : cet effet étant maintenant
bien reconnu avec le céfaclor, il est sans doute moins notifié par
les professionnels de santé, ce qui entraîne une sous-estimation
de son incidence au sein de la population pédiatrique traitée par
céfaclor.
FLUOROQUINOLONES (tableau I)
Les “nouvelles” fluoroquinolones, à savoir ciprofloxacine,
norfloxacine, ofloxacine, péfloxacine, puis sparfloxacine, ont
été mises sur le marché dans les années 1990. L’utilisation
de cette classe d’antibiotiques à large spectre antibactérien,
offrant une alternative possible aux bêtalactamines et semblant
bien tolérée, a été d’emblée importante. Toutefois, après quel-
ques années de commercialisation, des effets indésirables sont
apparus en notification spontanée et dans la littérature (8). En
France, l’Agence du médicament décida rapidement une analyse
des cas notifiés avec les fluoroquinolones du début de leur com-
mercialisation au 31 décembre 1993. Plus tard, la sparfloxacine
fut intégrée à l’enquête (8). Un profil d’effets indésirables des
fluoroquinolones s’est dégagé avec des particularités propres à
certaines molécules, qui seront détaillées plus loin. Des troubles
neuropsychiatriques, des atteintes tendineuses, des photosen-
sibilisations et des troubles cardiaques sont décrits (8, 9). Des
réactions plus rares d’hypersensibilité immunomédiées ont
aussi été rapportées en notification spontanée (9). Ces effets in-
désirables, maintenant attendus pour toute la classe, sont suivis
pour toutes les molécules mises sur le marché depuis l’enquête
initiale, comme la lévofloxacine, la moxifloxacine, la trovafloxa-
cine et la grépafloxacine.
Certains de ces effets indésirables sont expliqués par la structure
chimique des fluoroquinolones (figure 2). Par exemple, la pho-
totoxicité est influencée par la nature d’une substitution présen-
te pour la sparfloxacine et absente pour des molécules comme
la moxifloxacine, pour laquelle ces réactions semblent peu fré-
quentes (1, 9). Les fluoroquinolones trifluorées (trovafloxacine,
témafloxacine) sont à haut risque de réactions immunomédiées,
ce qui a été confirmé par l’apparition d’atteintes hépatiques sévè-
res sous trovafloxacine, rapidement après son obtention d’AMM,
et a conduit les autorités de santé à retirer ce médicament du
marché (1). Ces informations sur la relation structure-toxicité
sont donc importantes pour anticiper la toxicité des molécules
en développement.
Les trois types d’effets indésirables envisagés ici sont les tendino-
pathies, la phototoxicité et la cardiotoxicité.
.../...
LPN juil-aout 06.indd 144 25/09/06 12:33:38

Dénomination et forme pharmaceutique* : SPIRIVA®18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule. Composition* : 18 microgrammes de tiotropium (soit 22,5 microgrammes sous forme de bromure de
tiotropium monohydraté). La dose délivrée à l’embout buccal du dispositif HandiHaler®est de 10 microgrammes de tiotropium. Excipient à effet notoire : lactose monohydraté (qui contient des protéines de lait). Indications
thérapeutiques : Le tiotropium est indiqué comme traitement bronchodilatateur continu destiné à soulager les symptômes des patients présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Posologie et
mode d’administration* : La posologie recommandée de bromure de tiotropium est l’inhalation du contenu d’une gélule une fois par jour à heure fixe dans la journée. La poudre de bromure de tiotropium contenue dans la
gélule devra être inhalée uniquement à l’aide du dispositif HandiHaler®. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne pas avaler les gélules. Sujets âgés : le bromure de tiotropium peut être utilisé chez les sujets âgés à la dose
recommandée. Insuffisance rénale, insuffisance hépatique : le bromure de tiotropium peut être utilisé à la dose recommandée. Utilisation pédiatrique : La tolérance et l’efficacité du bromure de tiotropium sous forme de poudre pour
inhalation en gélule, n’ont pas été établies en pédiatrie. Par conséquent, son utilisation est déconseillée chez les patients de moins de 18 ans. Contre-indications : Antécédents d’hypersensibilité (allergie) au bromure de
tiotropium, à l’atropine ou à ses dérivés (ipratropium ou oxitropium), ou au lactose (excipient). Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi*. Interactions avec d’autres médicaments
et autres formes d’interaction*. Grossesse et allaitement*. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Surdosage*. Propriétés
pharmacodynamiques* : Anticholinergiques. Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité précliniques*. Liste I – Médicament soumis à prescription médicale. Boîte de 30 gélules + dispositif
HandiHaler®CIP 368 692.0 - 46,17 - CTJ : 1,54 - Agréé Coll - Remboursé Sec Soc à 65 %. Date de mise à jour du texte : 31/03/06. Titulaire : Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne).
Représentant local : Boehringer Ingelheim France S.A.S., 37-39 rue Boissière, 75116 Paris. Information médicale : 03 26 50 45 33. *Pour une information complète, consulter le dictionnaire Vidal.
** Bronchopneumopathie Chronique Obstructive.
(1) RCP SPIRIVA®.
1
er
bronchodilatateur anticholinergique de longue durée d’action en
1
prise par jour (1)
- Boehringer Ingelheim France SAS - SPY 166 - 06-179 - 05/06.
LPN juil-aout 06.indd 145 25/09/06 12:33:39

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006
Mise au point
Mise au point
146
R5
R7X6
R1
N
OO
COH
R2
F
Inuence la phototoxicité
et la génotoxicité Contrôle la chélation,
interaction avec antiacides
Contrôle les liaisons au récepteur
GABA, inuence les IAM
Contrôle la phototoxicité,
inuence les interactions
médicamenteuses (IAM)
Contrôle la génotoxicité,
l’interaction avec la théophylline
Pas d’eet
Pas d’eet
Figure 2.
Relations structure-toxicité des uoroquinolones (1).
Fluoroquinolones et tendinopathies
Le risque d’atteinte tendineuse a initialement émergé grâce à la
notification spontanée sur la péfloxacine, pour laquelle les cas
rapportés de tendinites, principalement sur le tendon d’Achille,
étaient plus nombreux qu’avec les autres fluoroquinolones (8-
10). La fréquence estimée lors de l’enquête française de phar-
macovigilance était pour la péfloxacine d’un cas par 23130 jours
de traitement, alors qu’elle variait de 1/173600 à 1/799600 jours
de traitement pour ofloxacine, ciprofloxacine et norfloxacine
(10). Des facteurs de risque tels que l’âge supérieur à 60 ans et
la corticothérapie associée ont alors été identifiés. Les données
de pharmacovigilance ont ensuite montré que le même type
d’atteintes tendineuses survenait fréquemment avec l’isomère
lévogyre du racémique ofloxacine, la lévofloxacine, bien que la
fréquence de survenue ait été difficilement comparable à celle
de la péfloxacine (9, 11). Des données industrielles internatio-
nales de surveillance post-AMM rapportaient une fréquence
inférieure à quatre cas de rupture tendineuse pour un million
de prescriptions (12). Les données recueillies en France au cours
des dix premiers mois de commercialisation de la lévofloxacine
montraient que les tendinites concernaient en majorité le ten-
don d’Achille, et pouvaient conduire à une rupture tendineuse
(30 % des cas). Les tendinites pouvaient survenir en 48 heures
après le début du traitement et devenir bilatérales. Les facteurs
de risque, âge et corticothérapie associée, majoraient nettement
le risque. Il en est résulté une mise en garde dans le RCP de la
lévofloxacine ainsi qu’une proposition d’adaptation des doses en
cas d’insuffisance rénale.
Fluoroquinolones et phototoxicité
Les fluoroquinolones exposent à un risque de phototoxicité
qui varie selon les molécules (9). Les atteintes cutanées, plus
ou moins sévères, vont du simple érythème solaire à la brûlure
(13). La sparfloxacine avait été mise sur le marché en septembre
1994 et suivie d’emblée par l’enquête de pharmacovigilance pré-
cédemment évoquée. Après huit mois de commercialisation, il
est apparu qu’elle était responsable de réactions phototoxiques
plus fréquentes et plus graves (nécessitant parfois une hospi-
talisation) que les autres fluoroquinolones (13). L’activité de la
sparfloxacine sur le pneumocoque ayant un intérêt en thérapeu-
tique, la molécule était restée disponible dans des indications
très restreintes, avec mention dans le RCP de “proscrire toute
exposition au soleil, à la lumière vive et aux ultraviolets, pendant
le traitement et trois jours après la fin”. Aux problèmes cutanés
s’est ajouté le potentiel cardiotoxique de la sparfloxacine, ce qui
a conduit le titulaire de l’AMM à retirer son produit du marché
en février 2001.
Fluoroquinolones et cardiotoxicité
La prolongation de l’intervalle QT est un effet indésirable
désormais considéré comme un effet de classe des fluoro-
quinolones, mais qui avait été initialement observé avec la
sparfloxacine (9, 14). Ce trouble de la repolarisation expose au
risque de torsades de pointes, une tachyarythmie ventriculaire
potentiellement fatale (14). Ainsi, parallèlement au problème de
phototoxicité, le potentiel cardiotoxique de la sparfloxacine était
analysé en temps réel par un groupe d’experts dans les études
précliniques, les essais cliniques et les données de pharmacovigi-
lance (15). Dès mai 1995, la contre-indication de la sparfloxacine
avec l’amiodarone en raison du risque d’allongement de l’inter-
valle QT était ajoutée au RCP. La grépafloxacine, enregistrée en
novembre 1997, a été retirée du marché en octobre 1999 pour
prolongation de l’intervalle QT (7 décès en Allemagne) (1).
Comme la sparfloxacine, la moxifloxacine, disponible en France
depuis 2002, a montré une tendance à allonger l’intervalle QT
dans les phases précoces de son développement (9, 14). Selon le
RCP de la moxifloxacine, toute association avec un médicament
susceptible d’augmenter l’intervalle QT est contre-indiquée. La
firme commercialisant le produit a, par ailleurs, obligation de
mener des études de sécurité (phases IV) sur son produit, afin
de détecter très précocement tout événement cardiovasculaire
grave (14).
MACROLIDES (tableau I)
Les macrolides représentent une classe d’antibiotiques homo-
gène dans ses indications. Ils constituent également une alter-
native pour les germes sensibles en cas d’allergie aux bêtalacta-
mines (16). Outre les troubles gastro-intestinaux retrouvés pour
la majorité des molécules, les effets indésirables découlent du
potentiel de certains macrolides à allonger l’intervalle QT et à
entraîner des interactions médicamenteuses cliniquement signi-
ficatives, les deux étant souvent liés (1, 17). Récemment mise sur
le marché, la télithromycine, un dérivé de l’érythromycine, pré-
sente certaines caractéristiques décrites plus loin.
Intervalle QT et interactions médicamenteuses
Les macrolides représentent la majorité des médicaments im-
pliqués dans la survenue de torsades de pointes, principalement
l’érythromycine et la clarithromycine (14, 17). D’une part, le po-
tentiel d’allongement du QT est intrinsèque à la molécule ; in-
terviennent alors la pharmacocinétique du produit (dose, voie
d’administration, distribution…) et les capacités métaboliques
et d’élimination du patient. D’autre part, l’impact des macroli-
.../...
LPN juil-aout 06.indd 146 25/09/06 12:33:39
 6
6
 7
7
1
/
7
100%