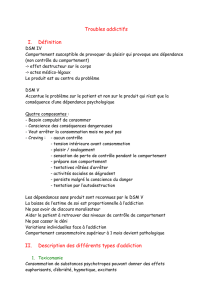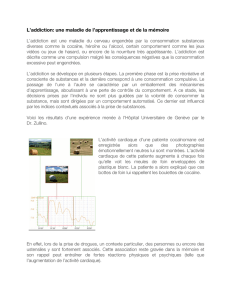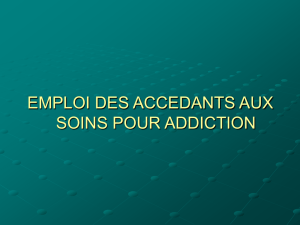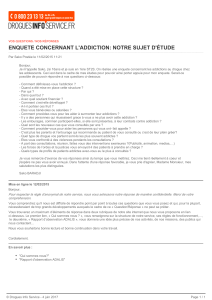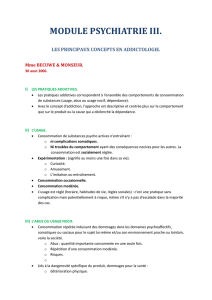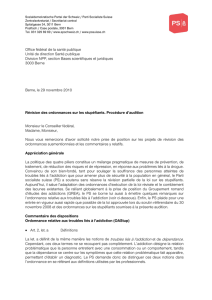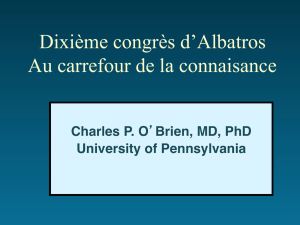Lire l'article complet

27
Plusieurs études soulignent l’importance
de cette comorbidité où les troubles se ren-
forcent mutuellement ou bien ont des évo-
lutions parallèles. Les sujets qui présentent
un double diagnostic ont des troubles plus
sévères, ils ont des difficultés plus impor-
tantes sur le plan affectif, social et écono-
mique. Cette comorbidité prédit un mau-
vais résultat thérapeutique, plus de réhospi-
talisations, une mauvaise observance,
l’augmentation des neuroleptiques, l’ag-
gravation des troubles mentaux et une mau-
vaise réinsertion. Chez les schizophrènes,
l’addiction accroît le passage à l’acte (vio-
lence, suicide).
Dans notre expérience à l’Écimud, cette
comorbidité reste élevée (86 %), les
troubles anxieux représentent 25 %, les
troubles dépressifs : 15,3 % et les troubles
psychotiques : 15,3 %. À côté, il existe une
forte prévalence des troubles de la person-
nalité (31,4 %). Il reste encore à effectuer
des études de prévalence avec des outils
structurés (Mini DSM IV, SCID, SCID-PD)
afin de proposer des soins au plus près du
patient.
À partir de ce constat, doit-on privilégier
des structures de prise en charge adaptées
(sur le modèle des Addiction Treatment
Unit) ou considérer l’addiction comme
l’épiphénomène d’un trouble psycholo-
gique sous-jacent ? Méthode d’automédi-
cation chez un sujet vulnérable ou choix
identitaire à travers un produit. Ici, se pose
un conflit éthique, le patient est-il le
meilleur juge du soin qui lui est proposé ?
Si la conception paternaliste repose sur la
bienfaisance. Le soignant fait des choix
pour le bien du malade, cette conception est
un moyen permettant d’obtenir le bien pour
le plus grand nombre. La substitution se
base sur ce principe dans la prévention du
VIH et du VHC, l’accès aux soins ou la
diminution de la délinquance. À côté, la
conception de l’autonomie est fondée sur le
principe de liberté où le soignant informe
le malade qui fait des choix pour lui-même.
L’autonomie est le but à atteindre si l’on
veut être juste pour l’autre.
Le caractère de l’addiction semble en
contradiction avec cette conception de l’au-
tonomie, c’est une maladie chronique pri-
maire où l’exposition à la drogue est seule-
ment un facteur étiologique de son déve-
loppement. L’addiction se manifeste par
des conduites comme la perte de contrôle
de l’usage, le craving et l’usage compulsif
malgré des conséquences physiques, men-
tales et sociales négatives. Le déni des
troubles étant un facteur aggravant.
Si l’éthique clinique est une action de soin
accomplie dans le souci de soi, le souci
d’autrui et de chacun ; le soin pour le sujet
dépendant repose sur la notion de contrat
“social” où sa maladie doit être reconnue
comme une résistance au changement. Cela
met en cause à la fois le secret profession-
nel dans le travail de réseau avec les asso-
ciations, les contre-attitudes des soignants
où la toxicomanie reste une maladie “socia-
le”, mais aussi la gratuité des soins (substi-
tution, consultations, sevrages) qui peut
entraver tout travail psychique.
Pour Freud, la cocaïne représentait un
“brise souci”, aujourd’hui on tend à penser
que l’addiction se rapproche plus des
troubles obsessionnels-compulsifs et des
troubles de l’humeur que de la solution à un
malaise social uniquement. Une éthique du
soin ne peut faire l’économie d’un diagnos-
tic psychopathologique propre au cas, la
médecine relève plus d’une obligation de
moyens que de résultats.
Psychiatrie/addiction :
intérêt des doubles diagnostics ?
L’éthique entre savoir et faire
Philippe Dupain*
Dans le cadre des addictions, aussi bien la littérature que
notre pratique clinique au sein de l’Écimud Saint-Antoine, nous
confrontent à ce que l’on nomme désormais les doubles
diagnostics. Pour les auteurs anglo-saxons, le double diagnostic
est l’existence d’un trouble mental associé à un trouble du
contrôle (Axe I, DSM IV).
* Écimud, CHU Saint-Antoine, Paris.
La naltrexone évite bien les rechutes
alcooliques
Dans cet essai clinique randomisé, contrôlé, 55 patients alcoolo-
dépendants traités en ambulatoire prenaient de la naltrexone (50 mg
par jour) et 56 un placebo. L’étude devait durer douze semaines, pen-
dant lesquelles tous les patients bénéficiaient d’une séance d’accom-
pagnement psychosocial et éducatif hebdomadaire de groupe. L’état
de chacun était également évalué chaque semaine. Quarante de ces
patients n’ont pas été jusqu’au bout des douze semaines : 17 dans le
groupe sous naltrexone et 23 dans celui sous
placebo. Parmi les sujets sous naltrexone, un
petit nombre seulement ont rechuté, et parmi
tous ceux qui ont été jusqu’à la fin de l’essai cli-
nique, le médicament, par ailleurs bien toléré, avait vraiment réduit la
consommation d’alcool. Ces résultats tendent à prouver que la nal-
trexone est efficace dans la prévention des rechutes, dans le cadre
d’une prise en charge psychosociale limitée dans le temps. Il faudrait
en contrôler l’efficacité à plus long terme.
– Morris PLP et al. (Southport, Australie) Addiction 2001 ; 96 : 1565-73.
F.A.R.
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
é
t
h
i
q
u
e
e
t
a
d
d
i
c
t
i
o
n
1
/
1
100%