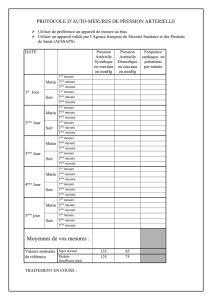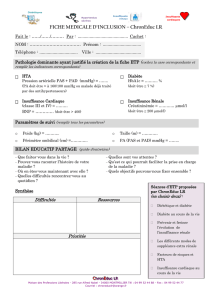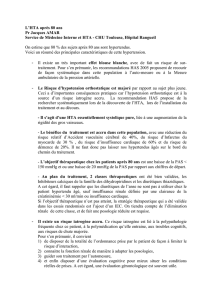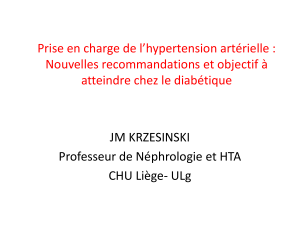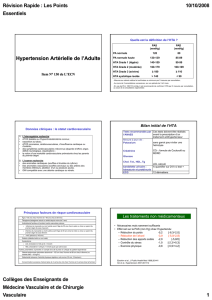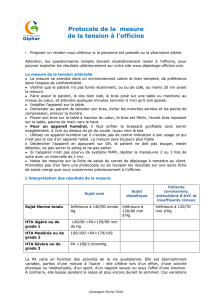Hypertension artérielle H

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999
37
PRISE EN CHARGE DU PATIENT HYPERTENDU
DU BON, DU MAUVAIS, DU “MOCHE” (UGLY)
Les conclusions du JNC VI restent, bien entendu, la base de la
prise en charge thérapeutique de l’hypertension artérielle (Arch
Intern Med 1997 ; 157 : 2413-46). Cependant, à la lumière des
études successivement publiées, des précisions sont apportées,
permettant de mieux cerner les objectifs du traitement, les motifs
et les profils des HTA dites résistantes, les moyens thérapeutiques
proposés, médicamenteux ou, surtout, non pharmacologiques. On
est frappé par le peu de communications concernant les antihy-
pertenseurs des différentes classes, contrastant avec l’importance
donnée à tous les autres aspects de la prise en charge des patients.
C’est dans ce domaine que paraissent se situer aujourd’hui “le bon,
le mauvais et le moche” des évolutions thérapeutiques de l’HTA.
Les protocoles nationaux de suivi aux États-Unis, telle la Natio-
nal Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III),
montrent une stabilisation, voire une régression, au cours des toutes
dernières années, du niveau de prise de conscience par les patients
de leur HTA, du traitement et de l’efficacité de celui-ci (tableau I).
Il semble exister, en conséquence, un tassement des progrès
observés dans la réduction du risque vasculaire, notamment céré-
bral, depuis 1994 aux États-Unis, et, selon D. Jones (Jackson),
ce phénomène paraît toucher essentiellement la population noire.
Les problèmes de la compliance thérapeutique deviennent
majeurs, et ont été bien étudiés par l’équipe de M. Hill (Balti-
more), chez les jeunes Noirs des milieux urbains. Une enquête
serrée montre que ceux-ci connaissent la gravité de l’hyperten-
sion et ses conséquences sur la mortalité, classée comme beau-
coup plus probablement liée à l’HTA qu’au vieillissement, et bien
loin devant les décès par mort violente ; néanmoins, seuls 2 %
d’entre eux considèrent le traitement de l’hypertension comme
une priorité de vie. Dans la population générale, même si ceci est
plus marqué chez les Noirs américains, les conséquences de l’obé-
sité, du manque d’exercice, de l’alimentation de type “fast-food”
et de la surcharge en sel ne sont pas bien prises en compte, que
ce soit pour des raisons économiques, sociales ou culturelles.
P. Whelton (La Nouvelle-Orléans) entend montrer, à travers
l’étude TONE (Trial of Non Pharmacologic Intervention in the
Elderly), l’efficacité de la perte de poids et de la réduction sodée
chez des patients âgés, obèses, déjà traités pour hypertension
artérielle.
D. Chow (Baltimore), dans l’étude plus novatrice DASH (Die-
tary Approaches to Stop Hypertension), a comparé l’effet ten-
sionnel de deux régimes enrichis en fruits et légumes, dont l’un
HTA
Hypertension artérielle
●A. Krivitzky, G. Nguyen*
* Service de médecine interne et endocrinologie, Hôpital Avicenne, 93009
Bobigny Cedex.
■ Après les progrès spectaculaires dans la prise en charge
de l’HTA constatés au cours des vingt dernières années, il
semble exister un tassement des résultats obtenus. Cet échec
relatif semble imputable, aux États-Unis, aux difficultés de
la prévention et du traitement non pharmacologique, parmi
les populations moins favorisées ayant plus difficilement
accès aux consultations, à la diététique et au sport.
■ La valeur pronostique de la pression systolique et de la
pression pulsée a été confirmée.
■ Sans que l’on remette complètement en cause la courbe
en J, notamment chez les diabétiques chez qui le pronostic
s’améliore de façon continue pour les pressions diastoliques
les plus basses, la PAD “idéale” dans l’étude HOT s’est
située entre 82 et 86 mmHg, ce qui n’est pas simple à obte-
nir et nécessite habituellement l’association de plusieurs
antihypertenseurs.
■ L’HTA de type blouse blanche a un pronostic plus bénin
que l’HTA avérée.
■ La PAS sera certainement un paramètre décisionnel pour
initier le traitement antihypertenseur.
■ La régression de l’HVG s’accompagne d’une améliora-
tion de la fonction ventriculaire.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
NHANES II NHANES III NHANES III
1976-1988 1988-1991 1991-1994
Se savent hypertendus (%) 51 73 68
Sujets traités (%) 31 55 53
Sujets équilibrés (%) 10 29 27
Tableau I. Données de la National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) concernant la prise en charge de l’HTA aux
États-Unis.
Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 37

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999
38
également en graisses insaturées et en protéines, à un régime amé-
ricain “standard” chez 133 hypertendus légers. Après deux mois
d’étude sans différence de poids entre les groupes, 70 % des
hypertendus soumis au régime le plus diététique étaient équili-
brés, contre 45 % des patients suivant le régime intermédiaire et
23 % de ceux respectant leur régime habituel. Malheureusement,
ces bénéfices spectaculaires sont perdus par la suite si les diffé-
rentes mesures sont abandonnées, comme l’a montré D. Jones
dans la phase II de l’étude de prévention TOHP.
De nombreuses équipes américaines ont publié des études
d’intervention auprès des patients, avec des résultats souvent
favorables : relances téléphoniques, auto-contrôle, ajustement
thérapeutique à distance, intervention des infirmières,
campagnes d’information...
K. Ishikawa (Tokyo) se préoccupe également de l’exercice phy-
sique et en constate des effets dissociés plus importants et plus
rapides sur la pression artérielle chez les sujets de 30 à 49 ans
que chez les plus âgés.
ET LA COURBE EN J ?
Si des corrélations ont été trouvées ou confirmées entre le niveau
de pression artérielle et l’homocystéine (J. Chambers, Londres)
et s’il existe un effet favorable de la vitamine C sur la fonction
endothéliale des hypertendus pour D. Sherman (Boston), la
recherche clinique continue de s’intéresser aux conséquences
éventuelles des variations tensionnelles et des valeurs respectives
de la systolique, de la diastolique et de la pression pulsée, ainsi
que, d’autre part, aux conséquences heureuses ou malheureuses
de la recherche d’une pression diastolique la plus basse possible.
Ainsi, S. Hoshide (Tochigi) étudie la relation entre la progres-
sion de la maladie cérébrovasculaire et les variations de pres-
sion artérielle chez des coronariens. Les sujets ayant le plus de
lacunes cérébrales en IRM et le plus grand nombre de sténoses à
la coronarographie avaient moins de chutes nocturnes de la pres-
sion artérielle. Pour la Framingham Heart Study,A. Haider tente
de rapprocher le pronostic cardiaque des critères :pression sys-
tolique, pression diastolique, pression pulsée, chez 2 040 patients
suivis 18 ans en moyenne. Après ajustement des divers facteurs
de risque, la pression pulsée se révèle être le meilleur critère de
développement d’une insuffisance cardiaque, suivie par la pres-
sion systolique, l’élévation du risque lié à la pression diastolique
n’étant pas significative.
Si, cependant, l’incidence des événements cardiovasculaires est
plus importante chez les sujets qui, malgré le traitement, élèvent
progressivement leur pression diastolique, et paraît dans certaines
études s’élever également lorsque cette pression devient trop basse
(courbe en J),elle ne paraît pas, pour I. Ferguson (New York),
être liée à des altérations de structure ou de fonction du ventri-
cule gauche préalables au traitement. La masse du VG, absolue
ou rapportée à la surface corporelle, ainsi que la FR et la FE
n’étaient pas, au départ, significativement différentes selon l’évo-
lution ultérieure, y compris pour des ▲▲PAD jusqu’à – 55 mmHg.
Plus généralement, les résultats de l’étude HOT (Hypertension
Optimal Treatment), publiés dans The Lancet (1998 ; 356 : 1755-
62),ont indiqué que l’incidence la plus basse d’événements
cardiovasculaires était obtenue pour une PAD de 82,6 mmHg,
et le risque le plus faible de mort d’origine cardiaque pour une
PAD de 86,5 mmHg. Cette étude portait sur 19 196 patients de
50 à 80 ans (PAD de 101 à 115 mmHg), avec l’objectif d’obte-
nir des PAD 90 mmHg, 85 mmHg ou 80 mmHg selon les
groupes, ceux-ci étant traités par félodipine avec une escalade
thérapeutique si nécessaire par bêtabloquant, IEC et hydrochlo-
rothiazide. Les résultats les plus spectaculaires étaient obtenus
chez les diabétiques, avec un risque cardiovasculaire réduit de
moitié après l’obtention d’une PAD 80 mmHg, par rapport au
groupe d’objectif 90 mmHg (p = 0,005).
HYPERTENSION RÉNOVASCULAIRE
D. Bluemke (Baltimore) a montré de superbes images en 3D
d’angio-IRM permettant une visualisation précise de la vascu-
larisation rénale et obtenues grâce à de nouveaux appareils avec
une acquisition rapide : coupes fines, multi-incidences, images
en contraste de phase, obtenant, pour certaines équipes, une sen-
sibilité de 97 % et une spécificité de 92 % pour le diagnostic de
sténose des artères rénales. Cet examen permet de voir des lésions
multiples, des sténoses modérées, des aspects de Takayasu, de
dissection, des images après transplantation, etc. Cet examen non
invasif, physiologique et anatomique, de mieux en mieux stan-
dardisé, garde certains inconvénients : disponibilité, parfois sur-
estimation de lésions en raison de calcifications ou de turbulences
vasculaires, perte de sensibilité pour les vaisseaux accessoires
intrarénaux.
Les places respectives de l’angioplastie et de la chirurgie ont
été une fois de plus discutées. On manque toujours d’études pros-
pectives randomisées. Il existe de nombreux biais, notamment de
sélection et d’homogénéité, dans le suivi. Pour l’équipe du John Hop-
kins,
40 % des hypertendus de plus de 60 ans ont une participa-
tion rénovasculaire ; chez 1 070 adultes répartis dans neuf études,
la chirurgie guérit l’hypertension dans 34 à 50 % des cas, l’amé-
liore dans 23 à 51 % des cas, échoue dans 9 à 35 % des cas, et
entraîne une mortalité de 1,1 à 4 %. Elle s’adresse à des sujets de
plus en plus âgés, avec insuffisance rénale d’origine ischémique,
notamment après échec du traitement médical ou de l’angio-
plastie. Cette dernière est complétée par la pose d’un stent dans
les lésions ostiales ou sur des sténoses résiduelles supérieures à
50 % après angioplastie. Les complications sont de l’ordre de 9 %
dans une série de 92 patients : 3 embolies de cholestérol, 2 throm-
boses de branche artérielle, 1 thrombose du stent, 2 pseudo-ané-
vrismes fémoraux. Une guérison ou une amélioration est obte-
nue dans 59 % des cas.
La préservation de la fonction rénale et l’allègement ou l’arrêt du
traitement antihypertenseur ont été étudiés après pose de stent :
J. Cooper (Tolède) a traité 177 artères rénales sténosées chez
127 patients (PAS 169 ± 3 mmHg) dont 17 hypertensions légères
et 36 bien contrôlées par le traitement médical. La PAS moyenne
de l’ensemble du groupe était réduite, à six mois, à 146 mmHg
(p < 0,0001) et 25 patients n’avaient plus besoin de traitement
médical.
A. Krivitzky
HTA
Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 38

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999
39
HTA DE LA BLOUSE BLANCHE : IMPLICATIONS
Le pronostic et la signification clinique de l’HTA de la blouse
blanche demeurent discutés. L’équipe anglaise de R. Khattar (Har-
row) a suivi 479 patients sur une période moyenne de 9,9 ± 4,2 ans.
L’HTA de la blouse blanche a été diagnostiquée chez 126 patients
ayant une PAS clinique comprise entre 140 et 180 mmHg avec
une PA sur 24 heures à la MAPA < 140/90 mmHg. Les 353 autres
patients avaient une HTA avérée. Au cours du suivi, la majorité
des patients étaient traités. Quatre-vingts pour cent des patients
classés HTA de la blouse blanche étaient mis sous traitement.
Globalement, environ 50 % d’accidents coronariens et 25 % d’ac-
cidents vasculaires cérébraux en moins ont été observés dans le
groupe HTA de la blouse blanche (figure 1). Cette étude a mon-
tré que l’HTA de la blouse blanche a nettement moins d’impli-
cation pronostique que l’HTA avérée. L’étude n’ayant pas inclus
de normotendus, la valeur pronostique de l’HTA de la blouse
blanche reste à démontrer.
L’étude de J. Ruiz Nodar (Madrid) portant sur 271 patients âgés
(65 ans) a évalué les paramètres échocardiographiques dans
l’HTA de la blouse blanche. Une prévalence plus importante
d’hypertrophie ventriculaire gauche a été observée. Les épaisseurs
pariétales et les index de masse dans l’HTA de la blouse blanche
sont plus élevés que chez les sujets âgés normotendus (tableau II).
AUTOMESURE ET TRANSMISSION TRANSTÉLÉPHONIQUE
L’automesure à domicile est une alternative utile à la prise de la
pression artérielle au cabinet. L’inconvénient majeur demeure son
observance. T. Pickering (New York) a suivi 60 patients
(31 femmes et 29 hommes) hypertendus traités et équipés d’un
appareil d’automesure de la PA avec un modem incorporé per-
mettant des transmissions transtéléphoniques des valeurs de pres-
sion artérielle. La concordance diagnostique avec la MAPA dans
l’étude a été de 90 %. L’observance des patients a été excellente.
Plus de 80 % des patients ont “télétransmis” en moyenne au moins
six valeurs de PA par semaine durant les deux mois de l’étude.
La pression artérielle a baissé en moyenne de – 8/– 7 mmHg.
Cette diminution est expliquée par une meilleure observance des
traitements et par un effet lié à l’apprentissage de l’automesure.
L’interrogatoire des médecins participants a montré que ce type
de matériel permettait de faire le diagnostic de l’HTA de la blouse
blanche, de négocier avec le patient la mise sous traitement et
d’adapter la prise en charge en ambulatoire.
M. Bondmass (Chicago), en utilisant le même type d’appareil, a
démontré une amélioration du contrôle tensionnel chez les hyper-
tendus noirs traités non normalisés (PA moyenne de 150,9 + 14,9/
88,5 + 8,7 mmHg) grâce à une prise en charge essentiellement télé-
phonique. Le taux de patients contrôlés à un mois selon les normes
du JNC VI a été de 58 %. L’évolution favorable des chiffres ten-
sionnels a été observée durant les trois mois de l’étude (tableau III).
HYPERTENDUS : IL VAUT MIEUX ÊTRE SOUS BÊTA-
BLOQUANTS AVANT DE FAIRE UN INFARCTUS DU MYOCARDE
Afin d’évaluer si le pronostic suivant le premier infarctus du myo-
carde est influencé par le type de traitement antihypertenseur pres-
crit, G.P. Aurigemma (Worcester) a analysé les dossiers des
3 095 patients de la Worcester Heart Attack Study. De façon sur-
prenante, un antécédent d’HTA n’est pas associé à une mortalité
plus importante au décours d’un IDM. Parmi les traitements anti-
hypertenseurs pris par les patients, seuls les bêtabloquants sont
associés à un meilleur pronostic au décours d’un IDM : 30 % de
réduction de la mortalité précoce (odds-ratio 0,70 ; IC 0,47-1,02)
et de l’insuffisance cardiaque (odds-ratio 0,69 ; IC 0,51-0,92).
L’APRÈS JNC VI
PAS versus PAD comme critère de classification
Une nouvelle classification de l’HTA a été proposée dans le JNC
VI, prenant en compte la PAD et la PAS. En cas de disparité entre
la PAD et la PAS, le patient est souvent “surclassé”. D. Jones
(Framingham) a repris les données de la cohorte Premier Heart
Study des 3 656 patients hypertendus non traités et a effectué une
nouvelle distribution des niveaux tensionnels (tableau IV, p. 40).
Lorsque la PAD était considérée comme normale, 32 % des
patients avaient une PAS élevée, tandis que 4 % avaient une PAD
élevée lorsque la PAS était normale. Chez les 1 295 patients ayant
HTA
16
14
12
10
8
6
4
2
0
% d'événements
Blouse blanche
HTA avérée
AVC Mortalité totaleAccidents
coronariens
Figure 1. Pourcentage d’événements dans les groupes HTA de la blouse
blanche et HTA avérée.
Normotendus Blouse blanche HTA avérée
(22 %) (30 %) (48%)
Épaisseur septum 9,85 10,97 11,84
Paroi postérieure 9,23 10,35 10,98
Index de masse VG 94,9 125,36 136,3
Prévalence HVG 13,2 % 49,1 % 54,3 %
Tableau II. Paramètres échocardiographiques et prévalence de l’HCG.
État basal À un mois À trois mois
PAS (mmHg) 150,9 ± 14,9 142,3 ± 15,6 141 ± 11,1
PAD (mmHg) 88,5 ± 8,7 84,4 ± 8,9 82,9 ± 10,5
Tableau III. Évolution des pressions artérielles.
Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 39

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999
40
HTA
des niveaux tensionnels discordants (PAS et PAD dans des classes
différentes), 89 % étaient dans des catégories d’HTA plus éle-
vées avec la PAS. Dans la catégorie “normale haute”, groupe pou-
vant bénéficier d’une initiation thérapeutique, 94 % des patients
avaient une PAS élevée, contre 33 % pour la PAD, c’est-à-dire
que 66 % des patients de ce groupe étaient définis dans la caté-
gorie “normale haute” avec une PAD strictement normale.
On s’aperçoit que les valeurs de la PAS sortant des différentes
catégories d’HTA définies avec la PAD sont fréquentes. Chez ces
patients utilisant le JNC VI, c’est la PAS qui fait la classification.
En conséquence, la PAS pourrait être un facteur d’éligibilité pour
le traitement.
ÉCHOCARDIOGRAPHIE ET HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Les traitements antihypertenseurs ont bien démontré leurs effets
sur la régression de l’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG)
et sur l’amélioration de la fonction diastolique. Leurs effets sur
la fonction ventriculaire restent à démontrer. La régression de
l’hypertrophie ventriculaire est associée à une amélioration de la
fonction VG. A. Schussheim (New York) a démontré, chez
32 patients ayant une HTA modérée traitée par vérapamil ou nifé-
dipine, avec une fonction systolique normale et sans pathologie
cardiaque associée, qu’une régression de l’HVG de l’ordre de
25 g s’accompagnait d’une amélioration de la contractilité myo-
cardique malgré les effets inotropes négatifs des médicaments
utilisés. La fraction de raccourcissement (midwall fractional shor-
tening) s’est améliorée durant les six mois de l’étude (tableauV).
La fonction diastolique et la fréquence cardiaque n’ont pas été
étudiées en raison des faibles effectifs. On peut s’interroger sur
les effets plus directs du vérapamil par son action sur la perfu-
sion myocardique durant le temps diastolique.
Cette amélioration, qui a été confirmée par le travail de M. Muie-
san (Brescia) chez 33 patients hypertendus ayant une régression
de l’HVG, persiste même après arrêt du traitement antihyperten-
seur avec remontée des chiffres tensionnels.
Lors de l’HVG, il a été décrit une réduction de la perfusion myo-
cardique. Celle-ci semble être liée à une altération de la capacité
fonctionnelle. O. Akinboboye (New York) a comparé la réserve
coronaire couplée à une épreuve d’effort pour mesurer la
VO2max chez sept patients hypertendus avec HVG et sept sujets
normaux. Les valeurs sont plus basses chez les patients avec HVG.
Il existe une corrélation directe entre la réserve coronaire et la
VO2max (r = 0,651). G. Nguyen
Normale
Normale haute
Stade I Stade II
< 85 mmHg 85-89 mmHg 90-99 mmHg 100 mmHg
Normale
< 130 mmHg 2 168 74 14 0
Normale haute
130-139 mmHg 518 75 45 0
Stade I
140-159 mmHg 394 92 95 6
Stade II
160 mmHg 86 27 39 23
Tableau IV. Distribution des patients en fonction des différentes
catégories d’HTA du JNC VI.
PAD
PAS
État basal À 3 mois À 6 mois
PA (mmHg) 168/104 144/90 147/91
Masse VG (g) 155 144 138
mFS (%) 16,3 17,1 18,1
Tableau V. Évolution des paramètres échocardiographiques.
mFS = midwall fractional shortening.
Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 40
1
/
4
100%