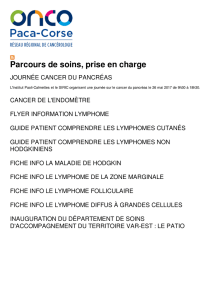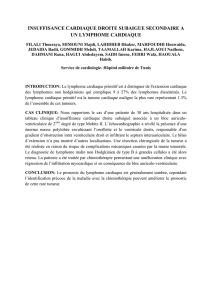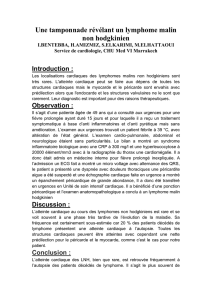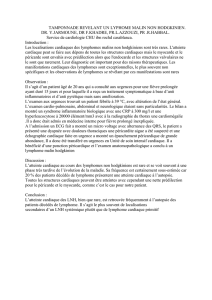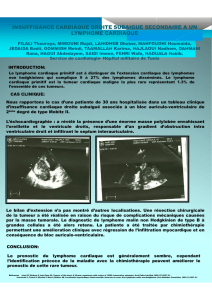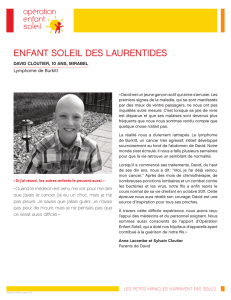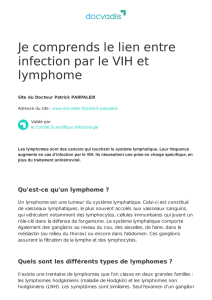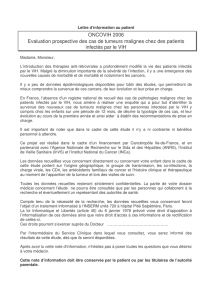Épidémiologie et prise en charge des lymphomes associés au VIH

dossier thématique
Hémopathies malignes
chez les sujets
immunodéprimés
Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013
120
Épidémiologie et prise en charge
des lymphomes associés au VIH
Epidemiology and management of HIV-associated lymphomas
J.M. Michot*, O. Lambotte*
* Service de médecine
interne et d’immunologie
clinique, CHU Bicêtre,
Le Kremlin-Bicêtre.
RÉSUMÉ
Summary
»
Les lymphomes associés au VIH sont un des principaux modèles
de lymphomagenèse induite par immunodépression acquise.
Ils restent actuellement une des complications les plus graves
de l’infection par le VIH, et sont une des principales causes de
décès des patients infectés par le VIH dans les pays occidentaux.
Il s’agit d’hémopathies B agressives et de présentation clinique
très variée. Les entités histologiques rencontrées sont les
lymphomes de Hodgkin, les lymphomes B à grandes cellules, les
lymphomes de Burkitt et les proliférations lymphoïdes associées
à HHV-8. Le pronostic s’est considérablement amélioré depuis
1996 (introduction des trithérapies antirétrovirales), rejoignant
progressivement celui des patients non infectés par le VIH.
Le traitement doit être adapté à chaque patient selon ses
comorbidités et son statut immunitaire.
Mots-clés : VIH – Lymphome B – Immunodépression – Lympho ma-
genèse.
HIV associated lymphomas are a major model of
lymphomagenesis induced by an acquired immunodeficiency.
These lymphomas remain currently a life threatening
condition occurring in the course of HIV infection, and are
main cause of death in HIV-infected patients in western
countries. They are aggressive B lymphoproliferations,
occurring with polymorphic clinical presentation. The cyto-
histological entities are Hodgkin lymphoma, diffuse large B
cell lymphoma, Burkitt’s lymphoma and lymphoproliferative
diseases associated with HHV-8. The prognosis has
considerably improved since 1996 (introduction of high
active antiretroviral therapy), gradually reaching non-HIV
infected patients. Treatment should be tailored to each patient
according to comorbidities and immune status.
Keywords: HIV – B lymphoma – Immunocompromised patient
– Lymphomagenesis.
L
es proliférations lymphoïdes sont une complica-
tion importante de l’infection par le VIH. Depuis
l’avènement des trithérapies antirétrovirales,
la survie des patients souffrant d’un lymphome a été
considérablement améliorée, et, globalement, la prise
en charge thérapeutique et le pronostic tendent à deve-
nir similaires à ceux des patients non infectés par le VIH
(1, 2). Néanmoins, les lymphomes survenant au cours
de l’infection par le VIH ont la particularité d’être très
hétérogènes dans leur présentation clinique et histo-
logique, mais également dans leur pronostic.
Épidémiologie
En 2011, avec 34 millions de personnes vivant avec le
VIH (dont la moitié ignore sa séropositivité), 2,5 millions
de nouvelles infections et 1,7 million de décès dus au
VIH, l’épidémie n’est pas sous contrôle ; elle continue
sa progression (figure 1) [3].
L’incidence des lymphomes non hodgkiniens (LNH)
chez les patients infectés par le VIH est 60 à 200 fois plus
élevée que chez les patients non infectés (4). Dans les
années 1990, environ 10 % des patients infectés par le
VIH développaient un lymphome au cours de l’évolu-
tion naturelle de la maladie VIH. Depuis l’utilisation des
combinaisons efficaces d’antirétroviraux dans le milieu
des années 1990, l’incidence des LNH a profondément
chuté et tend à se stabiliser. Inversement, l’incidence
de la maladie de Hodgkin est en légère augmenta-
tion (5-7). L’incidence des lymphomes reste inférieure
à celle des autres pathologies opportunistes, comme
la tuberculose (figure 2). En dehors de l’infection par
le VIH, les lymphomes sont au sixième rang des can-
cers les plus fréquents, mais ils passent au premier
rang chez les patients infectés par le VIH, avec une
incidence estimée de 3 pour 1 000 patients-année (8).
L’enquête prospective ONCOVIH de 2006 indique que
les lymphomes sont la principale tumeur survenant
chez les patients infectés par le VIH, devant la maladie

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013
121
Épidémiologie et prise en charge des lymphomes associés au VIH
de Kaposi, le cancer pulmonaire et le cancer anal (8).
Les lymphomes représentent également la principale
cause de décès (25 %) des patients adultes morts du
sida en France en 2010 (9).
La plupart des proliférations lymphoïdes survenant au
cours de l’infection par le VIH sont des lymphomes B
agressifs. Les hémopathies lymphoïdes B de bas grade
et les lymphomes T sont exceptionnels et ne semblent
pas significativement associés à l’infection par le VIH
(10, 11). Alors que certaines proliférations surviennent
principalement chez des patients sévèrement immuno-
déprimés (lymphome cérébral primitif, lymphome B
à grandes cellules de phénotype immunoblastique,
proliférations lymphoïdes associées au HHV-8), d’autres
surviennent malgré une immunité conservée ou res-
taurée (lymphome de Hodgkin [LH], lymphome de
Burkitt) [10].
Le sex-ratio (rapport H/F) est fortement déséquilibré
concernant le lymphome et la maladie de Kaposi, avec
respectivement un rapport à 4,5 et 7 hommes pour
1 femme (12). Ce déséquilibre ne se retrouve pas dans
les autres pathologies opportunistes.
Physiopathologie
Il y a une association forte et linéaire entre le déficit
immunitaire et le risque de développer un LNH au
cours d’une immunodépression, qu’elle soit congéni-
tale ou acquise (infection par le VIH, transplantation
d’organe) [13]. Une étude a montré que l’incidence
du LNH à grandes cellules B passe de 15 à 253 pour
10 000 patients-année et celle du lymphome primitif
cérébral, de 2 à 94 pour 10 000 patients-année, lorsque
le taux de lymphocytes T CD4 (LT CD4) est de 350/mm
3
versus 50/mm3 (13). Lorsque le VIH est présent, la
lymphomagenèse fait intervenir de multiples méca-
nismes. Le VIH induit un état de stimulation antigénique
chronique au sein du système immunitaire, comme en
témoignent la lymphadénopathie persistante généra-
lisée et l’hypergammaglobulinémie chez les patients
virémiques. De plus, l’étude du réarrangement des
gènes des immunoglobulines des LNH associés au VIH
montre une surreprésentation importante de la famille
IGHV4 et un taux élevé de mutations somatiques, ce
qui est en faveur du mécanisme “antigène induit” de la
lymphoprolifération (14). Une sécrétion de cytokines
pro-inflammatoires (interleukine [IL] 6 en particulier)
au cours de l’infection par le VIH a été montrée il y
a de nombreuses années. Cet état peut conduire à
l’émergence de lymphocytes B monoclonaux et de
lymphomes B (15).
La co-infection par des virus oncogènes est un autre
facteur. La protéine LMP-1 du virus d’Epstein-Barr (EBV)
est présente dans quasiment toutes les cellules tumo-
rales des LH, des lymphomes B primitifs cérébraux ou
dans le sous-type immunoblastique des lymphomes B
diffus à grandes cellules (10). De même, le virus HHV-8
est retrouvé dans les cellules du lymphome plasmablas-
tique ou du lymphome des séreuses (16).
Des altérations génétiques sont également de plus
en plus fréquemment décrites, comme l’activation du
gène c-Myc dans le lymphome de Burkitt (17). Enfin,
une dysrégulation cytokinique pourrait favoriser la
Figure1. Prévalence de l’infection par le VIH dans le monde selon le rapport Onusida 2012 (3).
Nombre de personnes (millions)
40
35
30
25
20
15
10
5
Personnes vivant avec le VIH
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Figure2. Évolution des incidences des lymphomes et de la tuberculose chez les patients infectés
par le VIH en France (3, 8, 12).
Incidence pour 10 000 patients-année
LNH
Maladie de Hodgkin
Tuberculose
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Hémopathies malignes
chez les sujets
immunodéprimés
dossier thématique
Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013
122
lymphomagenèse dans la mesure où des taux élevés
d’IL-6 et d’IL-10 ont été constatés au cours de certaines
proliférations lymphoïdes associées à l’EBV ou au HHV-8
dans le cadre de l’infection par le VIH (10).
Diagnostic et évaluation
Le diagnostic de lymphome repose sur l’analyse histo-
logique d’un tissu pathologique. Compte tenu du
grand polymorphisme anatomopathologique des
lymphomes associés au VIH, il faut s’efforcer d’obtenir
une analyse précise à partir d’un prélèvement suffi-
sant et de bonne qualité. Pour cela, l’analyse sera faite
préférentiellement à partir d’une exérèse chirurgicale
plutôt que d’une biopsie à l’aiguille fine. La conser-
vation d’un prélèvement frais et d’un autre congelé
est la règle, afin de pouvoir réaliser une analyse cyto-
génétique, notamment en hybridation in situ (FISH),
et des études de biologie moléculaire (réarrangement
de l’oncogène c-myc). En cas de lymphome de Burkitt
avéré sur un myélogramme, cet examen (assorti de
la cytogénétique et de la biologie moléculaire) peut
suffire à établir le diagnostic (18).
Trois urgences vitales, qui nécessitent souvent le
recours immédiat à un service de réanimation spé-
cialisé et un traitement sans délai, sont à rechercher
dans la prise charge initiale d’un patient suspect de
lymphome associé au VIH. Il s’agit du syndrome d’acti-
vation lymphohistiocytaire − devant des cytopénies
fébriles −, du syndrome de lyse tumorale spontané −
devant une insuffisance rénale avec hyperuricémie −, et
d’une atteinte neurologique spécifique du lymphome
− devant une atteinte des paires crâniennes.
L’examen clinique note le statut OMS et les aires gan-
glionnaires atteintes, et recherche une atteinte du foie
et de la rate. Une atteinte extranodale doit être recher-
chée attentivement, en raison de la grande hétéro-
généité de présentation clinique possible. L’examen
neurologique est systématique, avec notamment la
recherche du “signe de la houppe du menton”, qui
signe une infiltration du nerf dentaire inférieur, fré-
quente dans le lymphome de Burkitt. Les examens
hématologiques recherchent une phase leucémique
de lymphome (par frottis sanguin et immunophénoty-
page), et il est important de rechercher en biochimie
un syndrome de lyse spontanée en plus de la mesure
du taux de lactate déshydrogénase (LDH) et de l’éva-
luation des fonctions rénale et hépatique. Le bilan
d’extension doit être réalisé aussi vite que possible,
sans retarder le début du traitement. L’imagerie par
scanner thoraco-abdominal et pelvien est indispen-
sable, et une TEP est recommandée (17, 19). La biopsie
ostéomédullaire doit être pratiquée systématiquement
pour rechercher un envahissement médullaire. En cas
de lymphome B à grandes cellules ou de lymphome
de Burkitt, la ponction lombaire recherche un enva-
hissement méningé.
Une série d’examens est nécessaire pour déterminer
le statut des co-infections et obtenir les données pré-
thérapeutiques nécessaires au choix du traitement
chimiothérapeutique : taux de LT CD4 et charge virale
du VIH, sérologies des hépatites B et C, PCR cyto-
mégalovirus (CMV) plasmatique, PCR HHV-8 et EBV
plasmatiques, évaluation des fonctions cardiaque,
hépatique et respiratoire. En cas d’immunodépression
sévère (taux de LT CD4 < 100/mm3), le bilan d’extension
du lymphome doit être complété par une recherche
attentive d’infections opportunistes.
Lymphome non hodgkinien
Le lymphome B diffus à grandes cellules est le prin-
cipal type de lymphome associé au VIH (tableau)
[8, 10, 20]. La présentation clinique peut être très
variée, avec des formes extranodales viscérales fré-
quentes (tube digestif, système nerveux, foie, etc.)
[20]. L’immunohistochimie montre que les LNH sont
polymorphes, souvent riches en cellules immuno-
blastiques et plasmocytaires. L’intérêt de l’utilisation
conjointe du rituximab et de la polychimiothérapie est
probable, mais elle impose une vigilance particulière
concernant le risque infectieux chez les patients les
plus immunodéprimés (LT CD4 < 100/mm3) [21, 22].
En cas de facteurs de mauvais pronostic, une inten-
sification thérapeutique avec autogreffe de cellules
souches peut être envisagée.
Le lymphome primitif cérébral est une forme parti-
culière, rencontrée uniquement en cas d’immuno-
dépression profonde, et reste le diagnostic différentiel
Tableau. Les différents types de lymphoproliférations survenant au cours de l’infection par le VIH
(8, 10, 20).
Types histologiques Sous-types Fréquence (%)
LNH
•Lymphome B diffus à grandes cellules
•Lymphome de Burkitt
•Lymphome primitif cérébral
40
20
5
Lymphoproliférations
associées à l’HHV-8
•Maladie de Castleman
•Lymphome plasmablastique
•Lymphome des séreuses
10
Lymphome de Hodgkin
•Cellularité mixte
•Scléronodulaire
•Déplétion lymphocytaire
25

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013
123
Épidémiologie et prise en charge des lymphomes associés au VIH
principal de la toxoplasmose cérébrale (23). Le lym-
phome primitif cérébral doit être traité par des médica-
ments diffusant dans le système nerveux central (SNC)
par monochimiothérapie à base de méthotrexate ou
de cytarabine à fortes doses ou par polychimiothérapie
(régime CHOP-méthotrexate) [17, 23, 24].
Lymphome de Burkitt
Ce type de lymphome est extrêmement agressif, en rai-
son d’un temps de doublement des cellules tumorales
très rapide (moins de 48 heures) et d’une propension
à toucher l’ensemble des organes, et spécialement le
SNC (atteinte méningée ou de la base du crâne). Une
prise en charge immédiate dans un service de soins
intensifs spécialisés est nécessaire du fait du régime
de polychimiothérapie intensive requis pour obtenir
la rémission dans plus de la moitié des cas.
Lymphome de Hodgkin
Contrairement aux LNH, l’incidence du LH au cours de
l’infection par le VIH ne décroît pas depuis l’introduction
des antirétroviraux (2, 17). Le LH ne semble donc pas
seulement lié à l’immunodépression cellulaire, et ne fait
d’ailleurs pas partie des pathologies classantes des évé-
nements sida. Les hommes sont plus souvent touchés
que les femmes quelle que soit la période étudiée (5).
Les patients infectés par le VIH développent nettement
plus souvent le sous-type histologique à cellularité mixte
de la forme classique du LH (7, 25). L’EBV est presque
toujours présent au sein des cellules tumorales. La pré-
sentation clinique initiale est différente chez les patients
infectés par le VIH : les formes disséminées (stade IV)
sont plus fréquentes, et la maladie peut être accompa-
gnée d’un syndrome d’activation lymphohistiocytaire,
ce qui constitue un élément de gravité (7).
Proliférations lymphoïdes associées
au HHV-8
Les différentes études épidémiologiques font apparaître
une prévalence relativement faible de l’infection par
le virus HHV-8 dans les pays occidentaux (5 % chez les
donneurs de sang dans la région parisienne). La pré-
valence est en revanche plus importante (de l’ordre de
50 %) en Afrique noire et chez certains groupes à risque
de transmission sexuelle (homosexuels masculins) de
grandes villes occidentales comme San Francisco (26).
La maladie de Castleman multicentrique est une pro-
lifération lymphoïde histologiquement bénigne, mais
cliniquement parfois très grave. La sévérité clinique
est liée au syndrome d’activation lymphohistiocytaire
qui accompagne souvent les poussées de la maladie
(27). L’histologie montre une hyperplasie angiofollicu-
laire en forme de bulbe d’oignon caractéristique. La
maladie de Castleman est rencontrée chez les sujets
co-infectés par le VIH et l’HHV-8 (essentiellement des
homosexuels masculins ou des patients originaires
des pays d’Afrique noire à forte prévalence pour cette
infection). La maladie de Castleman est associée dans
75 % des cas à une maladie de Kaposi clinique (20). La
maladie peut initialement évoluer par poussées spon-
tanément résolutives, et revêt la présentation clinique
d’un lymphome ou d’une autre pathologie d’origine
infectieuse. Le début de la poussée est en général assez
stéréotypé, marqué par de la fièvre, des signes respira-
toires (obstruction nasale, toux, dyspnée), une polyadé-
nopathie périphérique, une splénomégalie parfois très
volumineuse, l’apparition d’un syndrome œdémateux
ou de sérites. Les formes les plus sévères sont associées
à un syndrome d’activation lympho histiocytaire, néces-
sitant un traitement spécifique de toute urgence par
chimiothérapie (étoposide). La maladie de Castleman
multicentrique peut évoluer vers des proliférations
lymphoïdes agressives associées à l’HHV-8, rares mais
particulièrement graves, comme le lymphome plasma-
blastique. Le rituximab est efficace et semble protéger
contre le risque d’évolution de la maladie de Castleman
vers le lymphome agressif (27, 28).
L’HHV-8 est également associé au lymphome des
séreuses, qui infiltre la plèvre, le péritoine ou le péri-
carde. Il existe également des formes extracavitaires ou
solides. La cytologie ou l’anatomopathologie retrouvent
de grandes cellules lymphoïdes B particulières avec un
phénotype aberrant, avec une absence fréquente de
marqueurs pan-B (CD19, CD20 ou CD79a) et l’expression
d’HLA-DR, CD30 et CD38 (29). Le pronostic est péjoratif,
malgré la polychimiothérapie généralement par CHOP
et méthotrexate à haute dose (30).
Pronostic
La plupart des études soulignent que les 3 facteurs
pronostiques principaux des lymphomes B associés
au VIH sont le taux de CD4, un antécédent de sida et
le score ECOG (31, 32). La survie à 2 ans des patients
infectés par le VIH et traités pour un lymphome B à
grandes cellules varie de 40 à 75 % selon les princi-
paux facteurs pronostiques (mentionnés ci-dessus)

Hémopathies malignes
chez les sujets
immunodéprimés
dossier thématique
www.edimark.fr
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition
Périodique de formation
Société éditrice : EDIMARK SAS
CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820
Bimestriel
Prix du numéro : 39 €
DPC
Vol. VIII - n° 2 - Mars-avril 2013
www.edimark.fr
DOSSIER
Toute l’actualité
de votre spécialité sur
www.edimark.tv
Maladies incipiens
Coordonné par Noël Milpied
•
Entre cancer biomédical et cancer vécu :
peut-on, et comment, dire au patient
qu’il n’est pas malade ?
– L. Perino
•
Lymphocytose monoclonale B : une entité complexe
M.S. Dilhuydy
•
Lymphome folliculaire à ses débuts :
lymphomagenèse et prise en charge – R. Houot, K. Tarte
•
Gammapathies monoclonales
de signification indéterminée
G. Fouquet, S. Guidez, C. Herbaux, H. Demarquette, X. Leleu
•
Myélome multiple indolent
G. Fouquet, S. Guidez, C. Herbaux, H. Demarquette, X. Leleu
… tout le sommaire
www.edimark.fr
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition
Périodique de formation
Société éditrice : EDIMARK SAS
CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820
Bimestriel
Prix du numéro : 39 €
Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013
DPC
Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013
www.edimark.fr
DOSSIER
Toute l’actualité
de votre spécialité sur
www.edimark.tv
Hémopathies malignes
chez les sujets immunodéprimés
Coordonné par Sylvain Choquet
•
Épidémiologie et prise en charge des lymphomes
associés au VIH
– J.M. Michot, O. Lambotte
•
Quels déficits immunitaires héréditaires faut-il
rechercher lors du diagnostic de lymphome
chez un adulte jeune ? – F. Touzot
•
Lymphoproliférations après transplantation
S. Choquet
•
Prise en charge des lymphoproliférations du VIH
J. Reure, N. Mounier
… tout le sommaire
Abonnez-vous sur
www.edimark.fr
Prochain numéro
Parution en septembre
Dossier thématique :
Formes familiales
d’hémopathies malignes
Coordonné par Thierry Leblanc
124
Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013
[21, 31]. Le pronostic dépend également du score IPI
(International Prognostic Index) et diffère selon le sous-
type histologique. Les lymphomes associés à l’HHV-8
sont de pronostic particulièrement sombre (10, 17).
Cependant, le statut immunitaire de la grande majorité
des patients s’est amélioré depuis l’utilisation efficace
des combinaisons d’antirétroviraux, et le pronostic des
lymphomes associés au VIH tend à devenir similaire à
celui des patients non infectés par le VIH. Il existe un
bénéfice en termes de survie en faveur de l’utilisation
des antirétroviraux pour corriger le déficit en LT CD4
dans le cadre des lymphomes associés au VIH. Le déficit
immunitaire doit être corrigé aussi vite que possible ; la
charge virale VIH indétectable est associée à un meil-
leur pronostic (33). La survie des patients est meilleure
quand les antirétroviraux sont poursuivis ou instaurés
pendant la chimiothérapie (31, 33).
Conclusion
L’incidence des lymphomes associés au VIH est en
nette diminution depuis l’utilisation efficace des tri-
thérapies antirétrovirales efficaces, mais ils restent la
principale cause de mortalité du sida dans les pays
occidentaux. L’hétérogénéité des lymphomes associés
au VIH impose un choix du traitement adapté à chaque
patient.
■
RÉSUMÉ
Les auteurs n’ont pas précisé
leurs éventuels liens d’intérêts.
1.Lim ST, Karim R, Tulpule A et al. Prognostic factors in HIV-
related diffuse large-cell lymphoma: before versus after highly
active antiretroviral therapy. J Clin Oncol 2005;23(33):8477-82.
2.Gérard L, Galicier L, Boulanger E et al. Improved survival
in HIV-related Hodgkin’s lymphoma since the introduction
of highly active antiretroviral therapy. AIDS 2003;17(1):81-7.
3.Onusida. Rapport Onusida sur l’épidémie mondiale de
sida, 2012.
4.
Beral V, Peterman T, Berkelman R et al. AIDS-associated non-
Hodgkin lymphoma. Lancet 1991;337(8745):805-9.
5.
Herida M, Mary-Krause M, Kaphan R et al. Incidence of non-
AIDS-defining cancers before and during the highly active
antiretroviral therapy era in a cohort of human immunodefi-
ciency virus-infected patients. J Clin Oncol 2003;21(18):3447-53.
6.Engels EA, Pfeiffer RM, Goedert JJ et al. Trends in cancer risk
among people with AIDS in the United States 1980-2002. AIDS
2006;20(12):1645-54.
7.Mounier N, Spina M, Spano JP. Hodgkin lymphoma in HIV
positive patients. Curr HIV Res 2010;8(2):141-6.
8.
Lanoy E, Spano JP, Bonnet F et al. The spectrum of malignan-
cies in HIV-infected patients in 2006 in France: the ONCOVIH
study. Int J Cancer 2011;129(2):467-75.
9.Roussillon C. Causes de décès des patients infectés par le VIH
en France en 2012. Étude ANRS EN20 mortalité 2010.
10.
Carbone A, Gloghini A. AIDS-related lymphomas: from
pathogenesis to pathology. Br J Haematol 2005;130(5):662-70.
11.
Gilardin L, Copie-Bergman C, Galicier L et al. Peripheral
T-cell lymphoma in HIV-infected patients: a study of 17 cases
in the combination antiretroviral therapy era. Br J Haematol
2013 (Epub ahead of print).
12.Lot F. Les pathologies inaugurales de sida, France, 2003-
2010. InVS 2011;43-4.
13.
Besson C, Goubar A, Gabarre J et al. Changes in AIDS-
related lymphoma since the era of highly active antiretroviral
therapy. Blood 2001;98(8):2339-44.
14.
Capello D, Martini M, Gloghini A et al. Molecular analysis of
immunoglobulin variable genes in human immunodeficiency
virus-related non-Hodgkin’s lymphoma reveals implications
for disease pathogenesis and histogenesis. Haematologica
2008;93(8):1178-85.
Références
Retrouvez l’intégralité
des références bibliographiques
sur www.edimark.fr
@
 6
6
1
/
6
100%