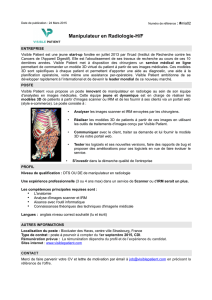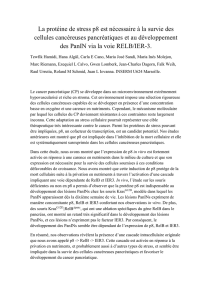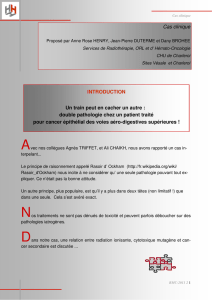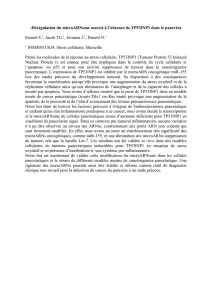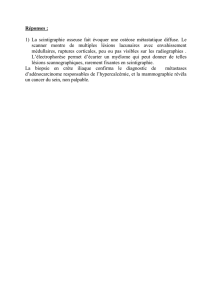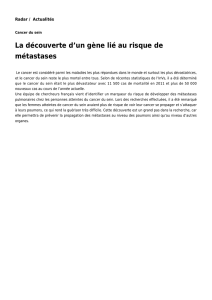Journées Françaises de Radiologie C Paris, 3-7 novembre 1997 O

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 199862
C
O N G R È S
Les techniques d’imagerie effectuent actuellement des progrès
rapides, notamment grâce aux avancées de l’informatique dévo-
lue au traitement du signal. La coloscopie virtuelle remplacera-
t-elle un jour prochain la coloscopie, en particulier dans le cadre
du dépistage ?
Voici un aperçu des principaux travaux présentés dans le domai-
ne de l’hépato-gastroentérologie au récent congrès de radiologie.
L’IMAGERIE DU TUBE DIGESTIF
Séances dirigées par P.J.Valette (Lyon),V.Vilgrain (Clichy), G. Schmutz
(Caen) et P.Taourel (Montpellier)
L’échographie du tube digestif a bénéficié de l’amélioration
des sondes de hautes fréquences pour différencier les différentes
couches pariétales comme en écho-endoscopie (la muqueuse et
la musculeuse hypoéchogène, la sous-muqueuse hyperéchogè-
ne). Le caractère non invasif, la disponibilité des examens écho-
graphiques, et l’augmentation des compétences des opérateurs
expliquent l’augmentation des performances diagnostiques dans
la pathologie appendiculaire, mais également dans les sigmoï-
dites, les iléites et les colites. Dans le contexte de l’urgence des
douleurs de la fosse iliaque droite ou gauche atypiques (sur les
seules données cliniques ou biologiques), il s’agit de l’examen
de première intention. Dans ces contextes, l’échographie est
Journées Françaises de Radiologie
Paris, 3-7 novembre 1997
•G. Genin

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 1998 63
également utile pour éliminer une pathologie extra-digestive
(colique néphrétique, cholécystite, pathologie tubo-ovarienne),
pour reconnaître des lésions non chirurgicales comme une adé-
nolymphite mésentérique chez l’enfant ou une banale appen-
dicite épiploïque chez l’adulte. Si l’échographie apparaît très
performante dans l’étude des épaississements pariétaux intes-
tinaux, elle peut sous-estimer la souffrance pariétale (et
notamment méconnaître des micro-pneumo-péritoines, une
aéroportie ou une pneumatose pariétale) et surtout rester aspé-
cifique. Les hématomes sous-muqueux du tube digestif (non
traumatiques, à l’inverse des lésions traumatiques sous-
séreuses) sont facilement reconnus par le contexte clinique
chez l’enfant (purpura rhumatoïde, syndrome hémolytique et
urémique) comme chez l’adulte (essentiellement les anticoa-
gulants, le purpura thrombotique thrombocytopénique ou le
syndrome hémolytique et urémique de l’adulte, en particulier
dans les cancers prostatiques, ou toutes autres anomalies de la
crase sanguine). En revanche, en présence d’un syndrome
diarrhéique ou hémorragique, la différenciation entre une coli-
te ischémique et une colite bactérienne (notamment les colites
à E. Coli de sérotype O157 : H7 responsables de diarrhées san-
glantes) reste très difficile, car souvent l’aspect échographique
se limite à un aspect congestif de la sous-muqueuse aspéci-
fique (comme dans une rectocolite hémorragique ou une coli-
te au glutaraldéhyde).
L’infiltration de la graisse mésentérique est très utile
pour reconnaître une pathologie infectieuse. Même si ces
anomalies sont recherchées de mieux en mieux par les
échographistes, le scanner reste l’élément de référence
pour l’étude des infiltrations des différents mésos, quel
que soit le morphotype du patient, quels que soient leurs
m é c a n i s m e s : surtout une pathologie infectieuse et/ou
inflammatoire, mais aussi une anomalie du retour veineux
dans une torsion intestinale, une infiltration séro-héma-
tique dans une souffrance pariétale ischémique (veineuse
ou artérielle), une sclérolipomatose, une panniculite
mésentérique, une appendicite épiploïque ou une torsion
du grand épiploon. La qualité diagnostique du scanner
dans les syndromes hyperalgiques de l’appendicite épi-
ploïque comme pour la torsion du grand épiploon permet
de surseoir à une intervention chirurg i c a l e .
Le scanner reste le document essentiel pour l’étude des espaces
péri-digestifs et il est fondamental dans la recherche d’une per-
foration d’organe creux pour reconnaître des micro-pneumo-
péritoines. La place du scanner hélicoïdal dans l’étude du tube
digestif n’apparaît pas déterminante comme dans les patholo-
gies hépatiques ou pancréatiques. Cette exploration hélicoïdale
(avec reconstructions) est toutefois utile pour les syndromes
occlusifs pour mieux définir le siège et la nature de l’obstruction
intestinale.
En pratique : on tend actuellement à faire converger les
auteurs vers une complémentarité des examens échogra-
phique et scanographique. Mais dans cette “cuisine” radiolo-
gique, quel devrait être le premier plat ? Chez l’enfant, il
s’agit sans nul doute de l’exploration échographique, et de
même pour un adulte (et a fortiori pour une femme) pour l’ex-
ploration de la pathologie vésiculaire et des urgences des
fosses iliaques ou du pelvis. En revanche, en présence de dou-
leurs épigastriques violentes, ou devant la crainte de la perfo-
ration d’un organe creux, l’exploration scanographique est à
réaliser en priorité pour la recherche d’un pneumopéritoine
“infra-radiologique”, d’un ulcère perforé gastroduodénal, ou
d’une pancréatite. Pour de nombreux auteurs, l’exploration
scanographique est privilégiée également dans l’exploration
initiale des syndromes occlusifs et la recherche d’une maladie
diverticulaire compliquée.
LA CHOLANGIO-IRM :UN AVENIR CERTAIN !
Séances animées par P. Bret (Toronto) et D.Régent (Nancy)
Pourquoi ? La cholangiographie IRM a bénéficié des récents
progrès technologiques et de nombreuses études d’évaluation
clinique, avec une très bonne concordance interobservateur sur
toutes les séries présentées, de rares erreurs diagnostiques en
confrontation avec le cathétérisme rétrograde, permettant
d’avoir une exploration globale des voies biliaires, même péri-
phériques, et des voies pancréatiques, avec une aisance dia-
gnostique du niveau de l’obstacle ou de sa nature. Le but de
cette exploration est de mieux définir les indications ou les stra-
tégies thérapeutiques ultérieures.
Quand ? Toute pathologie obstructive biliaire peut faire l’objet
d’une investigation, quel que soit l’état clinique du patient
puisque sa coopération n’est plus nécessaire avec la pratique du
“Single Shot” (avec des coupes de moins de 2 secondes). Les
ambitions de la cholangio-IRM sont de définir la meilleure thé-
rapeutique ultérieure devant tout syndrome obstructif bilio-pan-
créatique, avant toute autre procédure invasive, en assurant des
performances diagnostiques au moins équivalentes à celles du
cathétérisme rétrograde ou de la cholangiographie percutanée.
Toutefois, la disponibilité de l’IRM ou l’absence de remise à
niveau de ces appareillages (pour ces nouvelles séquences) reste
un obstacle incontournable pour beaucoup de structures
publiques (même en CHU) ou privées. Il faut mentionner éga-
lement la performance actuelle de la cholangio-IRM pour l’étu-
de des anastomoses bilio-digestives et la visualisation des voies
biliaires périphériques qui fait souvent défaut dans les explora-
tions rétrogrades (surtout en cas de cholangite ou de tumeur
hilaire). Certains auteurs proposent également la cholangio-
IRM comme un examen de dépistage des cholangites scléro-
santes des entéropathies inflammatoires chroniques (surtout

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 1998 65
dans la rectocolite hémorragique) devant toute anomalie du
bilan biologique hépatique, mais le problème du diagnostic de
la dégénérescence en cholangiocarcinome n’est pas résolu.
C o m m e n t ?On doit retenir la tendance actuelle en faveur des
coupes épaisses, souvent de 10 à 20 mm, avec un TE très long
de plus de 500 ms (jusqu’à 1100 ms) pour réduire tous les arte-
facts veineux (hépatiques ou portaux) et ne reconnaître que les
“structures liquidiennes stagnantes” (biliaire ou vésiculaire).
Les principaux plans de référence sont les plans frontal et
frontal-oblique, plus rarement sagittal. Secondairement, on
peut utiliser les coupes fines axiales, notamment pour préciser
l’extension des cholangiocarcinomes de la voie biliaire princi-
pale (selon la classification de Bismuth). La technique des
coupes épaisses en Single Shot Fast Spin Echo (SSFSE) a
l’avantage d’une simplicité de lecture en supprimant notam-
ment l’étape des reconstructions (MIP).
Des limites ? Les seules limites diagnostiques actuelles sont
la reconnaissance des microlithiases de moins de 2 mm, l’in-
dividualisation d’une pathologie ampullaire et les artefacts
d’hyposignal (pseudolithiasique) des aérobilies, du sludge
ou de la boue biliaire conglomérée.
LA COLOSCOPIE VIRTUELLE : DES PROGRÈS À SUIVRE
Séance animée par V.Vilgrain (Clichy) et J. Pringot (Bruxelles)
Il s’agit d’une acquisition volumique à partir d’une explo-
ration TDM spiralée. Le but n’est pas seulement de pallier
les échecs d’une coloscopie mais de “s’attaquer” égale-
ment au dépistage des polypes par une méthode peu inva-
sive (avec une faible valeur prédictive négative). La pré-
paration colique est identique à celle d’une endoscopie.
Une acquisition scanographique hélicoïdale est nécessaire
sur près de 40 cm de hauteur, avec une irradiation mini-
male. Cette méthode va explorer également la totalité du
cadre colique, même en présence d’une sténose “infran-
chissable”. L’association des différentes méthodes de
reconstruction semble prometteuse. Des constructeurs
proposent un logiciel (“navigator”) pour se promener
même dans un dolicho-côlon. La définition du seuil de
segmentation idéale reste à définir pour la fiabilité du
dépistage de petites formations polypoïdes.
L’interprétation des coupes axiales transverses permet de
mieux reconnaître les résidus fécaux. Les problèmes
actuels restent les polypes plans, les petits polypes mas-
qués par une haustration colique, les résidus liquidiens ou
un défaut d’expansion aérique du côlon. On atteint une
sensibilité de 75 % pour des polypes de plus de 10 mm. La
relecture a pu montrer également des faux négatifs de
l’endoscopie, pourtant considérée comme le “Gold
Standard”. Il s’agit donc d’une investigation sérieuse mais
une amélioration de la préparation colique et un long
apprentissage de lecture paraissent indispensables pour
augmenter les performances de la méthode.
IMAGERIE DU FOIE :PEU DE RÉVOLUTION
Séance animée par Y. Menu (Clichy) et L. Engelhom (Belgique)
Le point de vue du chirurgien : une “aff a i r e de spécialiste”
(J. Belghiti, Clichy). Il existe une importante extension des
indications chirurgicales dans les métastases hépatiques qui
met les radiologues en première ligne pour la qualité des bilans
d’extension préopératoires. La chirurgie des métastases
coliques augmente considérablement la survie des patients
avec des métastases uniques et même multiples. La mortalité
opératoire est actuellement très basse (1 à 2 %) pour des méta-
stases uniques. La marge de résection conditionne la survenue
de récidive et serait également un facteur d’échec des traite-
ments locaux. Une embolisation portale permet d’élargir ces
indications aux patients ayant moins de 30 % de foie sain en
p r é o p é r a t o i r e ; le drainage biliaire peut également augmenter le
volume de foie restant. Il existe toujours un débat chirurg i c a l
pour la prise en charge du cancer colique avec des métastases
hépatiques synchrones (en dehors des métastases superficielles
facilement accessibles). La chirurgie hépatique devrait être
considérée comme une chirurgie spécialisée justifiant des
approches “multi-opérateurs” des cancers coliques avec méta-
stases hépatiques. Ainsi, il peut être réalisé lors de l’interven-
tion initiale une ligature d’une branche portale droite pour des
métastases hépatiques droites, permettant d’assurer une expan-
sion du foie gauche sain (de plus de 40 %) dans les semaines
suivantes (4 à 6 semaines) et une hépatectomie droite diff é r é e
non compliquée (avec une parfaite tolérance clinique). Le
bénéfice de la chimiothérapie préopératoire (prés d’un tiers des
malades) a pu être exceptionnel dans 20 % des cas dans l’ex-
périence de J. Belghiti, mais elle n’a pas diminué la tolérance
de la chirurgie hépatique. Les récidives postopératoires sont
également des indications potentielles de la chirurgie hépa-
tique, avec des résections mineures mais souvent diff i c i l e s
(plus hémorragiques), avec une survie de 15 % à 5 ans. A i n s i
les bilans d’imagerie sont capitaux pour le dépistage de ces
récidives conduisant à des résections itératives. L’ é c h o g r a p h i e
peropératoire est systématique, malgré un apport minime de
près de 10 % (par rapport au progrès des bilans préopératoires),
essentiellement pour guider le geste de résection durant l’inter-
vention. Il semble que la chimiothérapie préopératoire pourrait
prendre de l’ampleur dans les années futures. Enfin, la
recherche de localisations pulmonaires par le scanner préopé-
ratoire est systématique, en sachant que la présence de nodule
métastatique pulmonaire ne constitue plus actuellement une
contre-indication pour la chir u rgie hépatique.
C
O N G R È S

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 1998 67
Les tumeurs bénignes (M.P. Géraud, Caen). Apartir d’une
série chirurgicale importante de 60 tumeurs bénignes du foie, le
diagnostic final n’a pu être affirmé que dans près de 40 % des
cas. Les auteurs rapportent l’intérêt d’une approche radiocli-
nique en rappelant que la cœliochirurgie peut faire des biopsies
de qualité et que la chirurgie hépatique de résection segmentai-
re devient “bénigne” dans des mains expertes. V. Vilgrain remet
en cause la faible pertinence des performances radiologiques
sans une méthodologie rigoureuse (avec seulement 22 patients
ayant bénéficié d’une IRM).
Les nodules dans la maladie de Budd-Chiari (M. Lewin,
Clichy). Les auteurs montrent la fréquence des nodules de régé-
nération (ou plutôt des “nodules cirrhotiques” selon V.
Vilgrain), multiples et homogènes, typiquement hyperdenses
spontanément en TDM et hyperintenses en T1 et T2, mais éga-
lement des hépatocarcinomes (surtout en cas d’obstruction
membraneuse de la veine cave inférieure) plutôt hétérogènes.
La différenciation des lésions bénignes et malignes peut toute-
fois rester difficile dans le contexte particulier en présence de
ces multiples lésions hypervasculaires.
Les nodules du cirrhotique (S. Zaim, Paris). Soixante-trois
lésions ont pu être retenues après une exploration hélicoïdale de
48 patients cirrhotiques. Aucune lésion hypervasculaire n’était
bénigne. En revanche, l’hypovascularisation reste aspécifique
pouvant correspondre à un nodule de régénération ou à un hépa-
tocarcinome peu différencié. Ces études rappellent l’intérêt de
l’exploration biphasique hélicoïdale hépatique (phase artérielle
précoce et veineuse tardive), et plus particulièrement l’apport de
la phase artérielle précoce pour la reconnaissance des hépato-
carcinomes (hypervasculaires). C. Lherminé note également le
problème des petits angiomes hypervasculaires trompeurs si
l’on ne tient pas compte de la cinétique du rehaussement. Il
n’existe pas actuellement de critère prédictif selon la taille des
lésions, même si statistiquement un nodule de plus de 3 cm a
plus de chance d’être un hépatome, surtout si l’on dispose d’un
bilan radiologique précédent normal.
IMAGERIE PANCRÉATIQUE
Séances dirigées par Y. Menu (Clichy) et L. Engelhom (Bruxelles)
Quelle est la meilleure technique en 1997 ?Il n’existe pas
encore de véritables substitutions du scanner par l’IRM. De
nombreuses études donnent actuellement une place privilégiée
au scanner hélicoïdal et des investigations supplémentaires res-
tent nécessaires pour définir la place de l’IRM. Le scanner
conventionnel est définitivement délaissé dans toutes les com-
munications et ne semble plus pouvoir être comparé aux perfor-
mances actuelles du scanner hélicoïdal.
L’apport du scanner hélicoïdal a été étudié (X. Meyer, Lyon)
dans l’exploration des obstructions bilio-pancréatiques en rap-
pelant l’intérêt du balisage hydrique (900 ml) (sans la gastro-
grafine habituelle des scanners abdomino-pelviens) et d’une
étude biphasique (artérielle et veineuse) avec une collimation
fine de 3 mm. La qualité diagnostique est améliorée (90 % de
sensibilité pour les adénocarcinomes pancréatiques). Il existe
une très bonne reproductibilité avec une très bonne sensibilité
pour détecter les envahissements vasculaires et les infiltrations
péritumorales venant compromettre la résécabilité des adéno-
carcinomes pancréatiques (même si on sous-estime encore les
lésions non résécables). Cette résécabilité peropératoire reste
parfois subjective selon l’environnement chirurgical et l’état
général du patient.
Certains ayant mentionné l’effet néfaste des injections de pro-
duit de contraste dans les pancréatites aiguës, cela a motivé une
étude IRM pour l’évaluation des pancréatites aiguës par l’équi-
pe de P. Bret (Montréal) qui a montré une équivalence des per-
formances diagnostiques par rapport au scanner pour la stadifi-
cation des lésions pancréatiques et péripancréatiques. Les
séquences IRM rapides en apnée ont été étudiées pour la carac-
térisation des lésions pancréatiques (D. Krausé et coll., Dijon).
Les explorations en T1 sont ainsi apparues très performantes
surtout pour les bilans d’extension locorégionale. En accord
avec l’orateur, les modérateurs (Y. Menu, L. Engelhom) rappel-
lent qu’il n’existe pas d’uniformité des machines actuellement
disponibles (avec des performances très variables des résultats)
et l’apparition de nouvelles séquences, en particulier de type
vasculaire, laisse présager des progrès futurs.
Attention au diagnostic de “polykystose pancréatique”.
L’atteinte pancréatique est très élevée sur les études autopsiques
(72 %) de la maladie de Von Hippel Lindau et cela a été confir-
mé par une étude remarquable de V. Vilgrain à partir de 149
sujets. Les diagnostics portés par l’imagerie sont des kystes
simples, des cystadénomes séreux, ou des tumeurs endocrines.
Une multikystose pancréatique est définie arbitrairement à par-
tir de 5 lésions kystiques. Il existe des calcifications (50 % des
cas) arciformes ou punctiformes, voire annulaires. Les cystadé-
nomes séreux (9 % des cas) sont également souvent calcifiés,
avec des cloisons fibreuses et souvent une atteinte panglandu-
laire. Ces différentes lésions peuvent s’associer entre elles. Les
lésions sont en règle asymptomatiques. Il n’existe pas de risque
plus important d’adénocarcinome pancréatique. Dans près de la
moitié des cas, les tumeurs endocrines peuvent présenter histo-
logiquement des signes de malignité. L’existence d’une multi-
kystose pancréatique (rare en dehors de 10 % des polykystoses
hépatorénales) associée à une tumeur rénale doit faire recher-
cher systématiquement, même en l’absence de lésion neurolo-
gique, une maladie de Von Hipppel Lindau avec une enquête
génétique.
C
O N G R È S

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 1998 69
C
O N G R È S
Le diagnostic de tumeur mucineuse intracanalaire a été pro-
posé (J.F. Rauturier, Bordeaux) par une approche IRM
(séquence HAST) avec typiquement : une dilatation du canal
pancréatique principal et/ou des canaux secondaires (“en nid
d’abeille”), des lésions kystiques en “grappe”, et dans un quart
des cas des anomalies de la papille (typiquement béante). Le
contenu des kystes peut avoir un signal IRM différent des
liquides de voisinage, probablement en raison de leur compo-
sante mucineuse. La sécrétion de mucus est retrouvée en endo-
scopie alors que le diagnostic clinique initial est souvent celui
d’une pancréatite chronique. La communication de l’équipe de
Bruxelles (S. Willemart) nous rappelle que la TDM permet éga-
lement d’évoquer le diagnostic pour éviter le caractère invasif
d’un cathéterisme rétrograde de la papille. Le potentiel malin
des lésions impose une sanction chirurgicale en l’absence de
contre-indication chirurgicale (en sachant que ces tumeurs peu-
vent évoluer lentement). Idéalement, la possibilité de localisa-
tions multiples devrait imposer une pancréatectomie totale. La
lésion tumorale tissulaire (prolifération papillaire intracanalai-
re) doit être recherchée au niveau de la dilatation maximale.
L’IRM permet de mieux montrer les dilatations canalaires
secondaires du processus unciforme. Il peut exister une atrophie
du tissu pancréatique et des calcifications voisines d’une pan-
créatite chronique.
La surveillance des gre ffes pancréatiques. L’évaluation de
l’imagerie dans les complications des greffes pancréatiques a été
présentée par l’équipe du Kremlin-Bicêtre (L. Rocher et coll.).
L’écho-doppler permet surtout de reconnaître de nombreuses
complications vasculaires (thrombose artérielle ou veineuse),
mais il reste malheureusement peu sensible dans les rejets (dont
le diagnostic reste fondé sur les données cliniques et biologiques).
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Séances multiples organisées par la SIAD (Société d’Imagerie
Digestive) et/ou le CRI (Collège de Radiologie Interventionnelle).
La photocoagulation au laser des “petites” métastases (A.
Gangi, Strasbourg). Classiquement réservée aux tumeurs de
moins de 4 cm sous contrôle échographique ou scanographique,
cette technique pourrait être une alternative chirurgicale pour le
futur. Le traitement doit déborder sur la périphérie de la lésion
avec plusieurs fibres optiques pour limiter le risque de récidive.
Les métastases de plus de 4 cm ont été reprises ultérieurement.
Les principales complications rapportées sont des douleurs tran-
sitoires et exceptionnellement un hématome sous-capsulaire. La
précision du laser assure la supériorité de cette méthode par rap-
port à l’utilisation de l’alcool. La diminution actuelle du prix
des fibres optiques devrait rendre cette thérapeutique beaucoup
moins coûteuse.
L’ablation par radiofréquence hépatique (M. Hoey,
Minneapolis). L’ablation par radiofréquence est limitée aux
lésions de petite taille du fait des phénomènes de vaporisation
(qui forme un isolant autour de l’aiguille). L’infusion concomi-
tante de sérum salé hypertonique permet d’accéder à des lésions
plus larges. Il s’agit, là encore, d’études expérimentales (chez le
chien).
Le lipiodol intra-artériel (Lipiocis) pour l ’ h é p a t o c a rc i n o m e :
plutôt décevant ! Il s’agit d’une étude multicentrique (T. de
Baère, Villejuif, P. Taourel, Montpellier, J.M. Tubiana, Paris)
réservée au traitement des lésions inopérables avec une throm-
bose portale avec l’injection intra-artérielle de lipiodol radio-
actif (LIP 131). La survie reste médiocre avec une médiane de
survie de 147 jours. Il a été retenu de nombreuses complications
(essentiellement des insuffisances hépatocellulaires). Il s’agit
également d’un traitement très lourd et très coûteux dont l’ave-
nir paraît douteux pour tous les auteurs.
Le shunt porto-cave percutané. Il existe maintenant près de 7
ans de recul depuis les premiers TIPS (shunt intrahépatique
porto-systémique) et ce recul permet de présenter des séries
importantes (notamment 242 malades pour l’équipe de Metz).
On peut donc admettre le bénéfice de cette procédure pour le
traitement en urgence des ruptures de varices (avec un succès
dans 75 à 90 % des cas) avec une mortalité immédiate et à
moyen terme plus élevée pour les Child C. Une réintervention
dans les 2 ans a été nécessaire dans 66 % des cas, essentielle-
ment par une obstruction secondaire par une hyperplasie néo-
intimale. L’efficacité sur les ascites réfractaires est moins pro-
bante selon certaines équipes (85 % pour l’équipe de Metz,
78 % pour l’équipe de Lille, et 64 % pour l’équipe de Toulouse),
et elle est conditionnée essentiellement par la sélection des
patients. Tous les auteurs confirment que les TIPS doivent être
réservés en priorité aux échecs du traitement médical et dans
l’optique d’une possible transplantation ultérieure.
L’embolisation portale préopératoire du foie cirrhotique
(A. Denys, Clichy). Une étude de l’embolisation portale droite
percutanée avant une hépatectomie droite chez des sujets cir-
rhotiques porteurs d’un hépatocarcinome montre une faible
augmentation de la pression portale (3mmHg) sans retentisse-
ment clinique, et une bonne tolérance biologique avec une aug-
mentation transitoire des gamma-GT (+20 %) et des transami-
nases (+40 %) lors de la première semaine, et surtout une aug-
mentation de 37 % du volume du foie gauche.
Biopsie hépatique “ à risque ” (P. Chevalier, Nice). Il est pos-
sible de maintenir l’indication d’une biopsie percutanée chez
des sujets à risques (TP inférieur à 60 %, plaquette inférieure à
80 000/mm
3
, ascite, etc.) en embolisant le trajet percutané au
décours immédiat du prélèvement. Les auteurs rapportent 28
cas avec une embolisation du trajet avec de l’Histoacryl
®
(enbu-
 6
6
1
/
6
100%