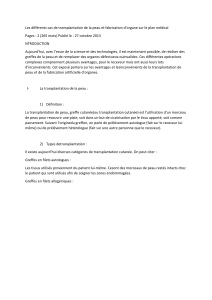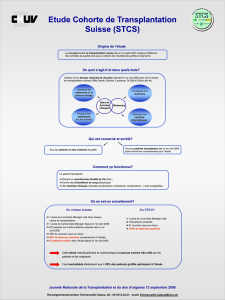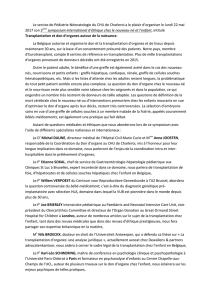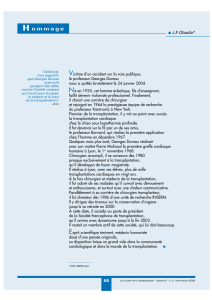L réunion c Compte-rendu de la deuxième Journée interdisciplinaire

0,55
0,22
0,58
0,16
0,60
0,10
0,67
0,10
0,76
0,13
0,77
0,16
0,93
0,21
0,90
0,21
1,08
0,39
1,16
0,28
0,4
0,5
0,6
0,7
Incidence annuelle
de lymphome non hodgkinien (%)
10 2 43 5 6 7 8 9 10
Années après la transplantation
Autre cancer Lymphome non hodgkinien
0,3
0,2
0,1
0,0
0,7
0,9
1,1
1,3
Incidence annuelle des autres cancers (%)
0,5
0,3
0,1
0,0
Figure. Incidence des lymphomes et des autres cancers après transplantation d’organe.
i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n
o 3 - juillet-août-septembre 2008
148
congrès
Compte-rendu de la deuxième Journée interdisciplinaire
de la transplantation (21 mai 2008)1
É. Thervet* ●
1 Article réalisé en collaboration avec les laboratoires
Wyeth.
* Service de transplantation adulte, hôpital Necker,
Paris.
La deuxième édition de la Journée
interdisciplinaire de la transplanta-
tion, organisée par les laboratoires
Wyeth avec le parrainage de la Société
francophone de transplantation, s’est
tenue à la Maison de l’Amérique latine.
Le thème, cette année, en était la déni-
tion d’une meilleure gestion du risque de
cancer après transplantation. La matinée
a été consacrée à des présentations et
l’après-midi à des ateliers interactifs.
Le Pr J.M. Rebibou a présenté les résul-
tats du registre des cancers réalisé par
l’Agence de la biomédecine. Ce registre
national a permis à toutes les équipes de
préciser l’incidence de tous les types de
cancer, à l’exception des tumeurs cuta-
nées. L’intérêt de ce registre repose sur
la possibilité d’évaluer la fréquence
d’apparition des cancers, de suivre leur
évolution, d’identier des facteurs de
risque et de guider les politiques de
dépistage et de prévention. Par ailleurs,
il permet de comparer les résultats avec
ceux déjà publiés dans d’autres pays
du monde. Pour préciser l’augmenta-
tion du risque après transplantation,
les données obtenues par l’Agence
de la biomédecine ont été comparées
à l’évolution de l’incidence et de la
mortalité par cancer en France grâce
au rapport 2003 de l’Institut national
de veille sanitaire. Le registre recensait
environ 47 000 patients ayant bénécié
d’une greffe : 30 000 greffes rénales,
9 500 greffes hépatiques, 6 100 greffes
cardiaques et 1 500 greffes pulmonaires.
Dans cette étude, 3 300 receveurs (7 %)
ont présenté au moins une complica-
tion tumorale. Les complications les
plus fréquentes étaient les lymphomes
non hodgkiniens (642 cas), suivis des
cancers pulmonaires, digestifs, mascu-
lins, urinaires ou rénaux puis des cancers
féminins. L’ensemble des transplanta-
tions entraîne une augmentation du
risque relatif de cancer de 2,8. Cela est
particulièrement marqué pour les cancers
pulmonaires, avec un risque relatif de 5,5.
Lorsque les cancers sont étudiés de
façon plus spécique, le risque relatif de
lymphome non hodgkinien est de 14,4.
C’est particulièrement notable pour les
transplantations pulmonaires, avec un
risque relatif de 66,6. Les cancers fémi-
nins et masculins ont une augmentation
du risque relatif de 1,2 et 2,7 respecti-
vement. En ce qui concerne les cancers
broncho-pulmonaires, le risque relatif
pour l’ensemble des patients transplantés
est de 3,3, en particulier pour les trans-
plantés cardiaques et pulmonaires (risque
relatif de 5,9 et 12,4 respectivement).
Pour les cancers gastro-intestinaux,
hépatiques et pancréatiques, l’augmen-
tation est particulièrement notable chez
les patients transplantés hépatiques,
avec un risque relatif de 3,9. Pour les
cancers urinaires et rénaux, le risque
relatif est de 3,6, avec une augmenta-
tion plus marquée pour les transplantés
rénaux (risque relatif de 4,5). L’analyse
de l’inuence de l’âge du receveur sur
la survenue d’un cancer est également
intéressante. En effet, si l’incidence de
tous les cancers augmente avec l’âge,
l’incidence annuelle de lymphome non
hodgkinien présente un aspect bipha-
sique : elle augmente chez les trans-
plantés âgés de moins de 10 ans et, de
façon plus marquée, chez les patients de
plus de 50 ans. Un autre facteur analysé
est le délai de greffe. Pour l’ensemble
des tumeurs, l’incidence augmente avec
le délai post-transplantation. Pour les
lymphomes non hodgkiniens, l’aspect
de la courbe est à nouveau biphasique,
avec une surincidence au cours de la
période initiale de post-transplantation
(première année ou lymphome précoce),
suivie d’un nouveau pic survenant 7 ans
après la greffe (figure).
L’incidence cumulative selon la période
de la transplantation a également été
évaluée dans ce registre. Pour tous les
cancers, l’augmentation de l’incidence
est plus importante pour les patients
transplantés entre 2000 et 2005 que
pour les patients transplantés entre 1995
et 1999. En revanche, il faut noter que
l’incidence cumulative des lymphomes

i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n
o 3 - juillet-août-septembre 2008
149
congrès
non hodgkiniens est plus faible durant
la période la plus récente (2000-2005)
que durant la première période de suivi
(1995 à 1999). J.M. Rebibou a égale-
ment présenté l’analyse multivariée des
facteurs de risque de survenue de cancer.
Pour les tumeurs solides, ces facteurs
sont l’âge du receveur, le sexe masculin
ainsi que l’organe greffé (en prenant
comme référence les transplantations
rénales).
L’intervention du Pr C. Duvoux, de
l’hôpital Henri-Mondor, a porté sur les
résultats de l’épidémiologie des cancers
en transplantation hépatique. Cette popu-
lation particulière peut être divisée en
trois grands sous-groupes : les patients
pour lesquels l’indication de la trans-
plantation était un cancer hépatique, les
patients transplantés hépatiques avec un
antécédent de cancer extrahépatique
et, enn, les patients pour lesquels une
tumeur de novo est survenue après la
greffe. En Europe, le cancer représente
actuellement 13 % des indications de
transplantation hépatique. Plus spéci-
quement, en France, pour 24 % des
patients inscrits sur la liste de l’Agence
de la biomédecine en 2007, l’indication
est un carcinome hépatocellulaire ; les
autres tumeurs représentent 1,3 % des
autres indications. La transplantation
pour tumeur devient donc la première
indication de transplantation en France.
Lorsque des critères de taille ou de
nombre de tumeurs (tumeur unique de
moins de 5 cm ou moins de 3 nodules
de 3 cm) sont retenus, la survie globale
des patients est de 90 % à 1 an et de
75 % à 4 ans. L’incidence de récidive de
tumeurs est de 8 %. C. Duvoux a fait état
des résultats obtenus chez les patients
ayant un antécédent de cancer avant
la greffe. Les données de la littérature
sont relativement éparses et hétérogènes,
avec un pourcentage de récidive allant
de 0 % à 24 %. Dans une étude réalisée à
Hambourg, 6,1 % des patients candidats
à une transplantation hépatique (n = 606)
présentaient des antécédents de tumeur.
Il faut noter que, pour la transplantation
hépatique, le respect d’un délai “suf-
sant” est souvent impossible. Il faut donc
estimer le bénéce pour ces patients lors
d’une concertation pluridisciplinaire.
La transplantation hépatique est envisa-
geable en cas de traitement curatif de la
tumeur initiale, de pronostic “acceptable”
et si le risque de récidive est de moins
de 15 %. En ce qui concerne les tumeurs
de novo après transplantation, le risque
relatif à 10 ans est de 13,5, avec une
augmentation très nette des lymphomes
et des tumeurs cutanées. La probléma-
tique des tumeurs de novo est importante
en transplantation hépatique, puisqu’elle
représente 2 % à 8 % de la mortalité à
long terme : c’est la deuxième cause de
mortalité tardive. Pour les lymphomes,
la localisation sur le greffon hépatique
est fréquente dans les formes aussi
bien localisées que diffuses. Lorsqu’il
est impossible de diminuer l’immuno-
suppression, le pronostic est médiocre :
64 % des patients décèdent, et seuls 29 %
obtiennent une rémission. Les autres
tumeurs solides touchent notamment
les voies aérodigestives supérieures,
en particulier lorsque l’indication de
la transplantation hépatique est une
cirrhose alcoolique, ces deux patholo-
gies ayant en effet des facteurs de risque
communs. Le risque standardisé d’un
cancer de l’oropharynx est de 25,4 chez
les patients transplantés pour cirrhose
alcoolique, versus 1,25 pour les cirrhoses
d’une autre origine.
Le Pr D. Abramowicz, de Bruxelles, a
présenté quant à lui l’épidémiologie des
cancers chez les patients en attente de
transplantation rénale. Il faut préciser
l’incidence des cancers avant transplan-
tation, la nature de ces cancers, le risque
de récidive et l’impact sur la survie des
greffons et des patients. À l’hôpital
Erasme, dans le registre des patients en
attente d’une greffe rénale, l’incidence du
cancer avant transplantation est de 3,2 %.
Il s’agit d’un cancer rénal dans 36 % des
cas et d’un cancer du sein dans 17 % des
cas. Viennent ensuite des tumeurs des
voies urinaires, de la prostate et du col
utérin. Dans toute la population, seules
2 récidives ont été observées (1 cancer
de la vessie et 1 cancer du rein) ; elles
n’ont pas entraîné de décès.
Le Pr J.L. Misset, de l’hôpital Saint-
Louis, a rapporté son expérience sur
l’annonce du risque de cancer chez
des patients en attente de greffe ou
lorsqu’une tumeur a été diagnostiquée.
Enn, le Pr C. Huriet, président de l’Ins-
titut Curie, a précisé la gestion éthique
des informations délivrées aux patients
en médecine et, en particulier, en ce qui
concerne la survenue d’une complication
grave comme un cancer.
Les ateliers de l’après-midi ont
donné lieu à de nombreux échanges.
Le premier atelier, animé par les
Prs Hurault de Ligny, Blancho et Leche-
vallier, a précisé les facteurs de risque
et le dépistage des cancers de novo chez
les patients en attente de greffe. À partir
de données de registres, les anima-
teurs de cet atelier ont précisé dans
un premier temps que l’augmentation
du risque de cancer se retrouve aussi
chez les patients dialysés. Cependant,
elle est encore plus importante après
une transplantation. Ils ont également
rappelé que, pour le patient transplanté
rénal, aussi bien avant qu’après la trans-
plantation, ce risque était particuliè-
rement élevé pour les voies urinaires,
qu’il s’agisse des reins propres ou de
la vessie. Des études internationales,
mais également françaises, conduites
sous l’égide de l’AFU, ont bien montré
cette augmentation du risque, en parti-
culier chez les patients présentant
une maladie multikystique acquise.
Un dépistage, chez les transplantés,
du cancer des voies urinaires par un
examen clinique, une cytologie urinaire
lorsqu’elle est possible ainsi que des
examens d’imagerie telle l’échographie
ou la tomodensitométrie est ici primor-
dial. En ce qui concerne les cancers
broncho-pulmonaires, il convient de
proposer, en cas de tabagisme actif,
un dépistage par scanner hélicoïdal à
faible dose. Les animateurs de l’atelier
ont également insisté sur l’importance
de la recherche de facteurs de risque
viraux chez les patients transplantés :
virus d’Epstein-Barr, hépatites B et C,
HTLV-1, HHV-8, papilloma virus et
SV40. Les recommandations euro-

Les articles publiés dans Le Courrier de la Transplantation le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© juin 2001 - Edimark SAS (DaTeBe Éditions) - Imprimé en France - ÉDIPS, 21800 Quetigny - Dépôt légal à parution.
i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n
o 3 - juillet-août-septembre 2008
150
congrès
péennes et américaines sur le délai
d’attente nécessaire après la découverte
d’un cancer chez un patient en attente
de transplantation ont été discutées. Ce
délai varie selon les pays et le type de
cancer. Il convient de respecter un délai
de 5 ans en cas de tumeur invasive ou
de cancer du sein. Les animateurs en
concluent qu’un dépistage systématique
des lésions précancéreuses et cancé-
reuses, avec une évaluation annuelle,
est important chez les sujets à risque.
La prédiction est difcile à l’échelon
individuel. Une concertation interdis-
ciplinaire est nécessaire. Enn, cette
évaluation pourrait inuencer le choix
initial de l’immunosuppression. Lors de
la discussion, tous les intervenants ont
insisté sur l’importance de donner aux
patients une information complète.
Cette information était le thème du
deuxième atelier, animé par les Prs Avril,
Le Meur et Thervet, durant lequel une
enquête réalisée auprès des centres de
transplantation a été présentée. Lors de
la visite prétransplantation, 76 % des
médecins interrogés abordent systéma-
tiquement le sujet du risque de cancer,
et 21 % le font dans la majorité des cas.
L’information donnée est d’ordre général
et porte sur l’augmentation du risque, en
prenant les exemples des tumeurs les
plus fréquentes. La moitié des méde-
cins interrogés donne une information
spécique sur le risque de lymphome.
Le risque lié au traitement immunosup-
presseur et aux tumeurs viro-induites est
également mentionné. L’information est
délivrée principalement par un entretien
avec le médecin. Un document écrit est
remis dans la majorité des cas. Il s’agit
le plus souvent d’un document rédigé
dans le service, mais d’autres documents
(Agence de la biomédecine, che de la
Société francophone de transplantation)
sont parfois utilisés. Tous les participants
à cet atelier ont insisté sur le fait qu’il
serait nécessaire d’avoir une information
plus standardisée. Dans la très grande
majorité des cas, des informations sont
également données sur le suivi et les
examens nécessaires après la trans-
plantation pour prévenir et dépister les
cancers. Les médecins insistent sur la
surveillance cutanée annuelle, le bilan
gynécologique et la recherche d’une
tumeur des reins propres. Une informa-
tion est donnée sur le rôle de l’exposi-
tion solaire, la nécessité d’une protection
vestimentaire et l’obligation d’arrêter le
tabac. La majorité des médecins inter-
rogés explique au patient que, lorsqu’il
existe des antécédents de cancer, il est
nécessaire d’attendre un délai sufsant
pour diminuer le risque. Les médecins
s’appuient pour ce faire sur les données
recueillies par les sociétés savantes.
Après la transplantation, 80 % des méde-
cins continuent à informer les patients.
Ils le font lors des visites de consultation.
Le ressenti des médecins par rapport à
l’information donnée aux patients est
plutôt positif, puisque 80 % estiment
que celle-ci est bien acceptée… même
s’ils pensent que, dans 50 % des cas, les
recommandations sont vite oubliées ! Il
a été rappelé que des informations sur
le suivi ambulatoire du transplanté rénal
sont disponibles sur le site Internet de la
Société de néphrologie et sur celui de la
Haute Autorité de Santé. Les connais-
sances du receveur de greffon au sujet du
risque de cancer ont été discutées à partir
d’un article récent. Le risque de cancer
est d’abord mal compris par le patient,
mais la prise en compte de ce risque
augmente avec le temps, surtout après
un premier épisode. Les patients pensent
que l’information n’est pas complète,
puisque seuls 30 % estiment en savoir
“assez”. Les facteurs de risque sont, en
revanche, bien compris. Les patients
estiment que l’information doit être
faite en premier lieu par les néphrolo-
gues et par les inrmières qui s’occupent
de la transplantation. Ils souhaitent que
cette information soit délivrée au moins
annuellement après la transplantation,
en particulier pour les cancers cutanés.
Les participants à l’atelier ont proposé
que les moyens de prévention (crème
solaire de haute protection) puissent être
remboursés.
Le troisième atelier, animé par les
Prs Culine, Rostaing et Bayle, s’est
intéressé à la conduite à tenir en cas de
cancer après transplantation rénale. À
partir de cas cliniques, les animateurs
de cet atelier ont insisté sur l’importance
d’études prospectives pour évaluer la
place des moyens de surveillance
systématique et la modulation de l’im-
munosuppression avec, en particulier,
l’utilisation d’inhibiteurs de mTOR.
En conclusion, la deuxième Journée
interdisciplinaire de la transplantation a
permis un large échange d’idées et d’in-
formations. De plus en plus, les outils
méthodologiques se mettent en place
en France pour préciser le risque et son
évolution dans la population française
transplantée. Après cet état des lieux,
le Pr Charpentier, qui a clos les débats,
a insisté sur la nécessité de mettre en
place des outils pratiques d’évaluation
et d’information pour gérer au mieux le
risque, en collaboration avec des méde-
cins d’autres spécialités et surtout avec
les patients eux-mêmes. ■
1
/
3
100%