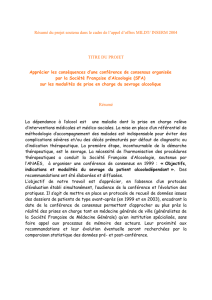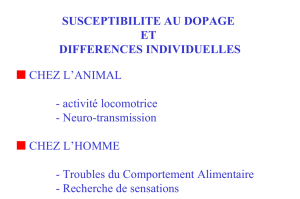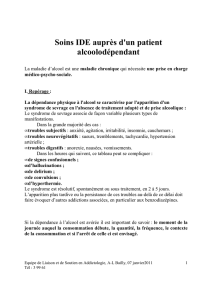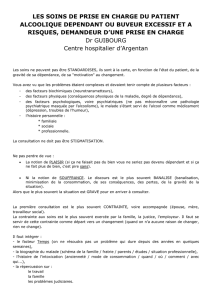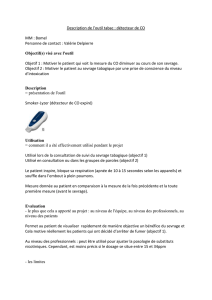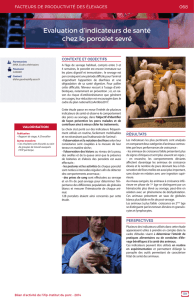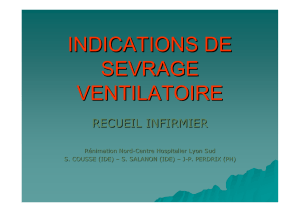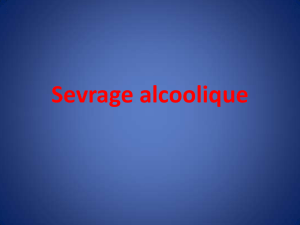Lire l'article complet

169
N°12
Fiche
Sous la responsabilité de leurs auteurs
thérapeutique
Sevrage hospitalier du patient alcoolodépendant
Laetitia Malingrey*
F
i
c
h
e
F
i
c
h
e
F
i
c
h
e
F
i
c
h
e
h
e
F
i
c
h
e
F
i
c
!
Il convient de distinguer l’abus d’alcool de l’alcoolodépendance. En effet, dans le premier cas, des conseils de modération peuvent être pro-
posés. En revanche, dès qu’il y a dépendance, le retour à une consommation modérée paraît extrêmement difficile. Dans ce cas, un
sevrage s’impose, avec pour objectif l’abstention complète et durable de l’alcool. Il peut, selon les cas, être réalisé en ambulatoire, ou en
milieu hospitalier. Un sevrage ambulatoire est souvent mieux accepté par le patient ; il permet la poursuite de l’activité professionnelle et
le maintien des relations familiales et sociales. Cependant, un sevrage “institutionnel”, permettant une surveillance continue et un éloigne-
ment du cadre de vie habituel, paraît préférable dans certaines situations : alcoologiques : dépendance physique importante, antécédent
comitial ou de delirium tremens, échec d’un sevrage ambulatoire ; somatiques : affection sévère, justifiant une hospitalisation ; psychia-
triques : syndrome dépressif, comorbidité psychiatrique grave ou codépendance à d’autres substances psycho-actives ; sociales : isolement
et désinsertion sociale, entourage familial difficile.
Un sevrage thérapeutique hospitalier a donc pour objectif : de prévenir le syndrome de sevrage ; de donner le temps au patient pour la régres-
sion des troubles de l’humeur, des troubles cognitifs, des troubles somatiques ; de permettre une prise en charge psychosociale du patient.
Syndrome de sevrage : il associe, de façon variable, des troubles subjectifs (anxiété, agitation, irritabilité), des troubles neurovégétatifs
(sueurs, tremblements, hypertension artérielle) et des troubles digestifs (anorexie, nausées, vomissements). En l’absence de traitement, peu-
vent survenir un syndrome confusionnel, le classique delirium tremens, des hallucinations et des convulsions. L’hypokaliémie, très fré-
quente dans le cadre du sevrage alcoolique, aurait une valeur pronostique dans la survenue de telles complications. Les syndromes de
sevrage apparaissent dans les heures qui suivent la dernière prise d’alcool. L’aggravation se manifeste, en l’absence de traitement, en 12 à
24 heures. Les troubles régressent habituellement en 2 ou 3 jours.
Syndrome de Wernicke-Korsakoff : il s’agit d’une complication fréquente de l’intoxication alcoolique, liée au déficit en thiamine. Sa gra-
vité tient essentiellement à la survenue fréquente au décours d’une encéphalopathie de Korsakoff. Elle se manifeste par la triade paralysie
oculomotrice, troubles de la conscience, ataxie-hypertonie. Atteintes hépatiques : complications des cirrhoses (ascites, hémorragies diges-
tives, encéphalopathies) ; formes graves des hépatites alcooliques. Pancréatites aiguës. Atteintes hématologiques : hémolyses, leucopé-
nies mais sutout thrombopénies. Troubles métaboliques : acidocétoses alcooliques, hyponatrémies. Rhabdomyolyses. Infections (l’al-
cool est une cause d’immuno-déficience reconnue chez l’homme). À noter que les patients alcoolodépendants sont probablement plus sou-
vent victimes de mort subite que la population générale. Plusieurs étiologies peuvent être évoquées : accidents vasculaires cérébraux, trau-
matismes crâniens, fausses routes, suicides, troubles du rythme cardiaque et de la conduction, troubles métaboliques.
Lorsque le sevrage est institutionnel, les études ne montrent pas de bénéfice à poursuivre le séjour au-delà de 10 jours. Lorsque cela paraît
nécessaire, il est souhaitable de planifier, avant l’hospitalisation, le projet social et alcoologique et de programmer d’éventuels séjours en
structures relais.
A. Bilan : il convient de réaliser un bilan permettant d’évaluer le retentissement somatique de la consommation alcoolique et des éven-
tuelles pathologies associées. Il peut donc être pratiqué de manière systématique : numération formule ; ionogramme sanguin ; bandelette
urinaire ; fonction hépatique : transaminases, bilirubine, gamma-GT, CDT, TP, TCA, échographie hépatique.
Compte tenu de la fréquence des codépendances alcool-substances psychoactives et alcool-tabac, il peut être proposé d’emblée : dépis-
tage des infections par les virus de l’hépatite B et C et du VIH ; radiographie pulmonaire ; examen ORL à la recherche de lésions néopla-
siques des voies aérodigestives supérieures.
En fonction des éléments de l’anamnèse et de l’examen clinique, on proposera plus spécifiquement : une évaluation de l’état pancréatique :
amylasémie, lipasémie, scanner abdominal ; une fibroscopie gastrique à la recherche de varices œsophagiennes ou de lésions inflammatoires ;
un bilan psychométrique qui permet à la fois d’évaluer l’atteinte actuelle et de constituer un élément de référence pour des tests ultérieurs.
B. Exemple de prescription : apports hydriques suffisants, mais sans hyperhydratation qui peut être nocive. Les perfusions sont à éviter
chez le malade conscient ; correction des éventuels troubles hydro-électrolytiques ; traitement préventif du syndrome de sevrage : par
exemple : diazépam : 30 à 60 mg/j pendant 1 à 3 jours, puis réduction progressive et arrêt au bout d’environ une semaine ; thiamine : si
troubles neurologiques, ou si dénutrition possible (vomissements profus ou amaigrissement récent), par voie parentérale : 100 à 500 mg/j
pendant une semaine (à noter les fréquentes allergies et le risque de choc anaphylactique) ; sinon, par voie orale 500 mg à 1 g/j pendant
10 ou 15 j. Un traitement adapté aux comorbidités sera proposé, et une prise en charge des codépendances sera envisagée, avec en
particulier une aide au sevrage tabagique.
C. La prescription médicamenteuse ne doit pas occulter l’importance fondamentale de la prise en charge psychologique et sociale.
Toutes ces propositions concernent l’organisation pratique de la période hospitalière du sevrage. Elle varie très peu selon les patients.
Les modalités de l’accompagnement du sujet alcoolodépendant après le sevrage sont, en revanche, adaptées spécifiquement aux
conditions de chaque patient.
Références bibliographiques
– Expertise collective : alcool : effets sur la santé. Les éditions INSERM, Paris, 2001; 358 p.
– Conférence de consensus “objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolodépendant”. Alcoologie
1999 ; 21.
–Conférence de consensus “Modalités de l’accompagnement du sujet alcoolodépendant après un sevrage”. Alcoologie
et Addictologie 2001 ; 23 (2) : 361-78.
Complications nécessi-
tant un traitement
médical urgent chez les
malades alcooliques
Propositions de conduite
pratique pour le sevrage
hospitalier
Sevrage ambulatoire ou
hospitalier
* Chef de clinique assis-
tante, service de méde-
cine interne à orienta-
tion toxicologique, hôpital
Fernand-Widal, Paris.
1
/
1
100%