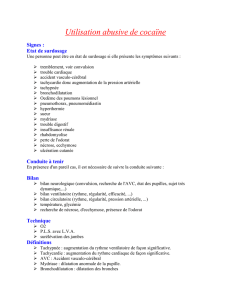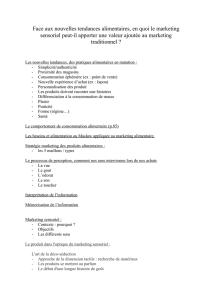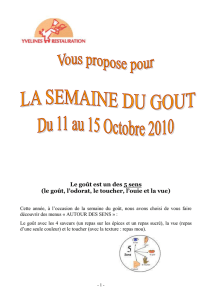Résultats d’un observatoire ORL des troubles de l’odorat, protocole AROME A

ACTUALITÉ
11
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no273 - mai 2002
L
a place de l’odorat est très importante dans la vie quo-
tidienne (1, 2). Les troubles de l’odorat affectent la
qualité de vie des patients, avec en particulier une perte
d’appétit entraînant un amaigrissement, mais parfois aussi un
syndrome dépressif (3).
Le trouble de l’odorat peut être quantitatif : il s’agit rarement
d’une exaltation de l’odorat, ou hyperosmie, mais plus souvent
d’une diminution de l’odorat, ou hyposmie, voire d’une anosmie,
c’est-à-dire une perte complète de l’odorat. Le trouble de l’odo-
rat peut aussi être qualitatif, avec perception d’une mauvaise
odeur (cacosmie) ou distorsion de l’odeur (parosmie) (4).
Les étiologies des troubles de l’odorat sont dominées par les affec-
tions rhinologiques transitoires (rhinite aiguë) ou plus chroniques
(polypose), qui représentent 35 à 67 % des causes (4-6). Les
troubles de l’olfaction augmentent avec l’âge (7).
Certains troubles apparaissent à la suite d’un traumatisme crâ-
nien (8, 9) ou d’une intervention chirurgicale rhinosinusienne ou
sur la base du crâne. Le tabac, certains médicaments et certaines
substances toxiques peuvent déterminer des troubles de l’odorat
plus ou moins réversibles (4, 10).
Les troubles de l’odorat peuvent résulter d’une dégradation du
transport des molécules odorantes vers l’épithélium olfactif,
d’une diminution du fonctionnement des neurones détecteurs ou
bien d’une perturbation au sein du système nerveux central. Déter-
miner avec précision, pour chaque patient, la nature du trouble
et son étendue nécessite une démarche expérimentale la plus
rigoureuse possible. Elle doit tenir compte de la variabilité natu-
relle que l’on constate, pour les sujets sains, tant au niveau de la
détection qu’au niveau de l’interprétation cognitive (par exemple,
la reconnaissance des odeurs). À ce jour, il n’existe pas d’outil
consensuel pour tester l’odorat en milieu clinique, ce qui explique
que cet examen soit peu répandu en pratique clinique. Certains
tests, par exemple celui conçu par C. Éloit et D. Trotier à l’hôpi-
tal Lariboisière, permettent d’estimer avec précision les seuils de
perception et de reconnaissance de chaque patient et de les com-
parer aux valeurs de sujets sains (11), mais ils nécessitent une
durée d’examen de l’ordre de 40 minutes. D’autres tests, comme
Résultats d’un observatoire ORL des troubles de l’odorat,
protocole AROME
Olfactory disorders, results of AROME protocole
●
C. Éloit
1
, D. Trotier
2
, P. Aubert
3
, J. Samson
4
, I. Chanal
5
, C. Arfi
5
, A. El Hasnaoui
5
, E. Serrano
6
1. Service ORL, hôpital Lariboisière, Paris.
2. Laboratoire de neurobiologie sensorielle, Massy.
3. ORL, Garches.
4. ORL, Noisy-le-Grand.
5. Laboratoire GSK, Marly-le-Roi.
6. Service ORL, hôpital Rangueil, Toulouse.
Résumé : L’olfaction de 436 adultes (âge médian : 47 ans) souffrant de troubles de l’odorat a été testée avec des capsules de
cinq odeurs différentes. Les troubles de l’odorat avaient un impact négatif sur la qualité de vie de ces patients. Les étiologies
les plus fréquentes des troubles de l’odorat étaient la polypose nasale, les rhinites, l’allergie et les sinusites aiguës. Les patients
qui avaient une pathologie rhinosinusienne inflammatoire ont reçu une prescription de corticoïdes locaux ou généraux.
Mots-clés : Odorat - Détection, identification des odeurs - Pathologie rhinosinusienne.
Summary : A series of 436 adults with olfactory disorders is described (median age : 47 years). This disorder impaired
the quality of life. The olfactory function was tested using five different odorants. The most frequent etiologies were nasal
polyposis, rhinitis, allergy and acute sinusitis. The patients suffering from nasal inflammatory disease had a prescription based
on local and general corticosteroids.
Keywords : Olfactory disorders - Smell recognition - Rhinosinusal pathology.

ACTUALITÉ
12
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no273 - mai 2002
le test UPSIT (12) de l’université de Pennsylvanie, d’un usage
très répandu aux États-Unis, sont basés sur l’identification des
odeurs présentées. Ces tests sont limités par la difficulté natu-
relle à nommer les odeurs et, de plus, ne permettent pas de quan-
tifier avec précision une baisse de la sensibilité olfactive.
L’objectif principal de cette étude était de mesurer la concor-
dance entre les résultats d’un test rapide de détection et de recon-
naissance de quelques odeurs et le trouble de l’odorat exprimé
par les patients venus consulter en ORL. Les objectifs secon-
daires étaient d’étudier les différentes pathologies impliquées
dans ces troubles de l’odorat et d’évaluer le retentissement de ces
troubles sur la qualité de vie des patients.
PATIENTS ET MÉTHODES
Patients
Il s’agit d’une enquête multicentrique transversale portant sur des
patients de plus de 18 ans venus consulter en ORL pour un trouble
de l’odorat et acceptant de participer à l’étude. Étaient exclus les
patients soumis à un litige juridique ou les opposant à une com-
pagnie d’assurances au sujet de leurs troubles de l’odorat et les
patients déclarant une “allergie” ou hypersensibilité aux odeurs,
constituant le syndrome “MCS”, ou Multiple Chemical Sensiti-
vities, des Anglo-Saxons.
Cinq cents médecins ORL ont été contactés. Ils ont été tirés au
sort, avec une stratification sur l’âge, le sexe et la région d’exer-
cice, sur la liste de médecins ORL CEGEDIM. Chaque investi-
gateur devait inclure le premier patient vu en consultation et
déclarant un trouble de l’odorat, ainsi qu’un patient vu en consul-
tation déclarant ne pas avoir de trouble de l’odorat, constituant
ainsi un nombre équivalent de sujets de référence. Ce groupe de
témoins ne sera pas développé dans cet article et fera l’objet d’un
travail ultérieur.
La proportion de patients déclarant des troubles de l’odorat et
dépistés par un test olfactif varie de 50 à 90 %. Le calcul statis-
tique fait apparaître que, pour obtenir une précision de 5 % sur
un pourcentage de 50 %, hypothèse maximaliste, il faut disposer
de 385 patients. Compte tenu des difficultés prévisibles de recueil
et d’exploitation des données, il a été décidé de contacter
500 centres investigateurs.
Données recueillies
Après acceptation du principe du protocole, les patients étaient
invités à remplir un questionnaire précisant les données démo-
graphiques, la catégorie professionnelle et le mode d’habitat. Les
patients remplissaient aussi l’échelle de qualité de vie SF36. Cette
échelle est un instrument générique fondé sur la psychométrie et
permettant de mesurer la qualité de vie liée à la santé du point de
vue du patient (13). Dans l’étude, le retentissement sur la qualité
de vie a été évalué à l’aide de cette échelle en 36 items, qui décri-
vent 8 concepts de santé : capacité physique, état physique, dou-
leurs physiques, santé générale, vitalité, fonctions sociales, rôle
émotionnel et santé mentale.
Les patients devaient aussi préciser depuis combien de temps ils
présentaient ce trouble de l’odorat, si le trouble était massif ou
sélectif, s’il était gênant dans la vie quotidienne, s’il affectait
les loisirs, les activités sociales, l’activité sexuelle, l’alimenta-
tion, la préparation des repas et/ou l’activité professionnelle.
Le médecin posait ensuite des questions plus précises et notait le
motif de consultation, les antécédents médicaux ou chirurgicaux,
les symptômes rhinologiques, les données de l’examen rhinolo-
gique. Il faisait préciser l’ancienneté des troubles de l’odorat, leur
caractère permanent ou intermittent, s’il s’agissait d’une dysos-
mie, d’une hyperosmie, d’une anosmie, d’une hyposmie, d’une
parosmie, d’une cacosmie ou d’hallucinations olfactives, les trai-
tements antérieurs, l’existence ou non de troubles du goût, de
modifications du poids et, enfin, l’étiologie possible du trouble
de l’odorat et le traitement éventuellement prescrit.
Tests de l’odorat
Cinq odeurs différentes étaient utilisées : banane, à quatre concen-
trations croissantes, vanille, menthe, lavande et citron à concen-
tration unique. Ces odeurs étaient présentées adsorbées sur un
substrat inodore dans de petites capsules.
Les capsules étaient ouvertes et présentées au patient une par
une, en respectant un temps de repos d’une minute entre chaque
présentation.
Le test commençait avec les capsules “banane” présentées dans
l’ordre croissant de concentration et se poursuivait avec les quatre
autres capsules. À chaque présentation, le patient devait indiquer
s’il sentait ou non une odeur et devait nommer l’odeur en choi-
sissant parmi une liste de 10 descripteurs proposés (banane,
citron, menthe, lavande, vanille, rose, noix de coco, cassis,
fenouil, muguet).
Méthodes statistiques
L’analyse des données a été réalisée avec le logiciel SAS version
8.2 (SAS Institute, Cary, Caroline du Nord, États-Unis). La
moyenne, la médiane, l’écart-type et les extrêmes ont été déter-
minés pour les critères quantitatifs. Les critères qualitatifs ont été
résumés par leur effectif et leur fréquence. Les tests statistiques
ont été réalisés au seuil de signification alpha = 0,05.
RÉSULTATS
L’étude a commencé le 9 mai 2001 et les inclusions ont été closes
le 24 juillet 2001 ; 500 médecins ORL métropolitains ont reçu le
matériel d’étude, 496 ont donné leur accord de participation et 444
ont participé. Au total, 436 patients se plaignant de troubles de l’odo-
rat ont été inclus, constituant le groupe considéré dans ce travail.
Description du groupe de patients
Les caractéristiques démographiques des patients sont indiquées
dans le tableau I. L’âge médian était de 47 ans, avec 44 % de patients
âgés de plus de 50 ans. Les antécédents médicaux et chirurgicaux
sont indiqués dans le tableau II. Il y avait 25 % d’antécédents d’ato-
pie et 15 % d’antécédents de chirurgie rhinosinusienne.

13
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no273 - mai 2002
Symptômes et signes rhinologiques
Parmi les 436 patients, le trouble de l’odorat était le motif
principal de la consultation ORL dans 36 % des cas. Il a été spon-
tanément signalé dans 45 % des cas et a été découvert lors de
l’interrogatoire dans 19 % des cas. Le trouble de l’odorat était
permanent pour 68 % des patients et s’était installé progressive-
ment dans 73 % des cas. L’ancienneté des troubles était en
moyenne de 4 ans 4 mois (écart-type 7,5 ans). La moitié des
patients souffraient de ce trouble depuis plusieurs années, et un
tiers depuis quelques mois.
Les patients se déclaraient hyposmiques dans 58 % des cas, anos-
miques dans 42 % des cas, dysosmiques dans 8 % des cas et
moins de 1 % se plaignaient d’hyperosmie. Vingt-sept patients
(6 %) se plaignaient de cacosmie, 13 (3 %) de parosmie. Enfin,
4patients (< 1 %) se plaignaient d’hallucinations olfactives (le
total est supérieur à 100 % car certains patients ne sentent plus
certaines odeurs, alors que, pour d’autres, la perception est affai-
blie ou distordue). Par ailleurs, l’intensité du trouble était éva-
luée pour l’ensemble des patients, avec les résultats suivants :
8% léger, 36 % modéré, 36 % intense et 17 % très intense.
Les symptômes rhinologiques les plus fréquents étaient l’obs-
truction nasale (67 %), la rhinorrhée (59 %), les éternuements
(44 %) et les douleurs faciales (31 %). À l’examen des cavités
nasales, les anomalies les plus fréquentes étaient les polypes
(29 %) et l’œdème de la pituitaire (69 %).
Qualité de vie
La comparaison des résultats du questionnaire SF36 des patients
de l’étude présentant des troubles de l’odorat et de ceux de la
population générale a mis en évidence un impact réel sur la qua-
lité de vie de ces patients, toutes étiologies confondues. La
figure 1, qui présente les résultats au sein de ces deux popula-
tions, montre que les résultats de la population générale sont signi-
Tableau I. Caractéristiques démographiques et antécédents médicaux
des patients.
N = 436
Âge (ans) N 433
Moyenne 48
Écart-type 15,4
Médiane 47
Minimum 17
Maximum 95
Sexe N 435
Masculin 205 (47 %)
Féminin 230 (53 %)
Mode d’habitat N 430
Urbain 295 (69 %)
Rural 135 (31 %)
Catégorie Agriculteurs 3
socioprofessionnelle Artisans 8
(en %) Cadres supérieurs 15
Professions intermédiaires 8
Employés 21
Ouvriers 5
Retraités 17
Chômeurs 2
Femmes au foyer 10
Étudiants 5
Autres 3
Tabac N 429
Fumeurs 101 (24 %)
Nbre moyen cigarettes/j 13,4 ± 9,2
Ancienneté du tabagisme (ans) 16,1 ± 9,6
Tableau II. Antécédents médicaux et chirurgicaux des patients.
Dont
N = 436 contemporains
au trouble
Antécédents Terrain atopique 106 (25 %)
médicaux Traumatisme
crânien 34 (8 %) 6 (1 %)
Endocrinopathie 23 (5 %)
Antécédents
psychiatriques 10 (2 %)
Trouble cognitif 4
Insuffisance
hépatique 3
Insuffisance rénale 0
Antécédents Anesthésie générale 234 (54 %) 5
chirurgicaux Anesthésie locale 211 (51 %) 2
Chirurgie
rhinosinusienne 66 (15 %) 4
Chirurgie de l’étage
moyen de la face 5 1
Neurochirurgie 3 2
Figure 1. Résultats du questionnaire SF36. CP = capacité phy-
sique, EP = état physique, D = douleurs physiques, S = santé géné-
rale, V = vitalité, FS = fonction sociale, RE = rôle émotionnel,
SM = santé mentale.

14
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no273 - mai 2002
ficativement supérieurs à ceux de la population présentant des
troubles de l’odorat, et ce dans chacune des 8 dimensions.
Par ailleurs, la gêne occasionnée par les troubles de l’odorat dans
la vie quotidienne était cotée en moyenne à 53,1 ± 26,8 mm sur
une échelle visuelle analogique de 100 mm. Le tableau III
indique les résultats de l’enquête sur le retentissement du trouble
de l’odorat dans diverses circonstances de la vie quotidienne.
Tests de l’odorat
Les résultats des tests de perception et de reconnaissance des
odeurs sont indiqués dans les figures 2, 3, 4 et 5. Dans tous les
cas, les patients ont eu plus de difficulté à reconnaître l’odeur
qu’à la détecter : 83 % des patients ont détecté une odeur sur au
moins l’une des capsules à arôme banane, alors que seulement
ACTUALITÉ
Tableau III. Pourcentage de patients souffrant d’un trouble de
l’odorat limités dans leurs activités.
Peu ou pas du tout Très limités
limités (%) (%)
Loisirs 62 15
Activités sociales 64 12
Activité sexuelle 73 5
Alimentation 28 47
Préparation des repas 27 47
Activité professionnelle 54 9
Figure 2. Résultats exprimés en pourcentages du test de détection
des capsules banane à 0,1 % (n° 1), odeur la plus diluée, 1 % (n° 2),
10 % (n° 3) et 20 % (n° 4).
Figure 3. Résultats exprimés en pourcentages du test d’identifica-
tion des capsules banane à 0,1 % (n° 1), 1 % (n° 2), 10 % (n° 3) et
20 % (n° 4). Seuls les patients qui avaient perçu une odeur étaient
invités à l’identifier.
Figure 4. Résultats exprimés en pourcentages de la détection et de
la reconnaissance de l’odeur des capsules de vanille, menthe, lavande
et citron.
Figure 5. Résultats exprimés en pourcentages de la reconnaissance
de l’odeur des capsules de vanille, menthe, lavande et citron. Seuls
les patients qui avaient perçu une odeur étaient invités à l’identifier.

Tableau V. Traitements les plus prescrits à la fin de la consultation, en fonction de l’étiologie des troubles de l’odorat.
15
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no273 - mai 2002
53 % des patients ont correctement identifié la banane sur au
moins une des 4 capsules ; 88 % des patients détectent au moins
une odeur parmi les 4 capsules à la vanille, la menthe, la lavande
et le citron, et seulement 68 % des patients identifient correcte-
ment au moins l’une de ces odeurs.
Étiologies des troubles de l’odorat
Pour 87 % des patients, l’investigateur a relié le trouble de
l’odorat à une étiologie (tableau IV). Ce diagnostic étiologique
était basé essentiellement sur l’interrogatoire (80 %) et sur
l’examen clinique (76 %). Le praticien a eu recours à un scan-
ner des sinus dans 35 % des cas, à une radiographie standard
des sinus dans 20 % des cas, à des tests allergologiques cuta-
nés dans 20 % des cas et à des tests allergologiques sériques
dans 19 % des cas.
Les étiologies les plus fréquentes étaient la polypose nasosinu-
sienne : 95 cas (22 % des patients), la rhinite : 71 cas (16 %),
l’allergie nasosinusienne : 70 cas (16 %) et la sinusite aiguë :
36 cas (8 %). Une virose (grippe, rhinite ou autre) a été invoquée
dans 22 cas (6 %), un traumatisme crânien récent dans 6 cas. Il
n’y a eu que quatre cas de cause possiblement toxique et trois cas
rapportés à l’âge. Certaines affections, classées sous “divers”
dans le tableau IV , ne sont représentées chacune qu’un petit
nombre de fois : grossesse, diabète... Ces affections sont très nom-
breuses (70 patients), ce qui indique la grande variété des étio-
logies possibles des troubles de l’odorat.
Les patients avec des pathologies aiguës (rhinite, sinusite, virose)
et chroniques (polypose, obstruction nasale chronique, sinusite
chronique...) détectaient et identifiaient moins bien les odeurs
que les patients avec des étiologies de type allergie.
Traitements
Sur les 436 patients, 140 avaient déjà reçu un traitement. Il s’agis-
sait essentiellement d’une corticothérapie locale (117 patients,
27 %) ou générale (52 patients, 12 %), ou d’un antihistaminique
(45 cas, 10 %). Parmi les autres médications prescrites, citons les
antibiotiques (24 cas), les oligo-éléments (5 cas), les vitamines
(4 cas), un vasoconstricteur (14 cas).
À l’issue de la consultation, un traitement a été proposé à
368 patients (85 %), essentiellement des corticoïdes locaux
(326 fois, 75 % des patients) et/ou généraux (108 fois, 25 % des
patients), des antihistaminiques (124 fois, 28 %), des antibio-
tiques (62 fois, 14 %) ou des vasoconstricteurs (33 fois, 8 %).
Les prescriptions d’oligo-éléments (11 fois) et de vitamines
(13 fois) étaient plus rares (tableau V).
COMMENTAIRES
Le trouble de l’odorat est difficilement objectivable, et encore
plus difficile à quantifier. Dans l’étude présentée ici, des patients
se présentant comme anosmiques, c’est-à-dire disant à l’inter-
rogatoire qu’ils ne percevaient plus aucune odeur, détectaient
en fait l’odeur de certaines des capsules présentées. Pour confir-
mer un trouble de l’odorat, alors que l’interrogatoire est parti-
culièrement difficile et pauvre dans ce domaine, il est donc
indispensable de posséder un moyen de le quantifier, au moins
globalement.
Le kit utilisé dans ce travail permet une évaluation du seuil de
détection avec les capsules contenant l’odeur de banane à diffé-
rentes concentrations et une évaluation de la capacité d’identifi-
cation du sujet, en lui proposant quelques odeurs bien connues :
vanille, menthe, lavande et citron. Dans tous les cas, l’identifi-
cation d’une odeur est plus difficile, en particulier s’il y a un
Tableau IV. Étiologie des troubles de l’olfaction chez 376 patients (le
total est supérieur au nombre de patients car plusieurs étiologies peu-
vent être évoquées chez un même patient).
Rhinite allergique 71
Affection rhinosinusienne aiguë
Rhinite 51
Rhinosinusite aiguë 36
Affection rhinosinusienne chronique
Polypose 95
Autre cause d’obstruction nasale 15
Sinusite chronique 10
Tumeurs des fosses nasales et sinus 1
Postopératoire 5
Virose 22
Traumatisme crânien 6
Exposition à des toxiques 4
Grossesse 1
Âge 3
Divers 70
Affection rhinosinusienne aiguë Affection rhinosinusienne chronique Rhinite allergique Autres
N = 51 N = 178 N = 71 N = 37
Corticoïdes locaux 65 % 82 % 87 % 43 %
Corticoïdes généraux 24 % 37 % 10 % 5 %
Antibiotiques 6 % 25 % 6 % 0
Antihistaminiques 10 % 25 % 72 % 11 %
 6
6
1
/
6
100%