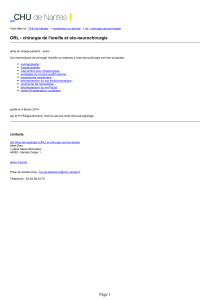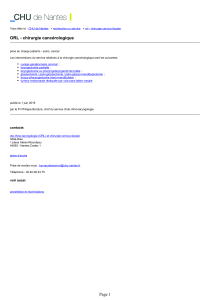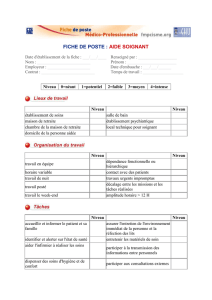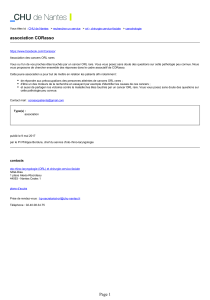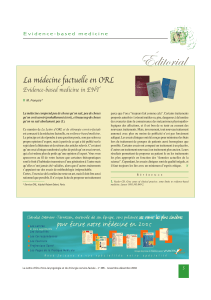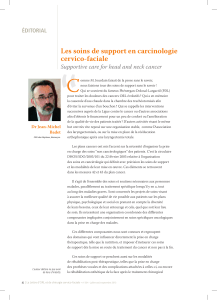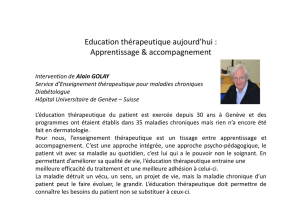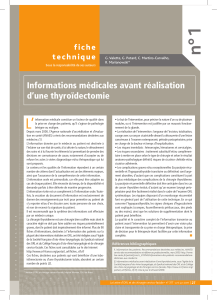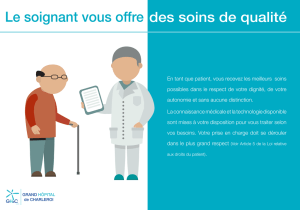Information de la personne malade en ORL et en chirurgie

DROIT MÉDICAL
28 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012
Information de la personne
malade en ORL et en chirurgie
cervico-faciale en France :
pourquoi, quand et comment ?
Information in otorhinolaryngology Head and Neck
Surgery in France: when, why and how?
O. Laccourreye1,2, A. Werner1, R. Cauchois1,3, L.M. Raingeard de la Blétière4, F. Lagemi5
1 Université Paris-Descartes, Sorbonne
Paris-Cité, service d’ORL, HEGP, Paris.
2 Expert judiciaire près le tribunal
de grande instance de Paris.
3 Expert près les assurances.
4 Magistrat, tribunal de grande
instance de Paris.
5 Magistrat, cour d’appel de Versailles.
E
n France, comme dans de nombreux pays
occidentaux, le passage au
e
siècle a été
marqué, dans le domaine de l’information
médicale de la personne malade, par la dispa-
rition du concept aristotélicien qui régissait classi-
quement les rapports entre soignés et soignants.
Ce très ancien concept faisait schématiquement du
soignant un “sachant” empreint de bonté, de sagesse
et d’humanisme, et du soigné un être qu’il convenait
de protéger en le maintenant dans un certain degré
d’ignorance car il était considéré comme incapable
de comprendre les subtilités de la médecine et trop
faible psychologiquement pour pouvoir participer à
la décision médicale.
Les scandales médicaux survenus au décours de
la Seconde Guerre mondiale et dans la deuxième
partie du e siècle, le développement des versants
commerciaux et médiatiques de la médecine, l’accès
aisé et rapide à l’information médicale (Internet),
l’individualisme grandissant au sein des sociétés
occidentales et l’apparition d’un droit au savoir
combiné à la judiciarisation de la relation médicale
sont les principaux éléments qui ont fait voler en
éclat cette conception ancienne, qui a progressi-
vement laissé place au partenariat.
Dans cet article, les auteurs présentent et discutent
les principaux éléments qui permettent au praticien
de savoir pourquoi, quand et comment informer la
personne malade atteinte d’une affection oto-rhino-
laryngologique ou cervico-faciale.
Pourquoi informer la personne
malade ?
L’information de la personne malade est une
obligation qui s’impose à tout oto-rhino-laryn-
gologiste. Cette obligation relève des obligations
de conscience ou d’éthique médicale auxquelles
le médecin est tenu. Avant la réalisation de tout
traitement, le médecin doit, en effet, recueillir le
consentement du patient, auquel il est reconnu le
droit de savoir et de consentir librement aux soins
qui lui sont proposés et, a contrario, de les refuser.
Cette obligation de recueillir le consentement du
patient est imposée “par le respect de la personne
humaine”, et sa violation constitue “une atteinte
grave aux droits du malade”, ainsi qu’en avait décidé
la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre
des requêtes du 28 janvier 1942, dit arrêt Teyssier.
L’information est aussi, et en premier lieu pour
l’oto-rhino-laryngologiste comme pour tout
médecin, un devoir déontologique prévu à l’article 35
du code de déontologie médicale, qui précise que
“(…) le médecin doit à la personne qu’il examine,
qu’il soigne, ou qu’il conseille, une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et
les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie,
il tient compte de la personnalité du patient dans ses
explications et veille sur leur compréhension (…)”.
La jurisprudence avait fait de l’information une
obligation contractuelle découlant du contrat

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012 | 29
Résumé
conclu entre le médecin et le malade. L’article
L1111-2 du code de la santé publique, issu de la loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé, en fait une obligation
légale intégrant la notion de droits, l’alinéa 1
er
du
texte sus-cité posant le principe que “toute personne
a le droit d’être informée sur son état de santé” (1).
Il est intéressant de constater que l’analyse de la
littérature médicale scientifique fait apparaître une
concordance entre l’esprit actuel de la loi et le désir
de la très grande majorité des personnes malades qui
consultent un praticien. Deux études anglo-saxonnes
ont ainsi souligné que l’information sur les risques
thérapeutiques est le premier des points que les
malades souhaitent voir abordé par le chirurgien lors
d’une consultation pré opératoire (2, 3). En pathologie
rhino-sinusienne, une étude nord-américaine récente
souligne que le souhait de la personne malade d’être
informée des risques inhérents à l’acte chirurgical
envisagé augmente si celle-ci est d’origine cauca-
sienne, jeune, ou a un niveau élevé d’éducation (4).
La sévérité de la complication encourue et l’inci-
dence de celle-ci sont des éléments qui interviennent
dans la demande d’information (5). Ainsi, avant
une chirurgie endoscopique des sinus de la face, le
pourcentage de personnes malades qui souhaitent
être informées du risque de survenue d’une compli-
cation passe de 43 % si l’incidence de la compli-
cation encourue est inférieure ou égale à 1/1 000,
à 69 % si l’incidence est comprise entre 1/1 000 et
1/100, pour atteindre 90 % lorsque l’incidence est de
10/100 (5). Cette attente augmente avec la sévérité
de la complication potentielle encourue, et ce sans
que son incidence intervienne : 83 % des malades
souhaitent être informés des risques de fuite de
liquide céphalorachidien et d’atteinte orbitaire (5).
L’évolution des motifs qui conduisent à la mise
en cause médico-légale des soignants est enfin
le dernier élément qui participe à la nécessité
d’informer la personne malade. Ainsi en 2009, aux
États-Unis, le défaut d’information sur les risques
encourus en cas d’acte médical invasif, qu’il soit à
visée diagnostique (ponction, biopsie, cathétérisme,
injection de produit de contraste, etc.) ou à visée
thérapeutique (prise médicamenteuse, manipulation,
acte chirurgical, etc.), est devenu, avec les séquelles
et le retard diagnostique, une des trois principales
raisons de la mise en cause d’un soignant (6). En
Allemagne, en 1999, une étude analysant plus de
21 000 complications a souligné l’augmentation
exponentielle des mises en cause en rapport avec
la chirurgie de la glande thyroïde au décours de la
période 1975-1998, avec un défaut d’information
identifié dans 11 % des cas (7). En France, en 2005,
l’analyse des litiges portés devant la Cour de
cassation entre 1990 et 2004 fait apparaître que la
délivrance d’une information de qualité à la personne
malade sur les risques encourus permet d’éviter 90 %
des contentieux portés devant cette cour (8).
Tous ces éléments donnent à penser que le souhait
de la personne malade d’être informée est actuel-
lement intense ; ils traduisent l’évolution de nos
sociétés modernes, qui ont fait du “droit au savoir”
un élément primordial de la relation soigné-soignant.
Quand informer la personne
malade ?
L’information de la personne malade est un devoir
constant qui s’intègre à tous les temps de la relation
soigné-soignant. Et la loi du 4 mars 2002 (article
L1111-2 du code de la santé publique) impose que
le médecin informe la personne malade sur “(...) les
différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents
ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus (…)” (1).
Les risques “normalement prévisibles” sont, comme
l’a écrit le conseiller à la Cour de cassation Sargos :
“(...) les risques de nature à avoir des conséquences
mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves
compte tenu de leurs répercussions psychologiques
ou sociales (...)” (9). La jurisprudence a considéré
que le praticien devait porter à la connaissance du
patient tous les risques d’un acte médical, y compris
les risques exceptionnels, étant toutefois précisé
qu’il ne peut s’agir que des risques connus en l’état
des données acquises de la science à la date de cet
acte. Et la formulation de l’article L1111-2 du code
À partir d’une revue de la littérature médicale publiée ces 30dernières années et indexée (moteur de
recherche : PubMed) ainsi que des principaux textes juridiques, les auteurs analysent l’évolution de la
pratique de l’information médicale de la personne atteinte d’une affection dans le domaine de l’oto-rhino-
laryngologie et de la chirurgie cervico-faciale en France.
Mots-clés
Information médicale
Consentement éclairé
Summary
Based on a review of the legal
and scientific medical littera-
ture (PubMed analysis), the
authors analyse and discuss the
evolution of the medical infor-
mation delivered in France to
patients with an otorhinolaryn-
geal or head and neck disease.
Keywords
Medical information
Informed consent

DROIT MÉDICAL
30 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012
de la santé publique n’a pas modifié la jurisprudence
antérieure puisque les travaux parlementaires ne
révèlent pas la volonté du législateur de revenir
sur celle-ci, que la notion de risque normalement
prévisible renvoie à celle de risque connu, et qu’un
risque exceptionnel reste normalement prévisible
pour un professionnel de santé.
Cette obligation d’information est aussi à “exécution
successive”, ce qu’illustre la nécessité d’informer la
personne malade non seulement sur ce dont elle
souffre (les résultats d’examens complémentaires
en font partie), mais aussi sur l’évolution possible
de sa pathologie (en particulier au cours de la phase
postopératoire). Pour le législateur et le magistrat,
moins la nécessité de l’acte médical – qu’il soit à
visée diagnostique ou thérapeutique – s’impose, plus
l’obligation et l’étendue de l’information se trouvent
renforcées. Ce concept s’applique tout particuliè-
rement au domaine de l’ORL qui, sans générer des
actes médicaux diagnostiques ou thérapeutiques dits
de “confort”, est une spécialité médicale où les situa-
tions cliniques d’urgence sont exceptionnelles, alors
que très nombreuses sont les situations cliniques
où plusieurs options peuvent être proposées à la
personne malade. Et si les soins délivrés font partie
d’une action de recherche, qu’elle soit clinique ou
fondamentale, l’obligation d’informer se trouve
encore plus renforcée (10). Le législateur considère
ainsi que le médecin permet à la personne malade
de comprendre et d’intégrer les soins proposés, afin
de l’aider à prendre la décision la plus conforme à
ses intérêts. Et à ses yeux, la mise en place d’un tel
partenariat contribue à la recherche d’une médecine
de qualité optimale.
En France, l’information de la personne malade a
pris un relief particulier aux yeux de l’oto-rhino-
laryngologiste depuis que 2 décisions majeures ont
été prises par la Cour de cassation.
La première a trait à la preuve de l’exécution
de l’obligation d’information. Depuis l’arrêt du
25 février 1997 dit Hedreul, le patient est dispensé
de rapporter la preuve de l’inexécution de cette
obligation. Il lui suffit d’affirmer qu’il n’a pas été
informé pour que le médecin soit tenu d’apporter
la preuve contraire, et ce par tous moyens. Cet arrêt
a donc renversé la charge de la preuve en matière
d’information médicale.
La seconde décision est relative au préjudice lié au
non-respect de l’obligation d’information. En effet,
il était traditionnellement admis que la responsa-
bilité du praticien ne pouvait être engagée sur ce
fondement que si le patient démontrait l’existence
d’un préjudice que lui avait causé l’absence d’infor-
mation ; ce préjudice s’analysait comme une perte de
chance d’avoir pu refuser le traitement proposé et,
donc, d’éviter le risque réalisé, et faisait l’objet d’une
indemnisation proportionnelle à la chance perdue, à
condition toutefois que celle-ci soit réelle et sérieuse,
la preuve de cette chance perdue incombant au
patient. Or, dans un arrêt du 3 juin 2010, la Cour
de cassation a rappelé au visa des articles 16, 16-3 et
1382 du code civil, que “(...) toute personne a le droit
d’être informée préalablement aux investigations,
traitements ou actions de prévention proposés, des
risques inhérents à ceux-ci et que son consentement
doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son
état rend nécessaire une intervention thérapeu-
tique à laquelle elle n’est pas à même de consentir”
et précisé en outre que “le non-respect du devoir
d’information qui en découle cause à celui auquel
l’information était légalement due un préjudice que
le juge ne peut laisser sans réparation (...)”. Cet arrêt
permet de considérer que, d’une part, l’obligation
d’information a acquis une véritable autonomie
puisqu’elle est sortie du champ contractuel et que,
d’autre part, sa non-exécution génère automati-
quement un préjudice susceptible d’être qualifié de
“préjudice moral”, que le juge sera en tout état de
cause tenu d’indemniser, ce même si la réalisation de
l’acte technique de soin n’a entraîné aucun dommage
et/ou s’il apparaît que, dûment informé, le patient
n’aurait pas opté pour une autre solution thérapeu-
tique que celle réalisée (par exemple, en ORL : un
appareillage au lieu d’une stapédectomie dans le
cas d’une otospongiose, un traitement local au lieu
d’une ethmoïdectomie devant une polypose nasale
ou une cordectomie laser au lieu d’une radiothérapie
en présence d’un cancer de la corde vocale classé T1).
Ces 2 arrêts imposent de bien connaître les éléments
qui permettront au magistrat, lors de la mise en
cause d’un praticien, de décider si l’information
délivrée avant les soins a bien été réalisée par le
soignant de manière loyale, claire et adaptée. Dans
ce domaine, le point clé est de savoir qu’il n’existe
pas d’élément formel de preuve et que la décision du
magistrat repose toujours sur un faisceau d’indices
devant constituer des présomptions suffisamment
précises, graves et concordantes dont la recherche
s’impose à l’expert mandaté.
Le premier de ces éléments de preuve, et sans
conteste le plus important aux yeux de la loi, est
la parole de la personne malade qui peut, lors
de la réunion expertale, reconnaître qu’elle a été
correctement informée par le soignant. Ce dernier
doit cependant comprendre que cette situation

DROIT MÉDICAL
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012 | 31
est rarement rencontrée, et ce principalement en
raison d’un défaut de mémorisation par la personne
malade de l’information qui lui a été délivrée. Ainsi,
dans notre spécialité, le taux moyen de mémori-
sation des risques chirurgicaux encourus, avant
un acte chirurgical programmé, varie de 37 % en
chirurgie plastique esthétique à 39,1 % en chirurgie
des glandes thyroïde et parotides, pour atteindre
à peine 54 % en chirurgie otologique (11-13).
En 2005, dans le cadre de la chirurgie de la glande
thyroïde, en France, il a été indiqué que 24 heures
après l’intervention, respectivement 14,5 %, 58,9 %
et 78,9 % des patients ne se souvenaient pas d’avoir
été informés en pré opératoire par le chirurgien du
risque de dysphonie par immobilité laryngée unila-
térale, du risque de décès et du risque d’immobilité
laryngée bilatérale pouvant conduire à la réali-
sation d’une trachéotomie, alors que seulement
0,9 % des malades mémorisaient la totalité des
risques chirurgicaux détaillés lors de la consultation
préopératoire, et 20,4 %, aucun (14). Par ailleurs,
les études scientifiques consacrées à l’analyse des
facteurs qui influent sur la mémorisation par la
personne malade des risques chirurgicaux encourus
au décours de la chirurgie des glandes thyroïde et
parotides soulignent que l’information délivrée est
d’autant moins mémorisée que le malade est âgé,
que son niveau d’éducation est faible, que des fiches
d’information ou des schémas explicatifs n’ont pas
été distribués lors de la réalisation de l’information
orale et/ou que le moment de la recherche de la
réalité de l’information délivrée est éloignée du
moment de la réalisation de cette information, sans
que le nombre de consultations réalisées en préopé-
ratoire semble améliorer le degré de mémorisation.
Le praticien doit aussi savoir que les complications
les plus graves ne sont pas celles qui sont le plus
mémorisées par la personne malade (14-16).
Aussi, le praticien, s’il souhaite disposer d’éléments
de preuve en cas de mise en cause, se doit d’anti-
ciper le défaut de mémorisation de la personne
malade et d’éviter plusieurs erreurs. La première
est de laisser la charge de l’information à un autre
collègue (interne) ou soignant (infirmière), voire
à la structure de soin (administration) [17]. Il
convient de rappeler que l’obligation d’information
incombe personnellement au médecin et, en cas
d’intervention de plusieurs praticiens, à chacun
des médecins intervenant au cours d’un même
acte ou devant prendre en charge le patient à un
titre quelconque. La seconde est de ne réaliser
une information que sur les risques encourus, en
omettant d’informer sur la maladie, sur les diffé-
rentes options thérapeutiques, et sans conseiller la
personne malade sur la conduite la plus adaptée à
son état. La troisième est de ne pas s’assurer de la
compréhension par la personne malade de l’infor-
mation délivrée. La quatrième est la non-dispo-
nibilité et le défaut d’explications de la part du
soignant après la survenue d’une complication.
L’analyse de dossiers et de plaintes démontre
que l’absence d’information des patients après
une complication, quelle qu’en soit la cause, est
à l’origine de nombreux contentieux, le patient
recherchant à travers une procédure judiciaire civile
ou pénale les explications qu’il n’a pu obtenir ; cette
information postopératoire qui n’a pas été assumée
par le praticien aurait souvent permis d’éviter une
action en recherche de responsabilité. Enfin, la
dernière erreur à éviter a trait au dossier médical.
Sa bonne tenue et la mention de la réalisation de
l’information sur la maladie, les options thérapeu-
tiques et les risques en divers endroits de celui-ci
(observation clinique, lettre au médecin traitant,
compte-rendu opératoire) sont des éléments clés
car ils permettent de rappeler à la personne malade,
s’il survient une complication ou un conflit, ce qui
a été dit et décidé, tout en fournissant à l’expert,
si le soignant est mis en cause, des éléments qui
permettent d’évaluer de façon objective la réalité
de l’information réalisée. Dans ce cadre, il nous
semble que la remise à la personne malade de la
copie de la lettre adressée au médecin référent
(offrant ainsi à la personne malade la possibilité
de re-contacter le soignant pour un complément
d’explication avant la réalisation de l’acte à visée
diagnostique ou thérapeutique), au mieux dictée
en sa présence, est un élément de preuve parti-
culièrement élevé. Rappelons aussi que la loi, là
encore, a évolué et impose maintenant :
➤
que le dossier médical comprenne l’observation
clinique, les comptes rendus des examens complé-
mentaires (radiologiques, anatomo-pathologiques,
etc.) réalisés, le compte-rendu de la réunion de
concertation pluridisciplinaire (en cas de pathologie
tumorale maligne), le compte-rendu opératoire,
le compte-rendu d’hospitalisation et les lettres au
médecin traitant ;
➤
qu’en cas de complication, une note écrite
retraçant l’évolution, obligatoire au plan légal, soit
inscrite dans l’observation médicale (18).
Enfin, bien qu’il ait été montré que le fait d’avoir été
mis en cause est le principal élément qui conduit les
soignants à modifier leur attitude en termes d’infor-
mation médicale (19), il nous semble qu’il convient

DROIT MÉDICAL
32 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012
de ne pas attendre une telle expérience pour faire
évoluer sa pratique dans le sens souhaité par les
personnes malades, et maintenant très clairement
prévu par la loi.
Comment “bien” informer
la personne malade ?
Aucun texte de loi ni aucune étude médicale scien-
tifique ne précise avec certitude les modalités à
suivre pour réaliser une “bonne information” de la
personne malade, et la réponse à cette question
est extrêmement difficile car la définition claire et
précise d’une “bonne information” est sujette à de
nombreuses interprétations, qui varient en fonction
du point de vue de l’interlocuteur (personne malade,
médecin, magistrat, avocat, expert, responsable
politique, journaliste, enseignant, philosophe,
consommateur, etc.), du niveau de connaissances
et du degré d’inquiétude de la personne malade
que l’on doit informer, ainsi que de la gravité de
l’affection dont elle est atteinte.
Le problème est d’autant plus complexe que
l’analyse des études scientifiques consacrées à la
perception par la personne malade de l’information
délivrée en suivant les termes de la loi souligne
que celle-ci n’est pas toujours positive. Toutes
les études publiées soulignent en effet l’intensité
du stress, de l’angoisse, voire de la peur, que
déclenche l’information sur les risques, qu’ils soient
inhérents à un geste à visée diagnostique ou à visée
thérapeutique. En France, 2 travaux consacrés à
la perception de l’information médicale sur les
risques chirurgicaux encourus lors de la chirurgie
de la glande thyroïde ont noté que, même si plus
de 80 % des personnes malades étaient satisfaites
de l’information délivrée en préopératoire sur les
risques chirurgicaux, 30 à 50 % d’entre elles étaient
atteintes par ce phénomène (14-16). L’angoisse
peut être telle que certaines personnes malades
refusent le geste thérapeutique proposé, avec un
taux qui varie de 10 % dans le cadre de la chirurgie
des sinus de la face à 14,6 % dans le cadre de la
chirurgie de la glande thyroïde (16, 20). Cette
information sur les risques chirurgicaux encourus
est aussi parfois perçue par la personne malade
comme une décharge de la part du médecin ou
de la structure de soins de leurs responsabi-
lités, voire comme un acte défensif de la part du
médecin (16, 21, 22). L’effet collatéral possible des
difficultés que les médecins rencontrent actuel-
lement lorsqu’ils doivent informer leurs malades
est le développement d’une médecine “défensive”.
Une étude nord-américaine publiée en 2006, dans
The Journal of the American Medical Association,
souligne que 93 % des médecins qui exercent une
spécialité dite “à risque légal” (oto-rhino-laryn-
gologie, ophtalmologie, chirurgie esthétique,
gynécologie, neurochirurgie, etc.) reconnaissent
pratiquer parfois la médecine de façon défensive,
en éliminant de leur activité les interventions
susceptibles d’entraîner des complications, et en
évitant de prendre en charge les malades sujets à
des problèmes médicaux complexes ou bien perçus
comme procéduriers (23).
En 2001, la philosophe Jacqueline de Romilly
écrivait : “(…) Il existe un art de la parole qui n’est
ni mensonge, ni flatterie mais qui sert la vérité. Il y
a une façon d’exposer la vérité, de l’expliquer, de la
commenter, qui est le prolongement même de la
connaissance la plus rigoureuse. Et cela est plus vrai
que pour tout pour la médecine qui est finalement
une science de l’homme qui doit connaître la nature
de l’homme (…)” (24). Les principes dégagés par
la jurisprudence et la loi du 4 mars 2002 sont en
adéquation avec cette vision philosophique puisque
l’information délivrée à la personne malade par
son praticien doit être “adaptée”, ce qui signifie
qu’elle ne peut être délivrée sans discernement,
ni humanisme (1). Et la primauté de l’information
orale a été et est constamment et régulièrement
rappelée dans de nombreux écrits et décisions de
justice. Dans ce cadre, pour la Haute Autorité de
santé : “(…) Lorsque des documents écrits existent,
il est souhaitable qu’ils soient remis au patient pour
lui permettre de s’y reporter et/ou d’en discuter
avec toute personne de son choix, notamment les
médecins qui lui dispensent des soins (…)” (25).
Ces fiches ne sont cependant que des complé-
ments de l’information orale que doit réaliser
le soignant car plusieurs éléments en limitent
l’apport réel, lesquels sont liés aux défauts quali-
tatifs de certaines fiches d’information écrite, au
défaut de compréhension des données médicales
écrites par un pourcentage non négligeable de
malades (26, 27), au pourcentage élevé de ceux-ci
qui considèrent que l’information écrite n’est pas
adaptée à leur état (28) ou qui n’ont pas acquis une
maîtrise grammaticale suffisante pour comprendre
l’information écrite délivrée (29) et, enfin, au
grand nombre de patients qui considèrent que la
principale fonction de la fiche d’information écrite
est de protéger l’hôpital ou les droits des praticiens
en cas de conflit ultérieur (21, 30). Enfin, s’agissant
des mineurs, leurs droits sont, par principe, exercés
 6
6
1
/
6
100%